« Portrait de Carlos Wieder par Roberto Bolaño | Page d'accueil | Alexandre Mathis dans la Zone »
01/09/2017
Prolégomènes à une définition esthétique du fantastique par Francis Moury
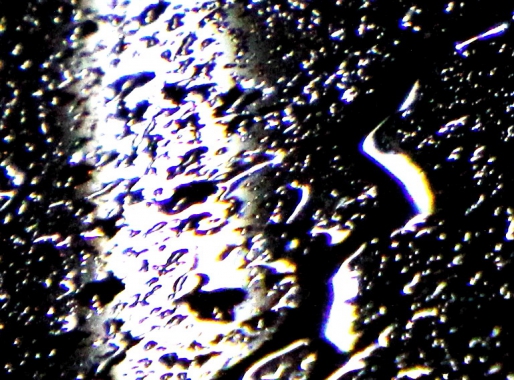
Photographie (détail) de Juan Asensio.
«D'où vient que je frissonne ? Quelle horreur me saisit ?»
Jean Racine, Andromaque (1667), acte V, scène 5.
«Littérature de décadence ! – Paroles vides que nous entendons souvent tomber, avec la sonorité d’un bâillement emphatique, de la bouche de ces sphinx sans énigme qui veillent devant les portes saintes de l’Esthétique classique […].»
Charles Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe (1857).
«Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change
Le Poëte suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu
Que la Mort triomphait dans cette voix étrange [...]»
Stéphane Mallarmé, Le Tombeau d'Edgar Poe (Baltimore, 1877, puis Bruxelles, 1888).
 La question de savoir ce qui distingue esthétiquement le fantastique comme genre à part entière se pose dans l'histoire des lettres au moment où la conscience littéraire distingue l'art pur de l'art d'assouvissement, tout en reconnaissant leur relation, à savoir qu'ils sont également issus du monde des formes, qu'ils relèvent bien tous deux de l'art en général avant de savoir de quel art en particulier. Reconnaissance exprimée dès 1933, dans le cas de la critique française mais concernant le roman policier, par la célèbre formule de Malraux : «Sanctuaire [de William Faulkner], c'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier». Envisageant le fantastique, certains grands écrivains du genre avaient eu assez nettement conscience de cette relation dès le milieu du XIXe siècle : créer du fantastique, c'est déjà le penser en toute conscience esthétique. Il faut donc se tourner d’abord vers eux pour avoir une certaine idée de la question : ils étaient assez bien placés pour, au moins, tenter d'y répondre.
La question de savoir ce qui distingue esthétiquement le fantastique comme genre à part entière se pose dans l'histoire des lettres au moment où la conscience littéraire distingue l'art pur de l'art d'assouvissement, tout en reconnaissant leur relation, à savoir qu'ils sont également issus du monde des formes, qu'ils relèvent bien tous deux de l'art en général avant de savoir de quel art en particulier. Reconnaissance exprimée dès 1933, dans le cas de la critique française mais concernant le roman policier, par la célèbre formule de Malraux : «Sanctuaire [de William Faulkner], c'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier». Envisageant le fantastique, certains grands écrivains du genre avaient eu assez nettement conscience de cette relation dès le milieu du XIXe siècle : créer du fantastique, c'est déjà le penser en toute conscience esthétique. Il faut donc se tourner d’abord vers eux pour avoir une certaine idée de la question : ils étaient assez bien placés pour, au moins, tenter d'y répondre.De fait, Edgar Poe (1809-1849), son premier grand théoricien esthétique, affirme dans sa Genèse d’un poème (Le Corbeau) : «Pour moi, la première des considérations, c’est celle d’un effet à produire». Logiquement, si l’horreur a été sélectionnée par l’auteur pour être le sujet d’un conte, il faudra rassembler deux éléments pour le réussir : son sujet qui doit être original et la manière de le traiter qui doit faire surgir du sujet son effet le plus intense. Cette alliance de l’irrationnel (le sujet est fourni par l’inspiration) et du rationnel (le style est une activité intellectuelle concertée et volontaire) est, selon Poe, la clé de voûte de l’activité poétique comme de l’activité du prosateur. Il excelle dans les deux genres. L'esthétique de Poe, on le voit, annonce autant celle de Mallarmé (qui lui rend poétiquement hommage dans Le Tombeau d'Edgar Poe) que celle de Paul Valéry. Àrebours, on pourrait dire aussi que Poe avait bien lu Eschyle, surtout si on se réfère à l'étude grecque classique de Jacqueline de Romilly, La Crainte et l'angoisse dans le théâtre d'Eschyle (éditions Les Belles lettres, 1958).
Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) dont Poe fut le modèle et qui a si bien étudié le genre fantastique avant d’y contribuer d’une manière si originale, écrit dans sa propre étude intitulée Épouvante et surnaturel en littérature [Supernatural Horror in Litterature] parue aux États-Unis en 1945 (traduite en français par Bernard Da Costa en 1969, éd. U.G.E. – Christian Bourgois & Dominique de Roux, collection 10/18) : «La plus vieille, la plus forte émotion ressentie par l’être humain, c’est la peur. Et la forme la plus puissante découlant de cette peur, c’est la peur de l’Inconnu. Peu de psychologues contestent cette vérité, justifiant ainsi l’existence du récit d’horreur et plaçant ce mode d’expression parmi tous les autres genres littéraires et sur le même rang».
Roger Caillois, dans la présentation de la première édition de son Anthologie du fantastique - Soixante récits de terreur (édition Club français du Livre, 1958 puis réédition remaniée Gallimard, N.R.F., tome 1 et 2, 1965) confirme la thèse de Lovecraft et de Poe : «Ce recueil réunit et confronte pour la première fois les récits fantastiques issus des différents pays du monde. Il présente une anthologie de la peur imaginaire, un catalogue des motifs d’épouvante, non point réels, mais inventés par l’homme, de toutes pièces, sans obligation, par plaisir. Pour admettre un récit dans le florilège maudit, j’ai exigé qu’il remplît une condition nécessaire et suffisante. Je ne juge pas inutile de la formuler ici, non sans pléonasme, sous ses deux aspects complémentaires : la terreur doit être engendrée seulement par une intervention surnaturelle; l’intervention du surnaturel doit obligatoirement aboutir à un effet de terreur».
Et Caillois de préciser qu’il a systématiquement écarté les récits où n’entre aucun élément fantastique tels que les récits symboliques ou fantaisistes qui charment sans effrayer, ou bien encore telles que les légendes issues du folklore, les allégories symboliques de la mystique ou de l’occultisme. Il propose ensuite de distinguer soigneusement des notions proches trop souvent confondues : le féerique qui oppose au monde réel un monde hétérogène qui n’en menace pas la cohérence, mais conserve une densité simplement parallèle à la sienne. Les licornes, les fées, les dragons, les talismans, les génies des contes antiques et médiévaux de l’Occident et de l’Orient n’ont donc rien à voir avec les fantômes et les vampires qui, eux, n’existent pas dans un univers merveilleux mais dans le nôtre, où ils introduisent horreur et épouvante. Le temps de la féerie est celui du «in illo tempore» alors que le temps du fantastique est celui du «hic et nunc». Pour la même raison, Caillois refuse le «surnaturel expliqué» à l’œuvre dans Le Château des Carpathes de Jules Vernes et il refuse aussi les contes à la fin desquels on découvre qu’on rêvait ou qu’on était victime d’une hallucination. Il repousse également ce qu’il nomme le «pseudo-fantastique» : par exemple un élément naturel (animal ou végétal) transformé en monstre par la science humaine ou un caprice soudain de la nature. Il ne considère donc pas comme étant strictement fantastique L’Étrange cas du Docteur Jekyll et de Mister Hyde de Robert Louis Stevenson.
Caillois écarte a priori la science-fiction (voyage dans le temps, dans l’espace, basculement dans une autre dimension) car elle repose sur des extrapolations scientifiques qui n’ont rien à voir avec l’horreur de l’absolument autre, notamment de l’Autre absolu, à savoir la différence ontologique séparant les morts des vivants, ce gouffre angoissant qu’aucune hypothèse de science-fiction ni aucun voyage interstellaire ne peut combler ni prétendre traverser. A posteriori, il me semble que l'histoire de la littérature de science-fiction lui donne tort : Je suis une légende de Richard Matheson est une histoire de science-fiction qui repose précisément sur cette différence. La remarquable anthologie Les Mondes macabres de Richard Matheson, éditée et traduite en 1974 par Alain Dorémieux, augmente encore la charge de la preuve, s'il en était besoin. Enfin Caillois écarte méthodiquement les récits de spiritisme et de parapsychologie, rédigés par des écrivains croyant au spiritisme et à la vérité des phénomènes psychiques en question (avec regret, prend-t-il soin de préciser, dans le cas de ceux de Sir Arthur Conan Doyle) car ils n’ont pas été composés «dans l’intention délibérée d’effrayer». Il énonce alors ce qu’on pourrait nommer son paradoxe sur l’écrivain fantastique, proche du Paradoxe sur le comédien tel que Diderot l’avait exposé dans ses œuvres esthétiques : la littérature fantastique n’a nullement pour objet d’accréditer la réalité des spectres ou des vampires. Elle est et doit demeurer un pur jeu intellectuel avec la peur : il vaut sans doute mieux que l’écrivain qui sert ce genre soit le dernier à y croire, s’il veut le servir le plus efficacement possible.
Cette circonscription esthétique du fantastique par Caillois s’accompagne d’une circonscription sociologique et historique : les récits sélectionnés proviennent principalement de la civilisation occidentale et asiatique. Concernant l’Occident, les plus anciens proviennent du Romantisme, donc à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle (1). Et cela pour deux raisons qui se renforcent l’une l’autre : il fallait que le fantastique naquît dans une société ayant forgé une conception stricte, constante et organisée de l’ordre naturel, celle, par conséquent, d’un strict ordo rerum ; il fallait en outre que sa rupture advienne à un moment où cette conception initiale soit devenue suffisamment puissante pour supporter une telle agression purement esthétique, qu'on puisse donc en jouir tout en en frissonnant. Caillois, en fait, extrapole au maximum de possibilité logique et esthétique le célèbre mot de Madame du Deffand : «Je ne crois pas aux fantômes : j’en ai peur».
Pourtant, cette armature intellectuelle si rigoureuse en apparence n’est pas parfaite : elle provoque l’exclusion de deux auteurs importants et reconnus par bien d’autres critiques du genre : Charles Nodier et H.P. Lovecraft, ce dernier pourtant proche de Caillois du point de vue théorique. Et on n’y trouve pas non plus un extrait de l’Aurélia de Gérard de Nerval puisque, ainsi que le note finement Pierre-Georges Castex dans la préface à sa propre Anthologie du conte fantastique français (éd. Librairie José Corti, 1963-1972) où il écrit : «l’émotion née du fantastique a été directement et pleinement vécue par Nerval lui-même avant d’être transcrite», ce qui en fait un cas limite selon la théorie de Caillois. Pire encore, Caillois se parjurera dans la seconde édition de 1965, intégrant dans son tome 1 au moins un conte, d’ailleurs tout à fait admirable (Escamotage de Richard Matheson) qui aurait dû en être écarté s'il avait respecté ses propres critères établis en 1958 ! Ce texte de Matheson relève, en effet, autant d’une littérature de science-fiction que d’une littérature fantastique.
Sous réserve de ces contradictions et de leurs ponctuelles conséquences néfastes ou incohérentes, il faut cependant convenir que la thèse de Caillois demeure globalement la plus rationnelle et la plus instruite, dans la mesure où elle repose autant sur une connaissance extensive du genre que sur un apriorisme ratiocinant. Son catalogue des situations possibles de la littérature fantastique est d’ailleurs dès 1958 très proche de celui que fournira Louis Vax dans sa petite étude sur L’Art et la littérature fantastique (troisième P.U.F. mise à jour, coll. Que sais-je ? n°907, 1970) qui actualise en la résumant sa grande thèse sur La Séduction de l’étrange, études sur la littérature fantastique (éd. P.U.F., 1965). Les raisons des choix anthologiques de Caillois sont globalement partagées par un Pierre-Georges Castex qui fait lui aussi débuter, pour l’essentiel, le fantastique français à la fin du XVIIIe siècle et au début du Romantisme, et pour les mêmes raisons philosophiques et historiques.
Reste que sa cohérence interne laisse échapper («inévitablement» diraient sans doute les pragmatiques anglo-saxons) une partie contingente mais bien réelle de l’histoire littéraire du genre, qu’il s’agisse de textes antérieurs ou postérieurs à sa rédaction.
Caillois refusa probablement d'intégrer dans son anthologie une histoire d'H.P. Lovecraft parce que ce dernier structurait son univers fantastique au moyen de la création d’une mythologie qui le faisait assez nettement verser du côté des Gnostiques, qu’il s’agisse des théologiens antiques ou des artistes et écrivains étudiés sous cet angle précis par Henri-Charles Puech et Serge Hutin. Et ce qui pouvait séduire un Jacques Bergier (voir l’introduction de Bergier aux Chefs-d’œuvre de l’épouvante (éd. Anthologie Planète, 1965) inquiétait certainement un Roger Caillois. Maurice Lévy montre, dans sa belle étude sur Lovecraft ou du fantastique (éd. U.G.E., coll. 10/18, 1972), comment le recours au mythe est peut-être le moteur premier de la création littéraire fantastique, équilibrant en somme les deux thèses opposées. Sans doute faut-il aussi, à l’inverse, convenir que Démons et merveilles est assurément une œuvre de Lovecraft nettement moins fantastique, au sens rigoureux que donne Caillois à ce terme, que ne le sont ses contes d’horreur et d’épouvante tels que La Couleur tombée du ciel, L’Abomination de Dunwich, L’Affaire Charles Dexter Ward. Sans doute faut-il, enfin, considérer qu’il existe des recoupements admirables entre des genres a priori hétérogènes mais que la magie de l’inspiration littéraire peut réconcilier : Malpertuis de Jean Ray, Je suis une légende de Richard Matheson, Demain les chiens de Clifford D. Simak appartiennent ainsi, assurément, à plusieurs genres à la fois : fantastique, science-fiction, fable philosophique, poésie pure. La littérature fantastique déborde donc régulièrement ses propres frontières, si soigneusement établies soient-elles.
Hors de l’enceinte stricte de la théorie esthétique littéraire, signalons au moins deux théories nées au XXe siècle, et qui se sont, toutes deux, intéressées au problème esthétique de la délimitation du fantastique : la psychanalyse freudienne et le structuralisme linguistique. Sans pouvoir ici, dans les limites imparties à ce texte, donner les raisons justifiant notre jugement, nous pensons pouvoir affirmer que la première s’est sans doute bien davantage approchée (sans jamais vouloir la réduire) de la vérité esthétique du fantastique que la seconde (qui prétendait, pour sa part, la réduire, comme le restant du réel, à une sorte de mécanisme fonctionnel). On trouvera les éléments à charge et à décharge de ces deux théories dans deux études synthétiques : Anne Clancier, Psychanalyse et critique littéraire (préface d’Yvon Belaval, éd. Édouard Privat, coll. Nouvelles recherches, 1973) d’une part, Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique (éd. du Seuil, coll. Points-Littérature, 1970) d’autre part. Sans oublier, concernant la conception psychanalytique, de se référer à l’article fondamental des Essais de psychanalyse appliquée de Freud sur L’Inquiétante étrangeté, ni de se référer à la monumentale étude psychanalytique (éditions définitive P.U.F. en trois volumes, 1958) de la princesse Marie Bonaparte sur Edgar Poe.
Le terme «thriller» (littéralement : qui fait frissonner tout le corps, qui provoque un choc émotionnel, puis, par extension, un roman «thriller» ou un film «thriller») est de la même nationalité que celle de Poe : américain. Et son premier emploi là-bas y daterait, selon notre Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, de l’année 1889. Ce terme a mis plus de cinquante ans à se populariser outre-atlantique : l'édition anglaise du Chamber’s Twentieth Century Dictionary de 1947 ne le répertoriait même pas. À tout seigneur, tout honneur : il n’est pas absurde de considérer que les premiers thrillers furent américains et que, en bonne logique, les premiers «thrillers» fantastiques le furent aussi. Et la réalité confirme la logique car l’histoire extraordinaire d’Edgar Poe, The Murders in the Rue Morgue, publiée pour la première fois en 1841 aux États-Unis (traduite en français en 1847 par Isabelle Meunier sous le premier titre Les Crimes de la Rue Morgue, puis en 1855 par Charles Baudelaire sous le titre aujourd’hui plus connu de Double assassinat dans la Rue Morgue) possède les caractéristiques d’un thriller fantastique authentique, même s’il ne s’agit que d’une nouvelle appartenant au genre «detective story» rationaliste et discursif, d’un conte et pas encore d’un roman. Signe qui ne trompe d’ailleurs pas : les trois adaptations cinématographiques de cette histoire de Poe par les cinéastes Robert Florey (USA, 1931), Roy Del Ruth (USA, 1954), et Gordon Hessler (G.-B., 1971) sont systématiquement classées dans les programmes hebdomadaires et les dictionnaires du cinéma comme «films d’horreur et d’épouvante» ou «films fantastiques» plutôt que comme «films policiers».
Il en sera de même, en Angleterre, pour The Hound of the Baskervilles [Le Chien des Baskerville] publié par Sir Arthur Conan Doyle en 1902 : la terreur provoquée par le chien monstrueux qui hante Sir Hugo Baskerville relève du fantastique bien que l’enquête du détective Sherlock Holmes autour de ce monstre relève de la stricte littérature policière, de même que la terreur provoquée par le singe monstrueux maniant le rasoir chez Poe relevait du fantastique bien que l’enquête de Dupin relevât de la littérature policière. Historiquement, une boucle s’est d’ailleurs bouclée en 1994, avec la parution américaine du savoureux Nevermore de William Hjortsberg, traduit en français par Philippe Rouard en 1997 pour la Série Noire-N.R.F. (volume N°2446) des éditions Gallimard. Dans le New York de 1920, un double meurtre particulièrement macabre met la police sur la piste d’un criminel psychopathe imitant les crimes décrits par Edgar Poe dans ses livres. La police locale s’y faisait aider par Sir Arthur Conan Doyle et même du magicien Houdini pour venir à bout du meurtrier. L’idée n’est d’ailleurs pas neuve : le film Theater of Blood [Théâtre de sang, G.-B., 1973) de Douglas Hickox mettait déjà en scène un comédien fou (joué par Vincent Price) assassinant ses critiques en s’inspirant des meurtres les plus sanglants décrits dans les tragédies de William Shakespeare.
Concernant le XXe siècle, il faut au moins citer trois écrivains ayant allié à la perfection le fantastique et le roman policier : le Belge Jean Ray (1887-1964), l’Allemand Curt Siodmak (1902-2000) et l’Américain Robert Bloch (1917-1994). Jean Ray pour son hallucinante série policière d’horreur et d’épouvante (occasionnellement saupoudrée de science-fiction) constituée par les 16 volumes d’Harry Dickson réédités dans la si belle Bibliothèque Marabout, série fantastique, de l’éditeur Gérard & Cie (Verviers, 1966-1974) où les explications du détective sont encore plus folles que les faits démentiels et atroces qu’il doit élucider. Le romancier et cinéaste Curt Siodmak (le frère du cinéaste Robert Siodmak) pour l’alliage étonnant de science-fiction, de fantastique et d’intrigue policière de son Donovan’s Brain [Le Cerveau du nabab] (première édition américaine 1942 ou 1944 puis traduction française en Série blême, rééditée en Série noire-N.R.F. N°1027 en 1966) dont la suite Hauser’s Memory [La Mémoire du mort] paraît en 1968 aux USA, traduite en Série noire-N.R.F. N°1296 en 1969. Robert Bloch pour le génial alliage que représente son Psycho [Psychose] adapté cinématographiquement en 1960 par Alfred Hitchcock et son scénariste Joseph Stefano. Sans oublier les moins connus mais tout aussi remarquables romans de Robert Bloch, Psychose 2 (adapté cinématographiquement par Richard Franklin) et Le Crépuscule des stars.
Au tournant des années 1990-2010, c’est l’écrivain français Alexandre Mathis qui doit être cité en raison de l’ampleur mi-joycienne, mi-célinienne de son œuvre de fiction policière irriguée de l’intérieur par une inspiration fantastique aussi constante que subtile : Maryan Lamour dans le béton (édition Idées-Encrage, Les Belles lettres, 1999) est le premier volume, écrit et médité sur une dizaine d’année, d’une trilogie comprenant ensuite Les Condors de Montfaucon (édition E-dite, 2004) et Chambre de bonnes – Le Succube du Temple (édition E-Dite, 2005) où surnaturalisme fantastique et réalisme policier sont étroitement alliés. Mathis fut un exégète précis des adaptations de Poe au cinéma à qui il avait consacré un bel article dans le numéro 64 de la revue Écran 77. Il a mi-imaginé mi-commenté les dernières heures de Poe lui-même durant sa dernière semaine de 1849 dans son très précis Edgar Poe : dernières heures mornes (édition E-dite, 2009). Signe supplémentaire de l'influence de Poe sur Mathis, bouclant une boucle qu'aurait appréciée à sa juste valeur l'auteur du Démon de la perversité : l'intérêt de Mathis pour le romancier français André Héléna dont il avait préfacé une réédition du Le Goût du sang (édition E-dite, 2004).
En somme, d'Eschyle à Mathis en passant par Racine, Baudelaire et Poe, on pourrait dire que la peur est bien la substance de l'art fantastique et que lorsqu'elle s'insinue dans d'autres genres, le fantastique s'y insinue logiquement avec elle. De ce point de vue, l'esthétique dramaturgique d'Eschyle ressort bien du fantastique qui ne débute pas, en tant que genre, par la conscience qu'il prendrait de lui-même chez l'écrivain ou le critique. Il n'y a pas un fantastique essentiellement antérieur ou postérieur au mot célèbre de madame du Deffand. Le jeu conscient avec la peur, auquel Roger Caillois tenait tant lorsqu'il s'agissait de le définir, n'est qu'un des aspects de son histoire et de son esthétique.
Note
(1) Roger Caillois néglige l'antériorité chronologique des lettres antiques car elle nuancerait peut-être sa thèse, d'un point de vue logique comme temporel, à un point tel qu'elle pourrait finalement l'invalider sinon d'un point de vue esthétique, au moins d'un point de vue historique et peut-être même logique. Prenons l'exemple de Plutarque, Vie de César, LXIII, (in Vies parallèles, tome IV, édition Classiques Garnier 1950, traduction Bernard Latzarus, page 270) qui relate, parmi les signes et prodiges ayant annoncé la mort tragique du dictateur, celui-ci :
«[...] Comme César lui-même sacrifiait, le coeur de la victime demeura invisible, et l'on regarda cette anomalie comme effrayante, car un animal dépourvu de coeur ne saurait exister d'après les lois de la nature [...]».
Plutarque de Chéronée écrit ces lignes, relevant de toute évidence de la littérature fantastique selon les critères de Caillois, à l'époque hellénistique, presque dix-huit siècles avant l'âge d'or de la littérature romantique européenne. On sait que les idées philosophiques, morales et religieuses de Plutarque ne sont pourtant pas tout à fait celles d'un Européen du dix-neuvième siècle mais Plutarque, en héritier cultivé des grands systèmes philosophiques grecs helléniques puis hellénistiques, admet sans difficulté le concept de loi naturelle, comme il admet aussi celui du Destin vengeur, de la Némésis de la mythologie archaïque à laquelle il croit non moins. Il croit à l'interférence des deux plans de réalité et sait doser ses effets d'un strict point de vue littéraire. William Shakespare n'aura pas de mérite lorsqu'il introduira cette terreur fantastique – terreur fantastique qui fut un des éléments-clés du succès critique de Shakespeare à l'époque romantique en France – dans sa Tragédie de Jules César (notamment dans l'acte II, scène 2). Elle était déjà, fond comme forme, dans le récit historique de Plutarque. Récit qui n'est nullement un jeu avec la peur puisqu'il se veut historique mais récit qui comprend déjà l'opposition fondamentale entre lois naturelles et rupture inexplicable de ces lois, opposition provoquant consciemment la terreur par sa relation littéraire, terreur redoublée parce que déjà éprouvée par les contemporains du fait mémorable historique. De ce point de vue, Plutarque est absolument le digne prédécesseur des Mémoires de Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon dont le fragment de 1704 sur les masques de cire du lieutenant général Bouligneux et du maréchal de camp Wartigny, correspond absolument, d'un point de vue logique et du point de vue du genre littéraire, à ce extrait de Plutarque. On se souvient que Caillois datait de cet extrait de Saint-Simon la naissance de la littérature fantastique française. Gageons qu'en relisant nos auteurs antérieurs du seizième siècle et du moyen âge, on trouverait probablement encore d'autres textes passibles de ce compliment.






























































 Imprimer
Imprimer