« Ce dont Philippe Sollers et Josyane Savigneau ne parlent pas, par Damien Taelman | Page d'accueil | L’Amérique en guerre (11) : Shiloh de Shelby Foote, par Gregory Mion »
10/03/2019
Le Sauvetage de Bruce Bégout, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Chip Somodevilla (Getty Images).
 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.«Pourquoi ai-je si peur parfois ? Et pourquoi plus j’ai peur plus mon esprit semble se gonfler, s’élever et observer la planète entière d’en haut ?»
Roberto Bolaño, Le Troisième Reich.
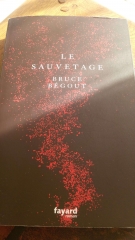 Ce roman de Bruce Bégout publié chez Fayard et dont presque personne n’a parlé (mais l’on ne s’étonne plus de rien dans un pays qui valorise le pire et discrédite le meilleur) aborde pourtant un faisceau de problèmes fondamentaux qui permet de mieux situer les pathologies de l’actualité française voire occidentale : la simplification malsaine du langage, la marginalisation des vrais penseurs, la construction permanente du bouc-émissaire juif et la nécessité de croire à la persévérance des héros de l’ombre qui vivent pour inverser les tendances affligeantes. Dans Le Sauvetage, donc, Bruce Bégout raconte le destin mouvementé des manuscrits du philosophe Edmund Husserl au milieu des bourrasques nazies. La mort de ce philosophe d’origine juive et inventeur de la phénoménologie, en 1938 à Fribourg-en-Brisgau, aurait pu condamner les 40 000 pages sténographiées de ses travaux inédits aux flammes arbitraires de l’autodafé, mais c’était sans compter sur quelques accords de violons de l’Histoire qui vinrent foudroyer de l’intérieur la symphonie percussionniste et vulgaire du nazisme. Il a fallu toute l’intrépidité d’un étudiant franciscain en philosophie, Herman-Leo Van Breda (1911-1974), inscrit à l’Université catholique de Louvain, pour exercer un contrepoids décisif dans la machine totalitaire et faciliter l’exfiltration des précieux manuscrits en lieu sûr. Il faut saluer la nature audacieuse de ce jeune homme «pas du genre impressionnable» (p. 31) et «déterminé» (p. 175), inspiré par l’obstination de François d’Assise, ce magnifique Poverello qui ne recula devant aucune adversité, prêt à se rouler dans toutes les nuances du dénuement, sachant que l’altitude d’une âme se mesure à la faculté d’avoir des visions de sagesse dans tout ce qui répugne habituellement le commun des mortels (la maladie, l’impopularité, la saleté, le refus de céder aux autorités usurpées). Par conséquent et de manière intermittente, Bruce Bégout réserve plusieurs chapitres aux vertus de saint François d’Assise, insistant d’une part sur le sobre héroïsme de cet ambassadeur de Dieu, puis, d’autre part, comme un reflet de cette sobriété battante, nous prenons plaisir à suivre la constance invincible du disciple belge, la façon dont Van Breda piétine la folie nazie et triomphe pour ainsi dire du Triomphe de la mort de Felix Nussbaum.
Ce roman de Bruce Bégout publié chez Fayard et dont presque personne n’a parlé (mais l’on ne s’étonne plus de rien dans un pays qui valorise le pire et discrédite le meilleur) aborde pourtant un faisceau de problèmes fondamentaux qui permet de mieux situer les pathologies de l’actualité française voire occidentale : la simplification malsaine du langage, la marginalisation des vrais penseurs, la construction permanente du bouc-émissaire juif et la nécessité de croire à la persévérance des héros de l’ombre qui vivent pour inverser les tendances affligeantes. Dans Le Sauvetage, donc, Bruce Bégout raconte le destin mouvementé des manuscrits du philosophe Edmund Husserl au milieu des bourrasques nazies. La mort de ce philosophe d’origine juive et inventeur de la phénoménologie, en 1938 à Fribourg-en-Brisgau, aurait pu condamner les 40 000 pages sténographiées de ses travaux inédits aux flammes arbitraires de l’autodafé, mais c’était sans compter sur quelques accords de violons de l’Histoire qui vinrent foudroyer de l’intérieur la symphonie percussionniste et vulgaire du nazisme. Il a fallu toute l’intrépidité d’un étudiant franciscain en philosophie, Herman-Leo Van Breda (1911-1974), inscrit à l’Université catholique de Louvain, pour exercer un contrepoids décisif dans la machine totalitaire et faciliter l’exfiltration des précieux manuscrits en lieu sûr. Il faut saluer la nature audacieuse de ce jeune homme «pas du genre impressionnable» (p. 31) et «déterminé» (p. 175), inspiré par l’obstination de François d’Assise, ce magnifique Poverello qui ne recula devant aucune adversité, prêt à se rouler dans toutes les nuances du dénuement, sachant que l’altitude d’une âme se mesure à la faculté d’avoir des visions de sagesse dans tout ce qui répugne habituellement le commun des mortels (la maladie, l’impopularité, la saleté, le refus de céder aux autorités usurpées). Par conséquent et de manière intermittente, Bruce Bégout réserve plusieurs chapitres aux vertus de saint François d’Assise, insistant d’une part sur le sobre héroïsme de cet ambassadeur de Dieu, puis, d’autre part, comme un reflet de cette sobriété battante, nous prenons plaisir à suivre la constance invincible du disciple belge, la façon dont Van Breda piétine la folie nazie et triomphe pour ainsi dire du Triomphe de la mort de Felix Nussbaum.L’aventure intellectuelle s’insinue volontiers à la trame de l’aventure historique dans ce livre où le savoir et le drame cohabitent, où le travail et la passion de l’écrivain s’entre-nourrissent également, car Bruce Bégout, philosophe et romancier, consacre une grande partie de son enseignement aux textes de Husserl et nous en restitue littérairement la substance avec ce Sauvetage très abouti. On devine dès le prologue (cf. pp. 11-9) l’hommage de l’intellectuel français à celui qui a donné une direction majeure à ses activités philosophiques. En effet la mort de Husserl y est décrite avec le degré de solennité qui convient. L’assistance n’est point nombreuse autour du maître à l’agonie et les mots pour évoquer ce crépuscule sont aussi respectueux que devait l’être Eugen Fink, élève et continuateur de Husserl, quasiment un frère siamois (cf. p. 119), auprès du corps fatigué du philosophe. Les témoins de l’agonie attendent que les ténèbres s’emparent de ce mastodonte de la pensée, de ce stakhanoviste époustouflant qui pratiqua un «sacerdoce laïc de la vérité» (p. 247), chaque jour de sa vie n’ayant jamais manqué à la densité de la patiente élaboration conceptuelle (cf. p. 68). À bonne distance du pathétique qui entoure la mort de Socrate, avec des amis qui comprennent de moins en moins les arguments en faveur de l’immortalité de l’âme, les circonstances brisant peu à peu les digues du raisonnement, le dernier jour de Husserl, par contraste, souligne le recueillement du mourant et la «majesté distante d’un animal condamné» (p. 16). Le silence domine en cette spectrale journée de printemps qui n’est perturbée, dans l’esprit de Fink, que par le ressouvenir d’une petite fille enjouée par la beauté de ce 27 avril 1938, croisée au parc quelques heures plus tôt (cf. p. 11-5). L’insouciance de cette petite fille est double : d’abord elle ne sait pas qu’un astre de la philosophie va s’éteindre aujourd’hui, ensuite elle ignore que l’extinction concerne aussi un monde qui ne devrait plus tarder à entrer en guerre. En définitive, Husserl meurt dans un monde mourant, et son attente peut-être légèrement craintive bascule vite dans le consentement – dans la grâce qui sent avec l’éternité qui commence à l’embrasser (cf. p. 18). À l’instar d’un sage kierkegaardien tourné vers l’infini, Husserl a conquis une telle profondeur subjective que sa mort va encore amplifier son détachement de l’histoire mondiale (1).
En outre, le détachement présumé de Husserl dans ses ultimes moments coïncide avec l’un de ses concepts prédominants qui intéresse beaucoup Van Breda : l’épokhè ou «manière de mettre entre parenthèse le monde pour ne conserver que son apparence» (p. 45). C’est aussi plus précisément «la suspension de notre croyance naturelle dans la réalité, la saisie du monde comme un phénomène, rien qu’un phénomène, la reconduction immédiate de l’ensemble à des vécus de conscience» (cf. pp. 45-6). On soupçonne forcément que les conditions d’une mise à distance de la réalité, en temps normal, ne sont déjà pas évidentes ou clairement accessibles. En tant qu’elle est spontanément passée au crible de nos jugements objectifs et de nos croyances naïves, la réalité souffre a priori d’une saisie oppressée par le poids de nos habitudes théoriques et par l’endurance des valeurs partagées. Or si nous déplaçons le curseur de ces conditions de distanciation à l’intérieur d’un monde exponentiellement saturé comme celui qui est décrété par le Führer, les conditions de ce recul émancipateur sont d’autant plus sujettes à caution. Il est assurément difficile de créer une distance avec le monde quand celui-ci subit la surdétermination des typologies nazies et le martèlement continuel de la propagande. Ce sordide alourdissement de la réalité par les instances totalitaires constitue un défi à la fois philosophique et empirique pour Van Breda. Il est en position de tester la résistance du concept d’épokhè à l’aune des objections concrètes qu’il doit affronter aussitôt qu’il met le pied dans l’Allemagne du Troisième Reich. Comment redonner un sens pur à la réalité quand on pénètre dans un monde où même les urinoirs deviennent potentiellement significatifs de la surveillance hitlérienne (cf. p. 103) ? Comment transcender une axiologie qui a mis le monde sous les verrous d’un conformisme où la moindre apparence de la réalité vivante se voit d’emblée corsetée par les vêtements officiels du régime ? Il s’agit au fond de se demander comment l’on peut être husserlien dans un monde où dès qu’un bourgeon révèle sa charge de vie, celle-ci doit être embastillée dans le cachot dévitalisant du national-socialisme. Dans une situation pareille, la pureté du phénomène semble devancée par le marteau de l’idéologie qui en détruit toute capacité de croissance libre, la moindre fleur, le moindre bond animal, la moindre expression humaine, la moindre pissotière étant sommés de satisfaire au cahier des charges fasciste, comme si l’heureuse polymorphie de l’apparaître devait se résoudre à la triste uniformité du disparaître où chaque chose est recouverte par le suaire de la dictature. Tout l’enjeu consiste alors à ne pas s’avouer vaincu devant «l’Allemagne ensvastikée» (p. 31), à faire vœu de désobéissance malgré la crucifixion obscène du réel. De Fribourg-en-Brisgau à Constance (2), puis enfin à Berlin, le courageux Van Breda n’abandonnera jamais la spiritualité aux puissances temporelles nazies. L’intuition précoce de la catastrophe universelle en gestation, lors de l’été 1938, l’oblige à chercher une valise diplomatique pour délocaliser les manuscrits de Husserl en Belgique (cf. p. 48). C’est ainsi qu’un banal voyage d’études en vue de fortifier un projet de thèse se transforme en épopée historique.
Mais par-delà ce sauvetage du patrimoine husserlien, Van Breda, confessons-le, sauve aussi une fraction non négligeable du monde. En volant au secours d’une philosophie écrite par un homme juif, il affranchit symboliquement tous les Juifs, et, plus particulièrement, il délivre le monde des grammaires abusivement simplificatrices qui couchent la réalité sur un lit de Procuste. C’est dire que le Mal n’est pas toujours ce qui marche du pas bruyant des armées endoctrinées – il se dissimule aussi dans les mots et entre les lignes des discours itérativement vomis dans la bauge des foules. La langue du Reich a d’ailleurs fait l’objet de multiples examens, toutefois elle a probablement été le mieux caractérisée par Victor Klemperer (3), auquel Bruce Bégout emprunte opportunément une citation qu’il met en épigraphe de son roman : «Ce ne sont pas les grandes choses qui importent, mais la tyrannie au jour le jour que l’on va oublier. Mille piqûres de moustiques sont pires qu’un coup de tête. J’observe, je note les piqûres de moustiques.» On a ici une synthèse parfaite des rengaines nazies, une déduction métaphorique des éléments de langage antisémites, en somme des espèces de comptines insidieusement corrosives qui formatent les consciences et préparent des générations entières à détester le juif. Et d’un point de vue plus large, le nazisme se définit comme tout ce qui veut en finir avec «le terrorisme moral des faibles» (p. 160) afin d’exalter une virilité hyperboréenne outrageusement mythifiée. En sus du culte malfaisant de la race inaltérée, le message anti-chrétien est ici plutôt transparent, ce qui ajoute à la vaillante générosité du père Van Breda.
Dix jours de doutes et de misères psychiques auront été nécessaires à Van Breda pour établir un lien avec Malvina Husserl, la veuve du maître en phénoménologie (cf. p. 36). Pendant ces journées d’errance et d’opiniâtreté à Fribourg-en-Brisgau, Van Breda a pu se rendre compte des symptômes urbains de l’orthodoxie totalitaire in the making. Le contact avec Malvina Husserl a été compliqué par le fait que l’antisémitisme légal a progressivement dissipé les Juifs de l’espace public. Les «preuves d’existence de la famille du philosophe [ont] été effacées» (p. 38) par le biais d’une «impressionnante opération de raturage» (p. 36), le tout orchestré par un insupportable «traquenard bureaucratique» (p. 41). L’horreur de ce pouvoir omnipotent se perçoit encore plus férocement dans le diagnostic d’un tranquille grégarisme urbain (cf. p. 25). On a le sentiment, à travers l’œil sidéré de Van Breda, d’observer un troupeau qui accomplit une pastorale inconsciente, roulant sa bosse entre les durcissements administratifs et l’aseptisation galopante de la ville. La «propreté impeccable et terrible» (p. 104) de Fribourg-en-Brisgau traduit un hygiénisme faramineux, l’union impie de la stérilité municipale et des esprits châtrés. La «blancheur sanitaire» (p. 106) qui se dégage de ce tableau de sédation profonde renvoie à l’angoissante blancheur de Moby Dick, à ceci près que la créature, cette fois, paraît avoir englouti le monde entier, falsifiant la réalité sous les traits puissants d’un nouveau Léviathan faussement immaculé. Qu’est-ce à dire sinon que nous assistons là au sinistre processus d’une mise en bière du réel ? Voici désormais le «triomphe de la règle sur la spontanéité» (p. 135), le moment où la contrainte artificielle l’emporte sur la jubilation naturelle, la redoutable époque où l’espace vital a l’air d’être envahi par des milliers de garçons de café de Sartre.
Ce théâtre permanent de la cruauté a considérablement limité le rayon d’influence de Husserl au fur et à mesure que les lois antisémites se sont affirmées (cf. p. 52). Malvina Husserl n’édulcore d’ailleurs aucune des restrictions qui ont frappé son mari. Elle-même reconnaît sa «situation inédite de paria» (p. 57), son isolement de plus en plus pervers. À l’entendre, on ne peut être qu’admiratif du parcours acharné de Husserl lors des années d’affermissement du Reich. Même vieillissant, l’homme n’a jamais interrompu son ministère philosophique. Ce portrait du penseur valeureux détonne avec le portrait du penseur lâche et rampant, Heidegger bien sûr (cf. pp. 167-171), monstre de complaisance, de duplicité, de poltronnerie universitaire, comparable au personnage de Hans-Rainer Lehmann (cf. pp. 125-132), un nervi de la police secrète d’État plein d’une plasticité rédhibitoire, éponge du diable, schismatique de «la conscience morale» (p. 132), petit Eichmann des basses besognes intermédiaires. Tandis que l’outrecuidance de Martin Heidegger s’oppose à la sublime décence d’Edmund Husserl (cf. p. 171), le détestable Lehmann, de surcroît bouffeur de curé (cf. pp. 200-1 et 271-2), diffère de la foi immense de Van Breda. Ce dernier aura raison de ces deux zombies : le premier combattu par une appréciation mentale irrévocable, le second désarmé par l’intensité de la résolution monastique.
Enfin, il est indispensable de rappeler que Bruce Bégout a placé son roman sous le patronage de Victor Klemperer, et ce choix nous éclaire quant à la source éventuelle de toutes les calamités humaines : la «corruption du langage» (p. 54), la «jonglerie sémantique» (p. 103) et le «mysticisme enchanteur des mots» (p. 118) qui ouvrent la porte au «devenir-hécatombe des idées bestiales» (p. 123). À ce degré de contrefaçon du réel, nous n’avons même plus affaire à un monde contaminé par des bourreaux, car nous pourrions encore espérer des bourreaux en les créditant d’une conscience, mais nous sommes confrontés avec le nazisme à un monde de mannequins rembourrés de vide. C’est Kierkegaard qui distingue habilement le «bourreau» du «mannequin», disant qu’on a pu boire fraternellement avec le premier malgré le désagrément subi, mais que l’on risque de sombrer dans la folie en essayant de s’entretenir intelligemment avec le second (4). Ce détour par la vacuité du mannequin tend à justifier l’état général de zombification du Troisième Reich, un espace-temps où le langage dégénère en fouet dompteur des masses creuses (cf. p. 322), avec, au sommet de ce dressage, un gouvernement de locuteurs tout aussi creux, symboles d’une préoccupante dérive technique et superficielle de l’humanité. Ainsi, dans le sillage essentiel de Georges Bernanos, il semble que Bruce Bégout ait écrit un Van Breda contre les robots.
Notes
(1) Cf. Søren Kierkegaard, Post-scriptum aux Miettes philosophiques (Deuxième section, chapitre premier : Devenir subjectif).
(2) La piste de Constance est déblayée par la sœur Adelgundis Jaegerschmid (1895-1996), religieuse et philosophe, fidèle de Husserl jusqu’au bout (cf. pp. 238-244). Elle propose le concours de quelques bonnes sœurs antinazies de Constance pour aider à transférer les manuscrits en Suisse. Malgré l’échec de ce plan audacieux, le rôle de sœur Jaegerschmid fut un levier d’Archimède pour relancer les désirs de résistance de Van Breda.
(3) Cf. Victor Klemperer, LTI, la langue du Troisième Reich.
(4) Kierkegaard, op. cit. (Deuxième section, chapitre II : La vérité subjective, l’intériorité; la vérité est la subjectivité).




























































 Imprimer
Imprimer