« Matzneff, Beigbeder et Ardisson libidînent, hésitant pour dessert entre putes, pieu et pénils, par Damien Taelman | Page d'accueil | La Séparation de Sophia de Séguin »
12/03/2020
Adolphe de Benjamin Constant : un abrégé de l’amour en décomposition, par Gregory Mion

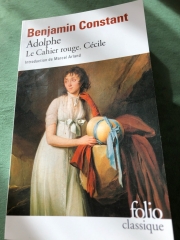 «Elle mourut peu de jours après, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde et qui aurait été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions.»
«Elle mourut peu de jours après, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde et qui aurait été la plus heureuse si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions.»Madame de La Fayette, Histoire de la princesse de Montpensier.
«Le fait est, voyez-vous, que l’homme le plus fort au monde, c’est l’homme le plus seul.»
Henrik Ibsen, Un ennemi du peuple.
Il faut être revenu des hallucinations de l’amour pour lire Adolphe (1) et s’en trouver pourquoi pas fort diverti. Il y a en effet une forme de jubilation méchante à suivre le parcours d’un homme fatigué de l’amour. Comme nous tous plus ou moins, souvent à un âge où la jeunesse nous imprègne de volontés homériques, cet homme a promis à une femme monts et merveilles avant de s’apercevoir qu’il ne tiendrait pas la moitié de ses illustres serments. L’argument du livre est du reste clarifié par Benjamin Constant dans la préface à la seconde édition : il s’agit d’explorer «les souffrances du cœur» et le désappointement d’une «âme trompée», le dépit d’une femme «délaissée par celui qui jurait de la protéger» (p. 30). Parallèlement à cela, quoique le cœur d’Adolphe possède une dureté certaine, il n’en est pas moins affecté par la conscience du mal qu’il inflige à Ellénore, de dix ans son aînée, lui étant âgé d’une vingtaine d’années bien comptées. C’est ainsi tout le problème du déséquilibre amoureux qui apparaît, en sus des impressions libidineuses que peut entraîner la maturité féminine chez un garçon nubile et vaniteux : faut-il s’abandonner aux bras d’une femme qui nous aime inconditionnellement quand nous ne l’aimons que subsidiairement ? On retire de ce genre de relation un confort absolu parce que tout ce que nous faisons, du bon ou du mauvais côté de l’Évangile efféminé, se voit susceptible d’être converti soit en acte héroïque, soit en virilité nécessaire. Quoi qu’il se passe, l’amante glorifie l’aimé, ignorant que ce dernier relève moins d’un amant que d’un intermittent du cœur. Dès lors ce type d’intensité amoureuse tout à fait définitive nous cause rapidement du tracas parce que nous sentons que nous sommes prisonniers. Que faire si un jour nous n’aimons vraiment plus ? Comment donner le change alors que nous n’aimons pas au même degré ? Le cas échéant, la femme à laquelle nous avons succombé devient une sangsue gênante, une ventouse qui agace notre esprit. On finit par se reprocher d’avoir cédé à la facilité, à la tentation de la chair et à l’orgueil de conquérir. On avoue secrètement – voire ostensiblement – qu’on a voulu du plaisir à court terme quand la femme désirait le bonheur durable, la vie de ménage et peut-être les sanctifications ultimes du mariage. Les hommes ont-ils d’ailleurs jamais cherché autre chose que des femmes expérimentées, délassantes et point trop encombrantes ? Sans doute Adolphe s’est-il persuadé qu’il aimait Ellénore, puis, de loin en loin, sitôt la consommation advenue, il s’est retrouvé piégé par la vérité de son cœur incapable d’aimer spirituellement et opiniâtrement. Comment donc se débarrasser d’Ellénore tout en sachant qu’il souffrira de faire souffrir ? C’est un conflit ordinaire quand on a encore un peu de pitié qui nous empêche d’avancer vers de nouvelles séductions : si nous restons dans la dyade, nous nous ennuyons mais nous sauvons les meubles en nous donnant bonne conscience, si nous partons, nous craignons de crucifier celle que pourtant nous n’aimons plus (si toutefois nous l’avons aimée un jour). Au fond, ce que subit l’apprenti Adolphe, c’est le «ni sans toi ni avec toi» d’Ovide, la haine de l’âme féminine et l’amour du corps féminin (2).
De sorte que les rapports entre Adolphe et Ellénore révèlent en creux la faiblesse d’un homme qui s’est menti à lui-même et la force d’une femme dont l’élan sentimental ne connaît pas la trahison. En outre l’écriture en première personne, extorquant les confessions d’Adolphe au gré de ses vacillements, nous raconte probablement quelque chose de l’auteur, à tel point que ce petit roman eût pu s’intituler Constant juge de Benjamin dans la mesure où nous savons ce que fut sa relation avec Madame de Staël – un long calvaire où l’impossibilité d’aimer s’est adjointe à l’impossibilité de dédaigner. Mais indépendamment des spéculations qui voudraient repérer chez Adolphe des traits flagrants de Benjamin Constant, le texte, à lui seul, offre une matière suffisamment importante pour réfléchir à l’inconcevable tranquillité de l’amour, du moins pour ceux qui ont encore l’ambition de l’autonomie. La leçon qu’on en retire, objectivement, se résume à une évidence qu’il est difficile de se formuler : les compromis ou les concessions atrophient d’emblée l’union des amants car l’un ou l’autre, directement ou indirectement, récuse une partie de ce qu’il est afin de ne pas blesser celui ou celle qui ne l’accepterait pas s’il en allait différemment. C’est pourquoi nous n’aimons guère que des versions modifiées de nos soupirants, des «qualités empruntées» dirait Pascal (3), mais rien qui ne saurait concourir à ce que l’on touche du doigt la véritable intériorité d’autrui. Combien d’hommes créatifs se sont ainsi perdus auprès d’une femme qui les a réquisitionnés pour de banales vies communes ? On pense par exemple au pauvre Louis Lambert de Balzac, d’abord génial, ensuite cloué au pilori de l’existence maritale où il finit de massacrer son génie. Et Adolphe, par assimilation, ne réalise pas les perspectives de son cursus à partir du moment où il s’amourache d’Ellénore. Il veut tellement conjurer sa timidité (cf. p. 39) qu’il se fixe en quelque sorte l’ordre de mission de ravir la mûre Ellénore à son aristocrate installé.
D’autre part, le besoin de solitude éprouvé par Adolphe est contrebalancé par un «besoin de sensibilité» qu’il ne peut se procurer qu’en société (p. 39). Ce contentieux existentiel rappelle que l’homme est une créature à la fois sociable et insociable, tantôt attirée par le monde et tantôt répugnée par lui, condamnée à errer de-ci de-là en essayant d’élucider la bonne distance entre l’individualité et la présence de la multitude. Ce jeu d’attraction et de répulsion, par ailleurs, définit parfaitement l’union contrariée d’Adolphe avec Ellénore. C’est un signe incontestable de vitalité parce que la rencontre amoureuse, au moins, ne se repose pas sur la «masse compacte et indivisible» d’une morale archaïque et frigide (p. 42). Même si Adolphe entend considérablement «disserter sur des principes bien établis, bien incontestables» (p. 42), il n’est pas dupe de ces façons d’aimer, de ces manières d’apprivoiser le monstre de la sensibilité à travers une succession de commandements isolés des réalités voluptueuses. Il préfère qu’on l’accuse d’immoralité et qu’on lui fasse une réputation de hargneux auquel on ne peut nullement faire confiance (cf. pp. 42-4). Le problème, cependant, c’est que ce rejet de la morale va aussitôt entrevoir ses limites. En effet, au-delà des conventions de la culture, il y a les ressorts incontournables de la nature, et la prescription des premières n’est pas tout à fait séparée de la constatation des seconds. Que le libertinage ou la légèreté de sentiment ne soient pas franchement tolérés parmi les traditionalistes de l’amour, on le comprend, mais parmi les libertins revendiqués, ou parmi les lovelaces qui débutent dans la carrière du badinage, beaucoup d’entre eux se découvrent soudainement des principes qu’ils estimaient hors de leur créance. En cela précisément, Adolphe, malgré l’éducation licencieuse qu’il a reçue par son père, ne sera pas épargné par son caractère sujet à l’attendrissement. Pourtant la philosophie paternelle avait tout pour hypnotiser un jeune homme en quête d’expériences fondatrices : prendre et quitter indifféremment les femmes avec lesquelles on ne prévoit pas de se marier, parce que «cela leur fait si peu de mal, et à nous tant de plaisir !» (p. 45). Ce programme dévergondé aurait pu s’appliquer avec Ellénore – et à certains égards il en est avantageusement question – mais plus la relation d’Adolphe avec son aînée se délite, moins il est enclin à couper les ponts une bonne fois pour toutes. Quelque chose en lui le pousse à revenir au chevet d’Ellénore même s’il n’a jamais eu pour cette femme la moindre attirance profonde. À son corps défendant, Adolphe est bien obligé de reconnaître que son tempérament compatissant justifie l’existence de plusieurs survivances de la morale. Très peu d’hommes, en définitive, ont l’air de pouvoir négliger à l’envi les femmes qu’ils enchaînent dans l’orbite de leurs voluptés.
Par contraste avec les tiraillements d’Adolphe, qui, admettons-le, se retranche derrière un douteux laxisme moral, Ellénore incarne la ligne droite de la vertu. Elle est non seulement très religieuse, mais, de surcroît, elle éduque austèrement les deux enfants qu’elle a eus avec le comte de P., son gentilhomme régulier. Ce clair-obscur qui distingue Ellénore et Adolphe traduit l’homogénéité du tempérament féminin et le possible manque «d’unité complète en l’homme» (p. 51). Cela explique éventuellement l’oscillation d’Adolphe entre la sincérité «de la meilleure foi du monde» (p. 56) et la déloyauté de son âme dilettante. Au commencement de son entreprise de séduction, du reste, plus Ellénore lui résiste, plus il déploie un cabotinage scabreux et une insistance malaisée, débitant des promesses d’anthologie et des pactes engagés avec l’éternité (cf. pp. 56-60). Il ne s’agit pas vraiment d’amour – il s’agit d’un célibataire qui se monte le bourrichon et qui veut se composer une dimension de Casanova. Et à force de marteler ses empressements, ses présages et ses témérités, Adolphe a raison des réluctances d’Ellénore : elle se sent une réciprocité pour cet adonis extravagant, si différent du protocolaire comte de P., si vivant par rapport aux habitudes qu’elle a dûment contractées (cf. p. 60).
La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, benjamin constant, adlophe, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer





























































