« L’Amérique en guerre (23) : Les nus et les morts de Norman Mailer, par Gregory Mion | Page d'accueil | L’Amour parmi les ruines de Walker Percy, par Gregory Mion »
11/07/2021
Les Éblouissements de Pierre Mertens

Photographie (détail) de Juan Asensio.
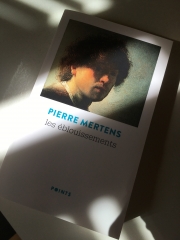 Acheter Les Éblouissements sur Amazon.
Acheter Les Éblouissements sur Amazon.C’est peut-être parce que Les Éblouissements (1) ont reçu le prix Médicis en 1987 que je n’ai lu ce roman sur Gottfried Benn, assez sobre dans ses effets et comme modeste malgré son ampleur, que fort tardivement, me souvenant tout de même que son auteur, Pierre Mertens, avait donné une brève mais juste préface aux Hauts-Quartiers de Paul Gadenne, ce qui ne pouvait, tôt ou tard, que me pousser à lire ce texte, fût-il, donc, récompensé, consacré à un poète fascinant et complexe : comme l’auteur l’écrit, à chacun «sa version des faits, et le Diable pour tous» (p. 396) comme, en somme, à chacun son Gottfried Benn. Celui de Pierre Mertens ne peut que donner envie, à celui qui ne saurait rien de la prose brutale et savante de celui qui fut, autant que poète, médecin, de la découvrir. Elle fut écrite, au travers d’années ô combien cruelles qui elles-mêmes ne souffrent ou ne devraient souffrir aucune facilité interprétative, par «un cruel mais doux et patient artisan des mots, le conquérant d’un nouveau babil» (p. 400) refusant les facilités puisqu’il obéit, selon Pierre Mertens, à un impératif catégorique de dureté et de force, d’exigence, que plus personne ne peut appliquer ni même comprendre, et surtout pas les hommes de lettres empesés faisant office d’écrivains voire de poètes subventionnés, trompant leur ennui en déclamant de la rimaille de festival en festival de poésie pour rombière ménopausée et retraité delavien, riche de la publication de 250 recueils de poèmes inutiles et reconnus comme tels : autant dire, oui, que les mots ne vont pas au poème «comme le taureau va à la vache…» (p. 416), une comparaison gaillarde qui n’a plus cours aujourd’hui, dans une France qui célèbre les rinçures d’une Cécile Coulon qui, elle, il est vrai, fait aller les journalistes de la cruche au pot, au pot de chambre bien sûr.
Le style de Pierre Mertens, assez sobre malgré quelques comparaisons frappantes (2) et belles embardées métaphoriques – je viens d’en citer une, paysanne en somme – sert assez finement le projet qui, selon l’écrivain, est celui qu’a tenté de remplir Gottfried Benn : trouver une forme d’espérance dans un monde vide et privé de Dieu, autant dire déployer un art «qui faisait les mots tituber mais tenir debout et marcher avec la sûreté du funambule sur un filin tendu au-dessus d’un précipice…» (p. 452), autant dire, encore, tenter, puisque de toute façon «on ne peut finir douillettement dans la peau d’un homme de lettres» (p. 454), comme si on était propriétaire des mots (cf. p. 461), de servir «la fière pauvreté des mots» (p. 465) sans la déshonorer, ainsi qu’il en va aussi pour Malcolm Lowry (3), autre humble serviteur crucifié sur la croix du Verbe que nous sommes joyeusement étonnés de voir mentionné, de «la forme elle-même, comme contenu» au sein du «vide des valeurs», l’un et l’autre de ces écrivains essayant peut-être, bien que par des moyens que nous ne saurions rapprocher que de manière pour le moins éphémère, de freiner voire d’enrayer la «chute des contenus» (p. 373). Chez Lowry, la tentation du roman total, inséparable d’une vie radicalement vécue, consommée tout autant que consumée et, chez Benn, la puissance et l’engagement céliniens d’une langue qui ne triche pas : «J’attends de pouvoir écrire le poème qui donnerait soif à l’alcoolique parvenu au terme de sa cure de désintoxication, et mettrait en état de manque le drogué revenu de la cocaïne. J’attends de moi les mots qui ramèneraient au bordel le débauché guéri de sa vérole, et à ses larcins le voyou repenti qui aurait purgé sa peine. Ceux, aussi, qui pousseraient à déclarer la guerre aux dieux celui qui aurait fait sa paix avec les hommes. Sinon je n’aurai plus qu’à fermer ma gueule» (p. 254). Moins, à notre sens, la tentation véritablement démiurgique du nommeur, le créateur adamique capable selon Nietzsche d’inventer des réalités en leur donnant un nom que celle, dans et par la langue, de retrouver la vie dans sa plus basse matérialité, celle des prurits et des eczémas, des sexes sanieux des femmes gonflés de blennorragie.
Comme Lowry, plus que lui peut-être puisqu’il est devenu une forme de proscrit politique avant d’être célébré, assez tardivement, par les jeunes générations, Gottfried Benn est l’homme de la plus intime fracture, de l’éblouissement dont Pierre Mertens nous rappelle le sens double : «l’un renvoie à la lumière, et l’autre à la nuit. Et ainsi va, et tant va notre regard qu’il peut, contre toute raison, confondre l’un avec l’autre…»; et l’auteur de développer son propos, affirmant que, si on a «trébuché une seule fois, c’est pour toujours. Au fond, nous ne sommes qu’en apparence éveillés. C’est un masque. Une ruse de fainéant. La vérité, c’est que nous dormons debout. Nous ne veillons que d’un œil. Nos plus pendables crimes, nous les commettons au tréfonds d’une sorte de torpeur. Et même nos actions les plus généreuses et les plus nobles, nous les accomplissons, hagards, au cours d’une crise de somnambulisme» (p. 288), non pas seulement, comme nous l’avons dit, parce que Gottfried Benn a peut-être illustré le genre de personnages que Hermann Broch a appelés «irresponsables» et que Musil a confirmé être sans la plus discernable qualité, mais parce que c’est aussi l’affaire de ce genre d’homme, que nous dirons, suivant Poe et Baudelaire, appartenir aux foules indivises, de nourrir, pour leur malheur insigne, des aspirations faustiennes à la rédemption par l’art d’une époque privée de transcendance, elle-même vide, atrocement médiocre : «Quel artiste faustien n’a, dans un vertige, envisagé d’immoler sa clairvoyance sur l’autel d’un univers qu’il s’imagine, tout à coup, régressant jusqu’à sa première aurore ? Il pleure. Il croit que c’est de ravissement. Ses larmes lui brouillent la vue. Lui dissimulent les futurs charniers. Il croit savourer la chair du cosmos. Il ne sait pas qu’il mange déjà son propre cadavre» (p. 289).
C’est de fait le motif d’une quête éperdue de pureté, d’autant plus paradoxale que Benn, en tant que médecin, n’ignore rien des plus infâmes maladies capables de ronger les corps, que Pierre Mertens ne cesse de tisser tout au long de ses Éblouissements : il s’agit donc en somme, toujours, d’écrire «pour réprimer le bâillement que vous arrachent les jours, à vous décrocher le cœur», et considérer l’écriture comme «unique remède au tarissement de toutes les sources», l’œuvre d’art comme «ultime rempart contre cette crue de sable» (p. 252) que nous n’aurons pas tort de prétendre nietzschéenne.
Mais comment retrouver «la ferveur, alors, bouillonnant sur le rivage» (p. 253) ? Comment tenter pareille remontée du puissant flot qu’est la modernité elle-même, alors même que l’invisible, même si nous feignons de l’ignorer ou de le mépriser, enserre chacun de nos gestes et lui confère une profondeur mystérieuse dont nous ne savons pratiquement rien, malgré les puissants coups de sonde que jetèrent un Léon Bloy ou un Georges Bernanos, sans oublier Leo Perutz, dans l’insoupçonnable gouffre qui ajointe intimement ou sépare infernalement les âmes ?
C’est, peut-être, cette dimension seule suggérée dès l’exergue du roman, empruntée à T. S. Eliot («Nous avons existé par cela, cela seul / Qui n’est point consigné dans nos nécrologies»), dimension dont nous ne savons pratiquement rien, qui peut, non pas racheter les erreurs manifestes («Quand je vous dis : Je vous laisse…, est-ce que je dis : Je vous libère, ou dis-je plutôt : Je vous abandonne ?», p. 262), mais les enserrer dans un entrelacs de significations que nous étions à mille lieues de supposer ni même de soupçonner, comme l’enseigne Pierre Mertens qui rapporte l’histoire de Kurt Gerstein, ce «luthérien fervent» qui, «horrifié par le langage que tenaient les officiels nazis sur l’Ancien Testament», décida de s’engager dans les troupes SS, «dans le seul but de [les] infiltrer, et de dévoiler aux Alliés les forfaits [qu’ils ont] perpétrés» (p. 431) puis qui, se livrant aux Alliés pour les avertir que des millions de Juifs partaient en fumée crachée par les tours des fours crématoires, ne fut pas cru et se suicida en 1945, dans sa prison parisienne : il fut, bien sûr, «tout de même stigmatisé, à titre posthume, par une commission de dénazification…» (p. 431).
On me dira que c’est encore affaire, bien que de façon détournée, de quête d’une pureté perdue, le poète sachant parfaitement que la «douleur prométhéenne» qui le ronge «n’est que pure nostalgie», implorant que lui soit versée «une heure / de bonne lumière d’aube d’avant le regard» (p. 169), puisqu’il nous faut, faisant le pari de n’être point compris sauf, peut-être, du jugement labile des générations futures, «traverser à gué ce fleuve d’ombre et de lumière, portant le deuil de notre transparence» (p. 20), ou encore puisque «nous portons en permanence le deuil d’une cohérence qui, à chaque instant, se compromet là, sous nos pas» (p. 48) et alors même, je l’ai dit, que nous sommes les hommes dont les cervelles sont remplies d’un peu de bourre, les hommes creux de T. S. Eliot tout autant que ceux de Broch et ceux de Benn commenté par Pierre Mertens : si le sujet qui était en nous a disparu, vers quoi se tourner, si ce n’est vers la forme (cf. p. 54), vers la cohérence secrète de l’Histoire sur laquelle, ma foi, aussi, tout comme sur Dieu, mais certes un Dieu contrefait, il faut parier ?
Gageons qu’avec Benn, la forme elle-même soit trouble, comme l’a compris Pierre Mertens, qui compare l’office du poète à celui d’une putain : «Guerrier démobilisé, médecin des pauvres, et poète stérile… Seule une putain, parce qu’elle est fille de la guerre, pourvoyeuse de fléau, et qu’elle se déshabille pour l’amour, comme le poète dénude – et travestit – les mots dans son poème, avec ce même mélange contre nature de vérité crue et de simulacre, oui, seule une putain, sans doute, peut entendre, ou peut feindre encore de n’être pas sourde…» (p. 223). Ailleurs, Pierre Mertens affirme qu’on ne «devrait écrire, aujourd’hui, qu’en trempant sa plume dans le pus» (p. 226), et c’est peut-être bel et bien dans cette source impure, l’entaille où le jus des cadavres qu’il a autopsiés s’est écoulé, qu’il a cru pouvoir chercher du nouveau.
Le Dieu de Gottfried Benn, tel que l’imagine Pierre Mertens tout du moins, est pour à l’évidence discret, rabougri, «Dieu nous manifestant toute sa complaisance ou bien faisant grève de Soi» mais «pour nous soulager encore, pour ne plus peser de tout son poids…» (p. 240), comme s’Il avait perdu tout pouvoir si ce n’est celui, de temps à autre et à condition que l’on cherche Ses traces, de disperser un rébus de signes subtils au revers de l’Histoire, comme quelque «inavouable récit» émietté qu’elle serait chargée d’écrire, «en secret, d’une main tremblante – et qu’elle cache sous l’autre, celui qu’elle avoue» (p. 117). C’est aussi un Dieu déficient, dans l’oreille sourde duquel il remettra sa foi comparée à un «vagissement» (p. 184) : «Il ne s’agissait pas tant, lui semblait-il, de discuter l’existence de Dieu que de relever le caractère énigmatique de ses façons d’être, l’opacité de sa présence au monde. Gottfried n’était encore qu’un enfant, mais il lui semblait cependant que Kant, Nietzsche, Weininger tenaient eux-mêmes, héroïquement, des propos puérils – si on les mesurait à l’aune de l’infernale complexité de la vie –, et qu’en même temps tous les secrets de l’univers retentissaient, néanmoins, dans un seul couplet d’une sirupeuse goualante, que s’exténuait à moudre un orgue de Barbarie, dans une arrière-cour de la Leipziger Strasse» (p. 86).
C’est sans conteste condamner le poète, tout grand poète à vrai dire, et justement parce qu’il est grand, à une impuissance essentielle plus ou moins cisaillée de cris, c’est le soumettre aux tentations (et pas seulement celles que lui offrent les putains, dont le portrait constitue quelques-unes des plus belles pages du roman de Pierre Mertens !) et à l’échec dans une époque elle-même ravagée car «C’est ainsi : nous Allemands, nous allons nous séparer les uns des autres par la façon dont nous aurons marqué notre territoire au royaume de l’erreur» (p. 272) (4). Mais, après tout, n’est-ce pas le prix, exorbitant sans doute, à payer, si l’on doit «apprendre à vivre avec son erreur, en tête à tête, comme le malade cohabite avec son cancer» et s’il «vient peut-être alors une heure où cette défaite importera moins que la façon dont on l’aura traversée» ? C’est alors, «au prix de ce tour d’écrou supplémentaire», que «notre âme sera de nouveau chevillée au corps qu’elle a failli trahir…» (p. 304), comme s’il fallait, en somme, se faire, monstrueusement, le réceptacle de l’erreur, s’enterrer vif, la bouche émergeant du sable, «pour s’ouvrir sur un cri silencieux» (p. 366), comme s’il fallait s’imaginer en bubon gorgé de pus mais le concentrant, l’empêchant de se diffuser dans le reste du corps qu’il empoisonnerait, cultiver, rimbaldiennement, sa propre monstruosité pour prix à payer des crimes s’étendant sur la terre allemande, au-delà de celle-ci : «Ceux que, parmi vous, cela fait sourire se souviendront, un jour, que je les en ai avertis : toutes les turbulences de notre vie se gravent au fond de notre enveloppe charnelle, et y déposent leurs sédiments» (p. 82), plongée en miroir d’une autre infection, cette fois-ci propre au langage ruiné, les mots se nourrissant les uns des autres, n’arrêtant plus, comme les ruines, de se reproduire (cf. p. 329), langage et monde de gravats et de pierres, verbe lui aussi ravagé par la guerre, Gottfried Benn rêvant selon Pierre Mertens «d’un langage qui se mettrait de lui-même en berne, et qui, pour renaître de ses cendres, se résoudrait à déposer d’abord le bilan de sa propre banqueroute» (p. 340).
Est-ce à ce prix terrifiant que le poète remarquable, ne serait-ce que parce qu’il fut cloué – tout de même moins réellement qu’un Ezra Pound – au pilori et «proscrit par le nouveau Reich» comme l’auteur l’écrit dans le court texte de présentation à son roman, ayant cherché «dans le vice et les orgies» «l’effritement et la dispersion même de soi qui lui assuraient d’échapper à la traque de ses poursuivants» (p. 83) et n’y étant apparemment guère parvenu, pourra «renouer avec la pureté d’un monde depuis toujours arrêté dans son premier matin», réconcilier, ainsi qu’un enfant ébloui par la lumière vivifiante trouant l’orage, «Hamlet et Apollon» mais aussi «mettre l’Orient en Occident» et «aller là où l’homme ne serait pas encore séparé de son épopée» (p. 224) ?
Notes
(1) Ce titre a paru au seuil, dans la collection Fiction & Cie du Seuil, en 1987. Sa version de poche, dans la collection Points est, comme il se doit, déparée par d’assez nombreuses fautes dont je n’ai pas vérifié la présence dans le texte d’origine. Signalons ainsi, parmi beaucoup d’autres erreurs, comme c’est de coutume dans l’édition française et toutes maisons confondues ou presque, hélas : on vitapproché et non «approche» (p. 94); Lasker-Schüler et non «Lasker Schüler» (p. 110); par-dessus et non «pardessus» (p. 143); sous les tilleuls et non «Sous les tilleuls» (p. 236); «Bertold Brecht et non «Bert Brecht» (p. 251; la même faute se répète à la page 415); il n’y a pas de point au milieu de la phrase «il ne le regrette au fond qu’à moitié» (p. 279); Mathias et non «Mathis Grünewald» (p. 314); vous amusâtes et non «vous amusâmes» (p. 315); remarquons la présence de plusieurs occurrences du verbe déposer ainsi que de l’adjectif intact dans le même paragraphe (cf. p. 335); Lise Kaul et non «lise Kaul» (p. 371); le et non «la mari» (p. 387) et, dans la même page, virgule à supprimer entre «des» et «babouins»; le et non «la vieil homme» (p. 389); Hölderlin et non «Hôlderlin» (p. 408); il la retient prisonnière et non «le» (p. 446), etc.
(2) Ainsi : «Allons ! dans les anneaux de l’abomination, les nœuds de la désolation, il nous est encore donné de voir se couler tant de merveilles, chargées de femelle séduction» (p. 373), ou bien : «on a fumé les années comme des mégots, en deux ou trois bouffées sans mémoire…» (p. 464). Ou encore, lorsqu’il est dit de Gottfried Benn qu’il est «un os jeté à l’Histoire, cette chienne, pour qu’elle se fît un peu les dents dessus» (p. 58). J’en cite une dernière : «Il y a une heure dans toute sa vie où l’on rencontre, désarmé, sa vérité nue telle une baïonnette qui viendrait de jaillir du fourreau» (p. 178).
(3) «Il m’a parlé d’Unter dem Vulkan, vous savez, ce chef-d’œuvre d’un Anglais qui se saoule au Mexique, à moins que ce ne soit le contraire ?» (p. 398, phrase dont la construction grammaticale n’est peut-être pas tout à fait claire, au demeurant, même si l’on imagine assez bien l’histoire d’un Mexicain se saoulant en Angleterre !).
(4) Et Pierre Mertens de citer, dans cette page ou dans d’autres, les noms d’Oswald Spengler ou des deux Enst, Von Salomon et Jünger.































































 Imprimer
Imprimer