« Réduction du domaine de Michel Houellebecq | Page d'accueil | Écoute notre voix, ô Seigneur... de Malcolm Lowry »
09/02/2022
Le Monstre de Stephen Crane, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Ben Pulletz (Siena Awards 2021).
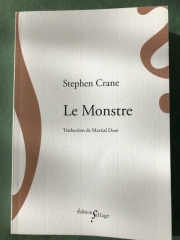 «En ces régions près de la mer la brume accompagne la tombée du jour et je me souviens d’avoir effrayé les enfants qui sortaient du pastorat.»
«En ces régions près de la mer la brume accompagne la tombée du jour et je me souviens d’avoir effrayé les enfants qui sortaient du pastorat.»Guy Dupré, Les Fiancées sont froides.
Lorsque Stephen Crane fait paraître Le Monstre (1) en 1898, il ne lui reste que deux ans à vivre. Il ne lui aura pas fallu plus d’une décennie pour remplir éperdument des milliers de pages et pour devenir un solide minerai de la littérature américaine. Récemment, d’ailleurs, Paul Auster lui a consacré une ample et belle biographie (2) où il redonne à ce prodige originaire du New Jersey une largeur d’épaules pleinement méritée. Celui qui fut journaliste à la ville comme à la guerre, poète et romancier, ami de Joseph Conrad et d’Henry James à la faveur de ses stations en Angleterre, celui-ci, ce jeune garçon que la mort attendait dans sa vingt-neuvième année au coin sud-ouest de l’Allemagne, ce Rimbaud du Garden State, donc, devait avoir une influence sur Ernest Hemingway et sur tant d’autres écrivains de sa patrie dont l’économie stylistique se justifie par la remarquable envergure d’une vision qui n’a pas besoin de simagrées pour frapper les sens.
Il n’y a pas de textes démesurément longs dans le répertoire de Crane, pas non plus de phrases filiformes, mais le torrent n’en est pas moins là, infatigable et redoutable, tonitruant déluge métaphysique emportant le lecteur dans une incroyable dimension de la connaissance universelle. Il ne semble pas qu’il existe un illustre problème de la vie humaine que Stephen Crane aurait manqué de poser ou négligé de soupçonner. Il a tant vécu avec la mort aux trousses que chacun de ses écrits fut pour ainsi dire le testament d’un enfant précoce impatient de nous révéler une partie de ses idées. Or quiconque a traversé le petit empan de sa longévité créatrice avec la mort pour meilleure amie a toujours eu plusieurs coups d’avance sur l’échiquier de l’expérience et de la compréhension du monde. En effet, quand on jette un œil rétrospectif sur l’existence d’une certaine jeunesse littéraire fauchée en plein vol par la maladie, le suicide, l’accident, l’homicide ou par toutes les versions de la tragédie que l’on voudra bien recenser, on s’aperçoit que le dernier jour de ces météores est la cause de tous les jours précédents, comme si la mort violente ou douloureuse, prématurée de surcroît, avait été constamment devinée, prédisposant ces futurs martyrs des agonies ingrates à s’infliger une espèce de martyre consonant parmi les inconfortables gradins de l’écriture la plus décisive. Un même anneau d’intuitions et d’urgence à les traduire en langage romanesque ou poétique unit donc Stephen Crane, Thomas Wolfe et Sylvia Plath sur sa périphérie, pour ne sélectionner ici qu’une trilogie d’identités flagrantes, un trio de vies américaines abrégées, un triptyque humain entièrement aiguillé par l’épreuve de la mort imminente et dont les livres sont de pures encyclopédies des grandes questions qui agitent l’honnête homme.
Avec Le Monstre, «la plus puissante et complexe de ses nouvelles» (3) selon Paul Auster, le génial Stephen Crane propose une courte mais intense radiographie de la mauvaise conscience de son pays. Le décor est planté au sein de la modeste cité fictive de Whilomville (New York), réplique imaginaire de Port Jervis où Crane a passé de nombreux moments de son enfance. L’histoire qu’il raconte serait inspirée par le lynchage d’un Afro-américain qui a endeuillé Port Jervis en 1892. D’autres sources évoquent la présence d’un groupe d’hommes défigurés dans cette même ville et souffrant d’une réprobation tacite. La désolation existentielle de ces malheureux aurait impressionné Crane. En outre, Paul Auster rapporte un événement de Port Jervis où deux vétérans de couleur, un 4 juillet de la fin des années 1870, ont été grièvement blessés à la suite d’un coup de canon festif qu’ils étaient chargés d’opérer. L’un de ces hommes a vite succombé à ses blessures mais l’autre a survécu, non sans être affligé de séquelles importantes au niveau du visage. Il apparaît ainsi que ces trois circonstances de la défiguration, qu’elles soient respectivement impliquées par le racisme, la nature ou le coup du sort, ont probablement semé dans l’esprit de Stephen Crane les semences de son propre monstre et surtout les compromettantes ramifications d’une société monstrueuse incapable de négocier avec ce qui bouleverse le socle janséniste de ses normes.
De sorte que le parcours d’Henry Johnson dans Le Monstre constitue la synthèse des persécutions physiques et psychologiques susmentionnées. Homme de couleur également, le personnage inventé ou reformulé par Stephen Crane cumule deux rameaux de la monstruosité, deux variantes d’une tératologie qui vont devenir absolument réciproques : d’une part il est déjà observé d’une manière latente comme un être contre-nature en raison de sa peau noire, et, d’autre part, la décomposition de son visage pendant un incendie va définitivement le reléguer parmi le camp retranché des disgraciés. La laideur morale induite par la couleur de sa peau sera calamiteusement homologuée par les conséquences de l’incendie qui a ravagé la maison du docteur Ned Trescott, son employeur et son protecteur. On a même la conviction que l’opinion n’attendait qu’une franche opportunité pour transformer la virtualité de sa haine vis-à-vis de Johnson en réelles manifestations d’hostilité. Les préjugés et les lois se sont délivrés de beaucoup de leurs hypocrisies en s’adossant aux réactions viscérales inférées par la transgression des lois de la nature. En d’autres termes, il a fallu que l’apparence physique d’Henry Johnson se dégrade subitement pour que la dégradation des mentalités se trouve un alibi en béton. Le dégoût indirect motivé par les préjugés racistes a rencontré son commode prolongement par le biais du dégoût direct motivé par un visage mutilé. Une aveuglante différence corporelle alourdit la charge d’une autre différence du même ordre (la peau noire) et légitime peu à peu l’inégalité devant les lois explicites et implicites sinon de toute une nation, du moins de toute une ville. Parce qu’il est noir et défiguré, Henry Fleming doit être logiquement inférieur à tous les étages de la société américaine. On ne le reconnaît plus en tant que citoyen dans la mesure où son visage a objectivement disparu. Et d’un point de vue subjectif, on ne reconnaît en lui que le monstre, on ne perçoit de lui que le contrevenant à toutes les lois juridico-naturelles, on ne voit que les agrégats d’une morphologie en lambeaux dont la calcination faciale a sévèrement compliqué la destinée de son propriétaire. Il n’est plus qu’un monstre au carré dont la situation sur Terre s’avère plus invivable que celle de John Merrick, l’Homme-Éléphant que le chirurgien Frederick Treves a émancipé de son infortune en 1886 en l’arrachant des griffes d’un forain qui l’exploitait comme phénomène de foire (4).
Cela dit, eu égard à l’une de ces coïncidences textuelles dont raffolait un W. G. Sebald et que d’aucuns auront déjà relevée, c’est aussi un médecin qui sauve en maigre partie – et passagèrement – Henry Johnson d’une totale extermination de sa mémoire et de son corps. Pourquoi du reste cet acharnement de Ned Trescott à vouloir préserver son misérable palefrenier de l’irréversible infamie qui s’est abattue sur lui avec la vigueur d’une foudre infernale ? Sans aucun doute parce que Johnson a sauvé l’enfant du docteur d’une mort assurée dans les flammes lors du terrible incendie. Mais il est indispensable de créditer ce médecin par d’autres voies que les simples et prévisibles actions de la gratitude. À l’inverse de tous ses voisins et même de sa femme, à l’inverse de tout un peuple qui ne parvient pas à digérer le vieux schisme de la guerre civile et le déplacement symbolique de la malédiction ségrégationniste au plus profond de sa conscience, le docteur Ned Trescott ne se laisse pas envahir par la majorité oppressive et par les survivances d’un nationalisme morbide. Il a sûrement compris que la monstruosité se dissimule ailleurs que sur la personne crucifiée d’Henry Johnson, d’autant qu’un médecin, de surcroît, conserve en général un calme olympien au contact des pires difformités. Ce qui est radicalement monstrueux, en fin de compte, c’est la conversion néfaste de l’héroïsme en nouveau péché capital, la destitution volontaire d’un acte courageux et la fabrication simultanée d’une mauvaise réputation, tout cela en vue de cacher les répugnantes exhalaisons d’une certaine conscience américaine. Dès lors, au lieu d’accuser frontalement un Noir d’avoir osé marcher sur les plates-bandes d’un héroïsme qui eût mieux convenu à un Blanc, la foule nourrit le prétexte du monstre afin d’entériner un rejet qu’elle n’avouera jamais précisément et à dessein de mieux s’exercer au pantomime d’un rejet charnel très arrangeant. On répète ici et là que Fleming effraie les enfants, les vieillards et toutes les âmes nobles à cause de son apparence ignoble, on construit un discours public accommodant avec les valeurs du troupeau fascisant, mais on ne désire nullement mettre en évidence la vérité potentielle de cette répulsion organisée. Peu d’entre ces gens ordinaires et si représentatifs de la banalité du Mal auraient eu l’audace de pénétrer dans l’enfer de l’incendie pour secourir un petit garçon promis à une mort atroce. Or il est inacceptable qu’un Noir ait eu l’impudence de réussir là où l’homme blanc de ces quartiers tranquilles eût vraisemblablement échoué.
D’une façon encore plus préoccupante, le comportement de la multitude rancunière tient de l’emprise, comme si la somme de ces individus était le reflet d’une parole négativement transcendante issue d’un Grand Inquisiteur dostoïevskien qui aurait emménagé en Amérique du Nord après avoir atomisé l’Espagne d’antan. Les notions de tolérance et de charité pourtant archi-communes aux églises américaines ont visiblement été remplacées par des dogmes qui menacent les fondations de l’humanité. Le bannissement qui touche Henry Johnson de plein fouet procède d’un renversement des piliers religieux et du renforcement d’un culte profanateur. Les rues et les demeures de Whilomville se sont possiblement détournées des repères sacrés de jadis (whilom and holy commitments) pour adopter un arsenal inédit de préceptes inhumains. Ce n’est pas tant que l’Église a disparu – car elle subsiste sous sa forme architecturale – mais elle paraît avoir détruit ses principes historiques au profit d’un fonctionnement sectaire et diablement épurateur. Le regard du Christ qui n’aurait pas omis d’embrasser une brebis égarée comme Henry Johnson s’est complètement éclipsé du centre et des faubourgs de Whilomville. Désormais ne se fomentent ici que des fausses communautés où la pratique religieuse a été dévoyée en stratégies de purification et en modèles politiques embryonnaires qui s’apprêtent à contaminer l’univers et spécifiquement la vieille Europe, toujours nostalgique de ses inquisitions, toujours hallucinée par les relents persistants de son trouble passé. Ce que l’on reproche à Henry Johnson, c’est son éclatante innocence, son mirobolant sacrifice, sa Croix érigée au milieu d’une capitale du ressentiment, et, pour cela, on lui prépare un second bûcher après le premier bûcher accidentel qui l’a estropié. Toutefois, ce que l’on souhaite par-delà l’imminente extermination de Johnson (que Crane ne décrit pas mais qu’il présage avec un sens inouï du signe annonciateur), c’est, indubitablement, un nuisible royaume de la masse, l’affirmation d’un grégarisme de la soumission aux pieds de l’Impuissance et d’un grégarisme de la répugnance envers toute réelle Puissance. À cet égard, on se rend tout à fait compte que l’homme noir, pour ces néo-fascistes de l’État de New York, cristallise l’ensemble des attributs de la lumière divine et qu’il est donc impératif de le discréditer au plus vite. Et bien qu’ils aient affaire à un homme noir défiguré et cognitivement diminué, celui-ci n’en est que davantage haï du fait même que ses afflictions renvoient nécessairement à l’élévation, à la gloire, à la promesse d’un relèvement dans l’œil omniscient de Dieu.
Il est par conséquent facile de comprendre que cette chronique locale mise en scène par Stephen Crane déborde la sphère géographique d’une bourgade ordinaire de l’État de New York et qu’elle investit un champ de problèmes philosophiquement vertigineux. À lui seul, le personnage d’Henry Johnson est une dialectique de la persécution et une éventuelle résurrection du Christ. Quant aux insistances du docteur Ned Trescott, elles se développent à l’instar d’un baroud d’honneur, d’un refus provisoire de capituler, preuve que la démocratie en Amérique ne s’est pas encore totalement changée en citrouille ou en despotisme visqueux. En outre, les tensions relatives au poumon urbain de Whilomville semblent héritées d’une matrice européenne peu reluisante, une matrice incubée depuis la construction de la nation américaine au XVIIIe siècle et relancée selon des tropismes autochtones inséparables de la Guerre de Sécession, une matrice, finalement, déployée sur plusieurs décennies hantées par le spectre de l’esclavage légal ou excusé, aboutissant aux plus abominables et irrémédiables désunions sous le patronage d’un concept unioniste captieux. C’est la raison pour laquelle les scandaleuses étapes de la répudiation d’Henry Johnson sonnent en quelque sorte le glas de l’Amérique et anticipent le retour de ce Mal matriciel sur le Vieux Continent, comme si la cité de Whilomville avait fait l’objet d’un jumelage politique avec d’anciennes cités espagnoles et que le ténébreux résultat de cette alliance durable, culminant avec le triste dénouement sous-entendu par Stephen Crane, s’apprêtait à migrer séance tenante sur le territoire européen pour féconder cette terre babylonienne en usant d’un sexe démoniaque et parfaitement aguiché.
Notes
(1) Stephen Crane, Le Monstre (Éditions Sillage, 2021), traduction de Martial Doré.
(2) Paul Auster, Burning Boy.
(3) Ibid.
(4) Frederick Treves, Elephant man. C’est à partir de ce récit que David Lynch a bâti son film éponyme.




























































 Imprimer
Imprimer