« La langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd'hui de Frédéric Joly | Page d'accueil | HOWL d’Allen Ginsberg : nouvelle traduction par Gregory Mion »
01/09/2023
La folle semence d’Anthony Burgess : présomptions autour d’une certaine obsolescence ayant trait à certains hommes, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Idrees Mohammed (EPA).
 Anthony Burgess dans la Zone.
Anthony Burgess dans la Zone. Sur La folle semence.
Sur La folle semence.«Une grosse goutte de sperme de bougie se solidifiait sur sa poitrine.»
José Lezama Lima, Paradiso.
«Sur le sol fertilisé qu’on n’aurait même pas besoin d’ensemencer, à qui il suffirait de montrer une graine de coton pour qu’il se mette tout de suite à produire, à germer.»
William Faulkner, Si je t’oublie, Jérusalem.
«Je cherche un homme.»
Diogène de Sinope.
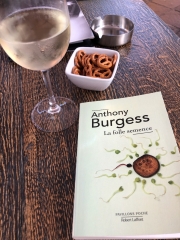 Dans l’œuvre profuse et parfois inégale d’Anthony Burgess, la futurologie qui pouvait amuser le lecteur de La folle semence (1) pendant les années 1960 mérite aujourd’hui une attention particulière et beaucoup moins distrayante. Bien sûr cette attention doit être portée au sujet principal de ce truculent roman de science-fiction – la surpopulation exponentielle et démentielle – mais elle doit également être étendue à toute une série de problèmes qui concerne le penchant de notre humanité à résoudre ses crises par des réponses toujours plus techniques ou technocratiques, et cela, d’une manière de plus en plus préoccupante, décourageante, exaspérante, fait ressortir des remèdes qui s’avèrent pires que les maux qu’ils sont censés combattre. Du reste, et l’on nous accordera cette banalité, ce n’est pas un surcroît de moyens artificiels qui pourra nous permettre de renouer un lien approximatif avec les évidences naturelles, car, cela va de soi, le niveau d’éloignement que nous avons désormais atteint vis-à-vis de la Nature ne permet pas de penser autre chose qu’une approximation dès lors que nous songeons à un hypothétique replâtrage de nos relations avec le monde vivant ou le monde non-humain des animaux, des végétaux et des minéraux. Autrement dit, au fur et à mesure que nos civilisations avancent dans l’Histoire, elles perdent semble-t-il le contact avec l’esprit de la Nature et elles s’enferment dans une certaine brutalité de la Matière, devenant ainsi cette espèce de Troupeau aveugle imaginé par l’écrivain d’anticipation John Brunner au début des années 1970, à savoir une sorte de masse grégaire contaminée par la croyance unidimensionnelle et forcenée envers le progrès technique, triste homogénéisation des mentalités qui aboutit d’une part à une destruction accélérée de l’environnement, et, d’autre part, à des sociétés qui vivent contre leurs intérêts tout en prétendant mieux vivre. Et c’est John Brunner encore, six ans après Anthony Burgess, qui s’interroge sur le phénomène spécifique du surpeuplement de la Terre dans Tous à Zanzibar (1968), poussant jusqu’à son paroxysme les éléments catastrophiques abordés ou esquissés dans La folle semence, notamment la multiplication des famines et des guerres, ces dernières étant, pour l’auteur de l’inoubliable Orange mécanique, le sujet à la fois central et ambigu de son livre, l’inquiétant et grandissant bruit de fond meurtrier, diversement fatal nous le verrons, supposé réguler toute planète en proie aux difficultés inhérentes à l’overcrowding.
Dans l’œuvre profuse et parfois inégale d’Anthony Burgess, la futurologie qui pouvait amuser le lecteur de La folle semence (1) pendant les années 1960 mérite aujourd’hui une attention particulière et beaucoup moins distrayante. Bien sûr cette attention doit être portée au sujet principal de ce truculent roman de science-fiction – la surpopulation exponentielle et démentielle – mais elle doit également être étendue à toute une série de problèmes qui concerne le penchant de notre humanité à résoudre ses crises par des réponses toujours plus techniques ou technocratiques, et cela, d’une manière de plus en plus préoccupante, décourageante, exaspérante, fait ressortir des remèdes qui s’avèrent pires que les maux qu’ils sont censés combattre. Du reste, et l’on nous accordera cette banalité, ce n’est pas un surcroît de moyens artificiels qui pourra nous permettre de renouer un lien approximatif avec les évidences naturelles, car, cela va de soi, le niveau d’éloignement que nous avons désormais atteint vis-à-vis de la Nature ne permet pas de penser autre chose qu’une approximation dès lors que nous songeons à un hypothétique replâtrage de nos relations avec le monde vivant ou le monde non-humain des animaux, des végétaux et des minéraux. Autrement dit, au fur et à mesure que nos civilisations avancent dans l’Histoire, elles perdent semble-t-il le contact avec l’esprit de la Nature et elles s’enferment dans une certaine brutalité de la Matière, devenant ainsi cette espèce de Troupeau aveugle imaginé par l’écrivain d’anticipation John Brunner au début des années 1970, à savoir une sorte de masse grégaire contaminée par la croyance unidimensionnelle et forcenée envers le progrès technique, triste homogénéisation des mentalités qui aboutit d’une part à une destruction accélérée de l’environnement, et, d’autre part, à des sociétés qui vivent contre leurs intérêts tout en prétendant mieux vivre. Et c’est John Brunner encore, six ans après Anthony Burgess, qui s’interroge sur le phénomène spécifique du surpeuplement de la Terre dans Tous à Zanzibar (1968), poussant jusqu’à son paroxysme les éléments catastrophiques abordés ou esquissés dans La folle semence, notamment la multiplication des famines et des guerres, ces dernières étant, pour l’auteur de l’inoubliable Orange mécanique, le sujet à la fois central et ambigu de son livre, l’inquiétant et grandissant bruit de fond meurtrier, diversement fatal nous le verrons, supposé réguler toute planète en proie aux difficultés inhérentes à l’overcrowding. En butte aux dangers de la surpopulation mondiale et aux mêmes problématiques exacerbées sur le territoire de l’Angleterre, le gouvernement britannique mis en scène par Anthony Burgess donne les pleins pouvoirs à un Ministère de l’Infertilité qui applique sans trop de pudeur morale une biopolitique aux méthodologies douteuses. Il faut évidemment se référer à la philosophie de Michel Foucault (2) pour comprendre l’ampleur d’une politique de la vie, au sens où, d’abord, une telle politique est toujours contemporaine d’une prépondérance du rôle dévolu aux médecins et où le savoir médical va nourrir d’une façon croissante les décisions propres au champ du pouvoir. Il s’agit d’un moment politique où la vie collective est susceptible de basculer dans un ordre de gestion redoutablement prophylactique, un ordre de manutention des libertés, finalement, où les individus sont constitués en tant que multitude statistique devant répondre à des catégories sanitaires précises, un ordre de structuration de l’extériorité de la vie qui s’unit à un insidieux modelage de l’intériorité de la vie dans la mesure où un excédent de paramètres médicaux envahissant les espaces public et privé s’achemine le plus souvent vers un excédent d’hygiénisme moral – un puritanisme exorbitant. L’objectif affiché ou caché d’une telle politique est de constituer une nouvelle distribution du pouvoir où l’État et la science médicale se préoccupent moins des aspects législatifs (le temps long de l’élaboration des lois) que des aspects exécutifs (le temps court d’une exécution des lois) censés promouvoir des normes régulatrices faisant force de loi. Pour le dire schématiquement et même polémiquement, une biopolitique, donc, relève toujours d’un lourd interventionnisme du pouvoir et de la médecine combinés afin d’investir – quelquefois jusqu’à la saturation – toutes les dimensions de la vie avec tous les dispositifs et les calculs imaginables pour y parvenir au plus vite. L’enjeu est de contraindre, de délimiter, de configurer, voire d’officialiser ce que Gilles Deleuze nommait à juste titre des sociétés de contrôle (3), et, partant de là, de légitimer un mode d’existence davantage collectif qu’individuel, un espace commun où chacun sera reconnu pour autant qu’il appartiendra totalement et axiomatiquement aux critères élaborés par l’État gestionnaire de la vie. Telle est à peu de choses près la situation décrite par Anthony Burgess à travers les actions du Ministère de l’Infertilité où la natalité et la dénatalité sont devenues les points dialectiques essentiels à l’exercice du pouvoir, et telle fut, ou telle est encore, la situation de notre monde à l’ère de la médiocrité administrative universalisée, à l’ère d’une bureaucratie tentaculaire et quasi soviétiforme où des hommes creux, des ombres d’hommes chargés de l’obscur maniement de milliards d’ombres dociles, ont décidé de semer les ténèbres sur la Terre en se fiant délibérément à la Machine et à ses Algorithmes pour régenter une pandémie.
L’arsenal des moyens qui servent à normaliser bien davantage qu’à légiférer une société ne serait en outre pas complet si l’on oubliait de mentionner les nombreux expédients qui ont pour vocation d’inciter à se comporter de telle ou telle manière. Il n’est pas question d’agir immédiatement sur les peuples en leur assénant une série d’injonctions parées des pompeux attributs de l’autorité scientifique, mais de les modeler médiatement, d’insinuer dans les consciences – pour peu qu’elles veuillent être réceptives – un genre de catéchisme redondant, un refrain moralisateur qui se revêt des apparences de la préconisation et qui se transforme petit à petit en discours dogmatique une fois qu’il est métabolisé par l’opinion consentante. Ce sont ni plus ni moins les méticuleux procédés du nudge (ou de la théorie dite du paternalisme libéral) que nous avons vu déferler massivement lors de la récente et toujours actuelle hystérie sanitaire (car l’on ne se remet pas in one fell swoop et sans dommages profonds de plusieurs années d’impudente bêtise). Ces procédés jalonnent le terrifiant – et même énervant – ouvrage d’Anthony Burgess tant sa redécouverte à l’aune de nos assujettissements ne peut que tirer une sonnette d’alarme pour les moins assujettis d’entre nous. En face de tant de sournois concassement des libertés, selon toute probabilité complice d’un désir de la population générale qui préfère sûrement qu’on lui fixe le mors aux dents et qu’on l’empêche de cavaler, on pense inéluctablement au caractère inédit de ce que Tocqueville exprimait en décrivant la nouvelle génétique de la démocratie, sa version moderne, distincte de sa version ancienne en cela qu’elle est moins l’apanage d’un net processus institutionnel transcendant que le fruit d’un nébuleux et graduel immanentisme opérant sur «la substance même de l’humain» (4). L’ambition démocratique ne consiste plus alors à fonder une isonomie parfaitement identifiée, une égalité devant la loi rigoureusement instituée, voire une aristocratie de législateurs dévoués à l’organisation perfectionniste de la Cité, mais elle consiste à promouvoir obliquement une égalité de tout le monde jusqu’aux plus intimes configurations de l’âme (à supposer qu’une âme puisse résister aux assauts d’un égalitarisme détruisant toutes les formes de la singularité). De là émerge une volonté générale non souveraine et se pliant à une volonté floue qui serait la volonté du nouvel esprit démocratique, et, ainsi, au sein même d’une conjoncture de type démocratique, jaillit l’effet pervers d’une tyrannie de la majorité qui oppresse toute minorité désobéissante ou en attente de conversion à l’uniformité ambiante et aux divers nivellements impliqués par un tel régime de la monotonie anthropologique.
On comprend donc que l’Angleterre modélisée par le flamboyant imaginaire d’Anthony Burgess relève moins d’une ordinaire tyrannie ou d’un ersatz de dictature que d’une rampante démocratie dévoyée par un peuple qui a certainement voulu ce qui lui arrive et dont la volonté affaiblie se trouve dorénavant instrumentalisée par un gouvernement qui n’en demandait peut-être pas tant. Par conséquent, tenant compte de ce qui est élucubré par Burgess et aussi troublant et illisible que cela paraîtra pour les cerveaux lavés à l’eau usée de la social-démocratie de notre temps, les campagnes publicitaires explicites ou implicites, les plaidoyers directs ou indirects et toutes les autres allocutions propagandistes faisant l’apologie réelle ou symbolique de l’homosexualité dans La folle semence, toutes ces occurrences de la défense et de l’illustration d’une affinité sexuelle affleurent comme l’embarrassante révélation d’un peuple d’Angleterre sinon efféminé (c’est-à-dire dépourvu des virilités nécessaires aux révolutions vitales), du moins s’accommodant de toutes les idéologies antinatalistes, ceci, assurément, du moment que les accommodements garantissent à ceux qui les adoptent des opportunités plus concrètes qu’à ceux qui ne les adoptent pas ou qui ne sont pas encore prêts à les adopter parce qu’ils ont éventuellement la chance – pour l’instant – de ne pas avoir enduré le sentiment de l’asphyxie psychique dérivant d’une société malade de la démocratie. Tirons ainsi ex abrupto une conclusion plus que provocatrice : si le contexte d’urgence raconté par Anthony Burgess à l’égard de la surpopulation dépend moins d’une raison d’État verticale que d’une raison populaire qui fonctionne horizontalement avec l’État, alors il se peut que la surpopulation ne soit qu’une chimère entretenue en amont et en aval, en haut et en bas, un épiphénomène à l’échelle de la Nature virtuellement prolifique en ressources, une thématique intentionnellement surexploitée qui tend à indiquer et à satisfaire un égoïsme aussi exponentiel que lamentable – l’égocentrisme de l’homme vidé de toute faculté de réflexion et de toute sensibilité, soustrait de toute projection de lui-même dans une descendance qui pourrait le cristalliser, l’amener à élargir ses perspectives, à se dépasser, à créer ou procréer plutôt qu’à produire ou à se démener platement pour monter en grade, autrement dit le nombrilisme national et international (puisque le reste du monde est à l’avenant de la tragique Angleterre inventée par Burgess) d’une humanité d’arrivistes pressés qui n’est plus capable de croire à son prochain et qui de ce fait se punit spirituellement autant qu’esthétiquement, engagée dans une existence délestée de Providence et de pratique d’un goût supérieur qui permettrait d’aller au-delà de soi-même, une existence, misérablement, qui s’intéresse davantage aux favoritismes de l’homosexualité authentique ou empruntée plutôt qu’aux vérités potentielles de la prière ou aux édifiantes propriétés de l’art de vivre et de l’art en tant que tel. En définitive, tout est devenu affaire de conformation aux tropismes dominants, et, partant de là, s’il fallait soudainement renier la mouvance homosexuelle pour s’égaliser ou s’atomiser dans une mouvance zoophile, on verrait le commerce des animaux tutoyer les meilleures cotations de la Bourse et l’on se féliciterait passablement de cette stratégie dé-nataliste pourvu qu’elle accomplisse sa députation de panurgisme.
Il semblerait alors que le tempérament de l’homme anglais et par extension de l’homme générique – à condition que l’on accepte de valider notre précédente hypothèse à propos de ce roman décidément surprenant bien qu’irritant – ne soit qu’un tempérament de scélératesse où chacun n’a de prérogative que la prérogative d’arriver à l’intérieur d’une entreprise mondialisée de l’arrivisme le plus significativement stérile. Et Anthony Burgess ne manque pas de cynisme lorsqu’il multiplie les circonstances de promotions actées ou promises dès lors que les titulaires ou les postulants du social upgrade se régalent d’avoir joué le jeu des valeurs uranistes ou lesbiennes. Quant à ceux qui seraient positivement des membres de l’équipe gay, ils ne sont socialement gratifiés qu’en fonction de l’arbitraire d’une démocratie asservie aux prédilections matricielles et variables du troupeau, ne s’apercevant pas que les inclusions d’aujourd’hui ne sont probablement que les exclusions de demain, ou que les exclusions du jour seront les inclusions du lendemain, ne s’apercevant pas, vraiment pas, que les ségrégations résolues ne sont que des conventions issues de volontés irrésolues car influençables aux futures crispations de la masse, ne s’avisant pas, en dernier ressort, d’une navrante et trompeuse succession de bienveillances qui dissimulent toujours de véritables manigances pour réussir (mais pour réussir quoi, dans la fiction d’Anthony Burgess, sinon l’ascension sociale accélérée, synchronisée à la solitude et au mensonge presque systématiques, à la misère de vivre, concomitante à la raréfaction des familles, des convivialités, des différentes chaleurs humaines et ce faisant ajustée à la froide abondance de l’individualisme ?). Et s’il fallait que ces hommes et ces femmes pour la plupart opposés à leur nature intrinsèque – et agissant de la sorte contre la Nature mais pour une Culture de l’Arrivisme – allassent jusqu’à s’alimenter avec des aliments synthétiques, ne fût-ce que pour participer d’une mythologie collective de la surpopulation induisant des sacrifices nutritifs et ne fût-ce que pour s’arranger avec les litigieuses démarches consistant à s’agréger coûte que coûte aux grégarismes les plus payants, alors il va de soi que ces hommes et ces femmes seraient prêts à exister comme dans le film Soleil Vert mais sans les réalités afférentes à cette histoire de fous originellement scénarisée par Harry Harrison. C’est précisément d’ailleurs ce dont il pourrait être question dans cette aberration romanesque concoctée par le subtil et industrieux Burgess si l’on faisait crédit à nos extravagants raisonnements. Qu’on s’entende bien cela dit : nulle part dans son livre Anthony Burgess ne laisse expressément se développer la croyance que tout ce qui se trame relativement au surpeuplement de la planète serait une illusion, mais, subrepticement, progressivement, il installe une interrogation qui va rencontrer une désarmante réponse, laquelle, avouons-le, dépasse notre provocante supputation d’une Démocratie de Carriéristes dupés par eux-mêmes et par les relais d’un pouvoir politique heureux des facilités de gouverner une foule dont les désirs seraient standardisés à outrance.
Quoi qu’il en soit de ces cogitations antécédentes, elles traduisent, dans le sillage alarmé de Burgess, les preuves tangibles d’une irrésistible décomposition de l’humanité où chaque individu ou presque a égaré son hétérogénéité féconde au cœur d’une homogénéité inféconde. Même la mort des enfants ne fait plus l’objet d’un deuil approprié ou d’une émotion au minimum proportionnée car le Ministère de l’Infertilité valorise à présent les décès en bas âge et négocie le recyclage de la matière inerte organique (les jeunes cadavres) en matière inerte inorganique (les aliments de synthèse). Les condoléances ne sont plus que des formules réglementaires et elles sont complétées par des assignats qui seraient scandaleux s’ils n’étaient entrés dans les mœurs. À quoi bon dans ce cas gaspiller sa semence pour concevoir des enfants qui se réduiraient désormais à des entraves sociales s’ils devaient persévérer dans l’être ou qui se résumeraient à des compensations financières anecdotiques s’ils devaient mourir ? On est même étonné que Burgess n’ait pas écrit un chapitre où l’onanisme eût été ouvertement encouragé, où les bibelots sexuels eussent été commercialisés à profusion, encore que, dans un sens, toute cette pathétique unanimité à l’endroit des normes de stérilisation n’est que le révélateur ultime d’une Terre échouée dans les pratiques masturbatoires les plus mécaniques et les plus dépourvues d’imagination (l’amour à deux s’étant même effondré en échange intransitif ou en désagréable clandestinité). Aussi la disparition des indices objectifs qui servent à homologuer la présence d’une réelle condition humaine ne peut que s’affirmer d’abord à travers la mort du sexe, à travers également la criminalisation latente et patente du partage des fluides intimes, ensuite à travers la mort de toute différence ou de toute intensité dans la différenciation puisqu’il est impératif – ou du moins de bon ton – de rechercher à prolonger pour chaque protagoniste un destin de Partie obstinément soudée au Tout de la masse démocratique.
En cela, il faudrait même signaler une mort de la mort, une indifférenciation du passage de vie à trépas qui s’étend bien au-delà de l’indifférence entourant la mort des enfants, et cette impiété s’explique forcément parce que la vie n’est plus une vie, parce que la vie que Burgess dépeint n’est plus qu’une agglutination de morts-vivants qui vont et qui viennent dans une très basse fréquence existentielle, comme s’ils étaient perpétuellement téléguidés par un je-ne-sais-quoi d’attraction invisible, par ce que Burgess appellerait volontiers les puissances des ténèbres eu égard au titre de l’un de ses plus grands romans (5), lequel grand roman, du reste, réinvestit le motif de l’homosexualité, tout comme il revient sur le débat spirituel qui oppose le pélagianisme et l’augustinisme s’agissant de l’étude des nuances des perfections de la liberté, débat de haute voltige qui hante les pages liminaires de La folle semence et beaucoup d’autres livres de l’écrivain, controverse théologique pour le moins déconcertante, admettons-le, étant donné qu’elle intervient fréquemment dans des climats littéraires où toute liberté se voit largement sujette à caution. Tout ceci pour poser, en fin de compte, qu’un monde qui parle de liberté à tort et à travers ou avec une pédanterie de docteur de l’Église mal dégrossi est souvent un monde servile, de la même manière qu’un monde qui a fait de la vie une vie de mort est devenu un monde immonde, et, dans de telles conditions d’impossibilité d’attester d’une condition de possibilité humaine sur le long terme, nous ne pouvons que déplorer ce que Günther Anders nommait une «obsolescence de l’homme», c’est-à-dire que nous nous trouvons confrontés à un monde où il n’est plus du tout conseillé de perdre son temps à espérer que les choses redeviennent subitement humaines, mais où il faut seulement espérer «que continue d’exister un monde» (6), un succédané de ce que l’on pourrait identifier comme une surface planétaire habitable et encore supportable, un sursis, en somme, avant que tout ne soit emporté par la sottise mondialisée ou un cataclysme nucléaire (ce qui revient finalement au même).
Ne nous méprenons pas cependant sur les causes qui président à la dévastation du monde malgré les minces poches de révolte que l’on voit surgir dans les angles morts de quelques vies réfractaires adroitement brossées par Burgess, et, surtout, ne nous laissons pas éblouir par les rares glorificateurs de la gloire de Dieu et des textes sacrés : si la vie s’est écroulée dans la mort, si la mort s’est invitée dans la vie en de désolantes pantomimes, si les intelligences ont été aplanies par le rouleau compresseur de la masse qui a retiré aux individus la capacité de penser, si les dialogues ont l’air possédés d’une platitude qui vérifie tragiquement la déperdition du langage, c’est que, au préalable, toute velléité spirituelle se retrouve contestée au profit d’un système de représentions qui élimine a priori la moindre aspiration métaphysique ou la moindre tentation poétique. D’où la promotion des solutions techniques et la relégation des solutions proprement humaines, d’où cette recrudescence du malaise que l’on ressent à la lecture, cette oppression accrue pour les derniers des Mohicans de l’ancienne humanité bientôt destituée, cette confirmation que nous sommes (en tant que «nous» projeté dans les personnages) maintenant condamnés à vivre dans un monde mort où ne subsistent que d’infimes poches de vie, alors que jadis, lorsque des âmes étaient encore établies dans des corps et que l’Histoire avançait parfois mortellement, nous vivions dans un monde paradoxalement vivant qui n’était obstrué que par d’infimes poches de mort. Car ce qui fait la mort au premier chef, ce ne sont pas les batailles de Verdun ou les massacres du Moyen Âge, ce sont, tout au contraire, les attentats promulgués contre l’intériorité, ce sont les décrets qui «[vont] droit à l’âme» à dessein de la dissoudre tandis que l’âme, lorsque le corps est malmené ou lorsque les corps sont par exemple agrégés en bataillons pour aller à la guerre, peut encore se tenir «glorieuse au-dessus» (7) de la matière corporelle si elle détient une suffisante épaisseur d’énergie divine. Par conséquent, ce que relate Anthony Burgess dans sa dramatique fable des abstinents ou des anesthésiés, c’est une forme d’abrogation du devenir historique de l’homme aggravée par une haine logique du surnaturel dans la mesure où le dessèchement des âmes détruit toute espèce d’amour de la transcendance. Et s’il y a un désamour de ce qui est susceptible de dépasser l’homme (car la multitude abjectement démocratique détesterait qu’une tête dépasse et par-dessus tout que la tête de Dieu prenne la tête de la société), alors, forcément, il y a un désamour généralisé qui s’ensuit, un démantèlement de l’Amour considéré dans son essence, un monde où une paix superficielle règne parmi les décombres d’une guerre larvée, où le risque de la rencontre est diminué voire supprimé, où l’Histoire subit une stagnation, pendant que tout le monde s’exècre et s’isole, se corrompt dans les méandres des jalousies mortifiantes, s’annule en tant que subjectivité active afin de réapparaître dans le troupeau en tant que subjectivité passive, ne souhaitant que des reconnaissances factices sur une échelle de Jacob inversée, sur une échelle où ne montent et ne descendent que les froids démons du conformisme. Il n’est pas étonnant, ainsi, que les univers mentaux rapportés dans La folle semence soient pour la majorité conditionnés à rejeter toute existence de Dieu, à refuser tout adossement à un culte édificateur, sinon au culte de la masse, à la religion de la foule, à l’idolâtrie d’une figure tutélaire baptisée «Gueux» et qui – Gueux merci ou loué soit Gueux ! – restructure la multitude avec les pires narcotiques délégués à l’endoctrinement des esprits.
Et pourtant, en dépit de ce sinistre amortissement des émotions, des sensations et de la participation à la dynamique du devenir, la guerre se prend à occuper un terrain de plus en plus vaste, passant d’un état larvaire de concurrence dans l’imposture à un état complexe d’apparente régulation des effectifs humains superflus. Tant et si bien qu’on ne fait plus la guerre pour des arguments recevables ou fallacieux liés à l’impénétrable turbulence cosmique de l’Histoire, mais on la fait pour légitimer une solution finale de la surpopulation, ou, plutôt, on la fabrique en lui assignant une écorce historique en vue de camoufler la sève d’un pur assainissement démographique. Mais comme tout est simulacre dans ce roman qui pourrait avoir été écrit par le génial et paranoïaque Philip K. Dick, même l’enjeu démographique est recouvert d’un voile, d’une cuticule de secret, d’une énigme discrète. Pour autant ce n’est pas le nouveau Ministère de la Fertilité qui fera illusion auprès des plus éclairés au milieu de ce despotisme des aveugles. En effet, de prime abord, s’il existe un Ministère de la Fertilité, c’est d’une part pour laisser croire que les économies de l’Infertilité sont terminées, et, d’autre part, c’est pour laisser penser que la guerre va engendrer une mortalité qu’il faudra vite contrebalancer par un supplément de natalité. Or c’est exactement là que les événements commencent à prendre une tournure tout à fait abominable et que l’intrigue de Burgess touche à son apogée : toute masse démocratiquement consolidée par l’immanence d’un égalitarisme d’eunuques et de soubrettes n’en est pas moins gouvernée par des chefs dont les yeux et les oreilles, certes dirigés dans la masse pour ne pas perdre une occasion de démagogie, peuvent à tout moment faire une crise et se mettre à voir et à entendre autre chose que les doléances populaires. Ce qui se produit alors, c’est que, cyniquement, terriblement, les procédures de la conscription semblent appeler sous les drapeaux un certain segment de la population, le segment pour ainsi dire le plus démocratique, le plus atomisé, le plus défavorisé en termes d’esprit critique, mais le plus massifié, le plus innombrable et in fine le plus encombrant. C’est pourquoi il apparaît que dans les hauts lieux du pouvoir – qui n’étaient jusqu’ici que les appendices de la multitude – a pu se décider ou se décréter que la masse devait être diagnostiquée comme appendicite de ses appendices et qu’il fallait de la sorte se livrer le plus rapidement possible à une appendicectomie.
Ce n’est rien d’autre évidemment qu’une politique génocidaire qui ne dit pas son nom car elle se protège sous de multiples couches de simulacres et sous la pesante membrane d’une foule toujours plus mûre pour répondre à l’appel d’un faux-semblant de mobilisation générale. On peut même évoquer la mise en place d’une doctrine eugéniste où les actionnaires maléfiques d’une crypto-aristocratie (pseudo-aristocratique au demeurant) fondus dans le gras démocratique s’amusent à préparer un monde où leurs enfants seuls respireront pendant que les autres continueront de mourir asphyxiés par une société qui leur fait maintenant la guerre sur tous les plans. Rien de nouveau sous le soleil, au fond, hormis la mise en pratique d’une tuerie de masse – d’un génocide de la masse – qui se substitue aux lenteurs d’une éradication détournée par des voies strictement sociales. Il s’agit en outre du seul et de l’unique Grand Remplacement qui vaille la peine d’être signalé (le Grand Remplacement de type racial n’étant qu’un fantasme d’imbéciles dont la crapulerie se soulage dans la crapulerie du calamiteux Renaud Camus et dans les miteuses visions de Jean Raspail) : ce sont toujours les maîtres de la pulsion de mort qui développent une aversion à l’égard de tout ce qui incarne la pulsion de vie, fût-elle contenue comme promesse d’éclosion dans une masse, et, en toute rigueur, le bourgeois ou l’homme d’argent étant la créature la plus vile qui puisse exister, la plus momifiée, la plus létale, cette créature est chaque fois représentative de ces prédicateurs de la mort qui ne tolèrent pas les défis lancés par la vitalité ou par l’élan christique des mendiants. En tout état de cause, donc, s’il existe un Grand Remplacement, que ce soit dans le roman d’Anthony Burgess ou dans notre monde actuel, il ne peut être qu’un Grand Remplacement d’ordre énergétique et supervisé par les dominants, une vengeance de l’énergie noire contre l’énergie blanche, et, conséquemment, ce Grand Remplacement ne peut être qu’un infâme effort pour remplacer la vie par la mort, pour écraser la lumière, pour piétiner la beauté, pour renverser les valeurs naturelles et imposer les valeurs arbitraires des adorateurs fortunés de l’artifice, de tous les artifices, pour justifier un libertinage envers tout ce qui est faux et un jansénisme envers tout ce qui est véridique.
Quelle issue de secours envisager pour se sortir de ce marasme ou de cette géhenne ? Quelle corde jeter à l’eau de toutes nos forces pour récupérer le navire de la civilisation en détresse ? Un indice nous est fourni par Anthony Burgess à la toute fin de La folle semence quand il reprend un vers célébrissime du Cimetière marin de Paul Valéry : «Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre !» Le choix de la fulgurance poétique assorti de l’impalpable rafale de l’air suggère peut-être le retour ou ne serait-ce que le souvenir fondamental des climats côtiers du Royaume-Uni, tel un genre d’imploration rhapsodique des puissances primitives, telle une supplique adressée aux nerfs aériens qui ponctuent la mystérieuse motricité des falaises, des criques et des rivages, telle une sommation qui exigerait de la masse amorphe un prompt dispersement du troupeau afin que chacun se souvienne de ce pays de vent et d’infinité marine et s’avive «d’eaux réjouies» (8) après avoir enduré les glaciations de l’Être et les catalepsies de l’organisme. Est-ce à dire qu’il faille classiquement revenir à cette idée un peu éculée qui consiste à habiter le monde en poète pour guérir d’avoir été trop longtemps inanimé ou apatride de la vie ? L’ensemble des mentions de la mer nous autorise cette lapalissade, la mer adjurée comme allégorie de la purification, la mer, encore, interpellée comme signe du mobilisme universel héraclitéen et comme grouillante signature de la fertilité. Il est indispensable à ce stade de nettoyer la scène de crime de l’Angleterre triviale, prosaïque, bourgeoisement défaite, mutilée, dévalorisée, pour instaurer à la place de cette Monarchie des Macchabées une alternative des poètes, un Empire des Parnassiens, une résurrection de l’homme ensemencé de poésie. Aucune espèce de mafia des philistins ne saurait perdurer si l’on concédait à nos sens la permission de discerner ces maquisards qui attendent l’heure de renverser les tables, l’heure de détrôner ceux qui font tourner les tables pour étendre le règne du Mal, ces dissidents sublimes que le guide – notre guide à tous – Armel Guerne appelait si justement les «divins voyous de l’amour» (9). Et puisque le vent n’a jamais rompu sa course pour ceux qui n’ont pas été séquestrés par eux-mêmes davantage que par un tyran, pour ceux qui n’ont pas succombé à la morale du troupeau, puisque la ténébreuse Angleterre de Burgess comptait encore en ses rangs quelques rarissimes porteurs de lanterne, alors, à l’unisson de ces sentinelles qui fendent bravement la nuit, remémorons-nous la voix du vent et du déchaînement, la voix qui délivre, la voix qui conjure les sérénités qui tuent et qui veut que l’on «[épouse] l’orage» (10) qui fait vivre – la voix qui «annonce les Saturnales d’un esprit qui a patiemment résisté à une longue et terrible pression» (11).
Notes
(1) Éditions Robert Laffont (coll. Pavillon Poche, 2021). Traduction combinée de Georges Belmont et Hortense Chabrier.
(2) Cf. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique (Cours au Collège de France – 1978-1979).
(3) Cf. Gilles Deleuze, Post-scriptum sur les sociétés de contrôle.
(4) Jean Vioulac, La logique totalitaire (chapitre II).
(5) Cf. Anthony Burgess, Les Puissances des Ténèbres.
(6) Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme (préface à la cinquième édition de 1979).
(7) Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (cette citation et la précédente).
(8) Paul Valéry, Le cimetière marin.
(9) Armel Guerne, Rhapsodie des fins dernières.
(10) Immense formule d’Armel Guerne (recueillie dans Armel Guerne l’annonciateur, de Charles Le Brun et Jean Moncelon – Éditions Pierre Guillaume De Roux).
(11) Nietzsche, Le Gai Savoir (préface).




























































 Imprimer
Imprimer