« HOWL d’Allen Ginsberg : nouvelle traduction par Gregory Mion | Page d'accueil | Mon dialogue avec Simone Weil de Joseph-Marie Perrin : un alphabet de la vie sainte en temps de damnation, par Gregory Mion »
11/09/2023
Entretien entre Rodolphe Cart et Baptiste Rappin à propos de Georges Sorel, Le révolutionnaire conservateur

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone.«La démocratie ayant pour objet la disparition des sentiments de classe et le mélange de tous les citoyens dans une société qui renfermerait des forces capables de pousser chaque individu intelligent à un rang supérieur à celui qu’il occupait par sa naissance, elle aurait partie gagnée si les travailleurs les plus énergiques avaient pour idéal de ressembler aux bourgeois, étaient heureux de recevoir leurs leçons et demandaient aux gens en réputation de leur fournir des idées.»
Georges Sorel, Les Illusions du progrès (1908).
«Le sublime est mort dans la bourgeoisie et celle-ci est donc condamnée à ne plus avoir de morale.»
Georges Sorel, Réflexions sur la violence (1908).
 Baptiste Rappin
Baptiste RappinCher Rodolphe, vous venez de publier aux Éditions de la Nouvelle Librairie un livre (215 pages) en forme de synthèse de la pensée de Georges Sorel. D’où vient l’impulsion qui vous poussa à commettre cet ouvrage ?
Rodolphe Cart
Au-delà de Sorel, c’est véritablement l’époque de ce dernier qui m’intéresse (fin XIXe – début XXe). Pour moi, elle représente une période d’interrègne au sens où Grasmci l’entendait. Comme il l’expliquait dans ses Cahiers de prison : «La crise consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître : pendant cet interrègne on observe les phénomènes morbides les plus variés». C’est cette entrée dans la politique moderne – avec ces balbutiements, ces retours et ces bonds conceptuels comme historiques – qui m’a toujours fasciné. Avènement de la société industrielle, métamorphose des institutions politiques, ébranlement de la science et transformations des peuples et des nations, tous ces événements s’influencent et se mélangent dans un chaos européen qui déterminera tout le XXe siècle. Concernant la France, une expérience sans commune mesure – sauf peut-être en Allemagne – avait retenu mon attention : le Cercle Proudhon (1911-1914). Cette tentative de coalition entre le monarchisme et le syndicalisme révolutionnaire – contre un régime républicain devenant de plus en plus une ploutocratie organisée et verrouillée par la bourgeoisie – m’avait poussé à m’intéresser à Proudhon. À la suite de la lecture du Franc-Comtois et des principaux acteurs de cette «association» (notamment Georges Valois et Édouard Berth), le nom de Sorel avait attiré mon attention par la récurrence de son emploi. Je me mis donc à lire ce penseur originaire de Normandie qui m’enchanta tout de suite. Peu après j’avais pris ma décision : il fallait que je fasse découvrir à ma génération (j’ai 30 ans) cet homme qui n’a pas la place qu’il mérite au panthéon des penseurs politiques français.
Baptiste Rappin
Vous inscrivez Sorel dans son temps. Mais alors, justement, quelles relations entretenait-il avec les philosophes et écrivains de l’époque ? Les Péguy, Maurras, Bergson, etc. ? Pouvez-vous brosser à grands traits l’univers intellectuel de Sorel ?
Rodolphe Cart
Les échanges épistolaires qu’a entretenus Sorel sont nombreux. Et effectivement, pas moins de mille cinq cents lettres envoyées par l’auteur des Réflexions sur la violence ont été retrouvées. Ces échanges sont capitaux pour bien comprendre sa trajectoire intellectuelle et son influence sur le débat public. La première chose qui nous marque quand on se penche sur ces conversations, c’est la diversité des interlocuteurs. Il est l’exact contraire de l’homme de caste et de parti. Comme disait Michael Freund, l’un de ses biographes, Sorel est demeuré toute sa vie conservateur mais aussi marxiste (1893-1897), révisionniste (1898-1901), syndicaliste révolutionnaire (1898-1911), nationaliste (1911-1913) et même bolchevique (1917-1922). Ces différentes «facettes» rendent l’étude de son cas d’autant plus intéressante, car il nous apparaît comme un penseur à la croisée des chemins de tous les courants et de toutes les disciplines de l’époque. Lire Sorel et sa correspondance, c’est avoir accès au large panorama intellectuel d’une époque fondamentale pour comprendre tout le XXe siècle. Sorel n'hésite pas à débattre avec Bergson des sujets «métaphysiques» tout en s'opposant aux vues de Pareto sur des questions d'économie politique. Aussi faut-il préciser d’emblée qu’il ne se cantonne pas à la France. Il a une correspondance riche avec de nombreux auteurs étrangers – notamment italiens comme Pareto, Michels ou Croce. Un exemple de cet ancrage dans son temps : Sorel fut un habitué, avec Péguy, des cours du philosophe auteur de Bergson au Collège de France. C’est pour cela que l’un des traits appréciables de ce penseur réside dans son absence de crainte d'être accusé de dilettantisme intellectuel. Il était en perpétuelle recherche de la pluralité politique et se riait bien des gens qui désiraient le «mette sur la touche» pour ses revirements. Sans a priori ni préjugés, il allait constamment là où il sentait une émulsion intellectuelle et politique – que ce soient aux niveaux des hommes, des idées et des événements historiques. Sur son cas, il note : «Les dialecticiens peuvent s’amuser à établir doctement que j’ai énoncé durant une période d’environ dix ans des opinions peu conciliables sur les moyens qu’il conviendrait d’employer pour résoudre les questions ouvrières… En constatant que je n’ai rien dissimulé des variations de ma pensée, ils ne pourront faire autrement que d’admettre (je l’espère du moins) que j’ai toujours apporté une entière bonne foi dans mes recherches… La multiplicité des opinions que j’ai successivement adoptées ne manquera pas d’attirer l’attention des métaphysiciens qui y trouveront la manifestation particulièrement frappante de la liberté dont jouit l’esprit quand il raisonne sur les choses produites par l’Histoire.» On comprend ainsi mieux pourquoi il passa du syndicalisme révolutionnaire au bolchévisme en passant par le nationalisme (monarchiste). Il se fiche de sa marginalisation en France (pas en Italie), et il revendique même le fait de n'appartenir à aucune institution académique ou politique. Cela ne fait pas de lui non plus un ermite, reclus dans sa bibliothèque de travail. On sait qu’il occupe, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à 1906, un poste d'administrateur à l'École des Hautes Études sociales, mais aussi qu’il assiste aux rencontres mensuelles du dimanche chez Lagardelle, avenue Reille, à Paris. Pendant plusieurs années (probablement entre 1903 et 1907), ces rencontres regroupent des intellectuels français et étrangers autour du Mouvement socialiste avec quelques leaders de la CGT, dont Griffuelhes, Merrheim et Delesalle. Autre lien capital pour comprendre son cheminement intellectuel : sa relation à Péguy. Sorel fut l’un des premiers abonnés aux Cahiers de la Quinzaine – même si des tensions apparaîtront par la suite avec le milieu péguyste. On le compte parmi les grands fidèles des jeudis de la boutique de l’auteur de Notre jeunesse, où il occupe une place de maître. C’est là qu’il rencontre un grand nombre de rédacteurs des Cahiers qui s’associeront plus tard à la revue L’Indépendance. C’est en effet dans la boutique des Cahiers que Sorel et Jean Variot se rencontrent, le premier jeudi d’octobre 1908. En outre, c’est à cette époque qu’il se sépare petit à petit du syndicalisme pour tenter un rapprochement avec le mouvement nationaliste. Cette convergence, Sorel l’esquissa, dès juillet 1909 dans le texte intitulé La déroute des mufles, lorsqu’il affirma
 que l’Action française était en position pour détruire le pouvoir parlementaire : «On peut espérer que grâce à eux, le règne de la bêtise et de la goujaterie sera promptement terminé.» Ayant pris acte de la mauvaise tournure de l’aventure syndicale (réformisme, emprise du parti intellectuel, essoufflement des grèves), Sorel reconnaît alors la pugnacité des jeunes Camelots et la force du renouveau catholique dans la jeunesse qui s’illustre dans les fameux mercredis de Thalamas. Le symbole de ce rapprochement est la naissance de la revue L’Indépendance, dont le premier numéro paraît le 1er mars 1911. S’adressant à «des hommes sages et de bonne culture», L’Indépendance entend défendre les traditions françaises. On compte parmi les collaborateurs les plus connus, dont Sorel en tête : Variot, Élémir Bourges, Barrès, Bourget, Maurice Donnay, Francis Jammes, Halévy, Claudel, le poète Paul Fort, Gustave Le Bon, Dom Besse, Pareto et Berth. Cette brève aventure finira par le départ de Sorel qui regrettera la dérive nationaliste et traditionaliste de la revue.
que l’Action française était en position pour détruire le pouvoir parlementaire : «On peut espérer que grâce à eux, le règne de la bêtise et de la goujaterie sera promptement terminé.» Ayant pris acte de la mauvaise tournure de l’aventure syndicale (réformisme, emprise du parti intellectuel, essoufflement des grèves), Sorel reconnaît alors la pugnacité des jeunes Camelots et la force du renouveau catholique dans la jeunesse qui s’illustre dans les fameux mercredis de Thalamas. Le symbole de ce rapprochement est la naissance de la revue L’Indépendance, dont le premier numéro paraît le 1er mars 1911. S’adressant à «des hommes sages et de bonne culture», L’Indépendance entend défendre les traditions françaises. On compte parmi les collaborateurs les plus connus, dont Sorel en tête : Variot, Élémir Bourges, Barrès, Bourget, Maurice Donnay, Francis Jammes, Halévy, Claudel, le poète Paul Fort, Gustave Le Bon, Dom Besse, Pareto et Berth. Cette brève aventure finira par le départ de Sorel qui regrettera la dérive nationaliste et traditionaliste de la revue.Baptiste Rappin
Voici donc Sorel situé dans son temps. Mais il est également un héritier et, de ce point de vue, s’il est un nom à retenir, c’est celui de Proudhon. Quelle est donc l’influence de ce dernier sur la pensée de Sorel ?
Rodolphe Cart
Proudhon est le penseur qui va donner les grands axes de la pensée sorélienne. «Sorel, énigme du XXe siècle, semble une greffe de Proudhon, énigme du XIXe», observait judicieusement Daniel Halévy. Sorel va même jusqu’à dire de Proudhon qu’il est «le plus grand philosophe du XIXe siècle». Et jusqu’à la fin de sa vie (il meurt en 1922), il conserva toujours ce désir d’écrire un livre sur le franc-comtois – il insista même auprès de Berth pour qu’il le fasse à sa place à cause de son état de santé. Il n’y a par conséquent aucun abus à parler de Proudhon, pour Sorel, comme d’un maître. Dans nombre de ses écrits se suivent les hommages à l’auteur de Qu’est-ce que la propriété ? : il qualifie L'Introduction à l’économie moderne de «livre inspiré de principes proudhoniens»; en 1906, L'organisation de la démocratie est un article totalement consacré à Proudhon; en 1908, les Réflexions sur la violence sont marquées par une «inspiration si proudhonienne» selon la formule de Pour Lénine en 1919. Même si la découverte de Marx (1892-1900) atténue momentanément cette influence, il demeure l’étoile polaire qui guida Sorel tout au long de sa carrière politique. Parmi les œuvres proudhoniennes qu’il chérit, on retrouve en tête De la Justice suivie de La guerre et la paix. Contre certains socialistes de l’époque qui se laissent aller à des théories nouvelles, Sorel choisit le parti de Proudhon le «Romain», l’homme qui doit constamment chercher à ne pas se laisser prendre dans ces dérives de la consommation, de la passion et de la débauche en tout genre – en clair, tout l’exact contraire de l’individu moyen des démocraties modernes. En 1906, la République de Proudhon est l'idéal auquel adhère Sorel : «Dans ces conditions, le principe d'autorité tend à disparaître; l'État, la chose publique, res publica, est assis sur la base à jamais inébranlable du droit et des libertés locales, corporatives et individuelles, du jeu desquelles résulte la liberté nationale. Le gouvernement, à vrai dire, n'existe plus; [...] c'est cette impersonnalité, résultat de la liberté et du droit, qui caractérise surtout le gouvernement républicain». Mais pour qu’un tel gouvernement soit possible, il faut aussi un certain type d’homme. C’est pour cela qu’il insiste si fortement sur la caractéristique morale. Pour témoigner de cette vision, il suffit de voir à quel point le «sentiment proudhonien de la pauvreté» est important. Sorel affirme que l’économie et le droit doivent servir à la conversion éthique de l’homme, et il ajoute que «tout le monde est d'accord pour regarder comme les plus belles pages de Proudhon celles où, racontant des épisodes de son existence de travailleur, il nous montre le fond de son cœur de vieux Français». Sorel connaît la vie de Proudhon et il sait qu’il est le fils d’un tonnelier et d’une cuisinière, garçon de cave puis garçon vacher jusqu’à l’âge de douze ans. Il sait aussi qu’il fréquenta l’école mutuelle puis bénéficia d’une bourse d’externat au Collège royal de Besançon; mais surtout qu’une fois sa famille ruinée, il fut contraint, en 1826, d’abandonner ses études. C’est cette adéquation entre la vie et les idées que respecte Sorel : «Nous voilà bien près de Proudhon qui, lui aussi, a célébré les vertus guerrières et qui a prescrit à l'humanité les lois du travail, de la pauvreté ou de la chasteté». Ces lois que Sorel fait siennes, elles sont celles à partir desquelles l'homme parvient à s'élever au-dessus de l'animalité et de la vie biologique – tout en lui conférant l’idéal du statut d’individu libre. Bien qu’il ne fût pas anarchiste, cette dimension chez Proudhon – ainsi que sa sensibilité libertaire – va largement l’influencer. Sorel rappelle que, pour Proudhon, la propriété individuelle est liée à la liberté politique. Il en fait l’assise de la souveraineté du citoyen contre la souveraineté collective. C’est aussi Proudhon qui fait naître chez lui cette méfiance contre toutes les formes de «gouvernement providentiel» ou totalitaire. Il devient une référence dans le refus sorélien du mythe de l'unité démocratique : «En posant ainsi sous une forme parfaitement claire le problème de la volonté générale, Proudhon réduit à l'absurde le dogme unitaire que la démocratie oppose constamment à la doctrine de la lutte des classes». Même chose pour le fédéralisme car Sorel pense, contre toute une partie des marxistes, que l’extension du fédéralisme, tant au domaine des institutions politiques que culturelles, permet de lutter contre la domination de l’État ou des intellectuels sur la classe ouvrière. Une autre notion proudhonienne qui le sépare des marxistes : celle qui suppose que seule une politique pragmatique – qui ne détient aucune solution scientifique préalable, ni une philosophie de l'histoire – est bonne. L’histoire est donc ouverte, et cela permet justement à Sorel de construire sa vision de la violence et du mythe mobilisateur pour contrer la décadence dans laquelle toute l’Europe est engagée. Tout cet ensemble d’idées reprises fait même dire à Sorel que la renaissance de la pensée proudhonienne serait un acte salutaire pour le socialisme : «Je crois que le moment est venu où les idées proudhoniennes après avoir exercé une grande action sur la pensée bourgeoise contemporaine vont devenir considérables pour l'avenir du socialisme. La question fondamentale qui est posée actuellement [...] est la question du socialisme d'État [...]. On a déjà signalé ici le danger que représente le réveil de l'esprit saint-simonien parmi les intellectuels venus au socialisme». Outre les principes idéologiques, l’immense gain que permet Proudhon réside dans l’acquisition, par Sorel, d’une sorte de méthode. Toute question politique doit être appréhendée sous trois angles obligatoirement liés : l’aspect moral, juridique et économique des éléments qui composent le champ social.
Baptiste Rappin
Venons-en alors à présent à la pensée de Sorel. S’il est bien une expression que l’on retient de lui, c’est celle de «mythe de la grève générale». Pourriez-vous nous commenter cette expression ? Que faut-il entendre ici par mythe ? Et pourquoi la «grève générale» plus que, par exemple, la lutte des classes ?
Rodolphe Cart
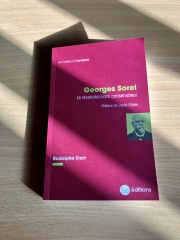 L’un des objectifs de la pensée sorélienne est de mettre les acteurs sociaux en mouvement, de les dresser contre le régime en place. Lorsque Sorel dénonce le parlementarisme et les compromissions de la gauche réformatrice, il ne le fait jamais de manière gratuite mais toujours dans le but que cette dénonciation trouve un certain écho dans le corps prolétarien. Or, Sorel se rend bien compte que tous les mouvements de révolte de l’histoire n’ont été possibles que lorsque les individus étaient plongés, et cela avant même la mise en action, dans un univers mental qui les poussait à prendre telle ou telle décision. Il ne peut y avoir de changement d’envergure sans une ferveur et un enthousiasme qui enivrent les cœurs, et donc qui créent en amont cette «scission» morale et des valeurs entre deux camps clairement identifiés. Toutes les révolutions comportaient une sorte de lien entre mystique et politique, entre élan et organisation, entre force et forme. Gramsci, dans le quotidien Avanti !, en décembre 1917, fit aussi une remarque similaire : «Le socialisme est une vision intégrale de la vie : il a une philosophie, une mystique, une morale». C’est en se penchant sur l’histoire des révolutions – notamment celle des chrétiens à l’époque antique – que Sorel met le doigt cette importance du concept de «mythe». Il entend démontrer que la violence est indissociable du processus de mythe et de régénérescence morale. Pour le cas du socialisme prolétarien – qu’il défend –, la perspective eschatologique d’une révolution finale est remplacée par celle, plus réaliste, de la grève générale. Cette dernière ne consiste pas dans la valorisation de la révolte ouvrière qui découlerait d’une fascination pour la destruction et le chaos, mais au contraire d’un espoir dans sa capacité à régénérer la société de son temps. Le syndicat doit remplir son rôle pour la préfiguration de la société socialiste : détachement «religieux» par rapport à l’ancien monde et construction «juridique» de l’ordre nouveau sont deux aspects de la même réalité. Concernant ce mythe de la grève générale, Sorel mesure, à son époque, que le développement des syndicats les oppose directement, et de manière de plus en plus violente, au cadre de la IIIe République. Tous les «ingrédients» d’une révolte sont présents : une violence qui s’accentue, deux camps qui s’opposent et une fracture qui ne cesse de s’agrandir. En clair, il ne manque plus qu’une idée directrice pour ce conflit désormais inévitable. Pour Sorel, c’est le concept de grève générale insurrectionnelle qui, seul, était capable de mettre en place le paradigme dans lequel le mouvement ouvrier français pouvait se projeter. Le but de ce mythe fut proprement de soutenir la lutte du prolétariat industriel associée aux valeurs positives d’héroïsme et de puissance. C’est par le combat quotidien des petites gens que pouvait se maintenir, sur le long, cet espoir de résistance pour sauver une civilisation menacée par la modernité libérale. En revanche, Sorel était trop respectueux de l’autonomie des syndicats et des travailleurs pour prétendre jouer le rôle d’«intellectuel organique». Il a pris toujours position en faveur de la branche la plus radicale du mouvement syndicaliste : refusant tout compromis avec la bourgeoisie, il souhaitait que le prolétariat entre en état de sécession avec les intellectuels et les représentants socialistes.
L’un des objectifs de la pensée sorélienne est de mettre les acteurs sociaux en mouvement, de les dresser contre le régime en place. Lorsque Sorel dénonce le parlementarisme et les compromissions de la gauche réformatrice, il ne le fait jamais de manière gratuite mais toujours dans le but que cette dénonciation trouve un certain écho dans le corps prolétarien. Or, Sorel se rend bien compte que tous les mouvements de révolte de l’histoire n’ont été possibles que lorsque les individus étaient plongés, et cela avant même la mise en action, dans un univers mental qui les poussait à prendre telle ou telle décision. Il ne peut y avoir de changement d’envergure sans une ferveur et un enthousiasme qui enivrent les cœurs, et donc qui créent en amont cette «scission» morale et des valeurs entre deux camps clairement identifiés. Toutes les révolutions comportaient une sorte de lien entre mystique et politique, entre élan et organisation, entre force et forme. Gramsci, dans le quotidien Avanti !, en décembre 1917, fit aussi une remarque similaire : «Le socialisme est une vision intégrale de la vie : il a une philosophie, une mystique, une morale». C’est en se penchant sur l’histoire des révolutions – notamment celle des chrétiens à l’époque antique – que Sorel met le doigt cette importance du concept de «mythe». Il entend démontrer que la violence est indissociable du processus de mythe et de régénérescence morale. Pour le cas du socialisme prolétarien – qu’il défend –, la perspective eschatologique d’une révolution finale est remplacée par celle, plus réaliste, de la grève générale. Cette dernière ne consiste pas dans la valorisation de la révolte ouvrière qui découlerait d’une fascination pour la destruction et le chaos, mais au contraire d’un espoir dans sa capacité à régénérer la société de son temps. Le syndicat doit remplir son rôle pour la préfiguration de la société socialiste : détachement «religieux» par rapport à l’ancien monde et construction «juridique» de l’ordre nouveau sont deux aspects de la même réalité. Concernant ce mythe de la grève générale, Sorel mesure, à son époque, que le développement des syndicats les oppose directement, et de manière de plus en plus violente, au cadre de la IIIe République. Tous les «ingrédients» d’une révolte sont présents : une violence qui s’accentue, deux camps qui s’opposent et une fracture qui ne cesse de s’agrandir. En clair, il ne manque plus qu’une idée directrice pour ce conflit désormais inévitable. Pour Sorel, c’est le concept de grève générale insurrectionnelle qui, seul, était capable de mettre en place le paradigme dans lequel le mouvement ouvrier français pouvait se projeter. Le but de ce mythe fut proprement de soutenir la lutte du prolétariat industriel associée aux valeurs positives d’héroïsme et de puissance. C’est par le combat quotidien des petites gens que pouvait se maintenir, sur le long, cet espoir de résistance pour sauver une civilisation menacée par la modernité libérale. En revanche, Sorel était trop respectueux de l’autonomie des syndicats et des travailleurs pour prétendre jouer le rôle d’«intellectuel organique». Il a pris toujours position en faveur de la branche la plus radicale du mouvement syndicaliste : refusant tout compromis avec la bourgeoisie, il souhaitait que le prolétariat entre en état de sécession avec les intellectuels et les représentants socialistes.Baptiste Rappin
Nous arrivons, cher Rodolphe, à la fin de notre entretien. Je vous pose par conséquent une dernière question : quelle est la postérité et/ou l’actualité de la pensée de Sorel ? Quelles traces, fussent-elles modestes, a laissées le penseur du mythe de la grève générale ?
Rodolphe Cart
Tout d’abord, ceux qui s’intéressent à l’histoire des idées sociales et politiques françaises se doivent de connaître Sorel. Je ne suis pas le seul à penser cela puisque le penseur du politique, Julien Freund, voyait en lui «probablement le plus grand théoricien politique français depuis la fin du XIXe siècle». Et effectivement, comment ne pas remarquer, à travers ses différents écrits, que son regard critique sur la société de son temps trouve dans notre époque des résonnances ? Chaque jour le fonctionnement du système parlementaire, la légitimité de la classe dirigeante et le rôle des intellectuels organiques du système sont remis un peu plus en cause par le peuple. Et que dire de la résurgence, dans nos sociétés, de la violence sous toutes ses formes (sociale, ethnique, économique) ! Sorel est l’un des grands esprits qui peuvent nous permettre d’avoir un autre point de vue que l’unique condamnation apportée par la philosophie des Lumières, le système républicain actuel et l’idéologie libérale. C’est lui qui nous permet d’opposer la violence à la force de l’État : «La force a pour objet d’imposer l’organisation d’un certain ordre social dans lequel une minorité gouverne, tandis que la violence tend à la destruction de cet ordre. La bourgeoisie a employé la force depuis le début des temps modernes, tandis que le prolétariat réagit maintenant contre elle et contre l’État par la violence». Il renverse l’opinion commune qui tend à admettre que la violence n’est que le résultat de la barbarie sans retenue, de la sauvagerie cruelle. Comme le remarque pertinemment Alain de Benoist : «Les choses s’éclairent dès que l’on met en rapport cette dichotomie avec un autre couple-clé : les notions de légalité et d’illégitimité. L’autorité étatique est assise sur la loi. Elle est légale, mais n’est pas toujours légitime. La légitimité est du côté des opprimés. Loin que la violence soit à regarder comme une forme illégitime d’usage de la force, c’est elle au contraire qui incarne la légitimité, tandis que la force n’a que la légalité pour elle». Aussi il y a un autre élément de la pensée sorélienne qu’il serait intéressant de reprendre à notre compte : sa critique de l’idéologie du progrès. Sorel nous donne les clés d’une critique profonde de cette doctrine «bourgeoise», qui dénonce l’optimisme de ceux qui s’imaginent que le mondialisme et le grand métissage de l’humanité représentent l’aboutissement naturel et nécessaire des progrès de l’esprit humain. La pensée sorélienne contredit cet axiome établissant que les idées de justice sociale et de progrès se confondent l’une avec l’autre. Si l’idée de progrès est une sécularisation de la notion biblique d’une histoire linéaire globalement orientée vers le meilleur, l’idée de justice sociale «résulte de l’exploitation du travail et de la misère créée dans les classes populaires par une révolution industrielle que cette même bourgeoisie libérale n’a cessé d’encourager» (Alain de Benoist). Et enfin, son enseignement (peut être le plus intéressant) est que Sorel est un maître qui nous pousse à l’action et à la rigueur – qu’elle soit morale, physique ou politique. Aucune collaboration, entente ou négociation avec le système dominant ne doit être acceptable. Il faut constamment chercher à «consolider» la fracture entre le peuple et les élites. Dans tous les cas, il s’agit de rechercher les conditions d’une scission permettant aux classes moyennes et populaires de se prémunir contre tout compromis, toute récupération, en se plaçant en état de sécession par rapport au reste de la société. Voilà les enseignements que nous pouvons garder d’un «professeur d’énergie» – la formule est de Barrès – comme Georges Sorel.





























































 Imprimer
Imprimer