« Censure sur Internet : à propos de Louis-Ferdinand Céline, par Marc Laudelout | Page d'accueil | Deux années passées dans la Zone... et puis ? »
08/03/2006
Au régal des Vermines ou les poisons inoffensifs de Marc-Édouard Nabe

Crédits photographiques : Ebram Harimurti (AFP/Getty Images).
«Si on n’écrit pas dans l’intention de refaire le monde en une seule phrase, alors c’est pas la peine : autant rester «à sa place», dans le strapontin, bien au chaud dans le noir, anonyme…»
Marc-Édouard Nabe, Au régal des Vermines.
 Nabe, Nabe, Nabe… J’en ai plus qu’assez d’entendre ce écrivain prolifique se plaindre, le pauvre, de n’être point soutenu par les médias qui lui préfèrent, devinez qui, celui auquel la chance a souri bien sûr, ce maraudeur timide arpentant la rue de la Convention que Nabe lui-même habitait au numéro 103, je veux bien sûr parler de Michel Houellebecq, le romancier raté qui pourtant, selon l’auteur d’Alain Zannini, a tout réussi, y compris à vivre de sa plume alors que Nabe, lui, il nous le répète assez, ne vit point ou, c'est la même chose, vit misérablement. J’ai enfin terminé mon éprouvante lecture, longue de plusieurs semaines et bien des fois, de guerre lasse, abandonnée, du Régal des vermines, le premier livre de Nabe publié en 1985. Qu’en dire ? Certes, la préface, intitulée Le Vingt-septième Livre, est assez drôle, cruelle de mordacité même, ne serait-ce que par son évidente et truculente mauvaise foi mais le reste du livre, mon Dieu, le reste du livre ! Je ne vois dans toutes ces pages verbeuses qu’une sous-parodie des tics céliniens montée à la diable en une sauce indigeste où flottent péniblement quelques grumeaux d’un Lautréamont barbotant dans l’ordure de potache et surtout d’immondes trouvailles littéraires, le plus souvent d’une vulgarité sans borne, qui vrillent l’esprit l’espace d’une milliseconde et le fatiguent ensuite pendant des heures entières de bâillement réflexif. Les pages les plus intéressantes de ce bouquin indigeste, mal fichu et parfois mal écrit, je l’ai dit concernent le jazz, mais aussi les œuvres de Bloy, Céline et Rebatet. Et dans ce domaine même, que de sépulcrales facilités se permet l’auteur, un vrai gamin qui découvre son corps, s'assurant que nul ne le regarde (ce qui suffit à nous prouver que Nabe, au contraire, est un pervers), que son petit vit, correctement manipulé, lâchera (presque) à la demande un jus gluant. Quel extraordinaire mauvais goût dans telle image, que Nabe, de peur de la perdre, s’empresse d’engrosser (je suis sûr que ses lecteurs empressés ont eu sur la langue un autre terme ô combien plus nabique, dont la pauvre Béatrice se souvient encore) afin de la reproduire jusqu’à la nausée, non pas celle de la provocation mais de l’insignifiance ! Par exemple, sur Léon Bloy : «Il coupe les pages avec un crucifix. C’est le prodige comme exégèse. Bloy est très exactement semblable à un pianiste qui joue, pendant que Jésus-Christ lui tourne les pages.» D’accord, magnifique même si on y tient, comme l'annote sur la copie crasseuse le professeur, amusé et agacé, par les facilités de son bizarre élève, non pas le plus intelligent de la classe mais certainement le plus habile. Oui mais… Et alors ? En voici un autre de ces chromos criards, en voici une autre de ces tirades toutes impeccablement formatées pour être gravées sur le marbre friable de la sentence faussement paradoxale : «Si je ne crois pas en Dieu, c’est que je crois en Bloy.» Fort bien, encore une fois mais… est-ce bien tout ? La maxime idiote, bourgeonnant à l'infini, comme parangon de la littérature contemporaine ? Rien de plus mon petit Marc-Édouard, vraiment, s'amuse à objecter Angot qui n'est pourtant pas exactement une adversaire intimidante ? Il est vrai que, comme beaucoup d’autres, je n’ai pas attendu de lire le graphomane Nabe, pour découvrir le géant qui eût négligemment tambouriné la face maigre de son facétieux et auto-proclamé héritier si ce dernier s’était avisé de se jucher commodément sur ses épaules rugueuses. Seulement, de Bloy, Nabe n’a rien de plus que la facilité, une facilité, dans son cas, dédouanée de tout impératif transcendant que je pourrais résumer commodément par ma petite tirade personnelle : là où Bloy prétend servir, par son génie, Dieu seul, Nabe, lui, moins génial mais infiniment plus prétentieux, n'écrit que pour se lire. Il est vrai que d’un autre modèle littéraire voué aux gémonies par les prudents (que l'auteur a ainsi toutes les raisons de moquer), modèle louangé jusqu’à l’orgasme, je veux parler de Céline, le style de Nabe n’est parvenu qu’à reproduire les fameux points de suspension. Bel exploit stylistique sans doute mais pour ce qui est de la profondeur de la vision commune à ces deux maudits, pour ce qui est de l’évidence même du sérieux inhumain avec lequel Bloy et Céline ont assumé leur vocation, le pauvre Nabe, affligé des écrouelles de l’insulte la plus commune, quelque chose comme le rhume du potache, serait bien avisé d’aller laper un lait moins coruscant pour son fragile estomac de petit minet parisien.
Nabe, Nabe, Nabe… J’en ai plus qu’assez d’entendre ce écrivain prolifique se plaindre, le pauvre, de n’être point soutenu par les médias qui lui préfèrent, devinez qui, celui auquel la chance a souri bien sûr, ce maraudeur timide arpentant la rue de la Convention que Nabe lui-même habitait au numéro 103, je veux bien sûr parler de Michel Houellebecq, le romancier raté qui pourtant, selon l’auteur d’Alain Zannini, a tout réussi, y compris à vivre de sa plume alors que Nabe, lui, il nous le répète assez, ne vit point ou, c'est la même chose, vit misérablement. J’ai enfin terminé mon éprouvante lecture, longue de plusieurs semaines et bien des fois, de guerre lasse, abandonnée, du Régal des vermines, le premier livre de Nabe publié en 1985. Qu’en dire ? Certes, la préface, intitulée Le Vingt-septième Livre, est assez drôle, cruelle de mordacité même, ne serait-ce que par son évidente et truculente mauvaise foi mais le reste du livre, mon Dieu, le reste du livre ! Je ne vois dans toutes ces pages verbeuses qu’une sous-parodie des tics céliniens montée à la diable en une sauce indigeste où flottent péniblement quelques grumeaux d’un Lautréamont barbotant dans l’ordure de potache et surtout d’immondes trouvailles littéraires, le plus souvent d’une vulgarité sans borne, qui vrillent l’esprit l’espace d’une milliseconde et le fatiguent ensuite pendant des heures entières de bâillement réflexif. Les pages les plus intéressantes de ce bouquin indigeste, mal fichu et parfois mal écrit, je l’ai dit concernent le jazz, mais aussi les œuvres de Bloy, Céline et Rebatet. Et dans ce domaine même, que de sépulcrales facilités se permet l’auteur, un vrai gamin qui découvre son corps, s'assurant que nul ne le regarde (ce qui suffit à nous prouver que Nabe, au contraire, est un pervers), que son petit vit, correctement manipulé, lâchera (presque) à la demande un jus gluant. Quel extraordinaire mauvais goût dans telle image, que Nabe, de peur de la perdre, s’empresse d’engrosser (je suis sûr que ses lecteurs empressés ont eu sur la langue un autre terme ô combien plus nabique, dont la pauvre Béatrice se souvient encore) afin de la reproduire jusqu’à la nausée, non pas celle de la provocation mais de l’insignifiance ! Par exemple, sur Léon Bloy : «Il coupe les pages avec un crucifix. C’est le prodige comme exégèse. Bloy est très exactement semblable à un pianiste qui joue, pendant que Jésus-Christ lui tourne les pages.» D’accord, magnifique même si on y tient, comme l'annote sur la copie crasseuse le professeur, amusé et agacé, par les facilités de son bizarre élève, non pas le plus intelligent de la classe mais certainement le plus habile. Oui mais… Et alors ? En voici un autre de ces chromos criards, en voici une autre de ces tirades toutes impeccablement formatées pour être gravées sur le marbre friable de la sentence faussement paradoxale : «Si je ne crois pas en Dieu, c’est que je crois en Bloy.» Fort bien, encore une fois mais… est-ce bien tout ? La maxime idiote, bourgeonnant à l'infini, comme parangon de la littérature contemporaine ? Rien de plus mon petit Marc-Édouard, vraiment, s'amuse à objecter Angot qui n'est pourtant pas exactement une adversaire intimidante ? Il est vrai que, comme beaucoup d’autres, je n’ai pas attendu de lire le graphomane Nabe, pour découvrir le géant qui eût négligemment tambouriné la face maigre de son facétieux et auto-proclamé héritier si ce dernier s’était avisé de se jucher commodément sur ses épaules rugueuses. Seulement, de Bloy, Nabe n’a rien de plus que la facilité, une facilité, dans son cas, dédouanée de tout impératif transcendant que je pourrais résumer commodément par ma petite tirade personnelle : là où Bloy prétend servir, par son génie, Dieu seul, Nabe, lui, moins génial mais infiniment plus prétentieux, n'écrit que pour se lire. Il est vrai que d’un autre modèle littéraire voué aux gémonies par les prudents (que l'auteur a ainsi toutes les raisons de moquer), modèle louangé jusqu’à l’orgasme, je veux parler de Céline, le style de Nabe n’est parvenu qu’à reproduire les fameux points de suspension. Bel exploit stylistique sans doute mais pour ce qui est de la profondeur de la vision commune à ces deux maudits, pour ce qui est de l’évidence même du sérieux inhumain avec lequel Bloy et Céline ont assumé leur vocation, le pauvre Nabe, affligé des écrouelles de l’insulte la plus commune, quelque chose comme le rhume du potache, serait bien avisé d’aller laper un lait moins coruscant pour son fragile estomac de petit minet parisien. Je parlai de mauvaise foi : nouvel abîme que Nabe ne craint point de parcourir, armé de sa seule lampe de nain licencieux, lorsqu’il déclare par exemple que tout grand livre mérite la prison, au sens premier de cette expression. Cela donne : «La Littérature gagne à être emprisonnée. De De profundis aux Deux Étendards, c’est vérifiable… Ne vous leurrez pas : tout écrivain écrit pour être écroué.» Parfait. Je ne puis que donner entièrement raison à Nabe et, sans rappeler l’illustre exemple que constitue à mes yeux La persécution et l’art d’écrire de Leo Strauss, il est évident que le cliché de l’artiste maudit, payant de son sang la naissance de l’œuvre douloureuse, crevant à petit feu comme Sade au fond d’une geôle, devrait être utilement médité dans les temps actuels d’immonde confort, où le seul danger qui guette tel écrivain médiatique concerne plutôt que sa vie (que d’autres, beaucoup moins connus que Nabe, perdent et qui témoignent de la liberté de l’esprit face aux hordes fanatiques des barbus), la bonne santé de son sexe paraît-il toujours saillant, hampe dressée aux vents de l'imprécation pourtant menacée d’une vulgaire chaude pisse à force d’être sollicitée par des hordes vénériennes de lectrices amoureuses. Continuons pourtant de lire la tirade de l’auteur, puisque les quelques mots qui suivent notre précédent exemple nous rappellent heureusement sur terre, à vrai dire dans le douillet intérieur que Nabe n’a quitté qu’une seule fois depuis qu’il est né, et encore, pour se réfugier dans l’hôtel quatre étoiles de Bagdad ceinturé de plus de militaires que notre téméraire romancier n’en verra jamais au cours de toute une vie d'insouciante inactivité, pardon, d'activité littéraire intense. Le voici qui écrit, cet Alexandre de brocante : «La littérature est une telle magie noire qu’elle ne s’opère bien qu’en cellule, dans un cocon, surprise un petit matin, sans autre danger mortel que l’ablation d’un mot ou son rétablissement, ce qui, du reste, finit par se confondre.»
Ce n’était donc que cela ? Mais oui. Sade devenant fou à force de privations carcérales parce qu’il a raté la chute de sa phrase. Wilde arpentant son minuscule cachot obscur durant des mois afin de glisser telle précieuse virgule à l’endroit de son texte prévu de toute éternité. Dostoïevski chahutant ses gardes pour que, ligoté au poteau d’exécution, l’inspiration lui vienne une dernière fois, dans un coup de rein prodigieux, avant de sombrer dans l’inconscience et peut-être même, allez savoir, la mort bien réelle.
Nous voici donc rassurés quant aux risques réellement énormes que l’intrépide écrivain désire affronter, lui qui est prêt, comme le chevalier à la triste figure, à défier tous les moulins de l’édition qui ont pourtant contribué non seulement à moudre le grain amassé par notre rusée fourmi mais à lui offrir le four banal où notre maître es littérature a cuit ses plus racoleuses pâtisseries.
Je ne puis résister au plaisir de citer l’un des derniers apophtegmes de ce père du dessert : «Il y a une tentation qui fait que Céline écrase tous les autres. Écrire, c’est jouer avec cette tentation.» Belle évidence serais-je tenté de dire, une de plus qui gagne à être répétée sans relâche. Quel dommage toutefois que Marc-Édouard Nabe, avant d’écrire ce premier livre suivi de beaucoup d’autres tout aussi inutiles et néanmoins publiés, n’ait pas jugé bon de fixer ce trop furtif éclair de lucidité bien capable de griller en une seconde ses plus fumeuses prétentions. N'est certes pas qui veut, comme Paul Léautaud (voire Joë Bousquet) en offrit l'incandescent et modeste exemple, un anachorète repoussant les putains splendides et, s'il fallait rapprocher Nabe d'un modèle paillardo-mystique, c'est au bouc en croix de Félicien Rops que je songerais immédiatement plutôt qu'au Saint-Antoine de Flaubert.

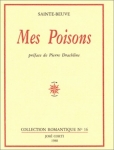 Fatigué de ne point en finir avec Nabe, j'étais prêt à lire absolument n'importe quel livre qui ne fût pas de lui, y compris à me plonger dans la flache certes peu profonde d'un de ces romans érotico-prétentieux lus par les mères de famille approchant la périlleuse quarantaine, l'âge où ces vaillantes redeviennent de consternantes gamines dès que les effleure la première ride d'ennui bourgeois. Heureusement, l'acrimonieux Sainte-Beuve dont un volume s'était égaré dans l'enfer rose de ma bibliothèque (celui des mauvais livres), m'a sauvé du dangereux péril de l'auto-célébration amoureusement dédiée à elle-même dans laquelle se complaît telle écrivainE (je suis un homme n'hésitant jamais à célébrer l'excellence féminine, qu'on se le dise) uniquement préoccupée de la bonne tenue de son cul artistique, et cela quel que soit le copieux verbiage censé enrober la douce praline que s'arracheront les libraires les plus inflexibles. Passons. Il existe un seul et unique point commun j’en suis certain (il ne peut donc s’agir de leur méchanceté légendaire) entre Sainte-Beuve et Nabe. Tous deux ont vécu dans la même rue que celle où résidait celui qui représentait à leur yeux le modèle même du grand écrivain et (surtout dans le cas de Nabe l’envieux), de l’écrivain ayant réussi. En effet, l’éminent critique, dont je viens de lire les peu acides textes composant Mes Poisons (José Corti, 1988; une réédition en poche sera bientôt disponible dans la collection La petite Vermillon), a vécu au 94 rue de Vaugirard alors même que Victor Hugo logeait au 90. Ensuite, Sainte-Beuve a eu la surprise de constater que, alors qu’il avait déménagé pour s’installer au 19, rue Notre-Dame-des-Champs, le poète des Contemplations résidait au… 11. Je ne reviens pas sur la proximité géographique qui a suggéré à Nabe un étonnant et bien tardif texte de louche admiration criée à l’endroit du voisin de pallier Michel Houellebecq. De même, j’avoue relire avec beaucoup de plaisir, ces derniers mois, les ouvrages jaunis de ces critiques du prodigieux et imbécile XIXe siècle comme Thibaudet, Brunetière, Renan ou Benda, eux-mêmes bien ignorés voire méprisés, on se demande pourquoi, par nos tonitruants journalistes littéraires à la mémoire courte, à la culture presque nulle. J’ai noté dans le livre de Sainte-Beuve cette pensée de laquelle Julien Gracq a dû se souvenir lorsqu’il a magistralement évoqué les mœurs de la critique dans sa Littérature à l’estomac : «La vraie critique à Paris se fait en causant : c’est en allant au scrutin de toutes les opinions que le critique composerait son résultat le plus complet et le plus juste.» J’ai encore goûté cette ironique appréciation à l’endroit de sa propre activité : «Un souverain, qui vient de monter sur le trône, et surtout de l’usurper, n’est pas plus jaloux de refondre toute la monnaie de ses prédécesseurs et de refrapper chaque pièce en circulation à son effigie, que les critiques nouveau-venus ne se montrent en général actifs à casser et à refrapper à neuf tous les jugements littéraires de leurs devanciers. Leurs successeurs leur rendront la pareille. Chacun, à son tour, se pique de régner.»
Fatigué de ne point en finir avec Nabe, j'étais prêt à lire absolument n'importe quel livre qui ne fût pas de lui, y compris à me plonger dans la flache certes peu profonde d'un de ces romans érotico-prétentieux lus par les mères de famille approchant la périlleuse quarantaine, l'âge où ces vaillantes redeviennent de consternantes gamines dès que les effleure la première ride d'ennui bourgeois. Heureusement, l'acrimonieux Sainte-Beuve dont un volume s'était égaré dans l'enfer rose de ma bibliothèque (celui des mauvais livres), m'a sauvé du dangereux péril de l'auto-célébration amoureusement dédiée à elle-même dans laquelle se complaît telle écrivainE (je suis un homme n'hésitant jamais à célébrer l'excellence féminine, qu'on se le dise) uniquement préoccupée de la bonne tenue de son cul artistique, et cela quel que soit le copieux verbiage censé enrober la douce praline que s'arracheront les libraires les plus inflexibles. Passons. Il existe un seul et unique point commun j’en suis certain (il ne peut donc s’agir de leur méchanceté légendaire) entre Sainte-Beuve et Nabe. Tous deux ont vécu dans la même rue que celle où résidait celui qui représentait à leur yeux le modèle même du grand écrivain et (surtout dans le cas de Nabe l’envieux), de l’écrivain ayant réussi. En effet, l’éminent critique, dont je viens de lire les peu acides textes composant Mes Poisons (José Corti, 1988; une réédition en poche sera bientôt disponible dans la collection La petite Vermillon), a vécu au 94 rue de Vaugirard alors même que Victor Hugo logeait au 90. Ensuite, Sainte-Beuve a eu la surprise de constater que, alors qu’il avait déménagé pour s’installer au 19, rue Notre-Dame-des-Champs, le poète des Contemplations résidait au… 11. Je ne reviens pas sur la proximité géographique qui a suggéré à Nabe un étonnant et bien tardif texte de louche admiration criée à l’endroit du voisin de pallier Michel Houellebecq. De même, j’avoue relire avec beaucoup de plaisir, ces derniers mois, les ouvrages jaunis de ces critiques du prodigieux et imbécile XIXe siècle comme Thibaudet, Brunetière, Renan ou Benda, eux-mêmes bien ignorés voire méprisés, on se demande pourquoi, par nos tonitruants journalistes littéraires à la mémoire courte, à la culture presque nulle. J’ai noté dans le livre de Sainte-Beuve cette pensée de laquelle Julien Gracq a dû se souvenir lorsqu’il a magistralement évoqué les mœurs de la critique dans sa Littérature à l’estomac : «La vraie critique à Paris se fait en causant : c’est en allant au scrutin de toutes les opinions que le critique composerait son résultat le plus complet et le plus juste.» J’ai encore goûté cette ironique appréciation à l’endroit de sa propre activité : «Un souverain, qui vient de monter sur le trône, et surtout de l’usurper, n’est pas plus jaloux de refondre toute la monnaie de ses prédécesseurs et de refrapper chaque pièce en circulation à son effigie, que les critiques nouveau-venus ne se montrent en général actifs à casser et à refrapper à neuf tous les jugements littéraires de leurs devanciers. Leurs successeurs leur rendront la pareille. Chacun, à son tour, se pique de régner.»Nous verrons bientôt, évoquant les essais d'Olivier Larizza et de William Marx, si ce règne tant décrié du critique littéraire traditionnel (disons, sans craindre la caricature répandue en masse dans nos universités : pieusement imbibé de structuralisme, enduit d'une couche plus ou moins fine de psychocritique et soucieux de saine déconstruction, autant dire, en un mot heureux, bien-pensant comme l'est tout imbécile) est près de s'achever.
Permettez-moi d'en douter.




























































 Imprimer
Imprimer