« La parole donnée de Louis Massignon | Page d'accueil | Notes sur Le Temps scellé d'Andrei Tarkovski, par Timothée Gérardin »
24/07/2009
Les Hauts-Quartiers de Paul Gadenne ou les hommes piétinés

Photographie de Jack Delano, A square with old houses in an old fishing village, Stonington, Connecticut, 1940.
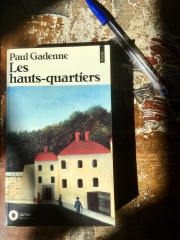 Acheter Les hauts-quartiers de Paul Gadenne sur Amazon.
Acheter Les hauts-quartiers de Paul Gadenne sur Amazon.«Celui que rien ne soutient, il ne lui reste plus qu'à se faire lui-même le soutien d'autrui.»
Paul Gadenne, Les Hauts-Quartiers, p. 662.
«[…] il s’apercevait que la charité avait été la seule découverte faite dans le monde depuis deux mille ans […].»
Ibid., p. 636.
Lire Paul Gadenne c'est s'enfoncer dans le silence. Un silence paradoxal, éminemment littéraire puisqu'il ne peut être cherché qu'au terme de centaines de pages.
Les Hauts-Quartiers, un livre que Paul Gadenne ne parvint pas à publier de son vivant (il parut ainsi en 1973) est un roman en tous points remarquable, peut-être même signe-t-il l'accomplissement littéraire de son auteur.
C'est en tout cas la seconde fois, en quelques mois seulement, que j'éprouve une émotion véritable, lisant ou relisant un roman : il y a eu La Route de Cormac McCarthy, véritable événement littéraire, et pour une fois cette expression a quelque sens (n'oublions pas le génial et labyrinthique 2666 de Roberto Bolaño), de l'année passée.
Il y a depuis quelques jours ce somptueux roman que j'avais lu une première fois en 1995, alors que je dévorai depuis quelques années déjà les romans de Paul Gadenne l'oublié, que mon professeur de philosophie d'hypokhâgne et de khâgne, Jean-Noël Dumont, m'avait fait découvrir.
Mentionnant ce roman, Pierre-Emmanuel Dauzat, dont la sensibilité littéraire n'est jamais aussi exacerbée que lorsqu'elle touche un thème qui lui est cher, la perte de la foi, parvient à écrire plusieurs âneries en une seule phrase : «Comment, lisant le portrait que brosse Anatole France, ne pas penser à l’écrivain «très chrétien» Paul Gadenne, qui après des amours délicates, dont il tint la chronique, écrira Les hauts-quartiers (sic), où il se présente en «valet de Judas», hybride du père lubrique et suicidaire de Maurras et du pudique et compatissant abbé Oegger ?» (in Judas. De l’Évangile à l’Holocauste, Bayard, 2006, p. 216).
Pauvre Pierre-Emmanuel Dauzat qui semble si décidément allergique, on se demande pour quelle mystérieuse raison, à toute forme de grandeur littéraire.
Résumée en quelques lignes, l'histoire de ce roman est toute simple : nous suivons les dernières années de vie de Didier Aubert. Malade, pauvre, il tente d'écrire des ouvrages sur les saints et leurs textes dans des conditions de vie pour le moins précaires voire épouvantables, en prise aux agissements et aux ragots des bourgeois vivant confortablement dans les Hauts-Quartiers d'une petite ville du sud-ouest de la France, Irube.
Avant de mourir comme il a vécu, en tentant de s'effacer et en y parvenant de fait, Didier aura connu quelques femmes, dont il aura été l'amant (ou pas) : Rosa, Betty, Mme Chotard, Paula, Mme d'Hem puis Flopie, une jeune fille de rien qu'il finira par épouser alors qu'elle porte un enfant qui n'est pas le sien.
Alors, Didier, abandonné de toutes sauf de Flopie, aux portes de l'église dont il s'éloigne, mourra du mal qui le ronge (la tuberculose), cet événement ne provoquant rien d'autre que la parution de quelques lignes idiotes dans Irube-Éclair, feuille de chou bien-pensante dirigée par un ecclésiastique à la panse repue et au cerveau vide.
Les Haut-Quartiers, un roman qui, malgré le fait qu'il ne se passe pratiquement rien, me paraît constituer l'acmé du romanesque : par sa taille d'abord, c'est un texte imposant qui prend le temps de suivre les menus faits et gestes de Didier ou de ses voisins peu respectueux de son silence. On imagine sans mal ce qu'un tel texte eût pu devenir, soumis à un comité de lecture d'une de nos maisons d'édition !
Dans ce gros roman, la place du narrateur est étrange : il se fait pure transparence, malgré quelques incises où il semble s'excuser, auprès de ses lecteurs, de devoir consigner des faits sans la moindre importance. Cet éloignement et cette proximité font du statut du narrateur une question à part entière : jamais Paul Gadenne ne m'a paru se fondre avec autant de délicatesse dans les contours d'un de ses personnages, littéralement, le porter, l'aimer, le pleurer. Les grands romanciers seulement peuvent accomplir pareil miracle : aimer leur personnage sans jamais nous donner l'impression de le plaindre, encore moins de le juger.
C'est la position même de ce narrateur omniscient qui nous livre la clé de ce roman splendide et ténébreux : prenant en pitié la destinée de Didier mais ne le pleurant jamais sottement, nous avons sans conteste affaire, n'en déplaise à Sophie Balso et aux universitaires à la compréhension atrophiée, à un texte sur l'impossibilité de la sainteté dans le monde moderne (Dauzat le subtil ne s'est pas trompé !), Gadenne endossant finalement le rôle de discret hagiographe d'un homme obscur, Didier Aubert, comme ce dernier se proposait d'ailleurs de se faire simple passeur des textes de feu des mystiques (1).
Impossibilité de la sainteté qui s'ente évidemment sur la lecture passionnée que Paul Gadenne fit de Sören Kierkegaard, se doublant donc de sa thématique corollaire : comment savoir si celui qui prétend souffrir pour un autre, à la place d'une multitude, n'est pas, tout simplement, un vil imposteur ? C'est tout le sens de ce beau passage : «Souffrir — c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il n'y a eu qu'un saint, d'ailleurs, et il était inimitable. Un grand signe apparut devant ses yeux et s'effaça, la figure sanglante d'un homme qu'on frappait, qui étendait les bras. Il y avait de quoi rire. Une voix lui disait : «Ça ne vaut rien, ce que tu sais faire. Souffrir ?... Si tu ne le fais pas pour quelque chose, pour quelqu’un, si tu n’y es pas autorisé…» Voilà donc ce qui lui manquait, ce qui lui avait toujours manqué : être autorisé. Il avait perdu son temps. Il ne serait même pas un saint négatif, il ne lui serait pas donné de boire la ciguë. Il pouvait écrire sur les saints, écrire une vie de saint, exposer les doctrines, parler des mystiques, montrer les degrés, les nuances, les valeurs… Comme un bon peintre. Non, encore n’était-ce pas sûr. Mais souffrir d’une manière valable, autorisée… Peut-être qu’il aurait fallu croire ? Mais les théologiens nous enseignent que la foi est un don de Dieu ? Et quelle foi ? Les croyants qu’il avait vus lui avaient fait perdre la foi. Et pourtant, ce qu’il faisait maintenant, il lui semblait qu’il le faisait pour se sanctifier. Mais peut-on se sanctifier soi-même ?» (2).
Sans doute est-ce, comme son amie Betty le lui fait durement remarquer sous l'apparence banale d'une métaphore de critique sociale, que Didier se plaint encore de souffrir, donc qu'il n'a point complètement embrassé une souffrance faite absolument sienne, voulue : «Tu es tout comme eux. Tu es tout tendu vers l’avoir, vers la possession. C’est même un peu ce qui fait ta souffrance. Et ta souffrance ne vaut rien, elle est sale. Il te reste beaucoup à faire, Didier. Tu te crois des mérites parce que tu es pauvre. Mais cette pauvreté, tu ne l’as pas voulue, tu ne l’as pas désirée, tu ne l’as pas encore faite tienne, épousée» (p. 439).
Certes, Didier, lorsqu'il se souviendra de la remarque que lui a faite son amie, la trouvera dure, injuste même. Il sait cependant que, dans le fond, elle dit la vérité, qu'il n'est pas encore descendu assez bas, n'est pas devenu un véritable objet de scandale aux yeux de la bourgeoisie d'Irube, qu'il n'est même pas parvenu à descendre non pas au niveau de Judas mais au-dessous, comme il l'affirme dans ces phrases saisissantes, véritablement diaboliques (3) (ou christiques ?) dans ce qu'elles suggèrent : «Il faut que tout le sang, la honte, la méchanceté du monde soient avec moi, sur moi; que toute la lie, l'écume du monde se retirent du monde avec moi et soient consumées avec moi. Je serai le réceptacle où le monde rejettera son ordure, c'est-à-dire sa souffrance. Le mal n'existe que par ma conscience. Ma conscience peut mourir dans le sein profané de cette fille. Ainsi s'établira la gloire de Dieu. Judas est nécessaire au monde. Mais est nécessaire aussi, beaucoup moins que Judas, quelque chose comme le valet de Judas» (p. 422). Nous retrouverons la même image d'abaissement à propos de Flopie, la fille de rien : «[…] il se voulait aussi bas que Flopie, plus bas que Flopie même, parce qu'il fallait bien aller la chercher où elle était et que, pour la soutenir et la soulever, il devait même se placer un peu plus bas qu'elle» (p. 691).
Valet de Judas ! : non, Didier ne parviendra pas à descendre si bas, parce qu'il n'a trahi personne, et surtout pas les femmes qu'il a aimées. Lui reste cependant ouverte une autre voie, moins grandiose, infiniment plus mystérieuse sans doute, que nous pourrions rapprocher de celle qu'emprunta Thérèse de Lisieux et, dans notre roman, de celles prises par Betty (qui déclare Je voudrais être encore plus légère, p. 247) et surtout Flopie (4). Ainsi revient plusieurs fois la description, par Gadenne, du support si peu poétique qui sert à Didier lorsqu'il prend ses notes en vue de rédiger des ouvrages que d'ailleurs personne ne lira : «Comme Betty avait toujours un sens éminent et fort juste de ce qui pouvait manquer à Didier, et que la crise de papier atteignait son maximum, elle lui apportait pour ses brouillons les fonds de panier, le dos des feuilles utilisées à demi et les contrats de mariage ratés ou abandonnés à la vermine; et ainsi Didier, en retournant les feuilles où il prenait des notes sur la mystique, était un peu plus renseigné sur les turpitudes humaines» (pp. 94-5).
La voie de la sainteté, pour extraordinaire qu'elle puisse nous paraître, ne saurait en aucun cas prétendre se passer des réalités les plus humbles de la condition humaine. Le romancier n'a de cesse de le marteler, écrivant : «Quel était le sens de cette activité intérieure, de ses visées, des dispositions qu’elle impliquait ? S’efforçait-il assez de vivre à la hauteur de ses modèles, de pratiquer leurs vertus ? L’hommage qu’il leur rendait en les signalant à l’attention était-il suffisant ? Et comment comprenait-il lui-même sa relation avec Dieu ? Il cherchait. Il croyait bien faire, les livres étaient sous son lit, à côté, devant, dedans, par terre. Il y en avait au-dessus de l’armoire à glace, et même dessous. Il allait chercher Tauler dans la poussière, Eckhart sous l’évier de la cuisine, saint Augustin servait de socle à une lampe, l’Ornement des noces spirituelles reposait au-dessus de la corbeille à papier» (p. 617). Comment le pourrait-elle d'ailleurs puisque, depuis la Chute, cette sainteté est sans doute l'unique aventure réelle qui puisse tenter de reconquérir quelque parcelle, même minuscule, de la félicité perdue qui est l'une des grandes interrogations de notre roman comme du reste des livres de Paul Gadenne ? (5)
Les universitaires sont décidément des êtres bien étranges, pour lesquels la réalité la plus profonde d'une œuvre est bien souvent, à leurs yeux, une faribole. Elle affirme le contraire de leurs dires et bat en brèche leurs prétentions systématisantes ? Qu'à cela ne tienne, ce sera l'auteur du texte étudié qui s'est trompé ! Sophie Balso et tous ceux qui prétendent nous donner, des Hauts-Quartiers, une interprétation qui exclurait l'une de ses dimensions essentielles, à l'évidence christique, sont, pour le dire clairement, des lecteurs ne sachant point lire. Paul Gadenne écrit noir sur blanc que son pauvre personnage, conscient de toutes ses faiblesses (la prétention intellectuelle en est assurément une), cherche à s'humilier, à souffrir, à s'oublier, non point pour rechercher le paradis artificiel dans lequel s'évadent les lémures usant de drogues, mais à seule fin de reconquérir la noblesse perdue. Et il faut aller la chercher là où elle se trouve, comme Simone Weil n'eut de cesse de l'écrire et de l'illustrer par sa propre vie, dans les bas-fonds où travaillent, souffrent et meurent celles et ceux que la haute société d'Irube méprise et enchaîne : «[…] il apparaissait à Didier que, faute de pouvoir arracher le monde ouvrier à sa condition, vivre sa passion pourrait être la façon de vivre la passion du Christ» (p. 117).
Ainsi les toutes dernières pages des Haut-Quartiers sont-elles bouleversantes qui nous rappellent la fin tragique de Nietzsche et, bien sûr, l'unique fin qu'il importe de rappeler, celle du Christ : «Ils [ces ouvriers] avaient une franchise, une nudité dans le regard, une expérience aussi, cet amer savoir du corps qui ne s’apprend pas sur les bancs des facultés et, sous la lassitude de leurs gestes, Didier, avec ce qui lui restait de forces, rejoignait, épousait passionnément leur fondamentale innocence, faite d’honnêteté et de vaillance martyrisées. Il avait sous les yeux ces esclaves, ces victimes du régime social qu’il y a cent cinquante ans déjà un Lamennais avait si exactement dépeint, ces hommes qui depuis toujours travaillaient, souffraient pour lui, pour nous, pour nous permettre de vivre à leur place» (p. 698).
Le débat sur le catholicisme social que ces lignes paraissent convoquer est désormais un fait historique que je n'évoquerai point. Tout autant me paraissent datées les justes récriminations de Gadenne contre les conditions indécentes de vie que la société moderne réserve aux plus humbles (6). Seule m'importe la permanence irrécusable de l'interrogation de l'artiste, ainsi que sa révolte contre le triomphe de l'argent facile, qui contamine tous les milieux sociaux, y compris ceux que l'on aurait pu croire, naïvement, à l'abri de pareille tentation : les hommes d'Église.
Bien sûr, Gadenne ne stigmatise pas seulement l'enrichissement des hommes de Dieu, qui n'est après tout que la conséquence fort logique d'un oubli plus grave, non seulement celui des hommes mais, sans aucun doute, celui même de Dieu. Ainsi nul lecteur sérieux des Hauts-Quartiers ne pourra aisément se défaire de la certitude que l'athée qu'est Didier Aubert est infiniment plus proche de Dieu, qu'il cherche dans l'abandon, le scandale et la pauvreté que jamais ne le seront les curés d'Irube et la noria caquetante des bonnes femmes pieuses : «Croire parce que c’est absurde ? murmura Didier. Oui, je sais. C’est la réponse à tout. Mais dites-vous que s’il y a une foi du charbonnier, il existe des gens qui présentent le phénomène contraire : ils ont l’absence de foi, l’incroyance, l’incrédulité du charbonnier. Imaginez une minute que je sois de ceux-là. M’enverriez-vous encore à votre capucin ?
L’abbé n’était pas préparé à cette attaque. Jusque-là, l’argument du charbonnier avait suffi à tout. Il n’avait jamais imaginé de charbonnier autrement que vaincu, illuminé par la triomphante certitude de l’existence de Dieu» (p. 190).
Les Hauts-Quartiers auraient pu ainsi porter sur leur couverture le premier titre du dernier roman de Georges Bernanos, Monsieur Ouine (7), qui s'appela, un temps, La Paroisse morte, tant reviennent, avec une insistance réellement évangélique, les scènes de colère contre les riches et la présence du faux dieu Argent qui paraît avoir triomphé de l'Autre (8) : «L’étoile de Dieu s’est éteinte derrière les nuages méphitiques des Hauts-Quartiers, derrière les restes rituels d’une religion automatique qui ne détruisait pas l’ordre superbe des jardins, qui ne faisait pas tomber les murs des villas où s’entassait l’or volé aux pauvres, qui laissait debout ce monde d’injustice, ce monde qui ne récompensait que l’habileté, et où un Beauchamp, lavé par sa fortune des péchés commis sous l’Occupation, et dressé sur son monceau de ferrailles, commençait à pouvoir prétendre aux honneurs municipaux» (p. 228).
Privée de Dieu, obsédée par le progrès (9) qui n'a d'autre but que celui de casser notre monde (10), la civilisation moderne ressemble au magma («Ils lui prenaient tout [...]. Ils avaient ouvert à son flanc, avec des cris de joie, une blessure par où coulait son sang. Malgré leurs disputes continuelles, ces êtres étaient amalgamés de telle façon qu’on ne les distinguait qu’avec peine les uns des autres», p. 393), à la boue originelle qu'évoque encore le Grand d'Espagne dans son crépusculaire roman et les femmes, qui illuminent de leur douce présence les pages désespérées des Hauts-Quartiers («l'existence de Betty lui semblait sanctifier le monde», p. 255), paraissent bien souvent elles-mêmes réduites à une simple matière dont la science révélera vite les mystères et qu'elle saura étudier pour s'en passer un jour : «Et maintenant elles [les femmes] n'étaient que grossièreté, humeur et matière, le creuset machinal du monde, le laboratoire crépitant et visqueux où la vie organise ses orgies, dans un effort stupide pour se perpétuer, pour faire éclater le scandale de l'absence monstrueuse de Dieu» (p. 662).
Cette perte semble même affecter jusqu'au langage (11), qu'en excellent clinicien Paul Gadenne ausculte attentivement, surtout lorsqu'il est celui des nantis, bien souvent des propriétaires qui paraissent faire leur beurre sans même s'inquiéter qu'ils le font sur le dos des démunis, écrivant : «Le Briffault jeune, qu’il avait à peine eu le temps d’entrevoir du haut de son grenier, avec sa stature carrée, ses joues bien rasées, son menton à l’équerre, bien posé sur ses quatre pieds, avait à peu de chose près la même voix timbrée et bien articulée, l’élocution précise et soignée du Briffault âgé. Celui-ci disait «Jâcques» en appuyant sur l’ «a», en l’écrasant sous un large accent circonflexe. L’autre dorait comme au four les syllabes de «mon oncle», prolongeait l’ «on» à plaisir, en faisait comme de la brioche. C’était un jovial échange de friandises, de dragées, comme à un baptême ou à un mariage. On sentait que cela leur était venu sans peine, c’était l’habitude, la tradition d’une vieille race, d’une bonne souche, la voix d’un bon sang : on se disait que pareilles élocutions attendaient tous les enfants Briffault encore à naître, que cette joyeuse acmé atteinte dans l’émission des syllabes et des sons n’avait attendu depuis toujours qu’un organe pour se manifester, l’organe de la famille Briffault, que personne n’a jamais pu prendre en défaut» (pp. 135-6).
Abandonné de tous et même de toutes, malade, sans argent, ne parvenant pas à trouver les conditions de vie matérielle qui lui permettraient de trouver la sérénité nécessaire pour écrire ses essais sur la vie mystique, le doute (12), et parfois même le blasphème chevillés à l'âme, que peut donc faire Didier Aubert ?
Nous l'avons dit : se vouloir moins que rien. Devenir un objet de rebut. Être détesté de tous, voire se prétendre damné : «Être en abomination à tous. Quel mot !» (p. 328). Attirer, comme sainte Lydwine de Schiedam évoquée par Huysmans, toutes les douleurs, se vouloir, follement, le réceptacle des souffrances : «Son devoir était de vouloir toujours plus de pauvreté, plus de souffrance, plus de difficultés à vaincre» (p. 250). Au risque même qu'on reproche à Didier cette position ou plutôt, cette pose : souffrir pour autrui, c'est bien, mais est-on jamais certain d'avoir été désigné pour accomplir cette tache ? Nous avons affirmé que Betty s'était moquée des folles prétentions de Didier : «Crois-tu que ce soit cela, la souffrance ? Crois-tu que tu saches souffrir ? Je ne crois pas. Tu sais ce que tu es, Didier ? Je vais te le dire. Tu es un bourgeois. Oui, tu es un bourgeois de la souffrance. Tu veux des souffrances qui te rapportent comme aux bourgeois leur argent. De la bonne souffrance, voilà ce que tu veux. Tu es comme tous les autres» (p. 438). L'argument est imparable et, d'ailleurs, Didier ne saura quoi dire.
Lui reste donc une seule voie : celle de l'exemplarité, c'est-à-dire celle de la sainteté. Si celui qui n'est plus soutenu doit se faire, selon Gadenne, le soutien des autres, s'il sait parfaitement combien «les hommes [sont] lourds à porter, lourds à vivre !» (p. 553), il doit tenter de rejoindre l'autre (qui n'est qu'un nous plus malheureux que nous ne le sommes, cf. p. 499) sans rien attendre de lui, ayant compris, une fois pour toutes, qu'il ne saurait se soustraire à son devoir : «[…] et puis, suis-je le gardien de mon frère ?...» (p. 545). Oui, tu l'es.
Didier parviendra à conquérir cet instant de pure joie, et ainsi à retrouver quelque éclair de la grâce perdue, quelques heures seulement avant de mourir, aidant, malgré son état physique lamentable, un ouvrier dans son labeur : «L'homme se retourna, offrant à Dieu sa face ravagée […]. Didier crut voir le linge de Véronique» (p. 700), parvenant même à sublimer sa souffrance : «Il n’en pouvait plus. Il était contre lui, dans l’ombre de la benne. On aurait dit deux hommes qui se colletaient. Le soir était tombé tout à fait. Didier se retrouva à genoux, tout tremblant, aux pieds de l’homme, ses mains crispées sur les pantalons de coutil et des sanglots lui venaient à la gorge» (p. 701) puis accédant à la paix, enfin ! :
«Oui ! Oui ! disait une voix en lui. Oui !...» Il entrouvrit les lèvres. « Son Corps. Quelqu’un a-t-il jamais senti cela ? Ou l’a-t-il cru ?... Vécu ?... Le corps du Christ ! Pas en image, mais…» Il aurait voulu ôter ce voile qui lui brouillait la vue. Soudain sa bouche se remplit de sang. Les clochers s’élancèrent avec un sifflement, projetés verticalement contre le ciel. […] Un ciel vermeil. Une douleur intolérable, foudroyante. Christi !...» (p. 747).
Lui a eu la joie. Didier a donc sauvé sa vie et son âme en les perdant.
Aux Assis les doutes moisissant l'âme.
Notes
(1) C'est volontairement que, dans le corps de mon article comme dans ces notes, je n'ai pas hésité à reproduire de très larges extraits des Hauts-Quartiers. «Il se demandait donc s’il allait inscrire ces mots [de saint Charles Borromée] en exergue à son dernier chapitre, ou les introduire dans le corps de son développement – mais comment oserait-il rapprocher ce qu’il écrivait lui-même de ces textes de feu, qui brûlent tout autour d’eux depuis des siècles et d’abord celui qui les lit – mais il n’y a plus personne pour les lire, se dit-il, et le seul bienfait que pourra apporter mon livre sera celui-là […]», Paul Gadenne, Les Hauts-Quartiers [1973] (Seuil, coll. Points Romans, 1991), p. 637. Toutes les références entre parenthèses renvoient à notre édition.
(2) Op. cit., pp. 695-6 (dorénavant entre parenthèses). C'est cette même interrogation qui sans doute aura empêché Didier de rentrer, à l'heure de sa plus grande angoisse, dans l'église, signifiant également l'intuition qui a été la sienne, le péché d'orgueil qui le paralyse, malgré ses désirs de se faire petit, le plus petit possible, et surtout, méprisé, l'homme le plus méprisé du monde : «Vous êtes assis sur les marches de la maison paroissiale, remarqua cérémonieusement le prêtre. Si vous avez besoin de quelque chose, entrez.
Il s’éloigna après une dernière hésitation.
Qui sait ce qu’il serait advenu du corps et de l’âme de Didier, quand Flopie serait revenue un instant plus tard, s’il était entré dans cette maison ? Toutes les portes ne sont-elles pas toujours ouvertes jusqu’au fond, jusqu’au dernier instant ?» (p. 742).
(3) Les figures du diable et de l'enfermement démoniaque sont présentes dans notre roman, quoique de façon discrète : «L'inverse de Résurrection: le bagnard ramenant à la vie, par son contact, la jeune fille sur le point de se perdre dans un monde médiocre : la vraie perdition» (p. 98). À plusieurs reprises, c'est Mme Chotard-Lagréou qui semble aux yeux de Didier l'incarnation du mal, comme il l'écrit : «[…] cette tache sur [s]a joue [...] était peut-être une marque invisible de ses souffrances, peut-être un indice de sa sainteté, ou aussi bien une manifestation diabolique, la cicatrice laissée par le talon rouge de Satan» (p. 272). Et encore, une phrase qui nous fait immédiatement songer à l'étrange Invitation chez les Stirl : «Le diable a reçu bien des noms à travers l'histoire, et tous les jours les cris effrayés des saints attestent sa présence dans un coin du monde. Mais non, ce n'est pas là le visage de Satan. Ce serait plutôt... Peut-être que l'Ange aussi aime torturer. Et quelle torture plus exquise que celle de l'Ambiguïté ?» (p. 448). Quoi qu'il en soit, Didier est un personnage dont le caractère pour le moins tranché peut faire songer à l'abbé Donissan de Bernanos, qui eût pu écrire ceci : «À force de haïr, il ne savait plus ce qu'il haïssait, ni pourquoi. Mais au centre de toute cette haine, comme un gros point noir et répugnant, il y avait lui, Didier, – Didier qui se haïssait absolument» (p. 383). Une scène peut également nous faire songer à l'errance nocturne de Donissan, s'étend des pages 673 à 701, où les thèmes du vertige, du cauchemar, de l’Enfer, de l’aspiration à la verticalité, de la nuit, de l’abandon, de l’identification au Christ et de la fin de Nietzsche s'entrelacent magnifiquement.
(4) «Betty, se dit-il, tout à coup illuminé, en ouvrant sa porte. Betty, c’est encore trop beau pour moi. Il faudra que je descende jusqu’à celle-ci [Flopie], que je leur prouve d’une manière définitive que je ne suis rien, que je ne vaux rien. Le scandale avec Paula était glorieux. Le scandale avec Betty était encore assez beau, et il y avait autre chose. Avec celle-ci dont je sais à peine le nom, il n’y aurait même plus de scandale… Je disparaîtrai tout à fait…» (p. 421).
(5) Quelques occurrences de cette thématique : «Le monde des plantes – surtout celui des plantes qui poussent toutes seules – est le monde de l’innocence, et nous avons besoin de ce monde» (p. 30). «Nous avons tous mérité de naître sans patrie et d'être persécutés à cause d'un signe que l'Ange a inscrit pendant la nuit de notre naissance sur notre visage […]» (p. 96). «C'était tout à fait une histoire de Paradis terrestre. Il avait vu l'ange vindicatif, armé de la hache [le jardinier], au seuil des territoires interdits» (p. 217).
Remarquons que, pour Paul Gadenne, la guerre, comme dans La Plage de Scheveningen, revêt une importance capitale dans la dramatisation d'une quête véritablement apocalyptique. «La guerre n’a pas détruit assez de choses, confesse Didier à Betty. Elle n’a pas détruit celles qu’il fallait, dit-elle vivement. Elle n’a rien détruit, dit-il. Elle a laissé les hommes comme ils étaient. Les tueries, les camps, les tortures d’un côté, de l’autre le courage surhumain des hommes, de ceux qui ont voulu tenir tête pour faire un monde meilleur, c’est comme si rien de tout cela n’avait existé. C’est très simple. Sais-tu pourquoi toutes ces horreurs ont été et sont encore possibles ? Ceux qui ont souffert seront vieux ou n’existeront plus dans vingt ans. Et les autres n’ont pas assez d’imagination. Car ce qui manque aux hommes, c’est l’imagination, uniquement. Pour se mettre à la place des autres, pour se représenter la souffrance» (p. 437). Et, puisque la guerre a été incapable de tenir ses promesses, puisqu'elle a été incapable de redonner au monde sa pureté en le plongeant dans le sang, les larmes et le feu, il faut coûte que coûte ne point se lamenter sur le monde passé et aboli, un état des choses de toute façon rasé par le séisme mondial qu'elle a provoqué mais, en somme, intérioriser sa démarche purificatrice et tenter d'accomplir la révolution socialo-politique (et même religieuse) qu'elle contenait en germe : «La guerre a coupé ses racines [celles de Didier] avec le monde enchanté d’autrefois – le monde où il avait une place, où il voyait les gens pour le plaisir, où il n’entendait jamais parler d’argent, où la pauvreté n’était pas considérée à l’égal d’un vice, d’une maladie honteuse. Il y en a qui ont franchi la guerre comme un tunnel et qui ont retrouvé leur monde. Lui, non. Ce qui était blanc est devenu noir [souvenir de Macbeth ?], ce qui était «plus» est devenu «moins», ce qui était innocent est devenu coupable. Tout s’est dégradé par l’intérieur; et toi, Didier, il semble qu’une lèpre secrète t’a gagné aussi; et que ton «signe» ait changé…» (p. 235). À moins, bien sûr, d'appeler de ses désirs une véritable tabula rasa, rêve de tous les révolutionnaires qui, quoi qu'on en dise, ne sont jamais tout à fait parvenus à se débarrasser d'une complexion millénariste : «Des choses laides. Mais il y a pire que cette laideur, c'est la médiocrité. Didier ne pourrait jamais pardonner à un tel monde. Devant ce monde, on ne pouvait avoir qu'un désir, l'abattre, le changer, pour extirper la racine du mal» (p. 413).
(6) «La soif du gain chez les petits-bourgeois, fouettés par des années de marché noir, était sortie de toute mesure, et personne ne faisait plus rien que pour de l’argent, le plus d’argent possible. Des masses de gens prétendaient tout à coup vivre sans rien faire, en accaparant des chambres, le plus de chambres possible, en morcelant des pièces, des demi-pièces, des quarts de pièces, en les divisant par des rideaux, en concentrant dans un seul coin tout ce qui était nécessaire à la vie, en installant une douche dans la cuisine, et le cabinet dans la douche ; des usages crapuleux et sordides s’introduisaient dans l’architecture, et le cerveau des architectes était de plus en plus partagé par de petites cloisons, qui se multipliaient à une allure folle, comme un microbe, selon une vitesse mesurable» (pp. 224-5).
(7) Paul Gadenne lut le roman de Bernanos et sembla l'apprécier, si j'en juge par certaines des annotations qu'il laissa sur son propre exemplaire de ce livre, comme j'ai pu m'en assurer en parcourant un document que Didier Sarrou eut l'amabilité de me faire parvenir. Il me semble qu'un tel passage ne peut qu'évoquer, par son rythme, certaines pages de Monsieur Ouine, notamment celui commençant par «C'est maintenant l'heure de la nuit qu'aucun homme ne connaît parfaitement...» : «Ce qui chagrinait Didier, c’était de ne pas savoir quand reviendraient les Maillechort, afin de pouvoir diviser son temps et fonder son travail en fonction de leur retour. Les jours s’allumaient et s’éteignaient, les astres glissaient sur la prairie à Beauchamp, sur le toit luisant de Stellamare, sur les chemins où des troupeaux de séminaristes rougeauds passaient dans leurs longues robes noires en pressant le pas, flanqués du parapluie de l’escouade, sur les parcs où le jardinier s’arrêtait de balayer pour savourer un mégot trouvé parmi les feuilles, où les chiens noirs s’attardaient en rêvant. Glissaient sur les rues, les avenues bien huilées, les toits de tuiles des villas heureuses où des familles se déchiraient, où des propriétaires méditaient de nouveaux accaparements, où Mme Chotard calomniait au service du Seigneur : parfois Didier, planté derrière un rideau, la voyait passer dans la rue, levant un regard prolongé vers sa fenêtre, comme si elle le suppliait d’apparaître. […] Glissaient sur les bonnes intentions et les mauvaises, sur les dames et sur les messieurs, sur les putains et sur les pucelles; sur les soucis distingués des belles. Glissaient sur les villes, sur les terres, les banlieues grouillantes, les usines crachant la fumée, les vies sans repos, sans bonheur, sur les mineurs asphyxiés dans leurs mines, qui mouraient loin de leurs femmes, de leurs gosses, loin du ciel et loin des astres qui glissaient, glissaient sur le faste des feuilles, sur l’avidité des marchands et sur l’ordure de l’or; sur la dureté de ceux qui possèdent et la charité de ceux qui n’ont rien» (p. 453).
(8) «La chrétienté était devenue une espèce de raison sociale, d’affiche électorale, un panneau publicitaire. Cela voulait dire mépris, orgueil, injustice. Personne n’avait plus d’amour pour personne» (p. 391).
(9) «En ajoutant une ressource nouvelle à l’absurdité des contingences, la technique finissait le plus simplement du monde par vaincre la technique, et l’humanité, le plus simplement du monde, retournait non peut-être à la barbarie, mais à l’abrutissement, par le chemin implacable du progrès» (pp. 630-1).
(10) «Plus loin les femmes étaient penchées sur un lavoir; Betty, qui n’avait jamais lavé quoi que ce fût, les envia, envia leur tranquillité, la paix de leurs gestes. Des laveuses d'épopée rustique. Image de fraîcheur, de début du monde, vite disparue, éclatée, dispersée en mille morceaux de l’autre côté de la route, de l’autre côté du temps. Pourquoi la vitesse ? Pourquoi, sinon pour pulvériser le monde, n’avoir plus à penser, cesser de ramper sur le sol, de s’égratigner aux rugosités de la terre ?» (p. 631). Betty mourra dans un accident de voiture, au côté de l'époux de Mme d'Hem, qu'elle aura tenté de secourir en abandonnant Didier.
(11) La version comique de cette maladie du langage nous est donnée par les pages savoureuses où Gadenne décrit par le menu le langage qu'utilise une femme à tout faire, Katia lorsqu'elle s'occupe de ses poules, cf. p. 144.
(12) «Il y a ceux qui croient facilement, a encore dit Lambert en soulevant son massicot, et il y a ceux qui ne croient que sur la croix, à qui la croix est donnée plus que le «Je crois», et pour cela ils ne seront pas moins bien traités que les autres, parce que le Christ est avec eux, avec sa croix, même s’ils n’y croient pas, même s’ils croient l’opposé, même s’ils disent non» (p. 463).




























































 Imprimer
Imprimer