« Le Jour de l’effondrement de Michèle Astrud, par Gregory Mion | Page d'accueil | L'Amérique en guerre (6) : Jack Kerouac de guerre lasse, par Gregory Mion »
18/08/2016
La littérature sans idéal de Philippe Vilain

Photographie (détail) de Juan Asensio.
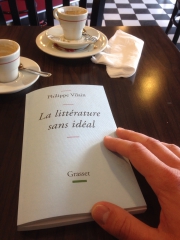 Acheter La littérature sans idéal sur Amazon.
Acheter La littérature sans idéal sur Amazon.Il est frappant de constater que des remarques et des analyses souvent justes, à condition toutefois qu'elles soient débarrassées de leur ridicule jargon pseudo-technicisant, sont presque immédiatement frappées d'inanité par le présupposé qui guide Philippe Vilain dans son ouvrage : ne réfléchir qu'en se servant de la matière brute, à vrai dire stupide, que constitue la «littérature contemporaine» que l'auteur définit en affirmant qu'il s'agit de «la littérature la plus médiatisée, la plus primée, la plus vendue aussi, au détriment d'une autre, minoritaire et moins représentée» (Note 1 de la p. 13), sans doute celle qu'il serait infiniment plus intéressant que l'auteur analysât.
Philippe Vilain va plus loin et ne se contente pas de définir son champ, fût-il aussi vaste qu'une flaque de vomi, un soir de raout parisien : il estime que cette littérature enfin, à mon sens, la littérature, par opposition à la farce commerciale plus haut décrite, est «sans doute amenée à disparaître», puisqu'elle «ne pourrait économiquement pas subsister sans la première qui, si l'on peut dire, la subventionne, et dont le plébiscite doit être symptomatique du goût et de l'esprit présidant à la littérature contemporaine». Si j'ai bien compris le propos de Philippe Vilain, mieux vaut prendre comme corpus des œuvres qui n'en sont point, puisque ces rinçures doivent finalement parfaitement correspondre aux attentes et aux goûts de lecteurs qui n'en sont pas davantage ! Et même : cette littérature contemporaine qui, pour le coup, et dans un sens qui n'était évidemment pas celui que Claude Mauriac donnait au terme qu'il avait forgé, est une véritable alittérature, une littérature sans littérature, un ad-verbe sans Verbe comme je l'ai écrit, se voit légitimée doublement par Philippe Vilain puisque, sans son existence, les vrais livres n'existeraient tout simplement plus.
 Comme il est commode, par ailleurs, pour cet auteur, de ne critiquer que la littérature, le on honni des philosophes, et de ne jamais oser s'en prendre nommément à tel ou tel ! Voyez notre prudent prendre grand soin de se parfumer, de se mettre des gants et un masque et, avant de se pencher sur le cadavre de la littérature française, de nous lâcher le maigre Sésame ouvre-toi de sa pratique de pseudo-médecin légiste : «je voudrais préciser d'emblée ce que j'entends pas ce terme [le désenchantement] en ces temps soupçonneux et inquiets, car le désenchantement dont je parle ne consiste pas en un jugement de valeur que je formerais sur la littérature, et qui proviendrait du pessimisme antimoderne cher aux prophètes en décadence et autres chantres des fins culturelles, ou d'une conception nostalgique d'un âge d'or de la littérature, voire apocalyptique du monde, censée déterminer des individus vers une régression morale, non, ce désenchantement me paraît être une donnée constitutive, aisément observable, du fonctionnement de la littérature, de sa vision et de son mode de pensée», et Philippe Vilain de conclure sa maigre expertise d'une clausule digne d'un fonctionnaire de jargon blanchotien pour colloque d'experts du rien : «le désenchantement de la littérature est de nourrir une croyance vide à son propos» (p. 10). Oublions les noms, petits, moyens ou grands, minuscules pour ce qui est de la littérature française contemporaine, au travers desquels cette littérature prend forme et voix
Comme il est commode, par ailleurs, pour cet auteur, de ne critiquer que la littérature, le on honni des philosophes, et de ne jamais oser s'en prendre nommément à tel ou tel ! Voyez notre prudent prendre grand soin de se parfumer, de se mettre des gants et un masque et, avant de se pencher sur le cadavre de la littérature française, de nous lâcher le maigre Sésame ouvre-toi de sa pratique de pseudo-médecin légiste : «je voudrais préciser d'emblée ce que j'entends pas ce terme [le désenchantement] en ces temps soupçonneux et inquiets, car le désenchantement dont je parle ne consiste pas en un jugement de valeur que je formerais sur la littérature, et qui proviendrait du pessimisme antimoderne cher aux prophètes en décadence et autres chantres des fins culturelles, ou d'une conception nostalgique d'un âge d'or de la littérature, voire apocalyptique du monde, censée déterminer des individus vers une régression morale, non, ce désenchantement me paraît être une donnée constitutive, aisément observable, du fonctionnement de la littérature, de sa vision et de son mode de pensée», et Philippe Vilain de conclure sa maigre expertise d'une clausule digne d'un fonctionnaire de jargon blanchotien pour colloque d'experts du rien : «le désenchantement de la littérature est de nourrir une croyance vide à son propos» (p. 10). Oublions les noms, petits, moyens ou grands, minuscules pour ce qui est de la littérature française contemporaine, au travers desquels cette littérature prend forme et voixTout lecteur, même superficiel, du vieux et grisâtre mage Blanchot qui, à tout le moins, tentait encore d'évoquer sa quête du Neutre en offrant à ses lecteurs comme la chronique d'une disparition annoncée de son écriture, a mille et mille fois lu ce genre de propos qui assimilent la littérature à une espèce de contrée sans frontière, faune ni flore, pure abstraction de mathématicien, grande voix anonyme ou bouche d'ombre hugolienne qui de temps à autres se servirait des pauvres écrivains, à leur corps défendant, comme de poupées ventriloques. Ce langage absolument neutre ou plutôt vide, qui évoquerait sur le même plan Tatania de Rosnay et Cristina Campo, William Faulkner et Mathias Enard, Hermann Melville et Yannick Haenel, permet à Philippe Vilain, tout en posant un constat savant (disons encore, technicien plutôt que savant) sur le mal qui ronge la littérature, de ne froisser personne : puisque «la littérature triche et ment sur son statut propre» (p. 11), c'est donc qu'il n'existe aucun auteur qui triche ou ment, c'est donc qu'il n'existe aucun imposteur dans l'heureuse République des lettres, et que toutes nos belles et surtout honnêtes âmes sont le jouet d'une prodigieuse marâtre qui se joue d'eux et qui a pour nom, tout aussi impersonnel qu'on le souhaitera, la littérature ! Il est d'ailleurs amusant de constater que le seul bandeau publicitaire que Grasset ait désiré apposer sur le livre de Philippe Vilain est un très anonyme «Pour le style», équivalent probable d'un tout aussi virulent «Pour le yaourt» ou bien «Pour la marche à pied». Oui, être pour le style comme pour la belle langue ou le bel ouvrage, voilà qui ne peut que contenter, et à peu de frais, toute la bancale et aphone ménagerie des lettres, des plus immondes vivandières et des plus scrofuleux aphasiques aux quelques rares écrivains dont la France peut encore s'honorer : Pierre Mari, Guy Dupré ou encore Christian Guillet ! C'est bien simple : Philippe Vilain pourrait reprendre à son compte une critique de Jean Paulhan, qu'il ne cite jamais, à l'inverse des habituels Roland Barthes (cf. p. 134) et Gérard Genette (cf. p. 136), muses de tous les perdreaux de l'Alma Mater universitaire : «L’on dirait étrangement que le critique a, de nos jours, renoncé son privilège, et quitté, sur les lettres, tout droit de regard» (1). Ici, ce privilège du critique, nous le revendiquons assez fort et même le défendons au besoin contre la marée montante de merde.
Je ne suis donc pas en désaccord avec le constat que pose Philippe Vilain dans ses quelques pages très éclairantes, à vrai dire suffisantes, de présentation, autour desquelles le reste des chapitres ne fera rien de plus que revenir, mais me gêne prodigieusement l'absence d'engagement de l'auteur. Qu'est-ce que Philippe Vilain si nous osions le comparer à un Charles Du Bos, un Albert Béguin, un Stanislas Fumet, un Gaëtan Picon ? Un critique de peu de poids tout d'abord, ensuite un pleutre, un pudique extrême tout du moins qui, par peur de devoir filtrer quelques tonneaux de merde, préfère se réfugier dans le tableau impeccablement tracé des petites grilles de lecture. Les classifications séduisent et rassurent toujours les médiocres, alors que les grands, eux, c'est sans compas ni équerre qu'ils se lancent sur les flots démontés ! Oui, tout se passe comme si «cette littérature ne se construisait plus sur un sentiment de la langue, mais sur un ressentiment de sa langue, je veux dire, comme si elle s'écrivait depuis l'irréligion de son Verbe» (p. 14), formule frappante, blanchotienne pour changer, mais creuse, puisque la coquille vide ne contient aucun exemple, aucun nom, ne montre rien de plus que le simple fait que tel ou tel écrivant et non écrivain, justement, ne possède plus et, allons plus loin, ne veut surtout plus posséder quelque sentiment que ce soit de la langue, de sa langue, fût-il un avorton de sentiment, un sentiment nain, microscopique, tout frappé d'indignité littéraire. Oui encore, cette littérature cadavérique, exsangue, qui est l'objet de la dissection de Philippe Vilain, «se satisfait de perdurer industriellement sur ses propres ruines, sans Dieu ni maître spirituel, sans valeur supérieure ni idéal qu'elle forgerait depuis son histoire, sans un modèle de perfection depuis lequel elle s'écrirait, fût-ce en s'y opposant» (p. 15), et, oui encore, comment ne point être d'accord avec une analyse que je mène depuis des années, lorsque je lis que, sans «idéal, sans s'inscrire dans un rapport vertical, la littérature ne vaut plus qu'horizontalement, dans la similarité des valeurs de son temps et un nivellement militaire qui, rasant le crâne de toute singularité, l'anonymise dangereusement : une littérature ne s'inscrivant dans aucune histoire, ne s'enracinant dans aucun héritage, sera-t-elle capable, ce faisant, de produire une histoire ?» (p. 16, l'auteur souligne). Ridicule question du reste, dont nul ne nous fera penser que le si prudent Philippe Vilain n'en connaît la réponse. Pourquoi, encore, feindre de s'interroger sur l'état calamiteux des lettres françaises, puisque c'est bien davantage du constat de cette déréliction qu'il faudrait partir ?
Le reste de l'ouvrage de Philippe Vilain présente ces mêmes défauts, rédhibitoires à mes yeux, et qualités, vagues, contenus dans les passages que je viens de noter : une volonté d'analyse du désenchantement de la littérature contemporaine, quitte à l'enfermer dans de petites cases qui feront les délices des professeurs (comme celle du «présentisme», cf. p. 31 et sq.), alors même que cette volonté analytique prétend forer profond sans jamais critiquer l’œuvre d'un de ces auteurs sans voix, impuissants et, corollaire de l'impuissance une fois sur deux, prétentieux. Il n'est pas tout à fait vrai d'affirmer que Philippe Vilain conserve, systématiquement, y compris devant la plus parfaite nullité que représente tel roman contemporain (comme l'ignoble Pas pleurer de Lydie Salvayre, évoqué à la page 38), son calme de jésuite du jargon savant. Il réserve en effet ses coups les plus puissants, ceux-là même que nous eussions aimé le voir distribuer à tant de nullités sur lesquelles il ne pipe mot, à Céline. Il est d'ailleurs assez fascinant que, pour le coup, contre Céline, notre thuriféraire assoupi du Neutre retrouve un vocabulaire éminemment judiciaire, de condamnation morale et de refus de la séparation, en effet commode, entre les romans de l'auteur et ses idées, monstrueuses nous le savons selon le commandement que nous sommes, tous, tenus de répéter pieusement, ou bien au risque, en paraissant le critiquer, de passer pour un fou, ou bien un antisémite, c'est-à-dire un fou au carré : «Nombreux sont ainsi les célinolâtres qui, pour réhabiliter leur idole, s'ingénient à ce révisionnisme critique, à ces compromissions de la conscience, à ces acrobaties morales qui obligent à transiger avec le texte, comme, par exemple, d'hyperboliser l'inventivité poétique afin d'édulcorer la monstruosité des thèses racistes soutenues par Céline, notamment celle contre la minorité juive dans Bagatelles pour un massacre» (p. 21, l'auteur souligne).
Philippe Vilain évoquera une nouvelle fois, plus longuement et en l'opposant cette fois à Proust, le cas de Céline (2), qu'il déteste sans s'en cacher, mais ce n'est point à vrai dire l'objet de son livre, ni même de cette note qui l'évoque. L'objet de ce livre étrange, point faux mais sans beaucoup d'âme et encore moins de tripes qu'est La littérature sans idéal, paradoxal ouvrage de critique qui jamais ne critique, comme un molosse qui aurait été éduqué à ne surtout jamais mordre, est l'analyse stratosphérique, dont le propos, une nouvelle fois, est si parfaitement blanchotien qu'il se dilue dans la généralité ouatée des cumulonimbus de l'évidence : «toute littérature naît de la littérature, toute œuvre naît d'une précédence, toute écriture se construit sur les ruines d'une ou plusieurs autres écritures : de littérature, d’œuvre ou d'écriture, sans doute n'en est-il aucune qui ne trahisse sa filiation et n'est, plus ou moins consciemment, l'héritière de quelques autres, dont il serait aisé de suivre la traçabilité, de retrouver l'invisible généalogie» (p. 25). Cette évidence est bien sûr de moins en moins vraie, car la littérature française contemporaine semble rejeter celle qui l'a précédée et de laquelle elle est née, même si elle feint de l'ignorer ou même, de plus en plus sûrement, l'ignore bel et bien, Philippe Vilain rappelant à juste titre qu'il faut «creuser pour demeurer en surface, s'enraciner pour fleurir», puisqu'une «postérité certaine ne [peut] se trouver qu'à la condition d'excéder son temps» (p. 29).
C'est retrouver le présentisme déjà évoqué plus haut, que Philippe Vilain caractérise comme étant la seule préoccupation d'un écrivant obsédé d'autofiction, de biofiction ou de docufiction (cf. pp. 42 et sq.) nous nous en moquons, pour lequel «le passé littéraire n'a plus d'avenir», le «faible voltage ampoulé» du passé n'éclairant «jamais mieux que le survoltage halogène du présent, qui, seul, au vérisme de son histoire, demeure détenteur de sens et de vérité» (p. 34). Ce présentisme n'est pas un humanisme puisqu'il semble uniquement obsédé par le moi du lilliputien écrivant : «pourquoi pas moi, semble penser l'écrivain contemporain, après tout, le roi a le même corps que nous, et le crépuscule des idoles annonce enfin notre aube» (p. 41), n'est-ce pas ? Ce présentisme est également autotélique et incapable de ressasser inutilement autre chose que l'événement érigé en totem, proposant ainsi une «alternative à la littérature journalistique» (p. 44) qui nous semble peu crédible, la «proximité dans le temps de ce réel» étant d'ailleurs «si frappante que sa connexion permanente à l'actualité, au présent historique», finit «par abolir toute notion du temps» (p. 45).
Par ces quelques mots, Philippe Vilain définit ce qu'il nomme la littérature post-réaliste, qui est, encore une fois, la dilatation d'une pupille uniquement obsédée d'elle-même, l’œil voyant étant devenu «un œil subjectivant, participant, activant, non plus spectateur mais acteur de l'histoire, qui, par la fiction, majusculise sa perception» (p. 47, l'auteur souligne).
Mais un œil, aussi prodigieux qu'on le voudra, et Dieu sait que notre siècle est celui des yeux, comme celui de Rimbaud fut le siècle des mains, ne sera jamais une bouche, encore moins une voix capable de chanter le monde. Fort justement, Philippe Vilain affirme que «le sens s'est dilué dans le karaoké du monde», la quête inlassable de l'événement à tout prix n'étant plus «l'événement du dire ni de la langue» : ainsi, «La reproductibilité du discours, fût-ce par la fiction, reconnaît précisément, dans son bégaiement, dans ses redites et son ressassement, son insuffisance à dire le réel, et donne une idée de la menace qui pèse sur elle : son épuisement sémantique annonce, en creux, la défaite du langage, pour ne pas dire le triomphe de l'image, du visuel» (p. 61).
Ce que Philippe Vilain appelle, conséquemment, la «selfication des esprits», à savoir l'attitude «par laquelle un individu manifeste un souci de lui-même, se photographie par l'écriture» (p. 63) est le signe d'une perte irrémédiable d'intérêt, de pesanteur tout autant que de matière, et, au premier chef, de matière verbale : «Désormais, le roman agit sans plus faire du langage une survenue méditative, réflexive : il ne veut plus, ou ne peut plus, mettre en scène l'aventure intérieure de ses personnages» (p. 80), encore moins figurer ce que figure tout grand roman, à savoir une «aventure de l'écriture» (p. 81).
Prudemment trop prudemment, Philippe Vilain affirme que la littérature contemporaine «donne l'impression de ne plus s'écrire et de ne plus fonder sa croyance sur le fétichisme de la langue, une langue qu'elle renonce à transformer comme à en faire son enjeu, son immanence» (p. 84). Nous sommes ici en territoire connu, celui que j'arpente désormais depuis plus de douze années, où j'ai entreposé, bien empilés, les cadavres, pas même puants mais secs et saponifiés, de ce que Philippe Vilain appelle la «littérature aphone, castrée» (p. 89), qui paraît «se construire à partir de sa déconstruction», à savoir «le rejet du style», et aussi «devoir son succès à la promotion d'un désécrire, comme son évolution à l'involution de son écrire : la déconstruction de sa pratique de l'écrire vers son degré zéro» (p. 87, l'auteur souligne). De fait, en «se débarrassant du style», la littérature contemporaine, présentiste, soi-mêmiste pour reprendre un terme camusien que j'ai plus d'une fois retourné contre cet auteur si enragé de lui-même qu'il en abolirait le reste de l'humanité, «s'endeuille de son ambition la plus exigeante, de sa spécificité littéraire, celle qui transforme la parole en valeur; elle s'épuise d'elle-même, de l'intérieur, à vouloir renoncer à ses propres ressources» (pp. 87-8, l'auteur souligne).
La littérature contemporaine, que Philippe Vilain, d'ailleurs grand amateur d'autofiction, ce genre eunuque dont il ne cesse de théoriser l'indigence et de noter, méticuleusement, les progrès de son érection imaginaire, caractérise comme étant, en somme, une aphasie littéraire et une réussite commerciale, est produite par «l'écrivain du dimanche» qui «ne veut pas s'immerger pendant de longues années dans une œuvre», ni «consacrer sa vie à l'écriture, socialement valorisante mais peu rémunératrice» (p. 121). Il est à ce titre particulièrement drôle de constater que Philippe Vilain, un homme qui rarement s'énerve, nous l'avons vu, sauf contre Céline, n'hésite absolument pas à tancer vertement les sans-grade, celles et ceux, auteurs d'un jour ou d'un quart d'heure de gloire virtuelle, qui se prétendent, à leur tour, auteurs, voire critiques. C'est ainsi qu'il reprend le bon mot de l'inepte Philippe Sollers, ce cancre des cancres, cet imposteur au carré, affirmant, mais il a raison pour une fois !, que tout le monde est écrivain sauf lui (cf. p. 123), mais, lui, Philippe Vilain donc, pour s'en offusquer, probablement parce qu'il estime, bien à tort ou parce qu'il cherche, comme tant d'autres, à attirer le regard du vieux faune perclus, que le père spirituel des immondes et nullissimes Haenel et Meyronnis, est un écrivain véritable, tout comme il estime que les critiques indigentes de Nathalie Crom, rédactrice en chef de Télérama (cf. p. 139) moqué par l'excellent Pierre Mari, valent plus qu'un pet de moineau germanopratin. Philippe Vilain manque ainsi de s'étrangler de colère lorsqu'il écrit : «Quand la critique d'opinion outrepasse ainsi sa liberté et ses droits, revanche des non-qualifiés et des illégitimes, elle atteint son degré le plus méprisable» (p. 138). Dieu, que la colère des médiocres tout enflés de suffisance est immanquablement drôle, qui s'efforce de cacher, sous des apprêts hypothético-déductifs, une petite hargne de roquet !
Je pense être, aux yeux du très docte, du très jargonnant et donc du très inutile Philippe Vilain un de ces méprisables non-qualifiés, et je suppose, sans même prendre le soin de vérifier ce point, que son ouvrage a dû être comme il se doit salué par Télérama et quelques autres médias de cancres bavards qui tiennent l'autofiction pour davantage qu'un jeu de potache tout surpris de se découvrir un vit flaccide, avec lequel jouer et tenter d'impressionner la cousine Berthe. Quelle cruelle ironie tout de même pour Philippe Vilain que ce soit celui qui, pour le coup, manie une critique qui est l'inverse même de la non-parole journalistique qui «n'est plus si libre, en fait, de s'exprimer comme elle l'entend», puisqu'elle est «prisonnière d'obligations qui la dépassent comme d'une logique marchande» (p. 141), qui jamais n'a fait «passer frauduleusement, aux douanes de la conscience critique, de la littérature médiocre pour de la littérature» (p. 142), qui juge son livre, et, allusion que comprendra l'auteur et tout lecteur de cet ouvrage, qui affirme que 16 euros, c'est tout de même un peu cher pour un essai ménageant la chèvre et le chou, et même la bouse et le cul qui l'a lâchée, l'exigence critique aujourd'hui disparue de la presse française et la nullité d'un corpus qui n'est jamais analysé, encore moins critiqué dans son détail, Philippe Vilain refusant de porter le débat sur la question essentielle : l'écriture d'une œuvre, non point son prix purement commercial (cf. pp. 154-5) donc, mais, véritables absentes de tout bouquet, sa valeur, sa portée, son style et, partant, problématique volontairement tue, une critique littéraire digne de ce nom et capable, le cas échéant, d'en stigmatiser l'indigence.
Notes
(1) Jean Paulhan, Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres (Gallimard, coll. Folio essais, 1990), p. 23. L'auteur souligne.
(2) Philippe Vilain fait de Proust l'écrivain par excellence de l'itératif, défini comme étant le fait de «raconter une fois ce qui nous est arrivé plusieurs fois», par opposition au pullulement actuel des écrivains appartenant à «l'empire du singulatif (raconter une fois ce qui nous est arrivé une fois)» (p. 101). Proust, maître de l'itératif, devrait encore être le maître de nos pitres et piètres écrivants contemporains, car la notion d'itérativité «permet à celui qui en fait l'usage de s'envisager et de se concevoir abstraitement dans le temps, non dans une permanence, mais dans une unité idéale, de proximité distante, par le prisme d'une instance d'énonciation narrative qui en est la somme, qui en assume l'identité : celle d'un je retrouvé, accompli» (pp. 101-2). Philippe Vilain continue d'opposer le présent singulatif, «présent de facilité», le «temps du direct, du live» (p. 105, l'auteur souligne), au temps retrouvé que permet l'itératif, passé reconquis dans l'acte d'écriture éternellement rejoué, présent gagné de haute lutte en somme. C'est à partir de la page 109 que l'auteur attaque rudement Céline, qualifié d'apôtre de ce qu'il appelle «l'oralitécrite» et qui n'est qu'une forme d'«inexigence récréative», une impasse donc. Il poursuit, affirmant que «Céline ne réhabilite personne, il laisse ses personnages dans l'égout et le dégoût où il les a trouvés, dans l'aliénation où il les admet : point de rémission par la morale, de rédemption par le style, de salut par la poétique dont l'oralité régressive dégrade et déshumanise, se soumet à la dictée de son nihilisme, de son racisme social, de sa détestation du peuple» (p. 112). Et l'auteur d'enfoncer le clou, quitte à déplaire fortement aux plus que vagues continuateurs de Céline, comme le très insignifiant Émile Brami ici méchamment étrillé, en affirmant qu'il y a toujours «quelque chose de profondément ironique à constater que le grand lectorat choisit toujours Céline contre Proust et trouve précisément dans ce singeur méprisant de populace son porte-parole. Car le médecin des pauvres n'est sans doute, si l'on y songe, qu'un écrivain pour les riches, dont le vœu de popularité œuvre facticement dans une langue parodique réduite à la dérision, et qui, en réalité, se donne avant tout comme une esthétique du dominé, une écriture du pauvre pour les littérateurs, une poétique décultivée destinée à des lecteurs cultivés capables de jouir de l'exotisme social et culturel qui, souterrainement, y opère. Le populisme de Céline confine à un engagement esthétique stérile, à une provocation stylistique, à une poétique vide qui est loin d'avoir la dimension politique de la poétique d'un Genet, le chantre des bannis qui fait entendre subtilement leur voix dans une sublime langue classique volée, justement, à l'ennemi bourgeois» (p. 112, l'auteur souligne).




























































 Imprimer
Imprimer