« Ce Dieu qui n'en finit pas de crever... | Page d'accueil | Le Désespéré de Léon Bloy »
11/11/2015
Julien Gracq, Jean-Philippe Domecq et Pierre Jourde face à la comédie de la critique littéraire

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Jean-Philippe Domecq dans la Zone.
Jean-Philippe Domecq dans la Zone. Études sur le langage vicié.
Études sur le langage vicié.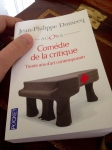 Jean-Philippe Domecq, avec le volumineux livre regroupant trois ouvrages qui vient tout récemment de paraître chez Pocket (1), illustre d'abondance le constat imparable que Julien Gracq, dans un petit texte aussi vif que lucide et devenu, justement et presque immédiatement, fameux voici plus d'un demi-siècle, La Littérature à l'estomac (2), jeta contre les marchands du Temple qui sont, avant tout, des marchands de poissons. Il serait faux de me faire remarquer que l'un, le premier, vise la critique d'art en priorité alors que l'autre se préoccupait, exclusivement, de critique littéraire puisque, dans les deux cas, c'est bien un délire verbal que ces deux auteurs, l'un dans un coup de colère aussi crâne que son refus de recevoir le Prix Goncourt, l'autre dans une méthodique et patiente déconstruction de la parole devenue baudruche stratosphérique des thuriféraires de l'art contemporain, ont prétendu dégonfler, à tout le moins tenté de ramener à des proportions à peu près acceptables.
Jean-Philippe Domecq, avec le volumineux livre regroupant trois ouvrages qui vient tout récemment de paraître chez Pocket (1), illustre d'abondance le constat imparable que Julien Gracq, dans un petit texte aussi vif que lucide et devenu, justement et presque immédiatement, fameux voici plus d'un demi-siècle, La Littérature à l'estomac (2), jeta contre les marchands du Temple qui sont, avant tout, des marchands de poissons. Il serait faux de me faire remarquer que l'un, le premier, vise la critique d'art en priorité alors que l'autre se préoccupait, exclusivement, de critique littéraire puisque, dans les deux cas, c'est bien un délire verbal que ces deux auteurs, l'un dans un coup de colère aussi crâne que son refus de recevoir le Prix Goncourt, l'autre dans une méthodique et patiente déconstruction de la parole devenue baudruche stratosphérique des thuriféraires de l'art contemporain, ont prétendu dégonfler, à tout le moins tenté de ramener à des proportions à peu près acceptables. Les marchands de poissons existent toujours bien sûr. Ils se sont même multipliés depuis l'époque, pas si lointaine que cela, où l'auteur du Beau ténébreux considéra comme une méprise d'être récompensé par une obole pécuniaire autant que médiatique, donc deux fois vile, et cela d'un geste point noble mais tout simplement cohérent avec ce qu'il pensait être son rôle d'écrivain, geste inimaginable aujourd'hui qui suffit pourtant à nous faire mesurer la servilité abjecte de nos derniers lauréats, Lydie Salvayre et Mathias Enard, tout pressés, eux, de recevoir cette consécration pour écrivant subalterne. Ni Gracq, ni même Pierre Jourde qui parodia pour s'en lamenter plus que s'en réjouir le titre de l'auteur du Rivage des Syrtes, ni, donc, Jean-Philippe Domecq qui initia les plus fameux combats contre la valetaille journalistique sollersienne voici quelques années, n'ont pu faire quoi que ce soit contre la multiplication exponentielle, journalistique, infra-verbale et animalculeuse, de ces marchands de poissons, et surtout, ils n'ont rien pu faire pour les empêcher de remettre des prix à des écrivants tout pressés de les recevoir et qui n'auraient même pas peur de lécher du jus de charnier pourvu qu'on leur affirmât que quelque microbe de gloire médiatique s'y trouvât.
Les marchands de poissons existent toujours bien sûr. Ils se sont même multipliés depuis l'époque, pas si lointaine que cela, où l'auteur du Beau ténébreux considéra comme une méprise d'être récompensé par une obole pécuniaire autant que médiatique, donc deux fois vile, et cela d'un geste point noble mais tout simplement cohérent avec ce qu'il pensait être son rôle d'écrivain, geste inimaginable aujourd'hui qui suffit pourtant à nous faire mesurer la servilité abjecte de nos derniers lauréats, Lydie Salvayre et Mathias Enard, tout pressés, eux, de recevoir cette consécration pour écrivant subalterne. Ni Gracq, ni même Pierre Jourde qui parodia pour s'en lamenter plus que s'en réjouir le titre de l'auteur du Rivage des Syrtes, ni, donc, Jean-Philippe Domecq qui initia les plus fameux combats contre la valetaille journalistique sollersienne voici quelques années, n'ont pu faire quoi que ce soit contre la multiplication exponentielle, journalistique, infra-verbale et animalculeuse, de ces marchands de poissons, et surtout, ils n'ont rien pu faire pour les empêcher de remettre des prix à des écrivants tout pressés de les recevoir et qui n'auraient même pas peur de lécher du jus de charnier pourvu qu'on leur affirmât que quelque microbe de gloire médiatique s'y trouvât. Lorsqu'une corporation se développe à une telle vitesse, il y a fort à parier que la qualité et la fraîcheur de la denrée proposée (du poisson) ne soient absolument pas le premier souci de nos tripoteurs d'étrons de vase. Nous l'avons vu, voici quelques jours, avec la remise, triomphale, du Prix Goncourt à Mathias Enard pour son gras loukoum tout luisant d'un orientalisme de bazar germanopratin intitulé Boussole, incontrôlable diarrhée contenant de parcimonieux et heureusement dissolvables grains de sable de Paris Plage plutôt que du Sahara, déjà prête à l'emploi non seulement pour la prochaine et hélas inévitable parution d'un livre énardien, mais aussi pour l'événement le plus insurpassablement éventé pour beauf parisien à pieds et cerveaux palmés qui aura lieu, hélas aussi, l'année prochaine, consacrant une très évidente grande œuvre romanesque ointe, seule, parmi plusieurs centaines d'autres toutes lues, comme cela ne peut qu'être évident, avec le plus grand soin, par le saint-chrême souplino-journalistique. L'avantage d'un poisson, sur nos carpes journalistiques, éditoriales et écrivantes, est qu'il se tait, alors que nos animaux de bocal fossilisé, eux, ne cessent de l'ouvrir, cette bouche sale de laquelle il ne sort pas plus de mots réels que du sphincter d'un poulpe des profondeurs. Ils ouvrent la bouche et ne parlent pas, ou plutôt, leurs térébrantes déclarations sont absolument équivalentes à des hoquets de monstre des abysses, chassant, à la lumière chiche d'une bougie pédonculaire, quelques miettes de chair pourrie lentement descendue de la surface lumineuse. Je m'avise que nous sommes désormais comme ces créatures molles, et qu'il nous faut décidément beaucoup nous étirer pour tenter de voir, au-dessus de nos têtes, l'ombre d'une très vague lueur.
Lorsqu'une corporation se développe à une telle vitesse, il y a fort à parier que la qualité et la fraîcheur de la denrée proposée (du poisson) ne soient absolument pas le premier souci de nos tripoteurs d'étrons de vase. Nous l'avons vu, voici quelques jours, avec la remise, triomphale, du Prix Goncourt à Mathias Enard pour son gras loukoum tout luisant d'un orientalisme de bazar germanopratin intitulé Boussole, incontrôlable diarrhée contenant de parcimonieux et heureusement dissolvables grains de sable de Paris Plage plutôt que du Sahara, déjà prête à l'emploi non seulement pour la prochaine et hélas inévitable parution d'un livre énardien, mais aussi pour l'événement le plus insurpassablement éventé pour beauf parisien à pieds et cerveaux palmés qui aura lieu, hélas aussi, l'année prochaine, consacrant une très évidente grande œuvre romanesque ointe, seule, parmi plusieurs centaines d'autres toutes lues, comme cela ne peut qu'être évident, avec le plus grand soin, par le saint-chrême souplino-journalistique. L'avantage d'un poisson, sur nos carpes journalistiques, éditoriales et écrivantes, est qu'il se tait, alors que nos animaux de bocal fossilisé, eux, ne cessent de l'ouvrir, cette bouche sale de laquelle il ne sort pas plus de mots réels que du sphincter d'un poulpe des profondeurs. Ils ouvrent la bouche et ne parlent pas, ou plutôt, leurs térébrantes déclarations sont absolument équivalentes à des hoquets de monstre des abysses, chassant, à la lumière chiche d'une bougie pédonculaire, quelques miettes de chair pourrie lentement descendue de la surface lumineuse. Je m'avise que nous sommes désormais comme ces créatures molles, et qu'il nous faut décidément beaucoup nous étirer pour tenter de voir, au-dessus de nos têtes, l'ombre d'une très vague lueur.J'exagère ? Si seulement c'était le cas ! Voyez ainsi avec quelle jubilatoire bêtise Mathias Enard nous dit ce qu'il pense de Balzac, de l'Orient, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de l'orient des perles composant le collier que, grâce aux royalties que lui rapporte sa Boussole indiquant un seul Nord, celui des meilleures ventes, il va enfin pouvoir offrir à sa maman qui, nous apprend-il en prenant des airs de Sphinx quatre fois millénaire, a toujours cru à son talent de barbouilleur. En somme, le mensonge, la fausseté, le barbouillage ai-je dit, et, pour filer notre métaphore, le mirage, ont remplacé la réalité, tout comme le bruit a submergé le silence, le bavardage de la réclame journalistique la parole vive, réelle, la parole du grand écrivain, et la chair tavelée des carpes de bidet l'éclat des puissants squales qui, naguère, d'un frémissement de nageoire, tuaient de peur tous les poissons-pilotes et rémoras ventousés aux fonds des toilettes tartreuses de quelques forts connus restaurants que la prudence la plus élémentaire m'interdit de citer, et où se réunissent ces cacographes pour célébrer la nullité d'autres cacographes qui remercieront avec larmes et trémolos ces derniers d'avoir salué leur cacographie : «On s’emploie donc», écrit ainsi Pierre Jourde, à fournir au public, «non pas de la littérature, mais une image de la littérature» (3), image qui est peut-être celle, je m'en avise, que l'imbécile selon Lichtenberg voit toujours devant lui, y compris lorsqu'il croit s'oublier en lisant ce qu'il appelle un bon livre : «Un livre est comme un miroir; si un singe s’y mire, d’évidence il n’y verra point un apôtre. Nous n’avons nulle parole pour parler de sagesse à l’abruti. Sage est celui qui, déjà, comprend le sage» (4). Nos marchands de poisson, s'ils se reflètent ailleurs que dans le regard vide de leurs pairs, ce n'est que dans l’œil vitreux des longues créature à chair molle et couleur chassieuse qu'ils ont pêchées dans quelque rigole d'égout dont ils taisent soigneusement l'emplacement, de peur d'attirer la concurrence, mais il est bien vrai que l'inscrutable stupidité de ces besogneux du slogan n'a cure, par essence, d'une quelconque forme de supériorité puisque, pour parodier Lichtenberg, supérieur est celui qui, déjà, comprend le supérieur et que peuvent comprendre, en matière de supériorité, des ânes qui récompensent Boussole et affirment que Soumission est un brûlot contre l'Islam ?
Ce n'est donc pas peu dire que la pêche, comme la littérature et, partant, la critique littéraire, ne sont plus ce qu'elles étaient : les mouches ont pullulé au point de tapisser d'un molleton immonde les cours d'eaux les plus vifs, les truites agiles et zébrées de reflets lumineux ont été supplantées par les congres et les mérous d'eau douce, les pécheurs se sont impatientés au bout de quelques secondes à peine et, faute de prises d'un bon calibre, se sont rabattus sur les têtards.
J'ai forgé, pour décrire le discours prétentieux et faux de la critique littéraire, le terme facétieux, quoique fichtien, de nullitologie, mais il semble que le progrès réalisé dans la classification des monstres ait d'ores et déjà rendu caduc ce néologisme, qui après tout pouvait encore s'appuyer sur quelque molle béquille. Nous n'avons plus aucune béquille, et la radiographie que réalisa Julien Gracq de l'état osseux de tous les beaux parleurs qui l'entouraient montrerait, refaite aujourd'hui, que les semblants de squelette qui tenaient lieu de charpente à ces fantômes bavards se sont à présent réduits en une substance saponifiée à odeur indéterminable, mélange de pourriture, mais parfumée, et de poussière, mais conservée à l'abri d'un ravissant bibelot exposé dans les meilleures librairies parisiennes, qui se repassent ainsi, avec une impatience non feinte, l'urne minuscule où est tassée tout ce qu'il reste de la compacte croûte pulvérulente de la littérature française : «Pour tout dire, on a rarement en France autant parlé de littérature du moment, en même temps qu’on y a si peu cru» (p. 9), voici une remarque fort juste que Julien Gracq assortit immédiatement de cette autre constatation, tout aussi évidente : «On ne sait s’il y a une crise de la littérature, mais il crève les yeux qu’il existe une crise du jugement littéraire» (p. 11).
La crise de la littérature, vieux serpent d'eau douce qu'aucun pêcheur n'a jamais réussi à attraper ni même à entrevoir, me semble infiniment moins prononcée, en tout cas (et de toute façon limitée à la France !), que celle de la critique littéraire qui est, pour dire les choses comme je les pense depuis quelques années tout de même, en état de mort cérébrale. Tout juste parvient-elle, comme je tente de l'illustrer depuis que j'ai créé ce blog dans une salle des marchés, une criée en somme (5), en mars 2004, à ne pas laisser complètement s'éteindre la frêle lumière d'un livre glorieux (6), et à maudire l'inanité de tant d'autres qui s'empilent dans tous les étals de librairie et même, nous l'avons vu, dans les caisses à odeur de marée immobile des poissonniers.
Tout le reste est ordure et publicité de l'ordure, tripotages et exaltation des tripotages, putanat et entretien consciencieux du putanat, des chairs blettes comme des valeurs, les unes comme les autres palpées par des mains dont les doigts boudinés et plein de bagues empoignent moins un livre, fût-ce pour en casser le dos car ces pâles virilités ne sont même plus, qu'elles n'en caressent les pages inexistantes, comme un fantôme frôlerait un diamant brut en espérant l'entailler au bout d'un milliard d'éons de patients efforts. Tout n'est que bavardage et perpétuation taylorisée, clonage industriel du bavardage (Sainte-Beuve, déjà : «Avec nos mœurs électorales, industrielles, tout le monde, une fois au moins dans sa vie, aura eu sa page, son discours, son prospectus, son toast, son auteur. De là à faire un feuilleton, il n’y a qu’un pas. Pourquoi pas moi aussi ? se dit chacun»... Oui, en effet, pourquoi pas moi !), l'opération aboutissant, une fois encore, au triomphe du mauvais rêve ayant pris la place, sans que nous nous en soyons aperçus ou plutôt, avec notre complicité inavouable, de la réalité. Julien Gracq toujours, décidément meilleur critique que romancier : «Car l’écrivain français se donne à lui-même l’impression d’exister bien moins dans la mesure où on le lit que dans la mesure où «on en parle». Il lui faut sans cesse relancer la presse prompte à s’endormir (et moins la critique encore que les échos, qui sont la récompense suprême), il faut tenir les langues en haleine» (p. 31), auquel répond Jean-Philippe Domecq, qui semble ne pas être revenu de ce qu'on a tenté de lui faire avaler, en lui assurant qu'il s'agissait de grandes œuvres d'art : «S’il n’y avait qu’elles [les œuvres]… mais les écrits, les écrits qu’il a fallu pour que ces hallucinations aient force de réel…» (p. 17). Il est étonnant que Gracq comme Domecq utilisent d'abondance la métaphore du discours flottant à vide, qui jamais n'embraie sur le réel, et s'auto-féconde sans relâche. Ainsi l'auteur de Qui a peur de la littérature ? peut-il écrire : «Aucune raison qu’un discours qui trouve moyen de proliférer autour de pareilles formes-tests puisse le moindrement cesser de s’autoreproduire» (p. 33), comparant, souvenir peut-être (7) de l'extraordinaire ouvrage d'Armand Robin intitulé La Fausse Parole, le langage second des commentateurs au novlangue de toute propagande lorsqu'il écrit : «ces mouvements du monde de l’art produisent des objets qui sont prétextes à discours codifiés par l’histoire des avant-gardes où ils s’inscrivent par prescription. Ces discours présentent une analogie de structure avec la scolastique médiévale, l’argumentation jésuite, ou stalinienne. Ils ont en commun la même cohérence finement quadrillée, à vide. Ils se reproduisent sans fin puisqu’ils sont construits en argumentations défensives étanches. À chaque effraction du concret, à chaque menace née du travail de la vérité, ils ont une réponse logique, tout ce qui n’entre pas dans leur logique étant taxé d’incompréhension» (p. 220). Julien Gracq n'a jamais dit autre chose que ce décrochage (8) entre ce qu'il importe de réellement considérer, voir et apprécier, la réalité, et le reflet, mais toujours déformé, de cette dernière, reflet, langage second et arrière-monde trompeur totalement démonétisés (9). Non pas, bien sûr, que le meilleur roman imaginable pourrait nous donner, de cette réalité, une vision éminente, objective, parfaite, définitive en somme. Un grand roman déforme la réalité tout autant qu'un petit, un mauvais roman, sans doute plus même que celui-ci mais, à tout le moins, un grand roman ne la fait-il pas mentir, et la creuse au contraire d'une dimension supplémentaire que le mauvais roman, lui, aplatit en quelques formules toutes faites, en truc qui raviront les ménagères et les journalistes, qui ne sont bien souvent plus que des ménagères, et de la pire vulgarité : l'Orient que peint Mathias Enard (où l'Espagne de la guerre civile de Lydie Salvayre) dans chacun de ses romans boursouflés et faisandés (mêmes les courts présentent ces deux caractéristiques) comparables à une surface de vente franchisée (10) qui prétendrait nous offrir, en plain Paris, la magie d'un Orient qui n'a d'ailleurs jamais existé ailleurs que dans le cerveau des lecteurs de Pierre Loti et de Lawrence d'Arabie, est un décor de carton-pâte qui n'englue que les imbéciles qui confondent une baignade dans les eaux sponsorisées d'Antalya avec une plongée en apnée dans les gouffres glacés que jamais le moindre rai de lumière ne pénètre. En un mot : une imposture.
La critique littéraire, si elle est morte, n'en a pas moins regroupé ses forces et, désormais, accomplissement de la vieille prédiction d'Anatole France (11) et réalisation du constat effrayé de Jean-Marie Domenach (12), est devenue autonome, comme une toupie devenue folle et tournant à vide, mots-valises s'engrossant les uns les autres, catachrèses journalistiques reproduites sur tous les écrans du monde, bavardage engendrant le bavardage dans un autre sens que celui que lui prêtait, peut-être, le si perfide et lucide Sainte-Beuve (13), sans jamais buter sur un atome de matière : «Mais la presse culturelle est dans une telle autonomie de pouvoir, sans compte à rendre à qui que ce soit, que certains journalistes sont portés logiquement, sans être malhonnêtes individuellement, à faire taire tout esprit critique, tout contradicteur, à censurer par mégarde, à tourner entre eux, à perdre le contact avec le réel, donc avec la littérature, que leurs lecteurs commencent à discerner mieux qu’eux et là ça devient gênant» (14).
Alors, que faire ? Comment n'être pas découragé par la bêtise, l'inculture galopante, et d'abord dans les rangs-mêmes de celles et ceux qui sont censés servir la littérature, comment ne pas baisser les bras, comme, plus d'une fois, je l'ai moi-même écrit et ai failli m'y résigner, depuis que, en mars 2004, j'ai créé la Zone ? Comment expliquer par exemple que pas un seul journaliste n'ait relayé, ne serait-ce que d'une ligne approximative, selon l'usage le mieux partagé de cette corporation, le long et méthodique travail que j'ai publié sur des correspondances pour le moins troublantes entre deux romans récents, dont l'un sous les feux du tout-Paris journalistique ? Faut-il croire, comme Jean-Philippe Domecq dans Qui a peur de la littérature ?, que nous avons, manifestement, touché le fond de la crasse inculture, de la consanguinité et de l'imposture, que nous sommes à jamais englués dans les sables mouvants d'une parole qui s'est enfermée dans son délire narcissique, et qui ne rend plus aucun compte ? : «Les périodes creuses sont les plus fréquentes dans l’histoire littéraire; elles présentent l’intérêt de faire toucher le fond et là le danger d’étouffement culturel devient trop perceptible pour qu’il n’y ait pas de sursaut» (p. 94). Où est le sursaut ? Faut-il au contraire craindre le pire, la disparition de la littérature, submergée par un océan de merde plutôt que par l'une de ces innombrables catastrophes que j'ai évoquées dans cette série consacrée aux romans post-apocalyptiques, comme d'ailleurs ne manque pas de s'en affliger ce même auteur, lorsqu'il écrit : «Cela dit, on peut encore se taire, et compter que la vive littérature pourra s’enclore, comme autrefois l’écriture, en abbayes bientôt bardées de fax, d’ordinateurs, et bordées de campus où liront quelques lecteurs réchappés du formidable commerce culturel qui pendant ce temps sur toutes les ondes du monde parlera, en les faisant parler, des grands auteurs du siècle» (Ibid., pp. 120-1). Va-t-il falloir se barricader contre les hordes de barbares et, afin de les sauver d'un salutaire autodafé, recopier en cachette les textes d'Angot, de Nothomb, de Binet, d'Assouline ou bien d'Enard, pour édifier les générations futures, s'il en reste, et leur montrer ce qu'écrire comme on chie a, il n'y a pas si longtemps que cela, signifié ?
Une disparition de la littérature, due, d'abord, à une disparition de la critique littéraire véritable, à cran d'arrêt, confondue avec l'indigne comédie de la critique journalistique putassière et de la pléthore de prix récompensant, neuf fois sur dix, des rinçures (15), et ayant laissé place à la prolifération devenue incontrôlable du bavardage journalistique, qui l'eût cru ? Qui de nous, s'interroge ainsi Jean-Philippe Domecq, «est prêt à envisager, ne serait-ce qu’envisager, qu’il arrive à l’art ce qui arriva à l’Histoire et à Dieu, de périr comme croyance englobante, en un ultime lever de rideau sur le réel ? Le réel ainsi laissé serait : l’homme, sans signe particulier, aura été un animal technicien et marchand, rien que marchand et technicien» (Ibid., p. 150). Prêts, nous le sommes, à envisager cette disparition paradoxale, puisqu'elle se donne désormais dans son excès d'insignifiance et de verbe devenu fou, tout comme la Parole vive a été recouverte par la lèpre des commentaires, dans un parallèle qui, lorsque Henri Raczymow le réutilise, n'est déjà plus une nouveauté depuis quelques lustres tout de même (16) : «Dieu est mort, et on en parle encore, et on n’en parle plus; la littérature est morte, et pourtant elle entretient le commentaire sophistiqué, l’exégèse savante ou le bavardage insipide. Mais on n’en parlera, à son tour, bientôt plus. Tout comme les morts dans nos familles. D’abord des souvenirs partagés, puis des souvenirs évoqués devant ceux qui nous suivent et n’ont pas connu les gens. Puis le silence» (17). J'ai moi-même pointé cette corrélation, sur les brisées de George Steiner, en parlant d'une littérature qui n'était plus ad-verbe de Dieu.
Une disparition de la critique littéraire, mais qui la pleurerait, si ce n'est ces ombres d'ombres perpétuellement bavardes et exsudant leur incompétence qui, aujourd'hui encore plus qu'hier, disposent de tous les pouvoirs au sein des salles de rédaction ? Pour sourire voire franchement rire, je n'ai qu'à imaginer la tête que ferait Caïn Marchenoir, le Désespéré de Léon Bloy, s'il s'avisait d'assister à l'un de ces raouts mondains où se décident, bien davantage hélas que dans la solitude austère à laquelle nous cloue toute lecture sérieuse, les livres à peu près nuls qui seront récompensés par d'à peu près moins que rien, grouillots insignifiants grouillant d'abondants clichés, raouts, cocktails et soirées parfaitement inutiles certes, sauf au juteux commerce de l'entregent où ces pauvres d'esprit deviennent riches à millions, où pérore toujours quelque journaliste au nom heureusement aujourd'hui oublié, roi d'un jour et eunuque de naissance qui n'a jamais eu besoin de chirurgie pour devenir augure à voix de fausset, et contre lequel le Mendiant ingrat a eu mille fois raisons d'éructer : «Il donne ainsi des mots d'ordre à la presse entière, organise le scandale, décrète le bruit, promulgue le silence et, aussi savant délateur que redouté complice, fait tout trembler de son omnipotente ignobilité», et contre le pouvoir duquel il continue de gueuler, sans se tromper hélas le moins du monde, et semblant comprendre que ce puissance de la Presse n'allait que croître au fil des années : «La force des choses vous a remplis d'un pouvoir qu'aucun monarque, avant ce siècle, n'avait exercé, puisque vous gouvernez les intelligences et que vous possédez le secret de faire avaler des pierres aux infortunés qui sanglotent pour avoir du pain»(18). Qu'elle disparaisse alors, car le critique meurt jeune, tout comme la critique, avais-je écrit dans un de mes livres, et qu'importe après tout qu'elle ne soit que la conséquence d'une plus grande disparition, celle de la littérature, celle de l'art, elles-mêmes dues à la à mort de Dieu (19), qui ne pourrait en tout cas être conjurée que par le silence, comme William Marx semble en faire le pari : «Dans un monde qui a perdu toute révérence envers la littérature, seul le refus d’écrire affirme encore la sacralité d’une écriture qui s’est partout ailleurs compromise et souillée, de même que, selon le dogme catholique, la continence volontaire des prêtres désigne en creux le caractère sacré du rapport charnel» (20).
Mais qui donc, aujourd'hui, est capable de se taire plus de quelques minutes ?
Notes
(1) Jean-Philippe Domecq, Comédie de la critique. Trente ans d'art contemporain (Pocket, coll. Agora, 2015). Cet ouvrage regroupe Artistes sans art ? qui sera ici spécifiquement évoqué, Misère de l'art et Une nouvelle introduction à l'art du XXe siècle. Nous citerons uniquement Artistes sans art ? dans sa première édition (Presses Pocket, coll. Agora, 1999).
(2) Julien Gracq, La Littérature à l’estomac (José Corti, [1950], réédition en 1997, celle que nous utilisons). Les pages entre parenthèses, concernant Julien Gracq, renvoient toutes à notre édition.
(3) Pierre Jourde, La Littérature sans estomac (Presses Pocket, coll. Agora, 2003), p. 12.
(4) Georg C. Lichtenberg, Pensées (traduites de l’allemand et préfacées par Charles Le Blanc, Rivages Poches, coll. Petite Bibliothèque, 1999), E 215, p. 95.
(5) Voir ainsi Julien Gracq, op. cit., p. 27 : «Ainsi se trouve-t-il que la littérature en France s’écrit et se critique sur un fond sonore qui n’est qu’à elle, et qui n’en est sans doute pas entièrement séparable : une rumeur de foule survoltée et instable, quelque chose comme le murmure enfiévré d’une perpétuelle Bourse aux valeurs». Julien Gracq n'hésite pas à filer cette métaphore de la criée ou de la Bourse, lorsqu'il écrit : «[…] même happement avide des nouvelles fraîches, aussitôt bues partout à la fois comme l’eau par le sable, aussitôt amplifiées en bruits, monnayées en échos, en rumeurs de coulisses […] même léger délire d’interprétation à propos de tout ce qui se présente : pas un livre, pas un auteur jeté en pâture à cette foule qu’une espèce de levain travaille, qui ne soit aussitôt supputé, disséqué, interprété, sondé, prolongé déjà par un avenir imaginaire, évalué dans toutes ses possibilités» (pp. 27-8).
(6) Ibid., pp. 23-4 : «Il y a des volumes qui sont tièdes encore sous les doigts comme une chair recrue d’amour, comme si le sang battait sous la peau fine, et aussi chaque nuit, dans le silence des grandes bibliothèques, il y a un livre glorieux dont vacille dans le noir et s’éteint pour toujours la petite lumière, mais sans qu’on le sache encore, comme nous parvient après des siècles la nouvelle de l’extinction d’une étoile».
(7) Julien Gracq lui-même a-t-il lu le livre d'Armand Robin ? Voyez ce qu'il écrit : «On pourrait […] tenter de délimiter ces zones du spectre infrarouge : rouge du public des ventes, braderies, congrès, vernissages, expositions […] – jaune des «condensés» et des digestes – vert des magazines et journaux du dimanche […] – bleu du cinéma – violet enfin – suprême clairon plein de strideurs étranges, silences traversés des mondes et des anges – de la radio, où le mugissement de la littérature vient mourir au bord de l’infini» (p. 62).
(8) «Quand le plaisir littéraire, comme le fait le nôtre, «décroche» de plus en plus de la délectation solitaire et sentie pour se socialiser éminemment, se transformer en perpétuel échange de signes de reconnaissance, en «plaisir-reflet», en moyen d’alignement sur une collectivité mouvante, et finalement en monnaie de singe, la pression multiforme qui nous enserre de toutes parts fait que nous en arrivons à ne plus voir (littéralement) ses manifestations consacrées que nous ne voyons réellement la mode du jour, «ce qui se porte», avec ses aspects monstrueux, grotesques, aberrants» (pp. 43-4).
(9) Julien Gracq écrit : «La perspective au contraire s’assombrit quand, comme c’est le cas en ce milieu de siècle, la circulation fiduciaire des «valeurs littéraires» commence à dépasser exagérément l’encaisse, on veut dire lorsque les opinions émises (ou répétées) sur les ouvrages de l’esprit ne sont plus fondées sur le contact direct et intime avec l’œuvre que dans une très minime proportion» (p. 46). Ailleurs : «[…] seulement il est passé, et d’abord en ceci qu’il est retiré de l’étalage : il a cessé d’être pris dans ce réseau de bruits, de discussions, de marchandages, de spéculations, de commérages, d’agiotages et de calomnies qui le tenait à flot, le mariait insensiblement à l’air du temps et au goût du jour, se substituait à lui et le recouvrait chaque jour de neuf comme une palissade se recouvre d’affiches» (pp. 44-5). Jean-Philippe Domecq, lui, affirme que : «Comme en politique, les mots ne portent plus, démonétisés qu’ils sont», Qui a peur de la littérature ? (Mille et une nuits, 2002), p. 13.
(10) Les termes «surface de vente» ne viennent pas au hasard dans ma note : «Le grand public, par l’entraînement inconscient, exige de nos jours comme une preuve cette transmutation bizarre du qualitatif en quantitatif, qui fait que l’écrivain aujourd’hui se doit de représenter, comme on dit, une surface, avant même parfois d’avoir un talent» (p. 68).
(11) «La critique est la dernière en date de toutes les formes littéraires; elle finira peut-être par les absorber toutes», cité par Jean-Thomas Nordmann, La Critique littéraire française au XIXe siècle (1800-1914) (Le Livre de poche, coll. Références, 2001), p. 264.
(12) «Nous approchons du moment où la critique se constituera à son tour en industrie autonome, installant ses derricks à proximité des gisements littéraires», Le Retour du tragique [1967] (Seuil, coll. Points Essais, 1994), p. 6. Jean-Philippe Domecq écrit pour sa part : «Et jamais ceux qui tiennent le discours sur l’art, les chroniqueurs, commentateurs et critiques, n’eurent plus de poids qu’au XXe siècle, où la part du discours sur l’art a primé sur les productions de l’art», Artistes sans art ?, op. cit., p. 110.
(13) «La vraie critique à Paris se fait en causant : c’est en allant au scrutin de toutes les opinions que le critique composerait son résultat le plus complet et le plus juste», Sainte-Beuve, Mes Poisons (extraits des Cahiers publiés en 1926 par Victor Giraud, José Corti, Collection romantique n°16, 1988), p. 135.
(14) Jean-Philippe Domecq, Qui a peur de la littérature ?, op. cit., p. 86.
(15) «Leur régularité [celle des prix littéraires], absurde en d'autres temps, redevient compatible avec le recyclage conjoncturel, avec l'actualité de la mode culturelle. Jadis, ils signalaient un livre à la postérité, et c'était cocasse. Aujourd'hui, ils signalent un livre à l'actualité, et c'est efficace», Jean Baudrillard, La Société de consommation (Denoël, 1970, repris par Gallimard, coll. Folio Essais, 1986, p. 153).
(16) «Je crois que l’avenir est aux filles, en art comme en tout, car je crois à la fatale et imminente putréfaction d’une latinité sans Dieu et sans symbole», déclare ainsi Joséphin Péladan, dit le Sar, à Jules Huret (in Enquête sur l’évolution littéraire [1891], José Corti, 1999, préface et notices de Daniel Grojnowski, p. 83).
(17) Henri Raczimow, La mort du grand écrivain (Stock, 1994), p. 42.
(18) Léon Bloy, Le Désespéré [1887] (présentation, remarquable, par Pierre Glaudes, Flammarion, coll. GF, 2010), pp. 329 et 347.
(19) Carlo Ossola écrit ainsi que «l’art ne semble lui aussi, aujourd’hui, qu’un fragment dispersé d’une identité perdue; après la mort de Dieu, s’ensuit la mort de ses copies : l’art, la poésie, la musique, tout ce qui était ordre et beauté», in L’Avenir de nos origines. Le copiste et le prophète (Jérôme Millon, coll. Nomina, 2003), p. 9. Nous constatons, nous, une prolifération démoniaque des copies et des copistes, des ventriloques ayant pris la place, non point des prophètes, mais des auteurs dignes de ce nom, mais je répète que ce phénomène est en fait parfaitement assimilable à une mort se donnant par la fausse vitalité de la multiplication des faux-semblants et des charniers, comme je l'avais évoqué dans l'une des scènes de mon Maudit soit Andreas Werkmeister !.
(20) William Marx, L’adieu à la littérature. Histoire d’une dévalorisation XVIIIe-XXe siècle (Les éditions de Minuit, 2005), p. 156.






























































 Imprimer
Imprimer