« Defalvard dans le narthex, par Guillaume Sire | Page d'accueil | In memoriam Francis Bacon, ou le soupirail de l’Enfer où s’enferma Vincent La Soudière »
10/05/2017
Les Sommets du monde de Pierre Mari : lorsque le coq chante comme un cygne, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Juan Carlos Ulate (Reuters).
«Est-ce vraiment la mort ? La voix intérieure répondait : oui c’est la mort. Mais pourquoi toutes ces souffrances ? Et la voix répondait : comme ça, pour rien.»
Léon Tolstoï, La mort d’Ivan Ilitch.
«Je continue de croire que ce monde n’a pas de sens supérieur. Mais je sais que quelque chose en lui a un sens, et c’est l’homme parce qu’il est le seul être à exiger d’en avoir.»
Albert Camus, Lettres à un ami allemand.
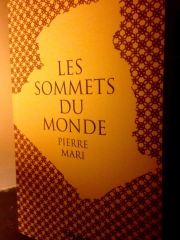 Acheter Les Sommets du monde sur Amazon.
Acheter Les Sommets du monde sur Amazon.C’est une indifférence presque totale qui a sanctionné le beau roman de Pierre Mari, Les Sommets du monde (1), et elle s’explique par une conjugaison de facteurs qu’il ne faut jamais passer sous silence dans la mesure où il en va désormais de l’honneur de la France : l’immense sottise d’une presse littéraire gavée de sots et de potiches, l’abrutissement généralisé du lectorat français, l’effondrement accéléré de l’exigence intellectuelle et la surestimation des médiocres par les voies royales du népotisme. Ce sont les quatre côtés d’un carré diabolique où s’initient évidemment des rapports plus profonds, des liaisons intimes qui pourraient dessiner un nœud inextricable où viendraient s’agréger les amarres de la culture et de la politique, la première, en phase terminale, appelant forcément la seconde, épidémique et délétère. Est-ce à dire que la santé d’un peuple se détermine éventuellement par ses lectures et les hommes qu’il choisit pour le diriger ? Si l’on nous accorde cette possibilité, alors il n’y a pas lieu de s’étonner de la discrétion qui entoure le roman de Pierre Mari, ni des rares articles qui le commentent dans un style affligeant et une densité argumentative relativement inexistante. Comme il s’agit du reste d’un roman qui aborde les tristement célèbres «événements» d’Algérie, lesquels ont peu à peu été reformulés dans la terminologie plus honnête de la guerre, il s’ensuit que nos blafards journalistes littéraires, dotés de cerveaux et de consciences du même ordre, ne pouvaient pas travailler une matière aussi prégnante de polémique et de subtilité, lui préférant les sombres flatulences de tel cacographe conformiste, plus faciles à caractériser car le souffle régulier de la fécalité ne trompe pas et plaît aux oies grasses qui se satisfont d’en parler.
Ce serait pourtant une erreur de faire des Sommets du monde un livre pour les seuls initiés ou les précieux lecteurs de qualité. Prenant la forme d’un récit composé de nos jours, dont le «Je» correspond à peu près à celui d’un octogénaire nous révélant son parcours dans l’Algérie française entre le début des années 1940 et l’année 1962 (cf. pp. 7-294), mais nous présentant aussi une superbe méditation sur le retour définitif en France et les différents effets de réminiscence encourus (cf. pp. 295-327), le roman produit une alternance habile entre les données historiques et les expériences de la vie, et il le fait dans un style où l’oralité le dispute volontiers à une forme d’écriture plus académique. Ainsi l’on ne trouvera pas l’ombre d’une intention didactique tout au long de ces pages, mais l’on se réjouira d’écouter aux portes de cette Algérie française, de glisser un œil indiscret par le trou d’une serrure ensorcelante, d’y entendre des conversations qu’on aurait quelquefois aimé taire ou, à l’inverse, faire sonner dans une trompette de lucidité, d’y voir des hommes et des femmes aux abois, en butte à des soleils noirs et des pressentiments affolés, des hommes et des femmes, néanmoins, qui ont su se bâtir une maison heureuse au septentrion de l’Afrique. En recyclant un mot connu de Bichat, on pourrait dire que l’Algérie française a été heureuse tant qu’elle a su résister aux intrusions politiques; on a mené la grande vie à chaque fois qu’on a surmonté les désirs mortifères d’une raison d’État.
En outre, il n’est pas question de nier un certain nombre d’attitudes déplorables de la part des Français, ni d’ailleurs de sous-estimer la réelle aversion de certains Algériens pour la France de jadis, toutefois l’on ne peut s’empêcher de penser que la politique a plus souvent aggravé les tensions humaines plutôt qu’elle ne les a minorées (2). Du temps de cette Algérie panachée, l’argument de la raison d’État, abusivement employé par le Mitterrand garde des Sceaux quand il fallait réfléchir au sort des ennemis de la France, n’a tout au plus été qu’une «casuistique de l’arbitraire» (3), une façon de se défaire à bon compte de la répartition concrète des torts et des horreurs. Cependant, par-delà les couloirs de la décision politique et les murmures d’hommes d’État, par-delà les vérités diplomatiques et les récits officiels, Pierre Mari projette un faisceau de lumière dans le puits des anonymes, et si les mémoires de son personnage principal ne peuvent pas faire autrement que de considérer la volonté des États, elles n’en sont pas moins tout à fait ancrées dans la pâte du réel, dans les quotidiens du tout-venant où les mots et les émotions, empreints d’une rafraîchissante spontanéité, nous en apprennent davantage que les calculs politiciens. Ce n’est donc pas vraiment un roman historique auquel nous avons affaire. On ne se tromperait guère, en fait, si nous plaidions pour la cause d’un roman d’apprentissage : un homme et ses amis apprennent à vivre et à aimer dans un pays troublé, si bien que la vie devient le juge fougueux de la politique, et cette dernière, de temps à autre, met la vie sur la sellette (4).
Par conséquent, loin des prudences du discours politique et des personnalités chichiteuses, nous sommes invités à la table des tripes et des entrailles. Les ventres en savent plus long sur la vérité des hommes, admettons-le, et celui qui se raconte dans ce texte nous avoue d’emblée la configuration du problème : la politique a tué les relations humaines, elle a suscité l’épuisement et l’impossibilité de s’associer aux drames d’autrui, toutefois, pour peu qu’il y ait encore un gargouillis d’entrailles quelque part, pour peu que nous sentions le soulèvement de nos estomacs ou celui d’un autre bide devant certaines situations, alors il est possible de véritablement se joindre à une détresse ou une exaltation (cf. pp. 11-2). Cette attention au langage des entrailles renverse d’ailleurs l’idée exprimée par le sociologue Erwin Goffman dans La mise en scène de la vie quotidienne. D’ordinaire, écrit Goffman, dès que nous percevons le bruit gargouillant d’un ventre, nous agissons comme si de rien n’était, pour sauver les apparences et surtout pour perpétuer les «rites d’interaction». Bis repetita placent, c’est une recette d’assainissement de la vie publique, lestée d’un lourd processus d’intériorisation des normes sociales. Selon Goffman, toute vie sociale implique donc le souhait de se maintenir à un haut niveau individuel de propreté comportementale, mais elle implique également le souhait de libérer l’autre de la moindre contrariété. En effet, si je ne veux pas montrer que j’ai par exemple entendu mon voisin de métro gargouiller du ventre, c’est que j’applique à la fois consciemment et inconsciemment les règles en usage d’une société pasteurisée de fond en comble. Goffman, du reste, se réfère spécifiquement à la société américaine, à savoir ici les États-Unis des années 1950, et l’on sait ô combien cette société, depuis lors, s’est constamment déguisée dans le puritanisme le plus mensonger.
Par contraste, l’Algérie du narrateur est déchargée de ces rituels hygiéniques, et l’on peut s’adonner complètement à l’écoute des ventres inquiets ou survoltés tant que la politique garde ses distances, ou bien tant que l’on s’efforce de fuir la politique. On y distingue la «rage d’exister», le déchirement de toutes les cuirasses mentales et physiques, les Français «[s’accrochant] de tous [leurs] ongles» à la terre algérienne (p. 192). Il y a de l’orgueil dans cette attitude, il y a du politiquement incorrect, certes, mais cela vaut mieux qu’une soumissions aux protocoles et aux langues de bois. Pour les Français du moins qui se cramponnent dignement à ce patriotisme hors-sol, a fortiori étrangers aux méthodes de l’OAS, cette intensité d’existence coïncide avec les tripes de toute l’Algérie. Les boyaux d’un homme ne mentent jamais, d’où qu’il vienne, et toute alliance humaine que l’on voudrait manigancer par des artifices de gouvernement n’aboutissent qu’à d’obscènes éventrations. C’est pour ainsi dire en dépit des vérités gastriques que l’Algérie française a évolué jusqu’au bout de son aventure, jusqu’à son éventrement final qui a fait voir au monde entier le spectacle effrayant d’un pays qui tentait par tous les moyens de remettre ses tripes dans son ventre. La France au ventre vide, émaciée par sa politique, c’est en filigrane ce qui apparaît avec toujours plus de franchise dans cette confession romanesque.
Mais avant les périodes de grande inanition, il y a eu les ventres pleins d’existence. Ce sont ici les vrais «sommets» du narrateur, les cimes des émotions sincères. C’est par exemple le souvenir marquant de la montée à l’Observatoire, l’ascension au «Village céleste» qui offre un panorama sublime d’Alger (cf. pp. 17-9). Située aux toutes premières pages de ces cahiers de confidences, cette découverte d’Alger vue du ciel, rapidement devenue un rituel de promenade, constitue la marque au fer rouge d’un zénith apolitique. Au balcon d’Alger, le ciel et la baie participent d’une éternité sans ornement, et la liberté qui se dessine là est proprement physique, fondamentalement sentie, aussi pure que «le fond du ciel» (p. 24). L’image d’un ciel infiniment bleu est convoquée à plusieurs reprises (cf. pp. 48, 59 et 84), comme pour affirmer l’exception de cette vie algérienne, dépourvue du moindre sentiment de limite et de garde-fou. L’infini céleste, en outre, se confond généreusement avec l’infinité de la mer, et c’est d’une certaine manière toute la ville d’Alger qui plonge dans le grand bain cosmique de l’Apeiron, qui sait inspirer à sa population la transe d’une vie qui ne souffre aucun à-coup, aucun découpage abusif, aucune représentation où un sujet se place en vis-à-vis d’un objet qu’il croit posséder. L’Apeiron des anciens Grecs est une telle force d’infini que Nietzsche aimait le traduire par le «sans-qualité», ce qui, en somme, excède toute espèce de fureur prédicative ou de Prométhée moderne. Or c’est être résolument au sommet du monde que de jeter par-dessus bord les pseudo-savoirs et les pseudo-langages, de se jeter tête la première dans cette infinité qui nous guérit des vulgarités habituelles, soutenues par des hommes qui s’imaginent conquérir tout et n’importe quoi. Pour le narrateur, il ne fait pas de doute que cette vue surplombante d’Alger suscite des émois inégalables. Là-haut, il est la vigie de la nature, il est coprésent, coexistant avec le devenir universel, au diapason du rythme le plus loyal, à l’opposé des arythmies culturelles, des promesses politiques ignorantes qui prescrivent aux hommes des promontoires de quincaillerie. Ainsi en va-t-il du discours prononcé par de Gaulle à Mostaganem, en juin 1958, lorsque celui-ci s’annonce comme le messie qui devra porter la France «vers les sommets du monde» (p. 116).
Par comparaison avec les sommets touchés dans l’Apeiron, les montagnes gaullistes paraissent alors bien minuscules. Tantôt physiquement éprouvée, la liberté qui se dégage de cette harangue politicienne est plutôt une création métaphysique, un vêtement artificiel qui essaie vaille que vaille de remplacer une nécessité naturelle qu’elle n’est pas en mesure de comprendre. Avant les interventions croissantes de l’État, ce n’est donc peut-être pas tant que le citoyen français d’Algérie était libre au sens naïf du terme, mais il était au moins sage devant la nécessité de ce beau pays, il acquiesçait à l’ordre secret de cette nation comme Albert Camus, par exemple, consentait à la minéralité fascinante d’Oran ou aux ruines magnifiques de Tipasa. Cette sagesse se perd inexorablement dans les séductions politiques, et, bien des années après le passage du revenant de Gaulle, on conclut sans ambiguïté que ces promesses n’étaient que des mots comestibles semés dans la gueule des foules (cf. p. 294). De Gaulle n’avait pour objectif que l’exploitation d’une ambivalence émotionnelle déjà bien installée parmi les Français d’Algérie, intérieurement dépités mais extérieurement embellis d’espoir (cf. p. 15). Or il n’empêche que si l’on ne peut totalement disqualifier l’envergure de cette stratégie de temporisation, il est en revanche impossible de la hisser au niveau des vérités essentielles. Il est rare que la politique s’adresse aux tripes, et si elle le fait, elle ne procède généralement que d’un mensonge gastrique qui sera bien assez tôt démasqué, piétiné ensuite par une vérité imparable. De Gaulle a beau vivre une apothéose lorsqu’il se rend à Alger, il n’en est pas moins l’intercesseur d’une politique qui n’est que «de la merde, du sang et de la fouterie de gueule» (p. 113). Débarqués d’une bouche partiale, ces jugements viscéraux répondent à d’autres viscères, en l’occurrence aux narrations gaullistes qui ont un goût de faux-semblant. La France du politique, à certains égards, n’est pas compétente pour serrer la main de l’Algérie. Ce n’est qu’une France philosophique, si l’on ose dire, qui aurait pu contourner les tumeurs des affaires d’État. Par ailleurs, est-ce que c’est ce manque de hauteur de vue qui a pu discréditer la France aux yeux d’André Mandouze ? Se référant au souvenir de quelques cours de Mandouze, le narrateur rapporte que le professeur n’hésitait pas à proclamer «que la vraie France était hors-jeu en Algérie, que l’argent des féodaux, la loi du silence et le pétainisme increvable pourrissaient tout» (p. 219). Malade et croulante de ses anciens gouvernements morbides, la France finissante d’Algérie n’en a jamais fini de crever, de se répandre en médiocrité internationale, aplanissant les sommets affectifs pour leur substituer les sommets passifs de la politique.
C’est toute cette manœuvre de passivité et de résignation qui gagne fatalement du terrain dans le magasin mémoriel du narrateur. Il se peut d’ailleurs que tout commence à basculer lors du débarquement américain sur le littoral algérien en 1942 (cf. pp. 38-46). L’arrivée des Américains est vécue à l’instar d’un chamboulement. Les gamins ont du mal à saisir la signification de ce branle-bas. On vit en quelque sorte une confusion des alliances, ne sachant plus très bien qui est avec qui. Tout jeune en ce temps-là, le narrateur est aux premières loges de cette cacophonie, de cette dissonance qui vient agresser l’incommensurabilité de l’Apeiron. Il se découvre là un genre de vulgarité préliminaire, comme l’incubation d’une maladie qui finira par expulser tous les Ulysse de leur Ithaque. Dès que ce débarquement spectaculaire est consommé, la chute de l’Algérie française semble irréversible, parce que la vulgarité dispersée qui sévissait à l’état gazeux trouve à se consolider avec les gros sabots de l’opération militaire. Le nazisme, le pétainisme et l’impérialisme s’entrechoquent et recouvrent la terre sacrée d’un voile grossier, profanant les rythmes harmonieux qui exhaussent en principe les âmes. Des années plus tard, en 1955, les massacres de Philippeville et de El Halia viendront coaliser les vulgarités initiales (cf. p. 57). Les inimitiés entre l’armée française et le FLN rejouent les vieilles partitions des hommes infâmes, incapables de noblesse, insensibles à la musique du cosmos (5).
Malgré ce contexte difficile et qui va en s’empirant, deux histoires d’amour relèvent le narrateur des précipices, le replaçant quelquefois sur un sommet d’existence. Il rencontre d’abord Colette Vivaldo, une fille autour de la vingtaine, pleine d’aplomb, «chevelure noire sur fond de ciel bleu» (p. 59). C’est une relation qui ressemble à une parade nuptiale prolongée, avec deux jeunes personnes qui recherchent moins la turbulence d’un lit que l’excitation de se tenir la main dans une ville où tous les liens, peu à peu, se dénouent. Le père de Colette, Joseph Vivaldo, remet sur le tapis le sujet de conversation où se devine la déliaison menaçante de l’Algérie et de la France, même s’il refuse de l’imaginer dans le détail. Pour lui, comme pour bien d’autres Français probablement, le départ de la France constituerait ni plus ni moins que la mort de l’Algérie (cf. pp. 69-70). Les réflexions de Vivaldo sont habitées par une fatuité qui dépasse le cadre froussard de la politique, en quoi elles s’intègrent à la volonté militaire et aux stratégies martiales. La soldatesque veut gagner la guerre sans le frein de la politique; on ne désire pas revivre Diên Biên Phu, pas davantage qu’on ne souhaite une victoire morale (cf. pp. 86-9). En fin de compte, le désir qui se détache de ce «bouillon» (p. 9), c’est l’espoir d’une Ve République triomphante qui viendrait exorciser la France de ses démons (cf. pp. 92-100). Quitte à penser la séparation de l’Algérie et de la France, quitte à mettre des bâtons dans les roues des amoureux, autant que cela se fasse par l’ensevelissement de la IVe République. On appréciera de ce point de vue le symbole d’un meuble qui passe par la fenêtre lors d’une journée cruciale de protestation, avec toute sa paperasse qui s’envole, comme si l’administration française procédait à la subite épuration de toutes ses lourdeurs (cf. p. 98).
Quant à la seconde histoire d’amour, elle est le fruit d’une rencontre avec une femme mariée, prénommée Agnès, mère de famille de surcroît (cf. pp. 123-7). Ce sont plusieurs mois d’errance et d’expectative, scandés par la frustration et la brûlure d’un sentiment qui ne veut pas s’éteindre. Les amis du narrateur lui conseillent de changer d’air, et, suivant ces recommandations amicales, il part faire une escale à Constantine, chez Paulette Liberati, la tante de l’un d’eux. Contre toute attente, le paysage de Constantine, avec les gorges du Rhummel, régénère notre «éclopé moral» (p. 132). Les ponts et les ravins de la ville le réaccordent à l’Apeiron, ajustant son amour d’Agnès à des sommets qui permettent de relativiser ce que l’on endure dans la vallée des hommes tracassés (cf. pp. 135-7). Mais l’apprentissage de l’amour, corrélé aux soubresauts du politique, n’est pas de tout repos. L’accumulation des remous et l’intervalle de plus en plus prononcé entre les différents pics d’existence achèvent d’épuiser notre héros. Dans ce qu’il faudrait baptiser le chapitre des défaites (cf. pp. 142-158), il quitte Colette et il se résigne avec Agnès, à quoi s’ajoute le retour de ses parents en France. La crainte des attentats, l’incertitude politique et le spectacle prolongé d’un crépuscule humain officialisent en quelque sorte la mise en bière du Pays de Cocagne algérien. Par la suite, à Alger, la «semaine des barricades» consacre le chemin de croix de l’Algérie française (cf. p. 166). Pour la première fois de leur vie, le trio d’amis, en l’occurrence le narrateur, Michel et Jeronimo, se retrouve d’un côté ou de l’autre de la barrière. Cette division, quoique superficielle, introduit forcément dans les ventres des traces qui ne trompent pas.
Est-ce que ces impressions de capitulation, cependant, suffisent à défaire tous les liens qui unissent les cœurs simples à la grandeur d’un lieu ? Une visite du narrateur à ses parents, en France, lui certifie que l’Algérie incarne pour lui un sommet que la France n’est pas. On s’en aperçoit dans une scène qui paraît anodine de prime abord (cf. pp. 173-4), mais qui, à notre avis, est peut-être le moment le plus décisif du roman. Il s’agit de la promenade aux rochers d’Uchon, site remarquable du Morvan. Cette excursion ne suscite aucun enthousiasme pour celui qui n’est pas encore irrévocablement revenu en France. Il ne parvient pas à sentir le cœur battant de la France, et cette roche d’Uchon, assurément, a moins de prestance que la minéralité africaine. Dans cette randonnée du dimanche, on ne voit que des Français qui ont la tête basse, des bagnards qui se prescrivent une intensité a minima, sachant bien que les forces telluriques sont restées en Algérie. Ses parents ont ainsi des airs de chiens battus, des museaux de caniches rentrés à la niche des petites ambitions, faisant écho à d’anciennes vitupérations de Joseph Vivaldo : «On serait pas en train de se faire couillonner par le grand Charles, des fois ?» (p. 142).
Son retour en Algérie lui offrira un énième sommet, le plus beau d’entre tous éventuellement, à savoir une parenthèse improbable avec Agnès, trois ans après les soupirs déçus de l’un et de l’autre (cf. pp. 192-8). Ce ne sont que deux ou trois jours de passion, mais cette «aventure est la seule de [sa] vie à n’avoir jamais pris le pli du souvenir» (p. 192). C’était l’ébullition des premières et des dernières fois mêlées, l’abandon absolu de soi avant la reprise des hostilités, les coïts qu’on ne vivra plus jamais et qui auront été les vérités charnelles de toute la vie, associés aux chevauchées dans l’Apeiron sur la plage d’Alma-Marine (cf. p. 194). Cet épisode sommital avec Agnès sauve l’Algérie de tous les gouffres qu’on y aura creusés, et peu importe la lettre d’adieu qu’elle lui envoie (cf. pp. 230-4), l’amour qu’ils auront partagé foudroie les peurs et les pertes de sens.
Les lendemains de cette halte sentimentale sont tout de même rudes. La folie s’empare d’Alger au mois de mars 1962 (cf. p. 241). Secouée de toutes parts, la ville a l’air d’un animal sur le point de se rebiffer. Le blocus de Bab-el-Oued est perçu comme une honte (cf. pp. 244-251), atteignant un degré d’abomination qui surclasse tous les combats contre le FLN. Après cela, la «fièvre du départ» (p. 271) devient contagieuse. L’Algérie se vide de sa substance française – le coq entonne le chant du cygne. Une image nous frappe, celle, en l’occurrence, d’une voiture en flammes (cf. p. 281). Comment ne pas y voir l’archétype de l’Algérie française qui se consume ? C’est une longue et douloureuse agonie, tel qu’on l’écrirait dans un faire-part de décès. Sous les allures d’un véhicule carbonisé, la France disparaît de l’Algérie. On va même jusqu’à suggérer que le repli de la France est une opportunité pour mieux observer le «merdier» (cf. pp. 284-5). À présent, «la grande dégueulasserie, vous l’avez sous les yeux, en entier, dans toute sa puissance» (p. 284). Ce sont les mots désabusés de Michel, le copain séculaire. On peut en faire deux interprétations : d’une part la plus audible, avec cette idée que la France qui a pris ses cliques et ses claques sera une perte considérable pour l’Algérie, et d’autre part la moins indulgente, celle que nous préférons, insinuant que la France n’a pas été digne de ses devoirs et qu’elle a constamment échoué dans ses choix de politique extérieure. Quoi qu’il en soit, les reliques françaises d’Algérie sont de nos jours encore nombreuses – elles pourraient être grandes, souvent elles sont petites, faute d’hommes et de femmes qui auraient la carrure nietzschéenne des législateurs de l’avenir, ces hommes et ces femmes qui pourraient fouler le vénérable sol algérien en philosophes, «comme des soleils» (6) pour le monde, proposant des politiques et des partenariats sans commune mesure, bref des politiques amies de l’Apeiron. Par conséquent, si nous voulions poser de nouveau la question de la présence française en Algérie, il faudrait le faire à une échelle spatio-temporelle foncièrement inédite, c’est-à-dire en dehors des corridors asphyxiants d’une politique repentante qui n’est que flatterie et socialisme décadent. Mais la France, pour l’heure, n’est qu’une vache malade, un puceron anémié qui n’a guère sa place où que ce soit sur la planète, et sa nullité, sa bêtise, son épuisement son tels qu’elle n’a même plus la force de pouvoir se mépriser afin de se rendre compte de ce qu’elle est devenue : la queue de peloton d’un minable troupeau.
Il faut alors avoir une pensée compatissante pour le narrateur, toujours vivant, revenu en France le 18 juin 1962. C’est un homme divisé, tiraillé entre une colère inépuisable et un pouvoir d’intelligence qui le modère (cf. pp. 299-300). Ceci étant, la France n’est pour lui qu’une seconde nature, l’époque d’une existence diminuée. L’Algérie le faisait pousser, la France l’a réimplanté dans une terre moins fertile. C’est d’autant plus voyant que les destins de ses connaissances ont entamé une phase descendante (cf. pp. 300-7). L’odeur si particulière de la fin de vie compose un tableau nostalgique où l’Algérie domine, dans les discussions comme dans les remembrances (cf. pp. 321-7). Son histoire algérienne nous apparaît ainsi comme son affinité élective, bien plus essentielle que sa vie maritale qui s’est soldée par un divorce au bout de vingt ans. Il avoue du reste qu’il a gonflé ses propres démons (cf. p. 300), qu’il s’est repu de ses enflures monstrueuses, au détriment de sa femme qui n’a jamais pu accueillir les fantômes de son château hanté. Et c’est bien ce qu’il est en dernière instance : un homme hanté par un passé qui refuse de passer, un homme qui dévale sans relâche les compartiments d’un train fantôme où parfois jaillissent les figures de quelques anges.
Notes
(1) Pierre Mari, Les Sommets du monde (Fayard, 2017).
(2) On n’oubliera pas non plus de mentionner les conflits franco-français.
(3) Cf. Michel Winock, François Mitterrand (Gallimard, 2015), chapitre 4 (Le vent violent d’Algérie).
(4) Dans l’émission Libre journal des débats du 12 avril 2017, animée par Charles de Meyer sur Radio Courtoisie, Pierre Mari effectuait des parallèles pertinents entre Les sommets du monde et L’éducation sentimentale de Flaubert. Nous suggérons de notre côté un film de Bruno Dumont qui pourrait constituer un formidable prolongement critique du roman de Pierre Mari : Flandres.
(5) Cette insensibilité au cosmos de la part des hommes en guerre est en l’occurrence superbement filmée par Terrence Malick dans La ligne rouge.
(6) Cf. Nietzsche, Fragments posthumes.






























































 Imprimer
Imprimer