« Papa, papa... | Page d'accueil | Nouvelle histoire de Mouchette de Georges Bernanos »
13/08/2018
Les Pharisiens de Georges Darien

Photographie (détail) de Juan Asensio.
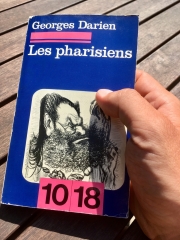 Affublé d'une préface d'Auriant quelque peu pénible tant elle manifeste de mépris pour Léon Bloy (1), Les Pharisiens est un roman bien moins impressionnant que l'extraordinaire fulmination exhalée d'un cerveau qui serait en train de bouillir dans un jus d'imprécations qu'est La Belle France. Recommencé plusieurs fois selon l'aveu de son auteur, craignant des poursuites de la part de Drumont campé en Ogre, il dut donner à son livre le titre qui devait initialement être celui du second volume projeté, Les Pharisiens donc, et il avoue à son frère en avoir fait «une chose très décousue» (p. 29), qu'Auriant, avec son habituelle raideur de ton, qualifie de «règlement de comptes emboîté dans un livre bâtard, à la fois factum, pamphlet et roman, d'une écriture tantôt emporte-pièce, tantôt déclamatoire, dont le meilleur était les réflexions hors-d’œuvre qui n'avaient rien à voir avec l'antisémitisme, sur la société, la littérature, la peinture, le théâtre et l'amour (pp. 29-30).
Affublé d'une préface d'Auriant quelque peu pénible tant elle manifeste de mépris pour Léon Bloy (1), Les Pharisiens est un roman bien moins impressionnant que l'extraordinaire fulmination exhalée d'un cerveau qui serait en train de bouillir dans un jus d'imprécations qu'est La Belle France. Recommencé plusieurs fois selon l'aveu de son auteur, craignant des poursuites de la part de Drumont campé en Ogre, il dut donner à son livre le titre qui devait initialement être celui du second volume projeté, Les Pharisiens donc, et il avoue à son frère en avoir fait «une chose très décousue» (p. 29), qu'Auriant, avec son habituelle raideur de ton, qualifie de «règlement de comptes emboîté dans un livre bâtard, à la fois factum, pamphlet et roman, d'une écriture tantôt emporte-pièce, tantôt déclamatoire, dont le meilleur était les réflexions hors-d’œuvre qui n'avaient rien à voir avec l'antisémitisme, sur la société, la littérature, la peinture, le théâtre et l'amour (pp. 29-30).Dans un excellent portrait d'infréquentable sous la plume de Nicolas Massoulier, nous retrouvions d'ailleurs Léon Bloy, puisque le roman de Darien n'a de réel intérêt que par le fort célèbre passage où il décrit celui dont il apprécia visiblement la puissance d'éructation et l'intransigeance manifestée à l'endroit d'une bonne totalité de la planète réduite à l'état de terrain de jeu immense pour imbéciles, bourgeois, écrivains, journalistes et catholiques réunis, le plus souvent confondus en fait dans un même magma d'individus peu ragoûtant. Selon notre préfacier, c'est Léon Bloy lui-même qui aurait rédigé le passage le concernant, à la demande de Darien qui écrivit à l'intraitable qu'il ne désirait pas avoir mis dans sa bouche un langage qui ne serait pas le sien (cf. p. 19).
Auriant, qui visiblement tient Léon Bloy pour un faux intègre, semble transférer à Darien les qualités de droiture qu'il retire à l'auteur du Salut par les Juifs, lorsqu'il écrit ainsi que l'auteur du Voleur eut une vie «pure de toute souillure», en portait du reste parfait témoignage car ce fut justement «parce qu'il ne consentit pas à écrire et parler contre sa conscience qu'il mena, privé de tout ce qui rend la vie supportable, une existence tourmentée» (p. 27). C'est au demeurant ce même préfacier que l'on espère avoir été lui-même aussi droit que son cher incorruptible qui explique toutefois de quoi il en retourne avec cette célèbre description d'un Léon Bloy ayant réalisé son autoportrait plus vrai que nature : «Pamphlétaire !... Sans doute que je le suis, pamphlétaire, parce que je suis forcé de l'être, – vivant, comme je fais, dans un monde ignoblement futile et contingent, avec une famine enragée de réalités absolues. Tout homme qui écrit pour ne rien dire est, à mes yeux, un prostitué et un misérable, et c'est à cause de cela que je suis un pamphlétaire. Mais être pamphlétaire pour de l'argent !...», ce passage est complété par cet autre où Bloy est de nouveau décrit, par une plume qui le connaît donc mieux que quiconque puisque c'est la sienne, comme un pamphlétaire : «Il est vrai que je suis un catholique véhément, indépendant, mais un catholique absolu, croyant tout ce que l’Église enseigne. Quand je saboule mes coreligionnaires, ce qui m'est souvent arrivé, c'est que leur lâcheté ou leur bêtise révolte en moi précisément le sentiment catholique. Pamphlétaire !... Ah ! je suis autre chose, pourtant… mais si je suis pamphlétaire, moi, je le suis par indignation et par amour; et mes cris, je les pousse, dans mon désespoir morne, sur mon Idéal saccagé !…» (pp. 152 et 154).
En somme, nous tenons là le motif que Georges Darien va constamment tisser dans son roman, y compris lorsqu'il figure les aventures petites-bourgeoises de son personnage pourtant intraitable, Vendredeuil, avec celle qui deviendra vite sa maîtresse, Suzanne, avant de le quitter pour les motifs paraît-il les plus nobles que celui-ci finira par comprendre, sa première colère passée. Ce motif, c'est l'effort qu'il faut toujours non seulement poursuivre mais renouveler, effort pratiquement surhumain s'il en est, consistant à rester coûte que coûte un homme libre, autrement dit une exception, calomniée et méprisée par tous et d'abord par celles et ceux qui ne supportent pas de ne pas vivre en troupeau ou, dans le meilleur des cas, en meute, dans une société qui n'aspire qu'au conformisme, y compris même, surtout à vrai dire, quand cette même société se donne des frissons en saluant les textes de celui, l'Ogre (autrement dit Édouard Drumont) qui n'est que sa plus parfaite cristallisation, la précipitation, au sens chimique du terme, de ses attentes les plus secrètes grâce auquel elles peuvent donc trouver un si commode exutoire.
Vendredeuil, qui à tout prix veut rester un homme libre, cet homme libre qu'il n'est plus en écrivant Les Mercenaires, éructation sur commande de son minable éditeur Rapine, livre infâme qu'il finira heureusement par jeter au feu, Vendredeuil est non seulement un polémiste (2) mais l'ennemi des pharisiens qu'incarne au premier chef l'Ogre. Ce passage, parmi quelques autres, est éloquent : «Lorsqu'on écrira l'histoire avec autre chose que des récits de batailles, des papotages de soi-disant témoins et des cancans de diplomates, lorsqu'on ne cherchera, dans la vie des peuples, ni leurs actes ni leurs rêves, mais leurs appétits, on s'étonnera de trouver, toujours, une époque entière synthétisée par un homme. L'Ogre était la synthèse vivante de la troisième République française» (pp. 52-3), ce que Georges Bernanos affirmera à son tour dans tel de ses grands livres.
Il est frappant de constater qu'il nous suffirait, de nos jours, de remplacer le terme honni de Juifs par celui non moins exécré de Maghrébins, et que dire de celui de musulmans !, pour faire de Renaud Camus, comme je l'ai plus d'une fois affirmé, un descendant plus ou moins direct de l'Ogre, autrement dit d’Édouard Drumont, puisque l'un comme l'autre peuvent être compris comme les fondés de pouvoir et les tribuns (bien que l'auteur de Tricks soit un fort piètre orateur, nous le savons) de «l'ignoble troupeau dont [ils incarnent] si bien les passions basses» (p. 121). Poursuivons le parallèle, en remarquant que Drumont comme Camus peuvent compter sur le soutien assez franc bien que discret de toute une frange des catholiques, hier (et aujourd'hui encore) parfois très profondément antisémites, aujourd'hui bien souvent obsédés par le péril nord-africain. Ainsi : «L'Ogre pouvait se livrer, sans crainte, au maquignonnage simoniaque le plus effroyable; les chrétiens applaudissaient son charlatanisme profanateur de renégat crucifère» (p. 69).
Qu'est-ce qui explique une telle communauté de vues et même une complexion si parfaitement partagées entre nos hérauts intraitables, lorsqu'il s'agit de dénoncer l'invasion de la France par des puissances étrangères qui certes ne sont point étatiques mais, là financières, usurières, capitalistiques et, ici, misérables et parfois fanatisées, et les foules qu'ils incarnent si inavouablement ? La médiocrité ou, pour le dire autrement, l'absence de caractère : «oh ! c'était bien la marque distinctive de cette masse avide dont l'Ogre était devenu l'inamovible représentant» car, sans «passions, sans haines, ne sachant plus souffrir et mordue, seulement, d'un effroyable désir de jouissance, elle ne vivait que pour l'Envie» (p. 123).
Darien englobe dans un même mépris les traditionnelles catégories sociales composant la société française de son époque : «Respectueux et disciplinés, les aristocrates vaguement réactionnaires; respectueux et disciplinés, les démocrates soi-disant socialistes. Respectueux et disciplinés, aujourd'hui, comme ils ne l'avaient jamais été. C'était à se demander, vraiment, si l'instinct de domesticité, le besoin de servilité, la nécessité d'abaissement, ne se développaient point en raison de l'extension donnée, par les faits, à l'idée de liberté». Ce qui fait qu'aux yeux de notre intraitable polémiste, ils sont «tous de la même farine, au fond, malgré les différences superficielles», et sont donc tous aussi, on s'en doute, «à jeter dans le même sac» (p. 124). Autrement dit : Georges Darien cherche des hommes, et n'en trouve pas, malgré l'existence de beaucoup de prétendants.
Nous y sommes bien sûr, à cette «simplification, après tout», qui correspond à la «formation d'une nouvelle classe moyenne, énorme mais idiote, dogmatique par respect et gouvernementale par discipline, à qui la misère même n'a pas donné la haine, mais la vénération jalouse, et qui ne veut pas détruire» mais bien au contraire «prendre», et cela à seule fin, comme les petits épigones de Renaud Camus, de «conserver» (p. 125, l'auteur souligne). L'analyse faite par Darien est frappante de justesse car à son époque comme à la nôtre, moyennant bien évidemment quelques ajustements terminologiques à la marge, «entre une poignée de réfractaires désespérés qui savent encore être des brutes et l'Aristocratie de l'argent» qui, précise Darien, est «la seule», «il n'y a plus en France, avec cette condensation de la bassesse et cette coagulation de l'envie, qu'une tourbe sale qui grouille sous la robe de la République comme sous les jupes souillées d'une mère Gigogne ivre-morte...» (pp. 125-6).
Au rebours même de cette «enrégimentation qui supprime la pensée et interdit l'initiative» (p. 128), nous trouvons l'homme libre, autrement dit Vendredeuil/Darien qui, lui, contrairement aux autres, «aimait mieux rester libre, sans chef» et bien sûr «sans drapeau», préférant se tenir droit «que de ses soumettre à une règle, d'accepter le respect des formules en vieux neuf et de se découvrir pieusement devant les mites de traditions reprisées comme des vieux bas par de maladroits ravaudeurs. Il savait bien qu'il se privait, ainsi, de la connaissance des procédés pour chefs-d’œuvre et des recettes pour livres à succès; mais ça lui était égal» (p. 129).
Homme libre s'il en est, Georges Darien ne saurait de près ou de loin être assimilé à cette «sale tourbe, décidément, et bien digne de s'incarner en la dégoûtante personne de l'Ogre», «foule sans caractère qui grouillait, comme les vers sur une charogne, sur un fonds d'idées en putréfaction» (p. 136), «groupement des imbécillités jalouses autour de ces fientes séniles d'un Idéal en déliquescence qui constituait cette immense classe moyenne dont l'Ogre était le dieu, avoué ou non» (p. 140), l'écrivain, comme d'autres, ayant parfaitement caractérisé, avant même de rentrer dans l'ère des masses marquant si terriblement le siècle passé, ces «riches ou pauvres, lettrés ou illettrés, de la bourgeoisie ou du peuple», individus composant ce «nouveau Tiers-État» (p. 140), ne pouvant que tenter bien évidemment d'éradiquer à tout prix les derniers ferments de liberté, les signes terrifiants mais salutaires de cette Révolution qui ne pourra être rien d'autre qu'une «Destruction» (p. 144).
Nous ne serons bien évidemment pas étonnés que Georges Darien, fidèle à ses convictions jamais reniées, fasse l'éloge de l'anarchie, de ces hommes qui «ne prenaient pas au despotisme, ainsi que les sectaires que flagornait l'Ogre, tous ses principes ignobles d'organisation et de répression», qui «réprouvaient le Dogme et l'Autorité, sous quelque forme que ce fût et prêchaient, purement et simplement, l'Anarchie». Ces hommes en effet ont répudié, «autant que possible, la Discussion» et ont «gardé l'Action» (p. 146), propos que n'eût assurément point désavoués Léon Bloy, qui, comme Darien, aurait pu encore écrire que c'est bel et bien la simplicité de la doctrine de ces Brutus d'un temps nouveau qui «leur assurait l'avenir» puisque, «contempteurs de la Discipline et du Respect, évangélistes du Rien absolu, ils avaient ébranlé déjà, comme Samson dans le temple de Dagon, les piliers qui soutenaient l'édifice social, et allaient le faire crouler» (p. 147).
Curieux chantre de l'Anarchie que Georges Darien tout de même, capable d'écrire, à propos de son personnage principal, que ce dernier «éprouvait successivement, et de très bonne foi, pour le principe d'Autorité, une haine violente et un amour sans bornes» et qu'il devait donc fort logiquement «mourir, au hasard, dans la peau d'un révolutionnaire à tous crins ou dans celle d'un réactionnaire enragé» (p. 148). Nous pourrions gloser sur cette étonnante correspondance, du reste plus d'une fois historiquement documentée, entre des positions politiques éminemment irréductibles, et ironiser ainsi sur la complexion secrète de Darien (et, partant, celle de Bloy), mais il n'en reste pas moins que sa lucidité est admirable, et que, évoquant l'Ogre et son éditeur, Rapine, il annonce en quelques mots le principe de l’Épuration des Juifs qui fera bientôt rage en France et dans d'autres pays européens, pour le plus grand bonheur de tous ces hérauts anonymes ou bien connus du Redressement national : «Ainsi, on inscrit sur un livre spécial, à l'encre rouge, les noms de toutes les personnes qui acceptent une invitation des Juifs. Les journaux nous renseignent admirablement à cet égard. C'est un des bons moyens de préparer cette utile épuration que nous désirons tous» (p. 161).
C'est peut-être parce que, quoi qu'il en dise, Vendredeuil ne peut manquer d'être à sa façon fasciné par les cohortes (autant de lecteurs potentiels !) auprès desquelles l'Ogre, aidé de Rapine, vend ses mauvais livres, ou bien donc parce que les frontières ne sont point si étanches que cela entre un anarchiste et un réactionnaire qu'il va accepter de se compromettre en mettant ses dons incontestables de polémiste au service de la cause anti-juive, en écrivant donc Les Mercenaires contenant quelques pages qu'il ne voulait pas relire, mais «qu'il savait d'une violence à faire lever d'elles-mêmes, sur le passage des hommes stigmatisés par lui, les plaques de fonte des égouts» (p. 261), faisant de la sorte mentir ses propos pessimistes bien que convenus sur l'impuissance du langage (3). En s'abaissant à écrire un livre de commande, Vendredeuil vaut moins qu'une putain et ainsi, «lui qui s'était juré de rester libre à tout prix», «s'était passé aux pieds des entraves du plus déshonorant esclavage» (p. 248), comme s'il cherchait ainsi que l'Ogre ou bien Rapine, à compenser, sans doute, son manque de réussite sociale, et «à se venger du dédain qui pesait sur leur insignifiance de ratés aigris, à faire du bruit, pour monnayer le scandale, avec la diffamation et l'injure» (p. 288).
Mais Vendredeuil, tout comme Darien, n'est pas de ce bois flotté dont on fait les petites journalistes insignifiantes mais diantrement arrivistes et les godelureaux à plume lisse, car il sait qu'il doit «agir seul, surtout, au risque de s'allonger, pendant de longues années encore, sur le lit de noyaux de pêche que le guignon lui faisait tous les soirs». Ainsi poursuit-il dans ces toutes dernières lignes, dans «la lutte qu'il allait engager, il ne voulait compter que sur soi-même» et «irait à son but, froidement, implacablement, sans crainte, mais sans illusions. Tant mieux s'il était vainqueur, et s'il était vaincu, tant pis» (pp. 310-1) car, étonnant paradoxe dont nous comprenons assez vite la justesse, il ne faut point penser à la vie pour vivre (cf. p. 311), mais à la façon de rester libre sans doute et, si décidément nous n'y parvenions pas, si nous étions pris comme tant d'autres naïfs ou idéalistes dans les filets du conformisme le plus servile, à la mort, à une mort qui serait aussi une action d'éclat secouant les vieilles fondations d'une société percluse.
Notes
(1) Léon Bloy est taxé par notre préfacier de «Jérémie de la rue Blomet» et «insigne traboucaire de la calomnie» (Auriant reprend des termes utilisés par Darien à la page 288) de même que de «virtuose plus accompli [que Drumont] du tam-tam», et de «saltimbanque plus sacrilège que l'Ogre [surnom donné à l'auteur de La France juive], in Georges Darien, Les Pharisiens (1891) (éditions 10/18, coll. Fins de siècles, 1978), p. 16. Une page plus loin, Léon Bloy est le maître peu reluisant d'une «écriture barbare, pastiche grossier de la manière de Barbey d'Aurevilly, d'Huysmans et des Écritures», qui a été «à la littérature ce que le faire pseudo byzantin de Rouault représentait en peinture».
(2) Tout comme l'est bien sûr Georges Darien, dont Vendredeuil est le prête-nom transparent, Darien si cruel lorsqu'il affirme par exemple, à propos de Drumont, qu'il «faisait des vers comme il faisait pipi – jusque dans son lit. Ses parents, justement effrayés dune fécondité si merveilleuse, voulurent arrêter cette incontinence de rimes. Tout fut inutile» (p. 58). Il dit encore de lui, et ce trait conviendrait merveilleusement à la presque totalité de nos écrivants, romanciers ou journalistes dont Darien semble avoir de très loin reniflé l'absolue médiocrité : «Une opinion lui faisait signe : il accourait. un journal lui faisait : Psitt ! il montait l'escalier» (p. 61). Du peintre Bracquehaye, autre médiocre, Darien écrit : «Des gens qui l'avaient connu tout enfant affirmaient qu'il ressemblait, dans son jeune âge, à un fœtus ressuscité par un malfaisant thaumaturge, et qui se serait échappé de son bocal après en avoir avalé l'alcool» (p. 94).
(3) «Et il faut avoir, alors, toutes prêtes, pour décrire, des images et des comparaisons qu'on pose, ainsi que des masques qui les déforment et les défigurent, sur des visions fuyantes... Et puis, la misère des métaphores, la petitesse des similitudes : le soleil comparé à une boule de feu, les étoiles à des diamants, les nuages à des plumes ou à des dentelles...» (p. 278).





























































 Imprimer
Imprimer