« Pervers de Jean-Luc Barré | Page d'accueil | Quand Pierre Legendre rencontre Martin Heidegger et que l’anthropologie dogmatique achoppe sur l’histoire de l’être (2), par Baptiste Rappin »
05/10/2019
L'Homme et la Technique d'Oswald Spengler

Photographie (détail) de Juan Asensio.
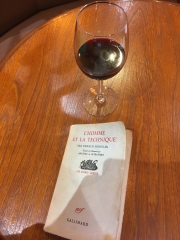 Publié en 1931 et traduit en français en 1958 seulement, L'Homme et la Technique est un texte assez synthétique d'Oswald Spengler, dans lequel, plus d'une fois, est fait référence au Déclin de l'Occident, bien plus ample par son ambition et ses innombrables ramifications comme nous le savons mais qui évoque finalement assez peu la thématique de la technique.
Publié en 1931 et traduit en français en 1958 seulement, L'Homme et la Technique est un texte assez synthétique d'Oswald Spengler, dans lequel, plus d'une fois, est fait référence au Déclin de l'Occident, bien plus ample par son ambition et ses innombrables ramifications comme nous le savons mais qui évoque finalement assez peu la thématique de la technique.La brièveté même de ce texte illustre, bien davantage que de copieuses analyses que l'on pourra par exemple trouver chez Martin Heidegger (rappelons que La Question de la technique date de 1954) ou Ernst Jünger (celui du Travailleur), la fulgurance de l'analyse : nous ne sommes pas face à quelque événement futur qui va immanquablement nous détruire, puisque nous sommes à vrai dire d'ores et déjà tout entiers entrés dans la catastrophe que convoque le Progrès incontrôlable, ce que Heidegger, justement, appellera l'aître de la technique qui est un arraisonnement de la nature, le dévoilement plus violente que progressif selon lequel tout ce qui est, je veux dire : le monde entier des choses comme l'écrit le poète, ne peut qu'être considéré comme ressource exploitable, perpétuellement disponible, gérable, comme l'indique l'ignoble expression ressources humaines, si ce n'est pire, consommable, et nous sommes là dans une vieille thématique romanesque. Spengler, donc, qui écrit : «Mais vers où cette marche ? Et pendant combien de temps ? Et pour arriver à quoi ?», lequel ajoute qu'elle «était un peu ridicule, cette marche vers l'infini et à l'infini, vers un but auquel les hommes ne pensaient pas sérieusement, ou qu'ils ne se représentaient pas clairement, ou même, à la vérité, qu'ils n'osaient pas envisager : car un but est une fin» (1).
Cette certitude que nous touchons à notre propre fin doit être saisie avant qu'il ne soit trop tard, car, prétend Spengler, «nous êtres humains du XXe siècle, nous dévalons la pente les yeux grands ouverts, en pleine conscience» puisque «notre sens de l'histoire, notre aptitude à la décrire et à l'écrire, sont des symptômes révélant clairement que nous parcourons cette pente vers le bas» et parce que c'est «à l'apogée des Hautes Cultures, au moment où elles se muent en Civilisations, que ce don de pénétrante lucidité leur vient et seulement pour un temps bref» (p. 47).
Ne nous étendons pas sur le parcours que Spengler brosse, pourtant rapidement, de l'évolution de l'homme (et de l'apparition du langage) en lien avec la technique, pour nous attarder sur ce qu'il appelle le dernier acte qui n'est autre que l'avènement et la dissolution, immédiate (à l'échelle historique bien sûr) selon l'auteur, de la culture machiniste. C'est le point qui nous intéresse le plus, cette rapidité de la consomption de la civilisation de la Machine, puisque nous nous trouvons selon Spengler et pour le dire en employant un de ses titres, dans les années décisives, «dans la phase la plus aiguë, au moment même où le rideau se lève sur le dernier acte» (p. 133), évidence doublée de la certitude que nous nous enfonçons de plus en plus (nous étions pourtant au début des années 30 !) dans un monde qui s'éloigne drastiquement de la réalité quotidienne, et nous emprisonne dans une bulle fantasmatique, encore plus étanche que la fameuse «cage d'acier de la servitude» évoquée par Max Weber : «Le nombre de mains nécessaires croît parallèlement au nombre des machines, car le luxe technique surpasse toute autre espèce de luxe et notre vie factice devient toujours plus factice» (p. 135). Pour ainsi dire, le Progrès, incontestablement, nous apporte des bienfaits techniques, il faudrait être un imbécile obscurantiste pour le nier, mais il n'en reste pas moins que cet accroissement du confort général de notre cadre de vie, se réalisé au prix de la progression inéluctable, de l'intumescence de la sphère de la facticité, de la stérilité de l'esprit qui «prend naissance et se propage», fait prospérer «une uniformité glaciale, sans relief ni profondeur» (p. 137) et nous asservit.
 Acheter L'homme et la Technique sur Amazon.
Acheter L'homme et la Technique sur Amazon.Cette bulle, véritable «monde artificiel [qui] dans l'étau de l'organisation» emprisonne «toutes les choses vivantes» (p. 143) va très vite imploser sous la pression d'une force mystérieuse, tragique par essence, c'est-à-dire faustienne, qui n'est autre que la nécessité intrinsèque propre à l'expansion techniciste dont l'idéal secret lui-même est «le mouvement perpétuel» (p. 144), l'inlassable soif d'ajouter des machines aux machines, de conquérir de nouveaux territoires, sur terre, sur mer, sous la surface bien sûr de la planète, mais aussi dans les airs et, désormais, dans l'espace avant que d'autres mondes ne soient pillés. Appelons ce mouvement le complexe de Trantor du nom de la planète colossale qu'Isaac Asimov a imaginée entièrement recouverte de kilomètres d'acier : «La créature se dresse contre son créateur. De la même façon que le microcosme Homme se révolta un jour contre la Nature, ainsi fait aujourd'hui le microcosme Machine se révoltant contre l'Homme Nordique», autrement dit l'Occidental, étant donné que le maître du monde qu'il incarne «est en train de devenir l'esclave de la Machine qui le force», que nous le comprenions ou pas, «à en passer par où elle veut», ce qui ne peut avoir comme résultat que cette image finale, éloquente, inquiétante bien sûr : «Abattu, le triomphateur est traîné à mort par le char» (p. 133).
Consomption de l'homme, surtout l'Occidental donc, contre lequel vont finir par se soulever les «multitudes innombrables de Mains des races de couleur» (p. 154), mais aussi fin de la Machine qui s'arrêtera ou même mourra une fois qu'elle sera privée de «l'inspiration qui l'anime» (p. 146), autrement dit de la puissante volonté (ou de la volonté de puissance ?) de la civilisation faustienne qui, une fois parvenue à son sommet, ne pourra longtemps s'y tenir et dont les débris, un jour, «seront éparpillés de-ci de-là, oubliés : nos voies ferrées et nos paquebots, aussi fossiles que les voies romaines et que le Mur de Chine, nos cités géantes de Memphis et de Babylone» (pp. 155-6). Si la pensée technique, toujours comme s'en souviendra Günther Anders, veut se réaliser, s'accomplir, et n'a d'autre but que d'organiser, à l'échelle la plus vaste donc planétaire, la propagation de sa volonté irrépressible, alors tout ce qui sera organique tombera sous la férule implacable et, bientôt, comme dans telle nouvelle d'E. M. Forster, la Machine elle-même s'arrêtera, faute de ressources à piller, faute d'humains à consommer, comme si l'homme, ramolli par un luxe de plus en plus criant, n'était même plus capable de se vouer corps et esprit à son occupation première qui n'est autre que la prédation, comme nous l'apprend l'auteur. C'est une vue à longue portée que développe Oswald Spengler car, incontestablement, d'ici-là, l'empire américano-européen se sera éteint, comme consumé de l'intérieur par l'inéluctable décadence, le relâchement de la volonté même de la technique de mettre au pas l'ensemble du vivant. Dans son intéressante présentation de ce texte, Gilbert Merlio parle, à ce propos, de «morosité technique», une expression qu'il faudrait peut-être corriger par celle de morosité de l'homme faustien (2), ou alors citer Spengler qui, lui, évoque une véritable «nausée des machines» qui envahirait l'organisme tout entier de l'homme faustien, notamment ses plus brillantes créations.
La leçon de Spengler, certes lucide puisqu'elle admet sans mal que, si la technique vise une annihilation finale tout en nous ayant transformés en engrenages, elle n'en reste pas moins l'une des plus remarquables conquêtes de l'homme faustien (3), n'en est cependant pas désespérée car il nous exhorte à adopter le «seul parti pris» digne de nous, qu'il appelle «choix d'Achille», autrement dit : «mieux vaut une vie brève, pleine d'action et d'éclat, plutôt qu'une existence prolongée, mais vide» (p. 156), les toutes dernières lignes de son ouvrage prenant dès lors une couleur résolument apocalyptique, elles qui affirment que : «Nous sommes nés à ce temps et devons poursuivre avec vaillance, jusqu'au terme fatal, le chemin qui nous est tracé. Il n'y a pas d'alternative. Notre devoir est de nous incruster dans cette position intenable, sans espoir, sans possibilité de renfort. Tenir, tenir à l'exemple de ce soldat romain dont le squelette a été retrouvé devant une porte de Pompéi et qui, durant l'éruption du Vésuve, mourut à son poste parce qu'on avait omis de venir le relever. Voilà qui est noble. Voilà qui est grand. Une fin honorable est la seule chose dont on ne puisse pas frustrer un homme» (pp. 156-7), bien que nous ne sachions vraiment, ainsi que semble le penser Michel Onfray dans sa préface, si cette fin honorable suppose que l'homme faustien, l'Occidental au sens large, se réveille de sa longue léthargie et de l'amollissement propre à toute décadence et, avant de disparaître, essaie de se défendre contre ses anciens esclaves, les «gens de couleur» pour qui la technique si incroyablement développée par leurs anciens maîtres n'est rien de plus qu'une arme qu'il s'agira de retourner contre ceux qui l'ont inventée et répandue sur toute la surface de la planète, sans même sembler se douter qu'avec leur plus magnifique créature, surgirait leur propre maître et bourreau implacable.
Notes
(1) Oswal Spengler, L'Homme et la Technique (Der Mensch und die Technik, traduction d'Anatole A. Petrowsky, Gallimard, 1958), p. 44. Une nouvelle édition, dans une traduction de Christophe Lucchese et une présentation de Gilbert Merlio, a paru en 2016 aux excellentes éditions R&N.
(2) La citation de Gilbert Merlio se trouve à la page 88 de la nouvelle édition de L'Homme et la Technique mentionnée à la note précédente. Si le texte de présentation de cet auteur est intéressant comme je l'ai écrit, ses dernières conclusions font toutefois preuve d'un horizon d'attente assez platement et veulement démocratique, comme l'indique par exemple ce passage faisant l'apologie, en fin de compte, d'un Empire aux vertus lénifiantes étendu au monde entier : «La grandeur de l'homme n'est pas d'accepter d'être en perpétuelle guerre avec ses semblables. Nous ne voulons pas être des défaitistes de l'humanité et plaçons malgré tout espoir dans la recherche d'un ordre mondial qui rendrait possible la résolution des inévitables conflits par la négociation plutôt que par la guerre. Et qu'importe le «déclin de l'Occident» pourvu que ses valeurs (droits de l'homme, démocratie, etc.) se répandent dans le monde !» (p. 98).
(3) Martin Heidegger, lui aussi, ne cessera de répéter qu'il n'est pas contre la technique, comme il l'affirma lors de l'entretien télévisé de 1969 à Richard Wisser, et ira même jusqu'à dire que l'aître de la technique «recèle en lui la possibilité que ce qui sauve se lève à notre horizon» (in Essais et Conférences, Gallimard, coll. Tel, 1980, pp. 43-4).





























































 Imprimer
Imprimer