Rechercher : francis moury george romero
Bellum Dei, 2 : terrorisme et mondialisation, par Francis Moury

 Bellum Dei : Guerre sainte, martyre et terreur de Philippe Buc.
Bellum Dei : Guerre sainte, martyre et terreur de Philippe Buc.Note de lecture sur Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation - Approches historiques (éditions Gallimard, NRF-Bibliothèque des sciences humaines, 2016).
«Tout est à présent, comprends-tu ? Hier ne finira que demain et demain a commencé il y a dix mille ans.»
William Faulkner, L'Intrus (1948), traduction R.-N. Raimbault, éditions Gallimard, NRF 1952., cité par Monique Nathan, Faulkner par lui-même (éditions du Seuil, 1963, tirage de 1969) page 138.
Cette histoire moderne et contemporaine des relations internationales, examinée sous l'angle du terrorisme transnational, international et global (de l'Europe de 1820 environ aux débuts de l'État islamique à partir de 2014) est un complément historique et méthodologique naturel au livre de Philippe Buc sur les rapports entre guerre sainte, martyr et terreur en Occident (1) car, inévitablement, les événements du 11 septembre 2001 constituent le point névralgique historique autant que conceptuel de la démonstration de Jenny Raflik. Or ces événements appartiennent à un épisode relevant de la guerre sainte islamique telle que les stratèges d'Al-Quaida l'ont conçue (reprise serait plus exacte : voir par exemple l'insurrection dirigée par Mohammad al-Mahdi au Soudan aboutissant au siège puis à la prise militaire de Khartoum en 1885, ce qui provoque la chute du premier ministre anglais William E. Gladstone accusé de n'avoir pas assez vite secouru Charles Gordon qui défendait la capitale), guerre sainte dont le terrorisme est partie intégrante, opératoire, fonctionnelle puisqu'il vise à semer la terreur chez les ennemis de Dieu. Alors que Philippe Buc était le tenant d'une thèse continuiste maintenant l'identité du phénomènes de l'Ancien Testament à nos jours dans les religions hébraïque, catholique, musulmane et protestante, Jenny Raflik estime qu'on peut y introduire une sorte de coupure épistémologique (2) qu'elle situe vers le milieu du dix-neuvième siècle, période où débute la globalisation au sens économique et technologique. C'est à partir de cette époque que le terrorisme moderne naît, en jouant simultanément et consciemment sur plusieurs échelles spatiales, temporelles et médiatiques, sa forme retentissant du coup inévitablement sur son contenu.
Il n'y pas pourtant pas de rapport de finalité entre les diverses familles distinguées : le terrorisme des anarchistes révolutionnaires russes, balkaniques, français ou italiens de la fin du dix-neuvième siècle se donne d'autres buts que le terrorisme du Ku Klux Klan, lui-même n'ayant pas grand-chose en commun avec les Tigres Tamouls de Ceylan, le terrorisme nationaliste de l'Irgoun juive de 1944, sans oublier l'IRA irlandaise dont les origines historiques remontent au moins à 1815. Inversement le terrorisme d'état théorisé par Léon Trotski en 1920-1930 et mis en œuvre par les Soviétiques ou celui appliqué par les Romains de l'antiquité contre les révoltes juives elles-mêmes terroristes des Zélotes n'ont pas tant de points communs avec la guerre d'Al-Quaida.
Le terrorisme serait-il donc un flatus vocis, un être de raison ? Non puisque les États occidentaux modernes organisèrent dès 1898 une première Conférence internationale contre le terrorisme (anarchiste) et que le vingtième siècle fut rythmé par de telles conférences vouées à des terrorismes ethno-nationalistes, politiques, religieux. Jenny Raflik a eu accès aux rapports secrets déclassifiés de la NSA et de la CIA américaines, à ceux du ministère français de la défense, de l'OTAN (1949-1982) et d'autres institutions encore. Sa bibliographie rassemble dix-sept pages de sources internationales et françaises très variées, utilisées à bon escient. On apprend ainsi qu'il existe des bases internationales mi-étatiques mi-privées, établies et mises à jour par des universitaires afin de recenser systématiquement et statistiquement les divers types d'action terroriste : on les répartit par sexes de l'agent terroriste, par classes sociales, par niveau culturel, par la répartition géographique de son action, par son évolution chronologique, par le nombre de morts provoqués, ainsi de suite. Tout comme en économie politique, les sophistes ne se privent pas d'interpréter dans les sens les plus contradictoires ces données, prouvant ainsi qu'il n'y a pas d'expertise claire et scientifique du terrorisme : il demeure difficile à définir, à quantifier, à qualifier, in fine à combattre.
C'est le grand mérite de ce livre, publié dans une «Bibliothèque sciences humaines» qui archive la sociologie historique et politique de Raymond Aron, les études d'histoire des religions de Georges Dumézil, les études de sociologie religieuse et économiques de Max Weber, que de pousser l'enquête plus avant, sur le terrain de la philosophie de l'histoire.
La section (troisième partie, chapitre 8, pages 247 à 260) la plus naturellement excitante pour le philosophe est bien entendu celle relatant le fameux dialogue (2003 modifié 2004 pour son édition française) entre Jacques Derrida et Jürgen Habermas sur le concept du 11 septembre. Il est examiné à sa place chronologique dans l'histoire contemporaine des idées, après la thèse de Francis Fukuyama (3) post-guerre froide sur le triomphe universel envisageable de la démocratie à la suite de la chute du communisme soviétique et maoïste, après l'antithèse de Samuel Huntington (4). C'était d'abord un dialogue socratique et interrogatif : que s'est-il passé et comment caractériser précisément, essentiellement, la nature de l'événement ? Infirmait-il définitivement la thèse de Fukuyama ? Confirmait-il la thèse de Huntington ? Il ne répondait pas clairement à ces questions et il lui était donc impossible de devenir un «modèle» opératoire ou conceptuel utilisable par la philosophie de l'histoire. Sans surprise, ce dialogue s'est donc révélé sinon un flatus vocis du moins un quasi-impensé parce que quasi-impensable, faute de recul. Il impliquait (sans le dire franchement) simplement que Fukuyama s'était trompé et que Huntington avait raison mais le moindre historien ayant sérieusement étudié sa discipline pouvait déjà le prévoir : Jenny Raflik cite en ce sens Arnold Toynbee (5) dont le pessimisme intelligent ne pouvait que contredire d'avance l'optimisme assez niais de Fukuyama. Elle remarque d'ailleurs bien que la thèse de Huntington peut donner satisfaction aussi bien au camp occidental qu'au camp terroriste d'Al-Quaida, signe de son inquiétante pertinence.
Les statistiques, l'histoire moderne et contemporaine, l'histoire des idées, la sociologie, l'économie sont convoquées et même la psychiatrie et la psychologie le sont aussi puisque, inévitablement, certains commentateurs ont très sérieusement posé la question de savoir si les terroristes étaient fous ou bien si leurs familles pouvaient présenter des signes statistiques de cas de démence meurtrière. Inutile de préciser que ces enquêtes n'aboutissent pas : un certain nombre de terroristes ont vécu une enfance heureuse dans des familles soudées et riches voire richissimes. De tout cela, on ne tire que des formes structurelles vides, pouvant être mises à disposition d'interprétations opposées et tout aussi vaines.
Il faudrait donc peut-être pousser un cran plus loin l'analyse du phénomène en utilisant la psychologie des profondeurs, la philosophie des religions et la philosophie de l'histoire mais d'une histoire envisagée cette fois des origines primitives à nos jours. Sortons donc un instant du cadre de l'histoire des relations internationales ou bien enrichissons-les de quelques points de vue intéressants.
Du côté de la psychologie des profondeurs, Francis Pasche s'était intéressé à la question. Il avait publié en 1990 un article (6) dans lequel il définissait, à propos de la question de savoir si la psychanalyse pouvait être assimilée à une idéologie, cette dernière comme la source du terrorisme. Il était revenu sur la question au début de Idéal et idéalité (7) en 1995, repris dans la seconde partie de son recueil posthume Le Passé recomposé. Voici la définition qu'il en donne (page 50) :
«Je ne crois pas que, dans les sociétés scientifiques, ni dans les médias, le terme idéologie soit souvent utilisé au sens que son inventeur Destutt de Tracy lui a donné, à moins de le spécifier. L'on entend par là habituellement de nos jours une croyance collective en un système exclusif de pensée et de règles d'action impératif, car à ce système il est conféré une valeur absolue. Cela entraîne chez tous ceux qui partagent cette croyance l'ambition de convertir par tous les moyens, fût-ce par les plus violents, le reste des êtres humains qui ne la partagent pas, ou tout au moins de leur imposer l'observance de ses lois par la conquête et la contrainte jusqu'à l'élimination physique et la purification ethnique. Il en est ainsi du marxisme-léninisme, du nazisme, des divers intégrismes religieux et des nationalismes exacerbés. »
L'idéologie ainsi conçue serait, sur le plan purement psychanalytique, «l'aboutissement d'un processus beaucoup plus global que dans le cas de l'Idéal du moi et de l'idéalisation. C'est une régression massive en deçà de la survenue du Surmoi paternel» (page 54). Sur la distinction afférente, théorique et clinique, entre Idéal du moi, idéalisation et idéologie d'une part, Surmoi d'autre part, le lecteur pourra lire avec profit l'article Du Surmoi ambivalent au Surmoi impersonnel (écrit en 1995 mais situé après l'article de 1993 dans le même recueil posthume organisé par Didier Anzieu) qui s'ouvre sous les auspices de la théologie négative du Pseudo-Denys l'Aréopagite et de la section psychologique de la métaphysique de René Descartes, à savoir Les Passions de l'âme.
Du côté de la philosophie des religions et de l'histoire des religions, il faut savoir que les thèses de Philippe Buc et certains aspects de l'analyse de Jenny Raflik trouvent un soubassement naturel chez celles de penseurs tels que Rudolf Otto, Mircea Eliade ou Roger Caillois. Le sacré inspire l'amour et la terreur simultanément : il est tremendum et fascinans. C'est de cette fascinante dualité qu'il faudrait partir pour étudier la question de l'origine religieuse du terrorisme d'une part, du rapport de l'histoire religieuse à la terreur d'autre part, non seulement dans les religions monothéistes révélées modernes (G.W.F. Hegel, Max Weber, James Frazer, Sigmund Freud, Karl Kérényi, Georges Bataille) mais encore dans les religions primitives indo-européennes et antiques (Franz Cumont, Georges Dumézil, Mircea Eliade, James Frazer, Sigmund Freud, Jean-Pierre Vernant), asiatiques (Mircea Eliade, Marcel Granet, Max Weber), africaines, américaines et australiennes (Georges Bataille, Mircea Eliade, Lucien Lévy-Bruhl, Marcel Mauss, Alfred Métraux, Géza Roheim).
La philosophie de l'histoire aurait enfin son mot à dire car elle utilise souvent des fragments de philosophie de la religion pour établir ses constructions théoriques. Sans la Vie de Jésus de G.W.F. Hegel et son exégèse du rachat sacrificiel, il n'y a plus de philosophie hégélienne de l'histoire qui tienne : Jean Wahl l'avait bien établi en son temps (8) et Bernard Bourgeois et Claude Bruaire l'ont depuis amplement confirmé. Sans philosophie de la religion, sans philosophie de l'histoire de la religion, il n'y a plus non plus de système du savoir encyclopédique hégélien qui tienne, ainsi que l'a très bien montré François Chatelet. (9) Que les religions se combattent et se succèdent temporellement dans un même espace, que la hiérophanie puisse être terrifiante, que les instruments de la gloire de Dieu puissent être la terreur qu'il inspire : ces éléments ont, dans la philosophie de G.W.F. Hegel, un sens dialectique. D'une certaine manière, mais dans un registre purement catholique dérivé de la théologie politique des pères grecs et latins (notamment saint Augustin et Origène), le thème inspire aussi son contemporain Joseph de Maistre (10). Il y aurait en outre des éléments à étudier dans ce sens à partir des études classiques sur les rapports du Destin et des êtres humains dans l'Histoire romaine de Tite-Live, dans la Pharsale de Lucain, dans les Vies parallèles de Plutarque : voir à ces sujets les études respectives de Raymond Bloch, de René Pichon, de Bernard Latzarus (11). Le thème en question se prolonge jusqu'à William Shakespeare au moins : le cauchemar fantastique de Calpurnia, la veille de la mort de César, provient en droite ligne des historiens grecs et romains des deux premiers siècles après JC. Les prodiges, les monstres, les cauchemars sont un avertissement des Dieux dans l'antiquité classique : ils terrifient les hommes parce qu'ils sont interprétés comme étant des messages divins, outre leur charge symbolique et plastique.
S'y ajoute le thème du sacrifice humain, transversal à l'histoire violente des religions primitives comme modernes, étudié par les divers historiens et philosophes des religions cités plus haut. Les étrangleurs voués à la déesse Kali sont mentionnés brièvement par Jenny Raflik mais il me semble qu'ils eussent mérités une étude à part entière. Ils lui rendaient depuis (au moins) le treizième siècle jusqu'au dix-neuvième siècle un culte primitif en étranglant les voyageurs indiens ou étrangers qui traversaient l'Inde : des dizaines voire des centaines de milliers (certaines sources évoquent des millions) de morts leur furent attribués par les administrateurs anglais victoriens qui furent contraints de créer une unité de police spéciale pour tenter d'en venir à bout (12). Ce phénomène pose d'intéressantes questions d'histoire des religions en raison de l'ampleur de sa répartition géographique, et de son aspect transversal puisqu'il recoupait des territoires hindouistes et musulmans – dont la distinction aboutit en 1947 à la partition politique de l'Inde et du Pakistan – d'une manière que les Anglais documentèrent aussi précisément qu'ils le purent durant leur colonisation de ces territoires au dix-neuvième siècle.
Sur le plan matériel, le livre de Jenny Raflik est pratiquement impeccable : je n'ai relevé qu'une seule coquille à la note 1 de la dernière ligne de la page 364 où il faut lire non pas le fautif «figure 31» mais le correct : figure 28, puisqu'elle renvoie à la dernière et vingt-huitième figure (un «schéma d'interprétation de l'évolution du terrorisme international» illustrant le livre. L'annexe rassemble commodément les sources internationales administratives, internet (bases de données) et bibliographiques, ainsi qu'une liste des sigles des organisations terroristes et un index des groupes terroristes.
Une seule lacune relevée, à la rubrique «Irgoun», page 401 : il faudrait rajouter en référence la note 1 de la page 124 qui répertorie les lieux et dénombre les victimes arabes et britanniques des attentats à la bombe et à la voiture piégée commis en Palestine par cette organisation juive entre février 1944 et février 1948.
Notes
1) Philippe Buc, Guerre sainte, martyre et terreur – Les formes chrétiennes de la violence en Occident (Éditions Gallimard, 2017). Voir note indiquée plus haut.
2) Ce terme s'entend au sens que lui avait donné Gaston Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique (Éditions Vrin, 1938). En histoire de la philosophie des sciences, Bachelard était discontinuiste : il assurait qu'il s'était produit au dix-septième siècle une révolution dans la pensée scientifique, instaurant un rationalisme inédit. Son collègue à la Sorbonne, Léon Brunschvicg, Les Âges de l'intelligence (Éditions PUF, 1934) défendait la même position. Tous deux s'opposaient à la célèbre thèse continuiste émise en 1908 par Émile Meyerson, le correspondant d'Einstein dont les disciples immédiats furent Alexandre Koyré et Louis de Broglie.
3) Francis Fukuyama, La Fin de l'histoire et le dernier homme (Éditions Flammarion, 1992). La première partie du titre est empruntée à la philosophie de G.W.F. Hegel et la seconde partie provient de Friedrich Nietzsche, ainsi que ne manque pas de le préciser Jenny Raflik.
4) Samuel Huntington, Le Choc des civilisations (Éditions Odile Jacob, 1997). Jenny Raflik remarque page 253 que le titre du livre de Huntington n'est plus suivi d'un point d'interrogation alors que celui de l'article original, paru en 1993, en comportait un.
5) Arnold J. Toynbee, A Study of History (Oxford University Press, 1934-1961). Pour une approche francophone, non citée par Jenny Raflik mais plus commode d'accès, cf. A.J. Toynbee, Guerre et civilisation, extraits par Albert-V. Fowler, traduction Albert Colnat (Éditions Gallimard, 1953 puis retirage in collection Idées-Gallimard, 1962). Du même Toynbee, Le Christianisme et les autres religions du monde (Éditions universitaires, 1959) traite d'une partie des questions soulevées par Philippe Buc d'une part, par Jenny Raflik d'autre part.
6) Francis Pasche, La Psychanalyse est-elle une idéologie ? in Revue Française de Psychanalyse n°54 (Éditions PUF, 1990).
7) Francis Pasche, Le Passé recomposé – Pensées, mythes, praxis, préfacé par Didier Anzieu (Éditions PUF, 1999), page 51.
8) Jean Wahl, Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, (Éditions PUF, collection BPC, 1929 + revue 1951).
9) Francis Moury, La Vie et la mort du système de G.W.F. Hegel (2009), archivé ici : https://www.juanasensio.com/archive/2009/02/11/la-vie-et-la-mort-du-systeme-de-g-w-f-hegel-par-francis-moury.html.
10) Jacques Ploncard d'Assac, Enquête sur le nationalisme : Joseph de Maistre, (Éditions Société de philosophie politique, Lisbonne 1969) demeure une estimable introduction d'ensemble à sa vie et son oeuvre + Juan Asensio, Notes de lecture sur les Considérations sur la France de Joseph de Maistre, archivée ici. Juan Asensio y résume clairement l'aspect théocratique de la philosophie de l'histoire de Joseph de Maistre : «C'est la violence même de l'événement révolutionnaire qui en signe l'appartenance à un ordre supérieur, invisible, qu'il convient de pouvoir discerner, comme seul peut le faire un voyant».
11) Raymond Bloch, Les Prodiges dans l'Antiquité classique (Éditions PUF, coll. Mythe et religions, 1963) + René Pichon, Les Sources de Lucain (Éditions Ernest Leroux, 1912) + Bernard Latzarus, Les Idées religieuses de Plutarque (Éditions Ernest Leroux, 1920).
12) Cf. la note historique finale inscrite à l'écran, à la fin du remarquable mais aujourd'hui un peu trop méconnu Les Étrangleurs de Bombay (The Stranglers of Bomba
14/08/2019 | Lien permanent
Wittgenstein par lui-même, par Francis Moury
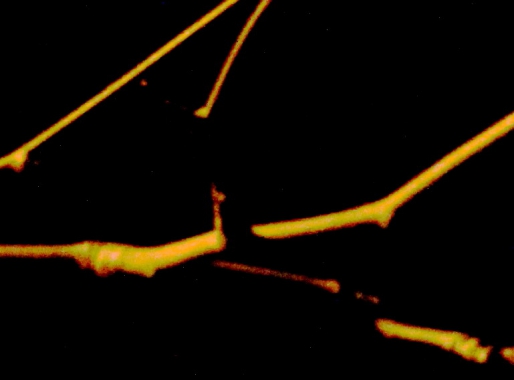
Notes de lecture sur : Ludwig Wittgenstein, Correspondance philosophique 1911-1951 (postface Wittgenstein à Cambridge par Brian McGuinness, traduction et notes par Élisabeth Rigal, éditions Gallimard, NRF, Bibliothèque de philosophie, novembre 2015).
«En quoi as-tu foi ? En ceci : qu'il faut déterminer à nouveau le poids de toutes choses.»
Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir (1882), §269 (traduction A. Vialatte, éditions Gallimard-NRF, 1950, retirage Idées-Gallimard, 1972), p. 219.
 Ce volume d'environ 900 pages rassemble la correspondance philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) tenue entre 1911 et 1951 avec ses collègues de Cambridge (Bertrand Russell, George Edward Moore, J.M. Keynes, etc.) et de Vienne (Gottlob Frege, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, etc.), avec ses élèves de Cambridge, avec Charles Kay Ogden, l'un des traducteurs anglais du Tractatus logico-philosophicus (ces lettres-là sont précieusement revues et annotées par Georg Henrik Von Wright), ainsi que des comptes rendus, parfois très savoureux, des séances du Club des sciences morales de Cambridge et de celles de la société mathématique de Trinity College. On lui a adjoint une intéressante postface de B. McGuinness sur la vie de Wittgenstein à Cambridge. L'ensemble, de presque 600 lettres et documents, était antérieurement éparpillé en plusieurs langues, en livres anglais et allemands. Certains volumes étaient parfois épuisés. Quant aux documents intégrés à certaines bases de données internet philosophiques allemandes, ils n'étaient pas d'un accès facile au lecteur français non-germaniste. Cette correspondance est pour la première fois réunie en un seul volume et traduite dans notre langue, ce qui a notamment nécessité de renuméroter l'ensemble des lettres et documents. Elle augmente notre connaissance de la biographie et de la philosophie de Wittgenstein, celle de l'histoire du positivisme logique de Vienne, et celle de l'histoire de la philosophie anglaise puisqu'elle couvre les trois périodes philosophiques qu'on distingue habituellement dans son œuvre : sa première période (Carnets 1914-1916, Tractatus logico-philosophicus, éditions 1922 et 1933), sa seconde période (Cahier bleu de 1934, Cahier brun de 1935, Fiches découpées entre 1929 et 1948, Recherches philosophiques, édition posthume de 1953), sa troisième période (De la certitude, aphorismes rédigés entre 1948 et 1951).
Ce volume d'environ 900 pages rassemble la correspondance philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) tenue entre 1911 et 1951 avec ses collègues de Cambridge (Bertrand Russell, George Edward Moore, J.M. Keynes, etc.) et de Vienne (Gottlob Frege, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, etc.), avec ses élèves de Cambridge, avec Charles Kay Ogden, l'un des traducteurs anglais du Tractatus logico-philosophicus (ces lettres-là sont précieusement revues et annotées par Georg Henrik Von Wright), ainsi que des comptes rendus, parfois très savoureux, des séances du Club des sciences morales de Cambridge et de celles de la société mathématique de Trinity College. On lui a adjoint une intéressante postface de B. McGuinness sur la vie de Wittgenstein à Cambridge. L'ensemble, de presque 600 lettres et documents, était antérieurement éparpillé en plusieurs langues, en livres anglais et allemands. Certains volumes étaient parfois épuisés. Quant aux documents intégrés à certaines bases de données internet philosophiques allemandes, ils n'étaient pas d'un accès facile au lecteur français non-germaniste. Cette correspondance est pour la première fois réunie en un seul volume et traduite dans notre langue, ce qui a notamment nécessité de renuméroter l'ensemble des lettres et documents. Elle augmente notre connaissance de la biographie et de la philosophie de Wittgenstein, celle de l'histoire du positivisme logique de Vienne, et celle de l'histoire de la philosophie anglaise puisqu'elle couvre les trois périodes philosophiques qu'on distingue habituellement dans son œuvre : sa première période (Carnets 1914-1916, Tractatus logico-philosophicus, éditions 1922 et 1933), sa seconde période (Cahier bleu de 1934, Cahier brun de 1935, Fiches découpées entre 1929 et 1948, Recherches philosophiques, édition posthume de 1953), sa troisième période (De la certitude, aphorismes rédigés entre 1948 et 1951).Dans une remarque sur l'alinéa 5-5563 du Tractatus, jointe en annexe à sa lettre à C. K. Ogden du 10 mai 1922 (p. 730), Wittgenstein écrit ceci : «Je veux dire que toutes les propositions de notre langage ordinaire ne sont pas, en quelque façon que ce soit, moins correctes, moins exactes ou plus confuses du point de vue logique que les propositions écrites, disons, dans le symbolisme russellien ou dans une autre «Begriffschrift». (Simplement il nous est plus facile de reconnaître la forme logique de ces propositions lorsqu'elles sont exprimées dans un symbolisme approprié)». Autrement dit, il a choisi de s'exprimer au moyen de la logique mathématique par souci de clarté. Choix que le lecteur français non prévenu en faveur de cette discipline, considérera peut-être moins absurde et paradoxal, à la lumière de cette remarque traduite près de cent ans après qu'elle a été formulée. Et lorsqu'il emploie le langage usuel, il le fait souvent en usant d'une forme aphoristique qui ne se signale pas, en histoire de la philosophie, par ses qualités de clarté : Héraclite (surnommé à juste titre Héraclite l'obscur) et Friedrich Nietzsche (interprété de tant de manières différentes parfois diamétralement opposées) constituant de fameux précédents à l'appui de mon assertion. C'est tout à l'honneur de Wittgenstein d'avoir voulu allier logique mathématique, aphorisme et souci de clarté, mais a-t-il réussi ? Que chaque aphorisme wittgensteinien soit clair, ce n'est, certes, pas toujours le cas. Et il faut bien convenir que leur réunion physique par des éditeurs posthumes n'augmente pas forcément la clarté des individus propositionnels réunis. C'est le moins qu'on puisse dire. Autrement dit, on peut à titre posthume lui retourner la critique qu'il proférait contre les Principia Ethica de G. E. Moore. Toute admiration étant, selon le juste mot de Renan, historique, et puisque je viens de citer le livre de Moore, l'histoire de la philosophie (histoire dont la connaissance est nécessaire avant de lire un philosophe quel qu'il soit, y compris – voire surtout ! – Wittgenstein) nous aidera peut-être à y voir plus clair.
À Cambridge, durant la période où le jeune Wittgenstein rédigeait le Tractatus, deux livres étaient considérés comme majeurs : les Principia Ethica (1903) de George Edward Moore, avec lequel Wittgenstein est en désaccord presque total, et les Principia Mathematica (1910-1913) de Bertrand Russell et Alfred North Whitehead, que Wittgenstein entreprit de «réparer» selon l'heureuse expression de B. McGuinness. Russell affirmait : «La logique est devenue la grande libératrice» (1). Mais libératrice de quoi ? D'abord libératrice de l'hégélianisme. Il convient de souligner que l'anti-hégélianisme de Wittgenstein s'exprime à deux reprises : il fait une allusion ironique à l'hégélien J.M.E. McTaggart (lettre n°134 à J.M. Keynes de 1913, p.181), il en fait une autre non moins ironique (lettre n°90 à Moore de 1914, p.132) à l'hégélien Bernard Bosanquet. Ensuite, libératrice du pragmatisme, avec lequel l'hégélianisme entretenait d'assez étroits rapports, bien que Wittgenstein ait été un lecteur passionné du livre de William James, Les Variétés de l'expérience religieuse (1902). Peut-être enfin et surtout, libératrice de l'ontologie aristotélicienne qui détermine l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Aristote n'a pas construit une philosophie du langage mais une philosophie ontologique. La Rhétorique ne constitue que la dernière section de son Organon. Wittgenstein semble avoir décidé de refaire l'Organon en faisant semblant d'ignorer la construction métaphysique d'Aristote (2) : cette posture peut sembler, sinon historiquement du moins logiquement, aussi absurde que celle des logiciens de Port-Royal ou que celle du Descartes des Regulae ad directionem ingenii, mais, en réalité, Aristote lui-même avait posé les bases de sa possible survenue. Aristote ne fait, en effet, absolument pas confiance au langage, tenu pour très inférieur à la réalité (3). Wittgenstein non plus n'a aucune confiance dans le langage (en dépit de la citation supra qui ouvre notre article) : c'est son point commun avec Aristote, et s'il n'y en a qu'un, c'est assurément celui-là. En logique, il s'intéresse à la copule aristotélicienne. Il faut noter que sir William Hamilton avait déjà, durant la première moitié du dix-neuvième siècle, concernant la quantification du prédicat, établi que la copule aristotélicienne peut, dans certains cas, équivaloir au signe «=». Wittgenstein s'intéresse à ce genre de problèmes, au calcul logique créé par Morgan et Boole, poursuivi par Russell et d'autres encore. C'est à la physique de dire si quelque chose existe, pas à la métaphysique. La logique ne peut pas dire si quelque chose existe dans la mesure où elle n'est qu'une tautologie perfectible. Elle peut, en revanche, établir d'une manière transparente comment le dire.
Les problèmes métaphysiques seraient donc simplement de faux problèmes provenant d'un usage incorrect des règles logiques du langage. Mais quelles règles ? Et sur le fond de ces problèmes, que peut-on positivement dire ? C'est la tâche infinie de Wittgenstein de répondre à ces questions. Wittgenstein a abordé, dans des leçons variées, l'esthétique, l'éthique, la mystique religieuse en tant que domaines de recherches et de réflexions. Avec quels résultats ? Quelle esthétique, quelle éthique, quelle mystique peuvent se revendiquer aujourd'hui de lui ? Wittgenstein n'apprécia pas un exposé de J.-L. Austin, ainsi qu'en témoigne une allusion de sa correspondance, allusion éclairée en note par la traductrice. Le fait est intéressant : peut-être parce que la théorie austinienne des énoncés performatifs n'est pas une théorie logique du langage ? Autant de langages, autant de réalités différentes, autant de mondes privés constitués de relations internes et externes, dont le langage serait un isomorphisme ? On discerne parfois, dans les trois périodes de l'histoire de sa philosophie, une certaine oscillation entre idéalisme et réalisme chez Wittgenstein.
Le Tractatus logico-philosophicus est difficile à lire et à traduire, d'autant plus difficile qu'au moment de sa rédaction, la machine à écrire de Wittgenstein ne pouvait pas reproduire les signes logiques utilisés par Russell, si bien que Wittgenstein leur en a, parfois, substitués d'autres ! L'enfer pour ses éditeurs et traducteurs ne s'arrêtait pas là car Wittgenstein modifie et précise constamment, à l'occasion de sa correspondance et de la réédition de 1933, les formulations initiales. Sans parler des traductions françaises parfois défaillantes : «le cas» traduisant «état de choses» ou plus exactement l'expression latine «status rerum» en s'inspirant du «case» anglais. McGuinness résume plaisamment l'ouvrage en disant qu'il répare la logique de Russell, qu'il améliore le calcul des probabilités de J.M. Keynes, et qu'il comporte des conclusions rajoutées en 1916-1918 durant la période où Wittgenstein était prisonnier du guerre, sur la religion, la liberté, le mysticisme. A cette époque, Wittgenstein lisait Tolstoï, Trakl (qu'il admirait particulièrement), Rilke et Kraus. Cette idée d'une fracture ouverte entre logique (commandant le langage et entretenant des similitudes avec la grammaire) et réalité est peut-être l'aspect le plus fécond des recherches de la section achevée du Tractatus dès 1915 mais il n'est pourtant pas non plus – faut-il le dire ? – une innovation : Aristote, Descartes, Kant et bien d'autres l'ont pensé, sinon comme lui du moins bien avant lui. Wittgenstein l'exprime d'une manière qui n'est pas non plus entièrement nouvelle. La forme fragmentaire énigmatique, aphoristique de Wittgenstein évoque aussi le style d'Héraclite et de Nietzsche parce qu'ils exprimaient précisément déjà cette fracture. Nietzsche avait même préféré, à mesure qu'il écrivait, la forme poétique à la forme discursive et argumentative. La seule nouveauté historique réelle apportée par Wittgenstein consiste probablement dans l'énonciation de nouvelles propositions de logique formelle, sous la forme de la logique mathématique. Conscient de ses insuffisances, Wittgenstein renia avec toujours plus de vigueur, à mesure que le temps passait, le Tractatus dans son ensemble.
Il faut donc bien en convenir : Wittgenstein est inconstant en philosophie (raison pour laquelle il n'a probablement pas pu constituer un système mais juste un ensemble de recherches) comme dans sa vie privée mais à chaque fois, il s'avère sincère. Il est, assurément, amoureux de la vérité comme pouvait l'être «ce cher Socrate !» qui sert d'exemple dans la définition de l'homme par la logique aristotélicienne classique, pré-mathématique. De fait, il y a quelque chose de réellement socratique en lui, formalisme logique excepté, car son amour de la vérité l'a empêché, sa vie durant, d'être satisfait. Son amour des exemples concrets (son étonnante définition du solipsisme le 25 mai 1940, telle que la relate Isaiah Berlin in op. cit., p. 842) est, lui aussi, éminemment socratique. De même qu'il y a quelque chose de platonicien et de socratique tout à la fois, dans cette manière qu'il a d'entretenir un rapport amoureux avec certains de ses disciples. Cet aspect de sa biographie est le plus haut en couleurs et il n'est pas anodin que le cinéaste anglais Derek Jarman lui ait consacré en 1993 un remarquable téléfilm avec Michael Gough dans le rôle de Russell (nul doute, soit dit en passant, que Gough eût été tout aussi parfait dans le rôle de Wittgenstein âgé si Jarman le lui avait confié). Sa sincérité philosophique s'exprime aussi, très concrètement, par ses disputes, ses inimitiés, ses jugements abrupts («...Wisdom, Waismann, Ryle et autres charlatans...» in lettre n°510 à Malcolm, du 19 mars 1951, p. 685) sans oublier celui sur C.E.M. Joad, professeur de philosophie et conférencier radiophonique, rudement comparé au tenancier d'un taudis «s'opposant à son assainissement».
Sur la position de Wittgenstein envers le christianisme, cette correspondance apporte un éclairage intéressant. On lit en effet parfois, dans certaines notices biographiques un peu hâtivement rédigées, que Wittgenstein était devenu chrétien après la Première Guerre mondiale. Outre que «chrétien» ne veut pas dire grand-chose en raison des différences théologiques significatives entre les trois variétés du christianisme que sont le catholicisme romain, le protestantisme réformé et l'orthodoxie byzantine, on doit désormais tenir compte du fait que la lettre 548 de Wittgenstein à Smythies, du 7 avril 1944 (pp. 791-792) contredit explicitement une telle affirmation : «[...] Apprendre que tu te rallies à l'Église catholique romaine est en effet une nouvelle inattendue. Mais comment saurais-je si c'en est une bonne ou mauvaise ? Voici ce qui me paraît clair. Décider de devenir chrétien, c'est comme décider de ne plus marcher sur la terre ferme mais sur une corde raide où rien n'est plus facile que de glisser [...] je n'ai moi-même jamais quitté la terre ferme».
Sur Kant, Wittgenstein aurait déclaré : «son style est bon mais c'est celui d'un fou» ! Or Wittgenstein a fréquemment l'impression de devenir fou : il l'écrit à l'époque du Tractatus à plusieurs reprises. Plus tard, durant les années 1940-50, il remarque assez souvent et dans des termes souvent identiques : «j'ai l'impression d'être stupide, bête... mon cerveau est vide, épuisé, je crains qu'il ne puisse plus jamais rien produire» (de telles expressions sont disséminées dans un grand nombre de lettres). Sur l'histoire de la philosophie en général, Wittgenstein considère qu'elle ne sert pas à grand-chose. Pourtant, il la connaît à la perfection, citant par exemple en connaisseur saint Augustin à propos du problème du temps. Sa culture est, de toute évidence, celle de l'élite viennoise contemporaine de Freud. Signalons, en passant, que Wittgenstein n'est pas insensible au génie de Freud qui est son contemporain. Cette posture anti-historique, nourrie d'histoire parfaitement connue, est-elle donc malhonnête ? Elle paraît, en tout cas, contredire son intérêt envers Oswald Spengler et sa théorie morphologique des «airs de famille» dans l'histoire. McGuinness précise que l'idée d'un «air de famille» telle que Spengler l'utilise, est un argument en faveur de l'absence d'essence métaphysique. Le signe, à cette époque, est devenu pour Wittgenstein quelque chose qui n'est pas susceptible de relever d'une grammaire. On connaît la fameuse anecdote du «geste de Sraffa». Sraffa était un économiste italien (un marxiste, tendance Gramsci) qui était protégé par Keynes et qui discutait fréquemment avec Wittgenstein : il aurait un jour esquissé devant lui un geste familier aux Napolitains en lui demandant : «Dites-moi quelle peut bien être la grammaire de cela ?» À cette question posée, on considère aujourd'hui qu'on doit la seconde philosophie de Wittgenstein. Notons enfin, concernant Spengler, que Wittgenstein s'oppose au jugement critique très négatif que portait Martin Heidegger sur le même Spengler dans son cours du semestre d'été 1920 à Fribourg (4). Je note cette opposition sans trancher le fait de savoir si Wittgenstein en avait conscience ou non, donc sans savoir s'il avait eu connaissance du jugement de Heidegger.
On considère Wittgenstein comme un grand logicien qui a contribué à l'histoire philosophique du problème classique du fondement (ou de l'impossibilité du fondement) des mathématiques, à la construction de la logique mathématique, à celle de la philosophie analytique du langage. Pourtant ce n'était pas du tout l'avis de son maître G. Frege. Les lettres 248 à 251 adressées par Frege à Wittgenstein, constituent en effet une implacable critique du Tractatus que je recommande de lire absolument. Wittgenstein a beau penser que Frege n'a rien compris au Tractatus, il se pourrait que Frege ait, tout au contraire, parfaitement compris ses irrémédiables faiblesses. Il faut d'ailleurs bien conserver en mémoire que Wittgenstein a maintenu, selon Élisabeth Rigal, son admiration intellectuelle envers Frege en dépit de cela, à la différence de ce qui s'est passé au même moment concernant Russell. Ses relations sont cordiales avec M. Schlick, mais elles ne le furent jamais avec R. Carnap qu'il accusa ouvertement de plagiat, mettant Schlick dans un profond embarras car il s'agissait de ne pas rompre le Cercle de Vienne. Je recommande de lire les échanges épistolaires entre Schlick, Carnap
19/02/2017 | Lien permanent
Religion et belles lettres chez Bossuet, par Francis Moury

 Réginald Gaillard, dans sa recension critique du livre de J.-M. Delacomptée (1), Langue morte. Bossuet (Gallimard, 2009) écrivait ceci, qui n’est pas rien : « Il faut dire que toute la matière chrétienne de ses livres est aujourd’hui illisible en raison de la déchristianisation de notre société. Il convient de déceler ce qu’il a cependant encore à nous dire, nous enseigner, nous transmettre, trois siècles passés. La langue, justement, une certaine relation à la langue française. »
Réginald Gaillard, dans sa recension critique du livre de J.-M. Delacomptée (1), Langue morte. Bossuet (Gallimard, 2009) écrivait ceci, qui n’est pas rien : « Il faut dire que toute la matière chrétienne de ses livres est aujourd’hui illisible en raison de la déchristianisation de notre société. Il convient de déceler ce qu’il a cependant encore à nous dire, nous enseigner, nous transmettre, trois siècles passés. La langue, justement, une certaine relation à la langue française. »On croit comprendre qu'il faudrait lire Bossuet en faisant totalement abstraction de la religion catholique, en l’oubliant, en passant par-dessus. Et on voit que le chroniqueur accepte le point de vue de l'auteur du livre, à savoir qu'au fond, le monde étant fait pour aboutir à un beau livre (comme disait Stéphane Mallarmé) et Bossuet maniant une belle langue, donc donnant une belle œuvre littéraire, nous pourrions finalement laisser de côté la religion de Bossuet désormais inconnue et quasiment inconnaissable, pour se contenter de jouir de la pureté de sa langue et de la beauté de son style. Lire Bossuet en esthète athée. La formule n’aurait pas déplu à un Nietzsche qui eût, sans doute, ajouté que si l’esthète voulait véritablement lire Bossuet, il devait être une rare espèce d’athée, un athée cultivé, lecteur des lettres grecques et des lettres latines, lecteur des Pères grecs et romains, lecteur des philosophes européens du XVIIe siècle et des siècles antérieurs, Moyen Âge inclus. La formule de Réginald Gaillard, sans cette adjonction nietzschéenne, signifie simplement que la religion – le pouvoir de lier entre eux des hommes par une commune fidélité – de Bossuet ne résiderait plus dans le contenu de sa pensée théologique mais uniquement dans son style, désormais seul «lien» réel qui nous rattacherait à lui. Si telle était bien son intention, si telle était bien la thèse ici défendue tant par le livre que par son chroniqueur, je devrais alors m'inscrire en faux contre elle avec la plus grande vigueur historique et théorique.
Ce serait, en effet, d'abord méconnaître que la langue du XVIIe siècle s'est constituée en fonction du catholicisme : il est impossible de la connaître sans le connaître, dans ses tenants philologiques comme dans ses aboutissants ontologiques. L'agrégatif à qui on donne à commenter la Logique de Port-Royal n'en est capable que s'il connaît suffisamment bien saint Augustin, Descartes, Pascal… et Étienne Gilson. En somme, l'histoire religieuse du catholicisme et l'histoire philosophique depuis la logique aristotélicienne jusqu’à la logique des Regulae ad directionem ingenii de Descartes. Mais surtout il n’en est capable que s’il garde bien présent à l’esprit qu’un texte du XVIIe siècle ne se lit pas comme un texte du XXe siècle en fonction d’attendus contemporains par nature déconnectés de ce qui fut la réalité intellectuelle du Grand Siècle. Il suffit d'avoir lu le commentaire de Louis Vax à l’occasion de son cour d'agrégation, publié par le C.N.T.E., pour en être définitivement assuré (2). C'est, bien entendu, la même chose lorsqu'on lit les oeuvres de Bossuet : on ne peut rien comprendre à ce qu'on lit si on n'a pas une solide culture humaniste antique ni une solide culture théologique catholique, les deux devant en général être alliées au sein d'une excellente culture d'histoire de la philosophie générale.
Admettons pourtant, la durée d’un instant, le point de vue d'une lecture historique, esthétique, distancée de Bossuet, bref d'une lecture athée qui refuserait le contenu au profit du contenant, qui refuserait les choses dites par Bossuet au profit des mots utilisés pour les dire. D'une lecture qui ne conserverait que le pur plaisir syntaxique de l'énoncé mais ne tiendrait plus aucun compte de ce qui est énoncé. Cela nous amènerait alors à lire les Sermons et les Oraisons de Bossuet en athée – ce qui est parfaitement possible – mais en athée totalement ignare, goûtant simplement la beauté des subjonctifs imparfaits sans savoir de quoi on lui parle. Cela nous amènerait donc à ne plus lire Bossuet stricto sensu puisque Bossuet n'a écrit, sa vie durant, que pour convertir et fortifier les conversions catholiques. Pire, cela nous écarterait de la conception même que Bossuet se faisait du langage : à savoir un simple instrument qu'il faut manier rigoureusement, conformément à l'ordre des raisons exprimées par la grammaire – cf. encore une fois la Logique de Port-Royal concernant la sémantique et la sémiologie religieuse du XVIIe siècle – mais qu'il ne faut évidemment pas tenir pour valable per se et qui est inférieur à bien d'autres moyens de transmission de la connaissance : signe, intuition, grâce transmise par la foi.
Quatre citations de Bossuet lui-même vont, je le souhaite, nous éclairer :
1 - Bossuet, Méditations sur l'Évangile, De la meilleure manière de faire une oraison (Desclée et Cie, 1903, p. 15) : «Tout ce qui unit à Dieu, tout ce qui fait qu'on le goûte, qu'on se plaît en lui, qu'on se réjouit de sa gloire, et qu'on l'aime si purement qu'on fait sa félicité de la sienne, et que, non content des discours, des pensées, des affections et des résolutions, on en vient solidement à la pratique du détachement de soi-même et des créatures; tout cela est bon, tout cela est la vraie oraison».
2 - Bossuet, Méditations sur l’Évangile, Discours sur l'acte d'abandon à Dieu (op. cit., p. 16) : «Jésus parle encore tous les jours dans son Évangile; mais il parle d'une manière admirable dans l'intime secret du cœur : car il est la parole même du Père éternel, où toute vérité est renfermée. Il faut donc lui prêter ces oreilles intérieures dont il est écrit : Vous avez, Seigneur, ouvert l'oreille à votre serviteur. Heureux ceux à qui Dieu a ouvert l'oreille en cette sorte; ils n'ont qu'à la tenir toujours attentive, leur oraison est faite de leur côté. Jésus leur parlera bientôt, et il n'y a qu'à se tenir en état d'écouter sa voix».
3 - Bossuet, Méditation sur l’Évangile, Excellence de la justice chrétienne au-dessus de celle des Païens et des Juifs ([in] Matth. 5, 20, 47, op. cit., p. 83 : «[...] c'est une justice pharisaïque qui semble avoir quelque exactitude, mais qui s'attire de Jésus-Christ ce juste reproche : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi» ([commentaire de] Matth., 15, 8).
4 - Bossuet, Méditation sur l’Évangile, Trahison de Judas, découverte ([in] Joan, XIII, 26, 30, op. cit., p. 619 : «Ce fut alors que saint Pierre fit signe à saint Jean, et que Jésus leur donna à eux seuls la marque du morceau trempé. Il ne le fit pas connaître à tous les disciples, comme saint Jean le dit expressément. Cela aurait causé parmi eux un trop grand tumulte, et ils se seraient peut-être portés à quelque violence; à laquelle aussi, par sa bonté, il ne voulait pas exposer le traître, ni le divulguer plus qu'il ne fallait. Mais comme il voulait qu'ils sussent, qu'il connaissait parfaitement toutes choses, et que cela leur était utile, il en choisit parmi ses disciples deux, dont il connaissait la discrétion, pour être, quand il le faudrait, témoins aux autres qu'il ne savait pas les évènements par de vagues connaissances, ou des pressentiments confus; mais avec une lumière claire et distincte. Il parla donc à saint Jean assez bas, pour n'être entendu que de lui seul, ou tout au plus de saint Pierre, qui y était attentif : les autres ne connurent rien à ce signal; et Judas, après avoir pris ce morceau, se retira incontinent, selon saint Jean».
Il ressort clairement de ces extraits que la communication claire et distincte du langage, si elle convient assez souvent aux hommes pour des buts humains, n'est pas l'unique moyen dont ils disposent pour communiquer entre eux ni avec Dieu, encore moins celui dont dispose Dieu pour communiquer avec eux. Il n'est pas toujours souhaitable de parler et le silence de la foi chrétienne vaut, pour Bossuet, toutes les paroles mondaines et non seulement les vaut mais axiologiquement les dépasse sans équivoque possible. Ce que G. Granger nommait «l'individuation du message» (cité par Georges Mounin, Linguistique et philosophie, P.U.F., coll. SUP, 1975, p. 212) n'est décidément pas l'objectif de Bossuet lorsqu'il écrit et c'est parce que ce n'est pas son objectif que son style est ce qu'il est. Le style de Bossuet est, par conséquent et de toute évidence, intégralement déterminé par sa religion et totalement incompréhensible sans elle (3).
Le plus amusant est que celui qui a, une fois pour toutes, éclairé cette communauté intime entre style et religion au XVIIe siècle, fut un Juif marxiste qui soutenait une thèse originale. Thèse dirigée par le grand professeur Henri Gouhier qui avait méthodiquement construit une admirable Histoire philosophique du sentiment religieux en France absolument parallèle et d'une hauteur théorique identique à l'ancienne, et non moins indispensable, Histoire littéraire du sentiment religieux en France écrite par Henri Brémond. Je veux, bien entendu, parler de Lucien Goldmann, Le Dieu caché ou Étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine (Gallimard, NRF-Bibliothèque des Idées, 1959). Ce que Sainte-Beuve n’avait pas vraiment réalisé dans son monumental Port-Royal, Goldmann l’a concrétisé : prouver en quoi la religion déterminait précisément le style, le conditionnait, le nourrissait. Sans doute la conception de la critique que se faisait Sainte-Beuve ne pouvait-elle guère l’aider dans une tâche que son esprit étroit ne pouvait envisager : inutile ici de redire ce que Proust dans son Contre Sainte-Beuve, a déjà si bien établi. Ajoutons que le point de vue de Goldmann était un point de vue marxiste totalisant : le janséniste étant selon lui dans la position du marxiste, les deux engageant non seulement le style mais la vision du monde à partir de leur position théorique ou de leur position théologique. Le parallèle était audacieux mais très bien étayé, sous les auspices d’un des derniers grands maîtres de la Sorbonne. La démonstration vaut évidemment pour un orateur théologien catholique tel que Bossuet, critique du jansénisme, ignorant tout du marxisme pas encore né mais chez qui la vision du monde et son expression stylistique sont commandées par la théologie catholique classique depuis les Pères grecs et latins jusqu’à Bérulle, son contemporain et, ce qu’on sait moins, le parrain spirituel de Descartes. On s'étonne donc, relativement à Bossuet, d’avoir à remémorer des évidences, et d’avoir à combattre d'aussi abominables moulins à vents prétendant dissocier un fond obsolète d’une forme éternelle. Mais la condition humaine est telle que nous devons remémorer sans cesse les évidences perdues, et sans cesse combattre de nouveaux moulins à vent. Le linguiste Georges Mounin écrivait, à propos de la poésie de René Char, ceci : «Le pouvoir irrationnel des mots dément le démenti que Kierkegaard avait voulu leur infliger au nom de leurs propriétés rationnelles. Quand je lis Kierkegaard lui-même, en dépit de ses affirmations réitérées sur l'incommunicabilité de son expérience, je connais à des signes certains en moi que je communique avec la détresse d'une bête religieuse blessée à mort, et qui secrète inlassablement des substances instables – secret, solitude, angoisse – pour cicatriser sa plaie jusqu'à cette guérison, la mort» (Linguistique et philosophie, Suis-je vraiment tout seul ?, P.U.F. 1975, p. 204).
Nous pouvons paraphraser de la sorte : l’étude rationnelle du pouvoir de séduction intemporelle du style théologique de Bossuet dément toute possibilité d'un abandon – ne prétendrait-il être que momentané – du socle irrationnel sur lequel il repose.
Notes
(1) Dans un article paru le 16 décembre 2009 ici.
(2) «Dans ces conditions, quelle besogne revient au commentateur ? Je pense que l’explication doit être avant tout philosophique et historique. Philosophique et historique parce que le passage soumis à votre sagacité renferme des termes et fait allusion à des thèses dont l’intelligence n’apparaît pas d’emblée au lecteur profane. Votre tâche est assez proche de celle des restaurateurs de tableaux. Les couleurs de la toile se sont altérées par l’injure du temps, et le vernis dont on les a couvertes, en les protégeant, les fait apparaître plus grisâtres encore. C’est à vous que revient le soin de restituer aux couleurs leur éclat premier», Louis Vax, Présentation, bibliographie et commentaire cursif de la Logique de Port-Royal d’Antoine Arnauld et Pierre Nicole, cours du C.N.T.E., agrégation de philosophie 403-453, texte série 6 – RRR – AGt 619 e, (s.d. : mais circa 1965) p. 4.
(3) Le premier soin d’un Jean-Luc Marion est de poser que Le Plaisir du texte tel que défini par Roland Barthes paru en 1973 ne s’applique pas au texte théologique. Je cite Marion : « Il faudrait enfin avouer que la théologie, de toutes les écritures, cause sans doute le plus grand plaisir. Justement pas le plaisir du texte, mais le plaisir – à moins qu’il ne s’agisse d’une joie – de le transgresser : des verba au Verbe, du Verbe aux verba, incessamment et en théologie seulement, puisque là seulement le Verbe trouve dans les verba rien moins qu’un corps. Le corps du texte n’appartient pas au texte, mais à Celui qui y prend corps. Aussi l’écriture théologique ne cesse-t-elle de se transgresser elle-même, tout comme la parole théologienne se nourrit du silence où, enfin, elle parle correctement. […] La théologie détourne l’auteur de lui-même […] elle le fait écrire hors de lui, voire contre lui, puisqu’il doit écrire non de ce qu’il est, sur ce qu’il sait, en vue de ce qu’il veut, mais dans, pour et par ce qu’il reçoit, et, en aucun cas, ne maîtrise», Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être (Fayard, coll. Communio, 1982), p. 9. La lecture intégrale du monumental ouvrage d’Etienne Gilson, La Philosophie au Moyen Âge (édition Payot, revue et augmentée en 1944) infirme en détails cette thèse de Marion : les théologiens et les philosophes du moyen âge (sans oublier les Pères grecs et latins sur qui deux chapitres furent rajoutés dans l’édition revue de 1944) ont des styles variés qui peuvent être étudiés d’une manière non seulement technique mais encore littéraire : seule une culture classique grecque et latine le permet en profondeur. Ajoutons que Le Plaisir du texte barthien ne s’appliquerait alors, si on suivait Marion, pas davantage aux textes philosophiques qui n’ont pas d’abord pour objet d’être beaux mais vrais. Ce n’est alors que dans une optique platonicienne (qui fut sérieusement reprise par Victor Cousin en son temps) qu’ils pourraient être considérés comme beaux parce qu’ils seraient vrais, Platon subordonnant absolument la beauté à la vérité dans son système esthétique. Ce platonisme, pour fascinant qu’il ait été, fut assez rapidement battu en brèche et cela dès l’antiquité. Cf. : les suggestives études stylistiques d’histoire de la philosophie de Brice Parain, Réflexions sur la nature et les fonctions du langage (Gallimard, NRF, 1942).
Nota bene : version refondue, revue et corrigée à Bangkok vendredi 18 avril 2014. Une première version de ce texte est parue en 2010 sur le site de Raphaël Dargent, Jeune France.
21/06/2014 | Lien permanent
Notes nouvelles sur Ernst Jünger, par Francis Moury

 Révolution et contre-révolution conservatrices : à propos de la correspondance entre Carl Schmitt et Ernst Jünger, par Francis Moury.
Révolution et contre-révolution conservatrices : à propos de la correspondance entre Carl Schmitt et Ernst Jünger, par Francis Moury. La théologie politique dans la Zone.
La théologie politique dans la Zone. Ernst Jünger dans la Zone.
Ernst Jünger dans la Zone. De la révolution conservatrice en Allemagne, par Jean-Luc Evard.
De la révolution conservatrice en Allemagne, par Jean-Luc Evard.«Nous autres nationalistes ne croyons pas aux vérités générales. Nous ne croyons pas à une morale universelle. Nous ne croyons pas à l'humanité comme être collectif à la conscience centralisée et au droit unifié. Nous croyons, bien plutôt, au conditionnement le plus marqué de la vérité, du droit et de la morale par le temps, l'espace et le sang. Nous croyons à la valeur du particulier. [...] Codes pénaux, constitutions et droit des gens ne peuvent “abolir” crimes, révolutions et guerres. La loi ne reste vivante qu'aussi longtemps que le veut la vie. Le sang brisera en deux les tables les plus dures.»
Ernst Jünger, Le Droit spécial du nationalisme (article paru en 1927, traduction François Poncet in Nouvelle École numéro 48 spécial Ernst Jünger, 1996, pp. 67-69).
«[...] la rencontre de Schmitt et de Jünger au cours de l'hiver 1951 fut une véritable expérience. En assistant à ce face-à-face, j'ai commencé à prendre la mesure de ce qui les séparait. [...] Jünger voyait en toute chose l'archétype, le mythique : ce qui reste immuable par-delà le changement, ce par rapport à quoi le changement se résume à de simples rides sur une surface lisse. Tous les efforts de Jünger sont ainsi voués à l'intemporel. Pour Carl Schmitt, en revanche, seul l'unique – ce qui ne se répète pas dans le temps – mérite attention. [...] Conformément à sa disposition d'esprit, Carl Schmitt se devait d'être chrétien, tandis que Jünger, malgré son inscription formelle au sein du christianisme, restait étranger en cette demeure.»
Armin Mohler, Rencontres chez Ernst Jünger – Fragments topographiques (Rencontres amicales. Mélanges offerts à Ernst Jünger pour son soixantième anniversaire, recueil collectif dirigé par Armin Mohler, éditions V. Klostermann, Francfort/M 1955, traduction in Nouvelle École n° 48 spécial Ernst Jünger 1996, pp. 128-9).
Alors qu'on fêtait le centenaire d'Ernst Jünger (1895-1998), un des rares écrivains à l'avoir lui-même fêté de son vivant en pleine possession de ses facultés créatrice et de sa santé, par ce remarquable numéro spécial de sa revue Nouvelle École (1) qui contenait, outre l'article inédit de Jünger ici examiné, des témoignages incontournables et une première bibliographie générale d'ampleur – y compris concernant son frère Friedrich Georg Jünger (1898-1977) dont les œuvres choisies allemandes comportent pas moins de 12 volumes mais demeurent inédites en France, sans parler des 26 articles littéraires et politiques relevant du courant national-révolutionnaire qu'il publia de 1926 à 1934 dont des extraits sont traduits et commentés par Volker Beismann –, Alain de Benoist estimait qu'il fallait résister à la tentation d'opposer Jünger à lui-même et constater l'unité de son œuvre. Assurément, à condition, ainsi qu'il le rappelait, de se souvenir que Jünger lui-même se voulait «un sismographe, homme des tremblements de terre et des tournants du temps, vigie qui annonce ce qu'il voit avant que les autres en aient seulement pris conscience, au risque de ne rencontrer qu'incrédulité et incompréhension» (2). Si Jünger apparaissait si multiple en dépit de son unité foncière et réelle, c'est qu'il annonçait le futur tout en reflétant un passé dont il était admirablement chargé. En découvrant ce remarquable article de 1927 dont je cite supra en exergue un extrait – article demeuré auparavant inédit en France et qui n'avait jamais été réédité en Allemagne car il n'avait pas été incorporé à un recueil par Jünger ni par ses éditeurs allemands posthumes –, il me semble possible d'y déceler une influence essentielle, trop peu évoquée, sur le jeune Jünger : celle du philosophe G.W.F. Hegel. Cette influence explique en outre, me semble-t-il, pourquoi la rencontre entre Jünger et Carl Schmitt fut si intensément ressentie comme authentiquement philosophique par eux-mêmes, ainsi que le prouve à l'envie leur correspondance récemment éditée (3), car Schmitt aussi, comme on le sait, fut profondément influencé par Hegel. Si Armin Mohler (4), dans sa contribution aux mélanges de 1955 dont j'ai cité supra un fragment en exergue, apparaît davantage sensible aux différences qu'à la ressemblance entre les deux hommes, c'est d'abord parce qu'il s'attache aux divergences de style des œuvres, ensuite parce qu'il néglige peut-être cette clé hégélienne permettant pourtant de les rapprocher sur le plan philosophique. Il néglige en outre l'éducation religieuse protestante de Jünger qui l'inscrit tout naturellement dans le courant de pensée qui va de Luther à Nietzsche.
Jünger écrit en 1927 : «Dans la période qui va de la proclamation des Droits de l'homme à la Grande Guerre [de 1914-1918], la foi en la généralité a épuisé son énergie. Nous reconnaissons volontiers que cette foi a déchaîné des manifestations d'une vigueur magnifique, car nous aimons en la vie la plénitude et l'élan qui entraîne tout. Mais que l'on place sa foi dans le général ou le particulier, là n'est pas l'essentiel, et dans la foi, l'essentiel ne sont pas les contenus, mais la ferveur et la force illimitée. [...] La proclamation des Droits de l'homme jaillit de la même source que le service militaire obligatoire ou la législation des armées, qui ont rendu possibles les formes dévastatrices de la dernière guerre. Et nous avons tous éprouvés que le suffrage universel n'amène pas le moindre adoucissement des luttes politiques et de leur dureté – au contraire. Si nous croyons au particulier et au primat des nécessités particulières sur les nécessités générales, nous y sommes souvent poussés par le dégoût que nous inspirent les formules remâchées des Lumières» (op. cit., page 67).
Dégoût, Jünger le précise quelques lignes plus loin, engendré par le fait que les mots de liberté, de fraternité, d'égalité ont perdu leur valeur en raison du travestissement que leur ont fait subir les «boutiquiers férus de salaires et de production» (op. cit., p. 67 à nouveau). Ce dévoiement du langage, cette putréfaction des valeurs de la révolution française au sein même de la nation qui leur avait pourtant conféré leur sens initial, ne sont pas une constatation isolée du jeune Jünger. Son frère Friedrich Georg (dans certains articles politiques se revendiquant du nationalisme révolutionnaire, parus entre 1926 et 1931) et lui multiplient alors les attaques contre la démocratie, les principes de 1789 et la décadence de l'Europe libérale. La Mobilisation totale (1930) ou bien les chapitres 2 à 5 de Le Travailleur (1932) en portent le témoignage. Ce refus politique se double d'un refus esthétique en apparence assez curieux : Jünger critique le romantisme français d'abord, allemand ensuite, tout comme Carl Schmitt l'avait critiqué dans son Romantisme politique (1919-1926, traduit aux éditions Librairie Valois en 1928). En réalité, Schmitt comme Jünger sont ici, autant sur le plan esthétique que politique, les purs héritiers d'une critique dont l'histoire remonte aux penseurs post-kantiens, à savoir J.G. Fichte (1762-1814), F.W.J. von Schelling (1775-1854) puis, surtout et d'une manière déterminante, G.W.F. Hegel (1770-1831).
En quoi le droit des gens ou droit de la guerre, le droit pénal, le droit civil issu de la révolution sont des droits artificiels, cela s'explique d'abord pour les post-kantiens par deux raisons, l'une historique (Napoléon a trahi de facto l'idéal révolutionnaire en rétablissant une autorité tyrannique sur l'ensemble de l'Europe mais il a fondé en même temps le premier État moderne) et l'autre philosophique (l'idéal révolutionnaire de 1789 est un idéal illusoire parce qu'il est un idéal : il a prétendu substituer une illusion à la réalité de l'histoire, de la tradition, de la culture occidentale des origines grecques puis catholiques à nos jours). Savoir si Napoléon a accompli ou s'il a trahi la révolution est une question qui partage encore aujourd'hui les historiens français : elle fut au cœur de la pensée politique allemande du dix-neuvième siècle. Sur le plan philosophique, il n'est pas inintéressant de noter l'itinéraire de J.G. Fichte (5), d'abord admirateur de la révolution française de 1789 puis orateur à Berlin occupé par l'armée française, durant l'hiver 1807-1808, des Discours à la nation allemande. Trois propositions fichtéennes en ressortent : la liberté de penser est une liberté absolue; la vérité d'une action est irréductible au jugement de l'histoire; la seule guerre légitime est la guerre d'un peuple pour son indépendance.
F.W.J. von Schelling écrit pour sa part dès 1806 : «Depuis Iéna [depuis la bataille gagnée par Napoléon, à l'occasion de laquelle Hegel avait vu passer l'empereur à cheval sous sa fenêtre], j'ai vu que la religion, la croyance publique, la vie dans l'État sont le point autour duquel se meut et où doit être fixé le levier qui doit ébranler cette masse humaine inerte.» Par-delà les vicissitudes politiques contingentes de l'histoire, il y aurait en effet selon Schelling une histoire mythique reposant sur l'idée de la séparation de l'être et de l'absolu puis du retour à leur unité après la chute, cycle rédempteur réel dont les histoires humaines sont des images, la plus juste étant d'ailleurs au carrefour du mythe et de l'histoire puisqu'il s'agit des poèmes d'Homère, L'Iliade (image de l'éloignement et de la séparation) et de L'Odyssée (image du retour au foyer originel). C'est relativement à ce système que Schelling écrit en 1809 ses Recherches philosophiques sur l'essence de la liberté humaine – auxquelles Martin Heidegger consacrera deux études (6) – dont le thème central est une métaphysique du rôle du mal dans l'histoire humaine, selon une perspective assez luthérienne.
À partir de G.W.F. Hegel, la séparation entre moi et non-moi, entre sujet et absolu, entre absolu et monde s'abolit dans l'histoire de la philosophie. Le vrai devenant sujet dans la figure de l'absolu et de l'esprit, prend en charge l'ensemble des faits positifs du réel, depuis les origines mythiques et religieuses jusqu'à l'histoire de l'époque moderne. Le mouvement de révélation est celui qui prend aussi en charge la mort, le négatif : de la notion inerte, le négatif engendre le devenir total de la réalité, accouchant d'un absolu libre car sujet total au terme de sa pleine manifestation. Hegel a donc repensé, au-delà de l'aspect d'abord subjectif (Fichte) puis objectif (Schelling) de l'absolu, un esprit total et réconciliateur intégrant les notions de droits à la lumière de ce processus qui aboutit parce qu'il réfléchit l'enrichissement du positif initialement inerte par un négatif, à son tour nié tout en étant conservé : cette négation est donc la mort du positif initial parce qu'elle est son enrichissement au moyen de sa négation, puis de la négation de cette négation. Au niveau le plus élémentaire de la logique, l'être est nié par le néant mais ne se maintient pas identique à lui-même de ce fait : le résultat (conservant tout en la dépassant l'opposition initiale) est le devenir. La révolution française existe ainsi comme telle dans le cours de l'histoire du monde mais elle ne peut demeurer identique à elle-même : elle appelle, par son propre mouvement interne, sa négation puis son dépassement. Dépassement et négation sont symbolisés, au yeux de Hegel, par la figure de Napoléon, incarnation momentanée du cours de l'histoire comme l'avaient été, en leurs temps, Périclès par rapport à l'histoire de la Grèce et César par rapport à celle de Rome. Dépassement à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans : l'invasion de l'Allemagne par Napoléon réveille l'Allemagne de son sommeil politique, un peu comme la lecture du sceptique anglais David Hume avait autrefois réveillé le philosophe allemand Emmanuel Kant de son sommeil dogmatique. L'État prussien, accomplissement et figure que Hegel considère comme la dernière réalisée de son temps par l'esprit du monde sur le modèle de l'État napoléonien, se constitue en combattant la révolution française : de cette lutte à mort sont nées les figures subalternes (car elles demeurent architectoniquement inférieures, dans le système de Hegel, aux trois figures supérieures de l'art, de la religion, de la philosophie) d'un nouveau droit, d'une nouvelle philosophie du droit, d'une nouvelle philosophie de la guerre mais aussi la figure contre-révolutionnaire par elle-même.
Les arguments de Hegel concernant la nécessité du dépassement de la révolution française par une contre-révolution allemande sont de nature logique, pratique, autant que religieuse. L'idée d'un État s'élevant contre la religion et les hiérarchies qui avaient constitué la nation comme individu réel, effectif, est une idée refusée par Hegel (7) en Allemagne, par Joseph de Maistre et par Louis de Bonald en France, par Burke en Angleterre. Un tel État prouve son caractère artificiel en perdant la guerre : l'Europe monarchiste – sa partie catholique pour l'occasion alliée à sa partie protestante – a vaincu Napoléon. Le principe de la liberté demeure au principe de l'Absolu et de l'Esprit mais il ne s'incarne plus dans les révolutionnaires français. Il s'incarne à présent dans ceux qui les nient, dans les contre-révolutionnaires européens, à commencer par les contre-révolutionnaires allemands. Ce que Hegel reproche aux penseurs révolutionnaires français du dix-huitième siècle, c'est d'avoir méconnu l'idée vivante de l'État effectif dont s'étaient approchés des penseurs aussi divers mais aussi importants que Aristote ou Montesquieu : on ne peut pas s'en tenir à l'idée formelle de la liberté de l'individu si on néglige la totalité incarnée par la nation et par l'État, intégrant ses mœurs, ses lois, son histoire, sa religion. Séparer théoriquement l'individu de cet ensemble ou, pire encore, le placer pratiquement dans une situation où il se sépare d'eux, c'est le rendre abstrait donc irréel, aussi abstrait et irréel que le sont les théories fictives de l'état de nature et du contrat social, vigoureusement critiquées par Hegel dès 1802-1803. Raison pour laquelle Hegel écrit (8) : «[Montesquieu] a eu l'intuition de l'individualité et du caractère des peuples [mais] ne s'est pas élevé à l'Idée la plus vivante». Aristote avait déjà aperçu le lien entre ceux-là et celle-ci : «Aristote ne met pas l'individu et son droit en premier, il reconnaît au contraire dans l'État ce qui est par essence supérieur à l'individu et à la famille [...]. Cela est diamétralement opposé au principe moderne qui part de l'individu [...]. Il ressort de ces quelques traits qu'Aristote ne pouvait avoir l'idée d'un prétendu droit naturel (si l'on déplore l'absence d'un tel droit); – c'est-à-dire justement la considération de l'homme abstrait en dehors de ses liens réels».
La fin de l'article de 1927 de Jünger, au ton très hégélien tout du long et qui reprend vigoureusement sa critique du droit formel, mérite d'être examinée et interprétée : «Vouloir le particulier signifie défendre une valeur, une moralité, un droit, une idée, au regard de quelque chose d'autre, d'étranger, signifie être en état de tension vis-à-vis d'un contradictoire. Par la loi, cette tension est rendue latente. Ce qui ne peut éviter qu'elle se décharge, car la loi codifie selon l'entendement un état de choses, mais la vie passe à travers les états, elle est toujours en flux. Codes pénaux, constitutions et droits des gens ne peuvent «abolir» crimes, révolutions et guerres. La loi ne reste vivante qu'aussi longtemps que le veut la vie. Le sang brisera en deux les tables les plus dures» (op. cit., p. 69).
Que sont ces tables dont la dureté est vouée, quel que soit son degré, à être brisée par le sang versé ? Ce sont probablement, dans l'esprit nationaliste allemand révolutionnaire imprégné d'hégélianisme qui influence la plume du jeune Jünger, une allusion aux règles draconiennes imposées à l'Allemagne vaincue lors du Traité de Versailles de 1919 mais peut-être bien aussi, et la référence serait alors plus ample, les tables de la loi formelle comme celles de la loi mosaïque en général.
D'abord la loi positive momentanée et formelle est contingente : elle s'oppose à la vie tumultueuse qui anime réellement la nation comme l'histoire, selon le jeune Jünger : c'est entendu et Hegel comme Friedrich Nietzsche – que Jünger a lu avec passion toute sa vie – n'auraient pas dit mieux. Souvenons-nous que Hegel privilégie dès 1802-1803 la vengeance par rapport au droit pénal (que Hegel méprisait, tenant le juge pour une sorte de comptable administrant les peines au prix courant édicté par le code alors que la véritable justice ne s'obtient que par la vengeance). Souvenons-nous que Nietzsche a constamment privilégié l'idée primitive de la vengeance par rapport au droit formel, symptôme d'une décadence vitale à laquelle il prétendait remédier, en tant que philosophe médecin de la civilisation.
Mais encore ? Peut-être faut-il aussi remonter aux tables de la loi mosaïque, pour saisir dans son ampleur l'allusion de Jünger. C'est ici qu'il faut savoir que deux intellectuels hégéliens (mais des hégéliens oscillant entre hégélianisme de droite et hégélianisme de gauche donc qui n'étaient tout de même pas des purs hégéliens) influencèrent respectivement Ernst Jünger et Carl Schmitt. D'abord Bruno Bauer (1809-1882) très lu par Carl Schmitt, ensuite Hugo Fisher (1897-1975) qui avait consacré sa thèse de doctorat à la méthode de Hegel en 1926. Helmut Kiesel, le commentateur de la correspondance de
18/09/2021 | Lien permanent
Lord of the Flies de Peter Brook, par Francis Moury

02/12/2008 | Lien permanent
La collectionneuse d’Éric Rohmer, par Francis Moury

31/01/2010 | Lien permanent
Andreï Roublev de Tarkovski, par Francis Moury

 Fiche technique succincteRéalisation : Andreï TarkovskiProduction : MosfilmScénario : Andreï Mikalkov-Kontchalovski et Andreï TarkovskiDir. Ph. : Vadim Ioussov (SovScope 2.35 N&B + couleurs)Musique : Viatcheslav Ovtchinnikov.Casting succinctAnatoli Solonitsyne, Ivan Lapikov, Nikolaï Grinko, Nikolaï Serguéev, Irma Rausch, Nikolas Bourliaev, etc.Une fiche exhaustive résumant les caractéristiques des différentes versions DVD de ce film peut être consultée ici.Résumé du scénarioRussie médiévale, à l’époque des invasions tartares et de la résurgence du paganisme : le célèbre peintre d’icônes Andreï Roublev commet un meurtre pour sauver une jeune fille d’un viol au cours d’un massacre collectif dans une église. Il renonce alors à son art et fait vœu de silence pendant dix années de pénitence. La famine et la peste surviennent mais l’invasion a prit fin et la Russie reconstruit néanmoins des églises. La construction d’une cloche gigantesque, menée miraculeusement à bien par un adolescent, lui redonne le courage de peindre.CritiqueAndreï Roublev (Andreï Roubliov, URSS, 1966) d’Andreï Tarkovski a reçu le Prix de la Critique au Festival de Cannes de 1969 où il était présenté «hors-compétition». Sa révélation au public français fut donc assez tardive par rapport à sa date de réalisation. En outre, le film fut distribué dans une version de 2H 30 min. plus courte que celle de la copie présentée ici. Il n’empêche que c’est peut-être le film de Tarkovski qui tourna le plus longtemps dans les salles parisiennes d’art et d’essai des années 1970-1975 où il fut quasi-continuellement programmé.Andreï Roublev peut certes être apprécié comme pur spectacle «profane» se résumant à l’histoire émouvante d’un grand artiste chrétien sauvegardant l’essentiel – son art et son âme – pendant une période troublée et dangereuse relativement inconnue chez nous. Les moyens financiers mis à sa disposition lui confèrent un caractère de film historique gros budget à grand spectacle assez régulièrement même s’il est constamment traversé par des séquences intimistes et souvent introspectives. Sa mise en scène en appelle pour les scènes d’action à la syntaxe la plus classique et la plus belle en vigueur à l’époque : il suffit de comparer les scènes de guerre à celles filmées par Vittorio Cottafavi et Riccardo Freda dans leurs péplums des années 1960-1965. On est en présence de la même perfection formelle. Mais elle est constamment novatrice aussi car cette syntaxe classique s’applique à des sujets inhabituels qui la transforment de ce fait dans son résultat : on avoue qu’on n’avait encore jamais vu filmer la mort violente au cinéma de cette manière. Réduire Andreï Roublev à un grand spectacle humaniste serait pourtant, de toute évidence, rater l’ampleur de sa visée interne. Car le véritable Andreï Roublev (vers 1360-1430) fut un moine peintre d’icônes, et toutes proportions gardées, un peu aussi le Michel-Ange russe même s’il vécut dans un dénuement bien plus dangereux et risqué que l’Italien. Il faut donc ajouter qu’Andreï Roublev – personnage historique comme personnage du film de Tarkovski – ne peut être vraiment compris que si l'on connaît l’histoire de la théologie chrétienne.Deux citations nous permettent de bien cadrer les enjeux du film :1) «Pour le judéo-chrétien, l’homme est créé par Dieu et non engendré par lui, ce qui signifie qu’il ne lui est pas identique, qu’il ne lui est pas homogène, qu’il n’a pas dans sa nature de quoi être divinisé, que ses qualités ne peuvent être portées à l’Absolu, qu’il est irréductiblement subordonné, dépendant, limité, fini. Il est avec Dieu dans le rapport de l’œuvre à l’artiste. D’ailleurs, s’il lui est promis que dans l’Au-delà il Le verra face à face, c’est bien parce qu’il ne peut espérer cesser jamais d’en être distinct.»Dr. Francis Pasche, Freud et l’orthodoxie judéo-chrétienne, Revue française de Psychanalyse (éd. P.U.F., Paris, 1959, p. 56, conférence reprise, revue et augmentée – mais sans le compte-rendu du débat final entre son auteur et S. Nacht, Marie Bonaparte, René Held, André Green – in À partir de Freud (éd. Bibliothèque scientifique Payot, coll. Science de l’homme, Paris, 1969, §8, pp. 129 et sq.)2) «La légitimité des images dans le christianisme a été tranchée sur le fond, en plein milieu de la sanglante querelle des images, au deuxième Concile de Nicée en 787. Cette décision ne marqua pas la fin de la guerre civile, qui dura jusqu’en 843, «triomphe de l’Orthodoxie». […] L’Incarnation, «imagination de Dieu», avait pavé la route. Elle préside à la distribution du divin dans le monde, à l’économie de la providence. «Qui refuse les images, refuse l’économie», dit Nicéphore. Ce que le Christ est à Dieu, l’image l’est à son prototype. Et comme le Fils tend vers Dieu, je dois tendre vers l’image du Fils. […] La vague iconoclaste lancée par Léon III à Byzance au début du VIIIe siècle a été la dernière grande hérésie touchant au dogme de l’Incarnation.»Régis Debray, Vie et mort de l’image – Une histoire du regard en Occident, livre I, §3 (éd. Gallimard, Paris, 1992, puis coll. Folio, Paris, 1994, pp. 107-109).On comprend mieux, après avoir lu cela, pourquoi Tarkovski filme avec autant d’attention dans Andreï Roublev tant les éléments matériels et naturels que les visages et les corps : ils sont dans une relation dialectique induite par la perspective de la nature religieuse de l’icône russe. Ce n’est pas à vouloir dire que Tarkovski fut ou non, dans le secret de son âme, chrétien en 1966. D’ailleurs dire cela serait ne rien dire : le christianisme n’est pas la même chose selon qu’on est catholique, protestant ou orthodoxe. Si on veut cependant tenter de le savoir, on pourra lire les 600 pages de son Journal 1970-1986 (au sens de journal intime) qui vient d’être réédité vers la mars-avril 2005 par les Cahiers du Cinéma. On peut juste assurer que les interdictions judaïques puis calvinistes relatives à l’image lui sont étrangères. On sait que le christianisme du Nouveau Testament qui fonde le catholicisme est historiquement et objectivement issu d’une rencontre entre l’esprit judaïque et l’esprit grec. La Russie a conservé bien ancrée une sensibilité – sans parler de son alphabet dont certaines lettres proviennent du grec antique ! – typiquement issue de cette rencontre : le lien entre la Grèce et la Russie est notamment l’icône byzantine. Et la religion orthodoxe est fondatrice de l’idée même de la Russie traditionnelle. On peut donc simplement conclure sur ce point en affirmant que Tarkovski avait parfaitement saisi et a parfaitement restitué l’essence de la spiritualité russe.Même les cinéastes œuvrant à l’époque du communisme le plus militant comme Dovjenko ou Eisenstein ressortaient finalement de ce courant esthétique : on pouvait s'en apercevoir à condition d’être un peu plus cultivé que nos braves (mais cependant encore utiles à lire d’un strict point de vue historique) Léon Moussinac ou George Sadoul. Ce n’est pas à dire qu’il faille comparer Andreï Tarkovski à ces deux illustres cinéastes car lui-même déniait formellement la validité du premier terme de la comparaison : «Il me semble que son esthétique m’est étrangère et franchement contre-indiquée.» (déclaration à la revue française Positif, n°109) et leurs univers moraux comme esthétiques lui sont, en effet, assez étrangers. Mais enfin, on pense parfois à certains plans de La Ligne générale (URSS, 1929) de S.M. Eisenstein ou de La Terre (URSS, 1930) d’Alexandre Dovjenko lorsqu’on visionne Andreï Roublev. Signe qu’il y a une permanence d’inspiration profondément chrétienne, et spécifiquement orthodoxe, dans le cinéma russe et que le communisme n’y fut qu’une parenthèse éminemment diabolique.C’est évidemment surtout à des films plus ouvertement eschatologiques comme Le Septième sceau (Suède, 1956) ou La Source (Suède, 1960) d’Ingmar Bergman dont les actions sont situées dans un univers également médiéval qu’il convient, en fin de compte, de le rapprocher. Il est, bien sûr, question du diable dont les symboles abondent dans le film : le prince tartare pénétrant dans l’église pour y massacrer les fidèles en est une incarnation. Il y est non moins question explicitement de Dieu puisque le miracle qui redonne foi à l’artiste religieux qu’est Roublev est accompli par la création improbable mais réussie d’une cloche colossale.La question naïve qu’on peut se poser est la suivante : comment les autorités de tutelle communiste de l’époque ont-elles pu permettre à un tel film d’être mis en scène ? La sœur du réalisateur nous donne dans son entretien une partie de la réponse : il tournait volontairement certaines séquences trop longues afin que la censure coupât dedans et ne touchât pas à l’essentiel. Mais surtout Tarkovski a eu l’habileté artistique de montrer des éléments qui pouvaient êtres lus dans une perspective marxiste par des censeurs marxistes naïfs de 1966. Une peinture historique (on sait que pour Marx et Lénine, disciples dévoyés de Hegel, l’histoire crée l’homme bien que l’histoire selon Marx et Lénine ne soit pas l’histoire selon Hegel) matériellement très soignée et précise d’une part, une vision d’un travail collectif semblant magnifier la puissance du travail humain au service d’une fin collective (la fabrication de la cloche) d’autre part. Pour des marxistes russes de 1966 patriotes et nationalistes, le film pouvait, en outre, aussi être vu comme une magnification de la résistance de l’âme russe aux envahisseurs étrangers asiatiques et les Tartares éventuellement symboliser la Chine rouge maoïste dont la redoutable «Révolution culturelle» avait lieu au même moment aux frontières de l’U.R.S.S., entérinant la séparation totale des deux régimes communistes les plus puissants de la planète à cette époque.Inutile de dire que ces diverses lectures du film furent peut-être réelles mais non moins évidemment totalement dénuées de sens. Le véritable sens final d’Andreï Roublev se confond avec l’irruption de la séquence finale chronologique montrant l’œuvre picturale réelle et originale de Roublev, filmée en couleurs et portée par une musique religieuse : des fragments, suppose-t-on, de la fresque du Jugement dernier, de l’icône de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'autres œuvres que nous savons pas identifier. Ce passage du N.&B. à la couleur à cette occasion est assez significatif par lui-même.
Fiche technique succincteRéalisation : Andreï TarkovskiProduction : MosfilmScénario : Andreï Mikalkov-Kontchalovski et Andreï TarkovskiDir. Ph. : Vadim Ioussov (SovScope 2.35 N&B + couleurs)Musique : Viatcheslav Ovtchinnikov.Casting succinctAnatoli Solonitsyne, Ivan Lapikov, Nikolaï Grinko, Nikolaï Serguéev, Irma Rausch, Nikolas Bourliaev, etc.Une fiche exhaustive résumant les caractéristiques des différentes versions DVD de ce film peut être consultée ici.Résumé du scénarioRussie médiévale, à l’époque des invasions tartares et de la résurgence du paganisme : le célèbre peintre d’icônes Andreï Roublev commet un meurtre pour sauver une jeune fille d’un viol au cours d’un massacre collectif dans une église. Il renonce alors à son art et fait vœu de silence pendant dix années de pénitence. La famine et la peste surviennent mais l’invasion a prit fin et la Russie reconstruit néanmoins des églises. La construction d’une cloche gigantesque, menée miraculeusement à bien par un adolescent, lui redonne le courage de peindre.CritiqueAndreï Roublev (Andreï Roubliov, URSS, 1966) d’Andreï Tarkovski a reçu le Prix de la Critique au Festival de Cannes de 1969 où il était présenté «hors-compétition». Sa révélation au public français fut donc assez tardive par rapport à sa date de réalisation. En outre, le film fut distribué dans une version de 2H 30 min. plus courte que celle de la copie présentée ici. Il n’empêche que c’est peut-être le film de Tarkovski qui tourna le plus longtemps dans les salles parisiennes d’art et d’essai des années 1970-1975 où il fut quasi-continuellement programmé.Andreï Roublev peut certes être apprécié comme pur spectacle «profane» se résumant à l’histoire émouvante d’un grand artiste chrétien sauvegardant l’essentiel – son art et son âme – pendant une période troublée et dangereuse relativement inconnue chez nous. Les moyens financiers mis à sa disposition lui confèrent un caractère de film historique gros budget à grand spectacle assez régulièrement même s’il est constamment traversé par des séquences intimistes et souvent introspectives. Sa mise en scène en appelle pour les scènes d’action à la syntaxe la plus classique et la plus belle en vigueur à l’époque : il suffit de comparer les scènes de guerre à celles filmées par Vittorio Cottafavi et Riccardo Freda dans leurs péplums des années 1960-1965. On est en présence de la même perfection formelle. Mais elle est constamment novatrice aussi car cette syntaxe classique s’applique à des sujets inhabituels qui la transforment de ce fait dans son résultat : on avoue qu’on n’avait encore jamais vu filmer la mort violente au cinéma de cette manière. Réduire Andreï Roublev à un grand spectacle humaniste serait pourtant, de toute évidence, rater l’ampleur de sa visée interne. Car le véritable Andreï Roublev (vers 1360-1430) fut un moine peintre d’icônes, et toutes proportions gardées, un peu aussi le Michel-Ange russe même s’il vécut dans un dénuement bien plus dangereux et risqué que l’Italien. Il faut donc ajouter qu’Andreï Roublev – personnage historique comme personnage du film de Tarkovski – ne peut être vraiment compris que si l'on connaît l’histoire de la théologie chrétienne.Deux citations nous permettent de bien cadrer les enjeux du film :1) «Pour le judéo-chrétien, l’homme est créé par Dieu et non engendré par lui, ce qui signifie qu’il ne lui est pas identique, qu’il ne lui est pas homogène, qu’il n’a pas dans sa nature de quoi être divinisé, que ses qualités ne peuvent être portées à l’Absolu, qu’il est irréductiblement subordonné, dépendant, limité, fini. Il est avec Dieu dans le rapport de l’œuvre à l’artiste. D’ailleurs, s’il lui est promis que dans l’Au-delà il Le verra face à face, c’est bien parce qu’il ne peut espérer cesser jamais d’en être distinct.»Dr. Francis Pasche, Freud et l’orthodoxie judéo-chrétienne, Revue française de Psychanalyse (éd. P.U.F., Paris, 1959, p. 56, conférence reprise, revue et augmentée – mais sans le compte-rendu du débat final entre son auteur et S. Nacht, Marie Bonaparte, René Held, André Green – in À partir de Freud (éd. Bibliothèque scientifique Payot, coll. Science de l’homme, Paris, 1969, §8, pp. 129 et sq.)2) «La légitimité des images dans le christianisme a été tranchée sur le fond, en plein milieu de la sanglante querelle des images, au deuxième Concile de Nicée en 787. Cette décision ne marqua pas la fin de la guerre civile, qui dura jusqu’en 843, «triomphe de l’Orthodoxie». […] L’Incarnation, «imagination de Dieu», avait pavé la route. Elle préside à la distribution du divin dans le monde, à l’économie de la providence. «Qui refuse les images, refuse l’économie», dit Nicéphore. Ce que le Christ est à Dieu, l’image l’est à son prototype. Et comme le Fils tend vers Dieu, je dois tendre vers l’image du Fils. […] La vague iconoclaste lancée par Léon III à Byzance au début du VIIIe siècle a été la dernière grande hérésie touchant au dogme de l’Incarnation.»Régis Debray, Vie et mort de l’image – Une histoire du regard en Occident, livre I, §3 (éd. Gallimard, Paris, 1992, puis coll. Folio, Paris, 1994, pp. 107-109).On comprend mieux, après avoir lu cela, pourquoi Tarkovski filme avec autant d’attention dans Andreï Roublev tant les éléments matériels et naturels que les visages et les corps : ils sont dans une relation dialectique induite par la perspective de la nature religieuse de l’icône russe. Ce n’est pas à vouloir dire que Tarkovski fut ou non, dans le secret de son âme, chrétien en 1966. D’ailleurs dire cela serait ne rien dire : le christianisme n’est pas la même chose selon qu’on est catholique, protestant ou orthodoxe. Si on veut cependant tenter de le savoir, on pourra lire les 600 pages de son Journal 1970-1986 (au sens de journal intime) qui vient d’être réédité vers la mars-avril 2005 par les Cahiers du Cinéma. On peut juste assurer que les interdictions judaïques puis calvinistes relatives à l’image lui sont étrangères. On sait que le christianisme du Nouveau Testament qui fonde le catholicisme est historiquement et objectivement issu d’une rencontre entre l’esprit judaïque et l’esprit grec. La Russie a conservé bien ancrée une sensibilité – sans parler de son alphabet dont certaines lettres proviennent du grec antique ! – typiquement issue de cette rencontre : le lien entre la Grèce et la Russie est notamment l’icône byzantine. Et la religion orthodoxe est fondatrice de l’idée même de la Russie traditionnelle. On peut donc simplement conclure sur ce point en affirmant que Tarkovski avait parfaitement saisi et a parfaitement restitué l’essence de la spiritualité russe.Même les cinéastes œuvrant à l’époque du communisme le plus militant comme Dovjenko ou Eisenstein ressortaient finalement de ce courant esthétique : on pouvait s'en apercevoir à condition d’être un peu plus cultivé que nos braves (mais cependant encore utiles à lire d’un strict point de vue historique) Léon Moussinac ou George Sadoul. Ce n’est pas à dire qu’il faille comparer Andreï Tarkovski à ces deux illustres cinéastes car lui-même déniait formellement la validité du premier terme de la comparaison : «Il me semble que son esthétique m’est étrangère et franchement contre-indiquée.» (déclaration à la revue française Positif, n°109) et leurs univers moraux comme esthétiques lui sont, en effet, assez étrangers. Mais enfin, on pense parfois à certains plans de La Ligne générale (URSS, 1929) de S.M. Eisenstein ou de La Terre (URSS, 1930) d’Alexandre Dovjenko lorsqu’on visionne Andreï Roublev. Signe qu’il y a une permanence d’inspiration profondément chrétienne, et spécifiquement orthodoxe, dans le cinéma russe et que le communisme n’y fut qu’une parenthèse éminemment diabolique.C’est évidemment surtout à des films plus ouvertement eschatologiques comme Le Septième sceau (Suède, 1956) ou La Source (Suède, 1960) d’Ingmar Bergman dont les actions sont situées dans un univers également médiéval qu’il convient, en fin de compte, de le rapprocher. Il est, bien sûr, question du diable dont les symboles abondent dans le film : le prince tartare pénétrant dans l’église pour y massacrer les fidèles en est une incarnation. Il y est non moins question explicitement de Dieu puisque le miracle qui redonne foi à l’artiste religieux qu’est Roublev est accompli par la création improbable mais réussie d’une cloche colossale.La question naïve qu’on peut se poser est la suivante : comment les autorités de tutelle communiste de l’époque ont-elles pu permettre à un tel film d’être mis en scène ? La sœur du réalisateur nous donne dans son entretien une partie de la réponse : il tournait volontairement certaines séquences trop longues afin que la censure coupât dedans et ne touchât pas à l’essentiel. Mais surtout Tarkovski a eu l’habileté artistique de montrer des éléments qui pouvaient êtres lus dans une perspective marxiste par des censeurs marxistes naïfs de 1966. Une peinture historique (on sait que pour Marx et Lénine, disciples dévoyés de Hegel, l’histoire crée l’homme bien que l’histoire selon Marx et Lénine ne soit pas l’histoire selon Hegel) matériellement très soignée et précise d’une part, une vision d’un travail collectif semblant magnifier la puissance du travail humain au service d’une fin collective (la fabrication de la cloche) d’autre part. Pour des marxistes russes de 1966 patriotes et nationalistes, le film pouvait, en outre, aussi être vu comme une magnification de la résistance de l’âme russe aux envahisseurs étrangers asiatiques et les Tartares éventuellement symboliser la Chine rouge maoïste dont la redoutable «Révolution culturelle» avait lieu au même moment aux frontières de l’U.R.S.S., entérinant la séparation totale des deux régimes communistes les plus puissants de la planète à cette époque.Inutile de dire que ces diverses lectures du film furent peut-être réelles mais non moins évidemment totalement dénuées de sens. Le véritable sens final d’Andreï Roublev se confond avec l’irruption de la séquence finale chronologique montrant l’œuvre picturale réelle et originale de Roublev, filmée en couleurs et portée par une musique religieuse : des fragments, suppose-t-on, de la fresque du Jugement dernier, de l’icône de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'autres œuvres que nous savons pas identifier. Ce passage du N.&B. à la couleur à cette occasion est assez significatif par lui-même.
07/07/2005 | Lien permanent
Docteur Jekyll et Mr. Hyde, par Francis Moury

 Robert Louis Stevenson dans la Zone.
Robert Louis Stevenson dans la Zone.Résumé du scénario
Le docteur Jekyll, médecin londonien attaché aux hôpitaux et estimé de la bonne société victorienne, est convaincu qu’il est possible de dissocier chimiquement le bien du mal au sein du psychisme humain. Il pense pouvoir ainsi guérir certains criminels qui ne seraient, de son point de vue, que des malades irresponsables. Ses recherches inquiètent ses collègues, ses amis, sa fiancée et son futur beau-père. Un soir, Jekyll décide d’expérimenter sur lui-même la substance qu’il a mise au point : il se dédouble effectivement en un Mr. Hyde sadique et autonome. Revenu à lui, à la fois fasciné et effrayé, Jekyll pense être en mesure de contrôler le rythme de ce dédoublement… à tort.
Situation filmographique des versions de 1931 et de 1941
Voici donc deux des plus célèbres adaptations cinématographiques du roman de l’écrivain anglais Robert Louis Stevenson (1850-1894), The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde [L’étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde]. Stevenson fumait alors de l’opium pour soigner la maladie pulmonaire qui devait finalement l’emporter à l’âge de 44 ans. Il avait fait une nuit un cauchemar et en avait tiré son récit en quelques jours. Il le fit lire à son épouse Fanny Osbourne qui ne fut pas satisfaite du résultat. C’est elle qui lui donna l’idée de faire de Jekyll non pas un homme mauvais qui cache sa méchanceté mais un homme bon qui n’arrive plus à dompter la part de méchanceté qu’il a voulu isoler mais qu’il a, du même coup, excessivement libérée. Stevenson, comprenant la puissance supérieure de cette inflexion thématique, brûla son manuscrit initial et réécrivit l’histoire en trois jours très exactement. L’édition originale, parue en janvier 1886, se vendit à 40 000 exemplaires en quelques mois rien qu’en Angleterre. Dès 1887, les théâtres de New York représentaient sur scène des pièces adaptées du roman.
Inutile de dire que la liste exhaustive des diverses adaptations cinématographiques, des origines du cinéma muet mondial à nos jours, est impossible à résumer dans le cadre de cette critique. Une simple filmographie succincte des principales adaptations européennes comme américaines occuperait déjà une page entière, sans parler du reste des cinématographies des autres nations. La première version filmée par William Selig date de 1908, une version danoise daterait de 1910. Que le lecteur sache simplement que la première grande version hollywoodienne muette (un film distribué par la Paramount, réalisé par John S. Robertson avec l’acteur John Barrymore dans le rôle-titre) date de 1920 : elle est généralement tenue pour supérieure à celle réalisée par… Louis B. Mayer (l'un des patrons de la M.G.M.) la même année. Celle de 1931, réalisée par Rouben Mamoulian avec Frederic March (aussi distribuée par Paramount) est la seconde grande version hollywoodienne : c’est la version classique de l’âge d’or du cinéma fantastique américain. Celle de Victor Fleming avec Spencer Tracy, Ingrid Bergman et Lana Turner réalisée en 1941 (distribuée par M.G.M.) est la troisième. La version de 1931 comme celle de 1941 prennent toutes deux les mêmes libertés avec le roman original : les personnages féminins y tiennent une place démesurée – ce dont on ne se plaint pas d’ailleurs. L’essence même du suspense y est en revanche parfaitement respectée et comprise même si elle est temporellement modifiée et même si la structure du récit de Stevenson est totalement remaniée dans les deux cas par Hollywood. La version de 1941 est un «remake» – parfois séquence par séquence – de la version de 1931, à quelques exceptions notables près d’agencement temporel. Certaines idées de scénario diffèrent, pas toujours sur des points de détail et certains dialogues sont intégralement repris mais ces similitudes n'empêchent pas cette version de 1941 de marquer un approfondissement déterminant du thème dans l'histoire du cinéma fantastique.
La version de 1931
 En dépit de l’apport technique du parlant et de la vivacité visuelle d'une mise en scène dynamique, la vision de Rouben Mamoulian n’innove pas particulièrement quant au fond. On peut même affirmer sans crainte d'être démenti que cette version de 1931 est l’accomplissement de la représentation traditionnelle du thème à l’écran. Jekyll s’y transforme encore en un Hyde velu et monstrueux mais redoutable et intelligent. C’est du point de vue formel que Mamoulian innove : caméra subjective installant le spectateur dans la situation de Jekyll au début du film, montage nerveux, effets de «split-screen», énergique direction d'acteurs. L'interprétation de March frôle la caricature et le grotesque mais n’y tombe pourtant jamais, se tenant à la pure frontière du comique et de la terreur, retrouvant l'inspiration d'acteurs contemporains du cinéma fantastique classique tels que Bela Lugosi ou Lon Chaney. Une faiblesse, surtout notable dans sa dernière partie : des scènes de dialogues parfois interminables et souvent mièvres ou naïves.
En dépit de l’apport technique du parlant et de la vivacité visuelle d'une mise en scène dynamique, la vision de Rouben Mamoulian n’innove pas particulièrement quant au fond. On peut même affirmer sans crainte d'être démenti que cette version de 1931 est l’accomplissement de la représentation traditionnelle du thème à l’écran. Jekyll s’y transforme encore en un Hyde velu et monstrueux mais redoutable et intelligent. C’est du point de vue formel que Mamoulian innove : caméra subjective installant le spectateur dans la situation de Jekyll au début du film, montage nerveux, effets de «split-screen», énergique direction d'acteurs. L'interprétation de March frôle la caricature et le grotesque mais n’y tombe pourtant jamais, se tenant à la pure frontière du comique et de la terreur, retrouvant l'inspiration d'acteurs contemporains du cinéma fantastique classique tels que Bela Lugosi ou Lon Chaney. Une faiblesse, surtout notable dans sa dernière partie : des scènes de dialogues parfois interminables et souvent mièvres ou naïves.La version de 1941
 La version de 1941 produite et réalisée par Fleming franchit un pas dans une direction nouvelle, celle qui aboutira à la révision fondamentale du thème dans le génial The Two Faces of Dr. Jekyll [Les Deux visages du Dr. Jekyll] (G.-B., 1960) de Terence Fisher. Fleming n’est certes pas Fisher mais ce bon technicien – qui venait de coréaliser le célèbre Gone With the Wind [Autant en emporte le vent] d’après le roman sudiste populaire de Margaret Mitchell – nous donne une version qui, de toutes les versions classiques pré-fishériennes réalisées, est la plus moderne et la plus intelligente. C’est aussi celle qui est dotée du budget le plus conséquent : la M.G.M., à l’époque de Cedric Gibbons, ne lésinait pas sur les éléments assurant une direction artistique de qualité. Décors, costumes, qualité technique de la direction de la photographie, stars mondiales : tout cela assure au film de 1941 un statut d’emblée supérieur à celui des productions antérieures et même à la plupart des productions postérieures. Sous ses dehors plus civilisés et moins frustes, moins surréalistes et moins baroques que ceux de la version de 1931, la version de 1941 demeure encore aujourd’hui plus terrifiante car beaucoup plus intelligente. L’horreur physique y est supplantée par l’horreur psychologique et la lourde démonstration des effets spéciaux, trop attendus, s’estompe heureusement au profit d’un approfondissement du sujet. Hyde chez Fleming n’est pas un monstre de foire (ce qu’il était chez Mamoulian à cause du maquillage de Wally Westmore qui durait quatre heures, contraignant March à venir chaque jour au studio à 6 heures du matin), mais un sadique dont le visage demeure strictement humain : c’est, au terme de sa transformation, simplement le visage d’une brute vicieuse. Et les effets de sa brutalité sont d’autant plus impressionnants. C’est sans doute la raison pour laquelle la bande-annonce de 1941 refusa de dévoiler le visage de Hyde aux spectateurs : Fleming et la M.G.M. étaient bien conscients qu’ils avaient innové, franchi un palier.
La version de 1941 produite et réalisée par Fleming franchit un pas dans une direction nouvelle, celle qui aboutira à la révision fondamentale du thème dans le génial The Two Faces of Dr. Jekyll [Les Deux visages du Dr. Jekyll] (G.-B., 1960) de Terence Fisher. Fleming n’est certes pas Fisher mais ce bon technicien – qui venait de coréaliser le célèbre Gone With the Wind [Autant en emporte le vent] d’après le roman sudiste populaire de Margaret Mitchell – nous donne une version qui, de toutes les versions classiques pré-fishériennes réalisées, est la plus moderne et la plus intelligente. C’est aussi celle qui est dotée du budget le plus conséquent : la M.G.M., à l’époque de Cedric Gibbons, ne lésinait pas sur les éléments assurant une direction artistique de qualité. Décors, costumes, qualité technique de la direction de la photographie, stars mondiales : tout cela assure au film de 1941 un statut d’emblée supérieur à celui des productions antérieures et même à la plupart des productions postérieures. Sous ses dehors plus civilisés et moins frustes, moins surréalistes et moins baroques que ceux de la version de 1931, la version de 1941 demeure encore aujourd’hui plus terrifiante car beaucoup plus intelligente. L’horreur physique y est supplantée par l’horreur psychologique et la lourde démonstration des effets spéciaux, trop attendus, s’estompe heureusement au profit d’un approfondissement du sujet. Hyde chez Fleming n’est pas un monstre de foire (ce qu’il était chez Mamoulian à cause du maquillage de Wally Westmore qui durait quatre heures, contraignant March à venir chaque jour au studio à 6 heures du matin), mais un sadique dont le visage demeure strictement humain : c’est, au terme de sa transformation, simplement le visage d’une brute vicieuse. Et les effets de sa brutalité sont d’autant plus impressionnants. C’est sans doute la raison pour laquelle la bande-annonce de 1941 refusa de dévoiler le visage de Hyde aux spectateurs : Fleming et la M.G.M. étaient bien conscients qu’ils avaient innové, franchi un palier. Toute la puissance du film de 1941 repose aussi sur son casting.
Ingrid Bergman en est le pivot et le moteur. Sa fascination pour Jekyll annonce sa fascination pour Hyde : le rapport sadomasochiste qui s’établit entre elle et Hyde en est le négatif. Victime consentante et ambivalente, c’est elle qui révèle à Jekyll, bien davantage que la science positive, la réalité du mal : sa seconde rencontre dans le cabinet de Jekyll, témoin horrifié des tortures que son double démoniaque lui a faite subir, est le sommet dramatique du film pour cette raison. Certes la structure de tout cela était déjà chez Mamoulian en 1932, mais de façon beaucoup plus fruste du fait du jeu simpliste de Miriam Hopkins et de la conception toute différente de Hyde. George Cukor s’est souvenu de l’interprétation d’Ingrid Bergman dans le film de Fleming lorsqu’il l’a reprise pour son remake de Gaslight [Hantise] (1944) aux côtés de Charles Boyer, de même que Hitchcock s’en est souvenu lorsqu’il l’a choisie pour Notorious [Les Enchaînés] (1946) et Under Capricorn [Les Amants du Capricorne] (1949).
Lana Turner semblait prédisposée à jouer le rôle d’Ingrid Bergman par l’image de séductrice très érotique qu’elle était en train de se construire à Hollywood : Fleming a eu l’idée d’inverser la donne et de lui confier le rôle de la jeune fille de bonne famille, aussi virginale qu’on peut l’être même si nullement naïve. Raison pour laquelle Lana Turner n’est pas un simple faire-valoir : elle fait vivre ce rôle a priori mièvre, très réellement et très intelligemment.
Enfin Spencer Tracy trouve là, pour le coup, tout bonnement le meilleur rôle de sa carrière dans la mesure où son image hollywoodienne est, elle aussi, utilisée à contre-emploi. Tracy était à Hollywood le symbole de l’homme droit et pur, de l’honnête homme désintéressé et idéaliste mettant son énergie au service d’une cause héroïque, de l’innocent accusé injustement : voir par exemple Fury [Furie] (1936) de Fritz Lang (1), qui est un rôle emblématique de ce point de vue. C’est donc tout le casting principal qui est ainsi contaminé en profondeur par l’idée stevensonienne, obtenant un effet supérieur à celui que Mamoulian avait ébauché nerveusement mais sans nuance. Et du coup, un nouvel érotisme et une épouvante neuve s’insinuent dans la version de 1941 qui conserve la puissance brute et enfantine, onirique et surréaliste, éminemment fantastique du beau film de 1931 mais en la retranscrivant à un degré supérieur de profondeur.
Les trois âges du thème dans l'histoire du cinéma fantastique
En somme, on pourrait dire que la version Mamoulian de 1931 est la version pure de l’enfance et que la version Fleming de 1941 est la version plus complexe de l’adolescence. Elles sont toutes deux indispensables à la connaissance de l’évolution filmographique de ce personnage mythique du cinéma fantastique. Ce n’est qu’après les avoir vues toutes deux – sans oublier celle du cinéaste Edgar G. Ulmer (1957) et quelques autres – qu’on pourra exactement mesurer la nature authentiquement adulte des apports décisifs, tant plastiques que thématiques, opérés sous l’égide de la Hammer Film anglaise par les cinéastes Terence Fisher dans Les Deux visages du Dr. Jekyll (1960) puis Roy Ward Baker dans Dr Jekyll & Sister Hyde (1971), ces deux dernières variations, très différente l'une de l'autre mais d'une aussi grande originalité l'une que l'autre, étant encore aujourd'hui les variations les plus audacieuses, les plus fouillées et les plus riches, engendrées par le court roman ou la longue nouvelle de Stevenson, dans l'histoire du cinéma fantastique des origines à nos jours.
Remarques techniques
L'image de la version de 1931, photographiée par Karl Struss (qui avait aussi photographié l’admirable Island of Lost Souls [L’île du docteur Moreau] (1932) d’Erle C. Kenton), est au format standard académique 1.37, format encore utilisé par celle de 1941 photographiée par le non moins talentueux Joseph Ruttenberg. La plus ancienne des deux versions est évidemment davantage influencée par l’expressionnisme allemand mais regorge d’audaces techniques : long plan-séquence avec travellings en caméra subjective, des split-screen» (dans une même image, la vision d'au moins deux actions différentes), panoramique à 360° (pendant lequel Struss était attaché à sa caméra pour plus de sûreté) sans parler de la transformation de Jekyll en Hyde, filmée pour la première fois en continuité. L'image de la version de 1941 est équilibrée entre expressionnisme latent et classicisme parfois discrètement baroque.
Le commentaire audio joint par Warner vidéo à l'édition numérique de la version de 1931, écrit et dit par l'historien américain Greg Mank dont le débit est parfois un peu trop rapide en dépit d’une prononciation claire et distincte, n’est pas sous-titré en français. Dommage car s’il n’est pas toujours adapté à l’image (Mank saisit par exemple l'occasion de tel plan avec Miriam Hopkins pour nous résumer sa carrière pendant plusieurs minutes), ce commentaire fournit de précis renseignements techniques (l’origine de l’effet d’ombre géante sur le mur d’une rue pendant que Hyde est poursuivi par la police, etc.) et historiques (Rouben Mamoulian considérait, à la fin de sa vie, sa version de 1931 comme une métaphore prophétique des ravages de la drogue sur la jeunesse américaine).
Note
(1) M le maudit (Allemagne, 1931) de Lang contient une idée de mise en scène reprise en 1941 par Victor Fleming. Le spectateur comprend, en entendant l'interruption de l'air fredonné par le protagoniste qui demeure hors de son champ visuel, que cette interruption manifeste une nouvelle emprise de la pulsion criminelle (cas de M) ou du double maléfique (cas du docteur Jekyll). Mamoulian, en 1931, s'en tient à une transformation visuelle spectaculaire. Étant donné que M n'était sorti aux États-Unis qu'en 1933, cette idée de Lang ne pouvait, il est vrai, l'avoir inspiré.
16/12/2015 | Lien permanent
Apocalypses biologiques, 5 : Virus, par Francis Moury

Le monde entier de 1980 à 1988 : une arme de guerre bactériologique, objet de la convoitise d'espions, est accidentellement répandue dans l'air. Ce virus de la grippe (incontrôlable car modifié) est inactif sous -10° mais se répand dans les autres zones terrestres tempérées et chaudes. L'état d'urgence est déclaré dans toutes les capitales, Tokyo et Washington incluses mais en vain. Les morts et les suicides se multiplient à un rythme exponentiel. Les rescapés internationaux des bases du continent Antarctique, d'abord impuissants, s'organisent : ils se protègent et deux d'entre eux sont convoyés à Washington, vaccinés mais sans certitude que le vaccin agira, afin d'éviter le déclenchement automatique d'une guerre atomique. Elle pourrait être provoquée par un séisme près d'une base de lancement de missiles. Le séisme, prédit par un savant japonais, se produit effectivement mais la tentative de désamorçage des missiles échoue : ils détruisent une partie de la terre. L'unique survivant japonais de la mission-suicide constate, cependant, que le vaccin qu'on lui a inoculé semble efficace. Il permettra sans doute aux survivants de l'Antarctique de repeupler la Terre. C'est la bonne nouvelle qu'il leur apporte, après un voyage de retour épuisant à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud jusqu'à la pointe Sud du Chili.
Virus [Fukkatsu no hi / Virus : qui héritera de la Terre ? / Virus : Day of Resurrection] (Japon, 1980) de Kinji Fukasaku est un film catastrophe très étonnant. Il revient de loin bien qu'il soit tout de même encore invisible en France dans des conditions vidéo correctes puisque les seules éditions intégrales disponibles pour l'instant en DVD sont des éditions étrangères dénuées de VOSTF et de VF d'époque. Il avait été distribué chez nous au cinéma en 1982 en version courte (environ 105 minutes), remontée pour l'exploitation internationale, ainsi qu'en témoigne une ancienne VHS Secam considérablement lacunaire. Ce n'est que depuis 2006 que sa version intégrale japonaise d'environ 156 minutes est visible en VOSTA aux États-Unis sur un DVD aux normes techniques compatibles 16/9 rendant justice à son format large original 1.85.
Produit par Haruki Kadokawa (bien connu des cinéphiles français car c'est, en partie, grâce au patronage de sa fondation que la Cinémathèque française avait organisé sa première grande rétrospective du cinéma japonais au Palais de Chaillot en 1984-1985), Virus fut présenté en 1980 comme le film le plus cher jamais produit au Japon. Son casting international est (le recul permet d'en convenir avec encore plus de netteté) d'une variété étonnante : l'acteur de films d'arts martiaux Sonny Chiba joue le rôle d'un médecin; une star américaine des années 1940-1950, Glenn Ford, joue le Président des États-Unis; de bons acteurs de second rôle des années 1960 (Henry Silva, Robert Vaughn, George Kennedy, Bo Svenson, Chuck Connors) y côtoient une beauté d'origine argentine des années 1970 (Olivia Hussey) aux côtés d’Edward James Olmos et de nombreux acteurs japonais des années 1970-1980. Le scénario est ample : guerre bactériologique, équilibre de la terreur et guerre atomique, apocalypse, survie. Le tout méticuleusement découpé en séquences temporelles indiquées (sur la version originale japonaise) par des intertitres japonais incrustés sur certains plans, couvrant une action s'étalant sur presque dix ans.
On chuchote que Kadokawa aurait voulu John Frankenheimer (1930-2002) comme metteur en scène : l'idée n'était pas mauvaise mais, quoi qu'il en soit, il n'a pas perdu au change en engageant le cinéaste Kinji Fukasaku (1930-2003), l'un des cinéastes japonais majeurs de la période 1970-2000. Fukasaku avait été co-réalisateur (avec Toshio Masuda) des magnifiques séquences japonaises de la superproduction de guerre Tora ! Tora ! Tora ! (États-Unis + Japon, 1970) de Richard Fleischer. Il savait donc parfaitement régler des scènes amples comprenant de nombreux figurants, et leur insuffler une légendaire énergie. Fukasaku était concerné, comme tous les cinéastes japonais de sa génération, par le thème de l'apocalypse. On se souvient que ses plus grands films noirs policiers violents des années 1970-1975 – à commencer par Combat sans code d'honneur : qui est le boss à Hiroshima ? (Japon, 1973) et par Cimetière de la morale (Japon, 1975) – débutaient sous le signe de l'explosion atomique et que leurs génériques brossaient, en plans fixes d'images N&B ou couleur sépia provenant de documentaires, le chaos urbain de 1945 au sein duquel les Yakuza régénéraient la nation japonaise en profondeur par leur attachement forcené, ultra-violent aux traditions nationales, sapant discrètement la main-mise démocratique dissolvante des forces d'occupation américaine.
De fait, on retrouve à certains moments (la panique des mères amenant leurs bébés à l'hôpital, la mise en place de l'état d'urgence tandis que l'armée japonaise se déploie baïonnette au canon à l'aube, la montée de la colère dans le sous-marin soviétique comprenant qu'il sera sacrifié) l'art brutal avec lequel la caméra de Fukasaku est capable, en quelques plans, de brosser une atmosphère survoltée, semblant prise sur le vif, débordante d'une énergie vitale en ébullition. Ces moments contrastent avec l'ampleur contemplative, presque détachée, avec laquelle est filmée le voyage final en solitaire du héros Yoshizumi à travers les Amériques puis le Sud du Chili (la marine chilienne et la marine canadienne permirent le tournage dans leurs sous-marins) vers l'Antarctique. Sans oublier la célèbre rencontre avec la statue du Christ que la version courte internationale initialement exploitée (y compris en France) montrait au début du film alors qu'elle se trouve vers la fin, dans la version intégrale du montage original japonais.
Telle qu'elle nous est restituée, la vision de Fukasaku (crédité co-scénariste au générique) annonce, par sa virulence récurrente (qu'un «happy end» peut-être de pure forme, mais cependant réaliste, ne contredit qu'à peine) les meilleurs moments de son dernier chef-d'œuvre du cinéma de la violence : Battle Royale (Japon, 2000). La fameuse séquence durant laquelle le héros japonais survivant dialogue mentalement (la scène est frappante de sincérité) avec une statue du Christ tombée à terre, dans une maison abandonnée au sol de laquelle gisent des squelettes avec lesquels il «parle» aussi mentalement, ouvrait le film dans sa version courte mais c'était par une séquence bien plus ample que s'ouvrait en réalité la version originale japonaise, à savoir par une vision de Tokyo aux rues jonchées de cadavres et de squelettes, retransmise en vidéo grâce à un drone (ils existaient déjà en 1980) envoyé par un sous-marin nucléaire américain venu de l'Antarctique. Saisissante introduction, au fond, et signe intime de la puissance du film.
On n'oublie pas non plus les différents suicides qui ponctuent l'action : celui de l'infirmière fiancée de Yoshizumi, en compagnie d'un enfant tandis qu'elle fuit Tokyo par la mer, celui de Tatsuno sur la base japonaise de l'Antarctique au milieu d'un nocturne blizzard. Il n'est d'ailleurs pas tout à fait impossible que certains plans nocturnes de cette base Antarctique filmée par Fukasaku aient influencé le cinéaste John Carpenter lorsqu'il réalisa The Thing (États-Unis 1982), son passionnant remake-variation du classique du cinéma fantastique The Thing From Another World [La Chose d'un autre monde] (États-Unis, 1950) de Christian Nyby, supervisé par Howard Hawks, d'après l'histoire de John W. Campbell, Who Goes There ? [La Bête d'un autre monde] (1938) intégrée par la suite en 1948 à son recueil d'histoires de science-fiction Le Ciel est mort (plus tard traduit aux Éditions Denoël, collection Présence du futur n°6, 1955).
Concernant les modifications de montage et de durée, on peut résumer en disant que la version internationale courte atrocement charcutée amputa un certain nombre de séquences purement japonaises ne mettant en scène aucun acteur occidental. La version longue japonaise intégrale restitue évidemment à l'œuvre son équilibre et son ampleur native, gage de supérieure densité. Reste que Virus fut un sévère échec financier : il ne fut pas distribué dans les cinémas américains mais fut directement exploité en «direct-to-video» et à la télévision. La version courte présentée en France durant la saison cinématographique 1982 connut un échec critique inévitable puisqu'on se rendait compte que la continuité filmique était parfois rompue sans autre explication qu'un abrupt point de montage. On était simplement en mesure d'admirer la beauté plastique de certaines séquences ou de certains plans sans pouvoir critiquer la totalité du film.
Cette version intégrale restituée, cependant, en dépit de sa puissance récurrente, fait tout de même écho au proverbe : qui trop embrasse, mal étreint. Le scénario est, en effet, d'une ambition peut-être excessive : on aurait pu se contenter de traiter seulement une des deux guerres, l'atomique ou la biologique, sans se considérer obligé de réunir les deux par une intrigue certes intelligente et savoureuse mais un peu artificielle dans sa démesure. La contrepartie de cette ambition est qu'elle donne l'occasion à Fukasaku d'un jeu de massacre parfois surréaliste, dans l'écriture comme plastiquement : on n'oublie pas l'ahurissante réunion d'espions autour du virus, leur accident qui ouvre la boîte de Pandore ni la folie avec laquelle le général joué par Henry Silva arme le processus automatique de mise à feu des ordinateurs de la salle souterraine de contrôle ni cette autre folie (épouvantée) qui s'empare des marins russes comprenant qu'ils vont être sacrifiés par les rescapés de l'Antarctique.
Au total, Virus est assurément à redécouvrir car c'est un des jalons du cinéma mondial eschatologique du vingtième siècle et une date importante dans la filmographie de Fukasaku, bien que ce ne soit, cependant, pas son meilleur film. En tout cas, il mériterait bien qu'on lui consacre une édition BRD haute définition.
Note sur les sources techniques
DVD BCI Eclipse américain zone 1 NTSC de 2006 (faisant partie d'un «Coffret Sonny Chiba»), version intégrale de 156 minutes, image couleurs 1.85 compatible 16/9 + VHS Secam française MPM de 1991. Il n'existe aucun DVD ni aucun BRD édité en France : il faudrait éditer la version intégrale restaurée en VOSTF et offrir en bonus la VF d'époque courte exploitée au cinéma en France en 1982, en guise de document d'histoire d'une exploitation erratique mais rétrospectivement savoureuse du titre à l'international.
21/06/2020 | Lien permanent
Le spinozisme eudémoniste de Robert Misrahi, par Francis Moury

 Sur Spinoza, L’Éthique (traduction française, introduction générale, notes et commentaires de Robert Misrahi, éditions de l’Éclat, collection Philosophie imaginaire dirigée par Patricia Farrazi et Michel Valensi, Paris / Tel-Aviv, 2005).«J’ai quelquefois donné à des étudiants, comme exercice de logique, à prendre une proposition dans le quatrième ou le cinquième livre de L’Éthique et à reconstituer, en suivant les références de Spinoza lui-même, la chaîne des démonstrations qui est censée la relier aux axiomes, définitions et postulats initiaux. Ceux qui ont tenté de le faire ont vite rencontré tant de ruptures, d’indéterminations, de «petits bonds» et même de grands qu’ils en ont été amusés ou rebutés.»André Lalande (et Société française de Philosophie), Préface (1902-1923) au Vocabulaire technique et critique de la philosophie (12eme éd. P.U.F., coll. Les grands dictionnaires des Presses universitaires de France, 1976, p. XVI).«Hegel a, il est vrai, déclaré que la méthode géométrique, telle que Spinoza l’a pratiquée, est celle qui convient le moins à l’absolu. [...] Plus sévères peut-être que Hegel [...] nous sommes enclins à dénoncer l’inadéquation radicale d’une telle méthode à l’objet que lui assignait Spinoza.»Victor Delbos, Le Spinozisme – cours professé à la Sorbonne en 1912-1913, Appendice § II Le cartésianisme et le spinozisme (éditions Vrin., coll. B.H.P., 1972, conforme à la première édition de 1916), p. 214.«Condillac a voulu démontrer que Spinoza n’a nulle idée des choses qu’il avance, que ses définitions sont vagues, ses axiomes peu exacts, et que ses propositions ne sont que l’ouvrage de son imagination, et ne renferment rien qui puisse conduire à la connaissance des choses.»Joseph Moreau, Spinoza et le spinozisme, § III intitulé Le spinozisme dans l’histoire (éditions P.U.F., coll. Que sais-je ? n° 1422, p. 108 – la citation provient de Condillac, Traité des systèmes, § X).«Je voudrais préciser mon propos en donnant un exemple, vous soumettre une brève lecture psychanalytique de Spinoza.J’ai choisi Spinoza pour maintes raisons dont la plus personnelle est qu’il me fascine à la façon d’un personnage de conte d’Hoffmann, fabricateur d’automates et marchand de lunettes (qui sont peut-être des yeux), lunettes qu’il fait passer de Dieu à moi et de moi à Dieu pour nous réunir enfin derrière la même paire. En somme une réplique dédramatisée de l’Homme au sable, sans effusion de sang, en deçà du complexe de castration, mais néanmoins, pour moi étrangement inquiétant.»Dr. Francis Pasche, L’Angoisse niée, Revue Française de Psychanalyse 1/1979 réédité dans Francis Pasche, Le Passé recomposé – Pensées, mythes, praxis § III (éditions P.U.F., coll. Le Fil rouge, préface de Didier Anzieu, 1999), p. 87.Voici une nouvelle* traduction française de L’Éthique de Spinoza. Une première remarque s’impose : il s’agit d’une traduction mais pas d’une édition du texte latin original accompagné d’une traduction. Pour connaître le texte latin original, le lecteur français doit donc toujours tenter de se procurer la seconde édition revue et corrigée en deux tomes du texte latin avec traduction française de L’Éthique par Charles Appuhn, à la Librairie Garnier, dans la célèbre collection des Classiques Garnier (1934).Le livre est plastiquement beau et très bien imprimé. Il s’ouvre par 55 pages d’Introduction générale mais la biographie de Spinoza est très brève et aucune bibliographie spinoziste n’est fournie. Cette introduction est divisée en deux parties distinctes : une justification historique et logique des innovations de Misrahi en matière de traduction d’une part, un résumé et une interprétation du spinozisme de l’autre. Il se poursuit par 265 pages contenant la Traduction proprement dite. Elle est parfois améliorée par rapport à la traduction Appuhn ou à celle de la Bibliothèque de la Pléiade, parfois identique, parfois discutable : dans une telle entreprise, il ne peut pas en aller autrement. Misrahi le sait puisqu’il faisait partie de l’équipe de La Pléiade en 1954 qui traduisit les Œuvres complètes (enfin presque complètes) de Spinoza en un épais volume – volume soit dit en passant aussi indispensable à l’étudiant français que les deux volumes d’Appuhn déjà cités, même s’il n’offre que des traductions. La note 1 de la Partie III (pp. 401-404) nous semble ainsi très convaincante et précise : elle rectifie d’ailleurs un terme qui semblait à notre professeur J. Castaing (cf. son cours d’agrégation sur Spinoza à l’université Paris-I Sorbonne du 20 novembre 1997) le seul défaut de la traduction d’Appuhn : c’est dire ! Comme souvent, le choix entre chiffres arabes et chiffres romains (numérotant les Définitions, les Axiomes, les Propositions) est un peu aléatoire et ne respecte jamais absolument l’original. Suivent 150 pages de Notes historiques et critiques souvent très précises et soigneuses mais parfois aussi très agaçantes, et pour cause… Misrahi pense que le système de Spinoza est le meilleur du monde et cela fait cinquante ans qu’il le dit ! Enfin on trouve un Index des notions de 30 pages environ mais certaines notions sont absentes (par exemple «indivisibilité», «négation», «pression») et on ne trouve pas d’Index nomini. Ce dernier point est très regrettable car l’appareil de notes cite de très nombreux noms propres : comment les retrouver aisément ? Nous suggérons momentanément une solution. Il suffit de constituer soi-même cet Index nomini en le reportant manuellement à la page 474 qui est blanche et située juste après cet appareil critique ou bien en l’imprimant et en glissant l’imprimé juste entre les pages 474 et 475.Misrahi a écrit bien des choses depuis sa collaboration aux Œuvres complètes de Spinoza à La Pléiade en 1954. Pages 505 et 506, on en trouve la liste et la lire est une source, parfois, d’amusement. Rien d’étonnant : Misrahi ne cesse d’utiliser les termes «joie» et «bonheur» dans les titres de ses ouvrage ! Enfin cela concerne une partie d’entre eux. À vrai dire, notre homme navigue depuis cinquante ans entre La Condition réflexive de l’homme juif, La Philosophie politique et l’État d’Israël, Existence et démocratie, Un Juif laïque en France et des idées plus gaies comme celles de L’Enthousiasme et la joie au temps de l’exaspération (sic), Un combat philosophique pour la joie, 100 mots pour construire son bonheur. Et bien sûr, l’esquif sur lequel il navigue entre ces notions bien hasardeuses c’est, vous l’avez compris, le système de Spinoza ! On ne sait pas ce que Spinoza aurait pensé du marxisme, de Martin Buber, du sionisme, du choix des sionistes de créer un État juif en plein milieu de terres palestiniennes (provoquant ainsi des guerres à répétition et des actions terroristes continuelles depuis plus de cinquante ans qui menacent régulièrement l’ordre et la sécurité du monde, pour paraphraser le beau titre d’un film de Claude d’Anna), ni de la condition des Juifs laïques en France en 2004. On sait aussi assurément (derniers paragraphes conservés du Tractatus politicus) qu’il n’aurait pas apprécié la candidature de Ségolène Royal ! Par contre, en lisant les notes de Misrahi on sait ce qu’il pense de Spinoza. Selon Misrahi, Spinoza «dépasse» l’antiquité, la philosophie médiévale, le cartésianisme et même tout ce qui vient après lui : ce verbe, «dépasser» est utilisé assez souvent. Il est particulièrement agaçant dans le contexte. À noter tout de même aussi que sa bibliographie comporte, en 1998, un Spinoza et le spinozisme (édition Armand Colin : est-ce Misrahi ou Armand Colin qui a eu l’idée de ce titre déjà utilisé par le regretté Joseph Moreau pour son propre livre – comme toujours remarquable – de 1971 ?) Bref, passons… Si les éditeurs de philosophie font des «remake» et rachètent les droits des titres (ou les volent) comme à Hollywood, les bibliographies vont contenir autant de titres homonymes que les filmographies tant l’imagination des uns et des autres semblent limitée ! Cette pratique est récurrente et on pourrait en citer tant d’exemples….Et puis finalement, on se demande en fin de compte à quoi il sert à Misrahi d’avoir lu Wolfson, Guéroult (qu’il critique constamment avec un acharnement qui nous semble tout de même suspect) et les autres si c’est pour arriver à ce résultat : considérer que Spinoza exprime «l’humanisme le plus exigeant et le plus qualitatif» (p. 466), et qu’il n’est surtout pas passible d’une interprétation déïste ou théologique. On croirait lire du Michel Onfray : Spinoza humaniste mais surtout pas mystique ! Et pourtant il y a un Dieu de Spinoza, et Spinoza croyait sincèrement en ce Dieu, au point de lui sacrifier sa vie privée comme publique. Il était absolument mystique et a vécu pratiquement comme un mystique. Mais son Dieu était un Dieu très particulier – sive natura. Une «natura» assez curieuse, elle aussi. Pas la nature de Lucrèce ou d’Épicure non plus ! Ce Dieu «ne crée pas, il ne pond pas, il n’émane même pas à la façon plotinienne, il reste gravide pour l’éternité. Il «exprime» comme dit G. Deleuze. Ce Dieu est une déesse, grosse d’un réel dont elle n’accouche jamais» (Francis Pasche, op. cit., supra). Joseph Moreau faisait probablement fausse route en pensant trouver chez Plotin le paradigme, la clef du spinozisme : le fait est assez rare pour être signalé puisque, d’une manière générale, Moreau fait bien partie de cette rare catégorie d’historiens français de la philosophie qui étaient capables d’écrire sur tous les sujets sans jamais commettre une erreur de fait ou de jugement, ainsi que nous l’avait fait une fois remarquer à juste titre le professeur Rémy Brague. Joseph Moreau : encore un de la génération d’avant-guerre ! On savait former les gens, à cette époque !Revenons à Misrahi qui, en dépit de sa précision et du soin méticuleux qu’il a apporté à la rédaction de ses notes, n’est pas tout à fait de la même trempe. Il cite parfois un peu approximativement : sa note 80 au livre I (p. 357) mentionne Aristote, De Anima III, 9, 432b comme source du finalisme critiqué par la théorie de la causalité efficiente chez Spinoza. En réalité, ce n’est que l’amorce de la discussion. Il faut aller à III, 10, 433 a pour y trouver posé le problème de la faculté motrice, source de toute discussion sur la finalité. Le reste est parfaitement correct mais la fin de cette même note 80 signale que «Maïmonide, comme Thomas d’Aquin, pense que Dieu agit par finalité, et qu’il a institué une finalité naturelle dans les choses». La dernière phrase de la quatrième page de couverture assimilant L’Éthique au Guide des égarés de Maïmonide est donc un peu abusive même si on devine qu’elle se cantonne au niveau moral davantage que métaphysique.C’est surtout du point de vue métaphysique que Misrahi nous pose des problèmes. «Pour posséder la vie éternelle, il nous faut croire, disait saint Paul, que Jésus est le fils de Dieu; il nous faut savoir, dit Spinoza, que nous sommes Dieu» écrivait en 1934 Charles Appuhn à la fin de l’ultime note du second volume de la seconde édition de sa propre traduction. Et cette belle et claire comparaison résume tout de même assez bien le problème. «Ainsi, après avoir, dans la Partie I, fait la critique du dualisme ontologique et du Dieu personnel, Spinoza, dès le début de cette partie II, fait la critique rigoureuse du dualisme psychologique (et de son substantialisme animiste) et de l’immortalité qu’il fonde. Contestant la Bible, le platonisme, l’aristotélisme, tout le Moyen Âge et Descartes, le spinozisme est aussi l’annonce d’une anthropologie philosophique et unitaire» écrit pour sa part bravement Misrahi à la fin de sa note 39 de la Partie II. Cela fait tout de même pas mal de belles et bonnes choses contestées tout de même, non ? Et c’est cela qui permet de traduire «individu» par «chose» comme le fait plus honnêtement Pierre Macherey, Hegel ou Spinoza (édition Maspéro, 1979, lorsqu’il cite le texte latin d’une phrase de la Partie II, Scholie de la Proposition 13, p. 182 !) On signale aussi la page 215 de Macherey concernant ce problème de la détermination / délimitation de ce qu’est un individu/chose/mode fini chez Spinoza : les lectures en regard du commentaire de Macherey et de cette note-là de Misrahi (ainsi que de ses notes 10 et 11 de la Partie II) sont instructives.Spinoza ne croit absolument pas aux religions monothéistes constituées à son époque car il refuse l’idée de création, celle d’un Dieu personnel, et dénie à l’homme toute liberté réelle. Il reconnaît cependant l’utilité des religions et des lois, bien que leurs objets soient fondamentalement des fictions réservés aux ignares et aux esclaves. En cela il influencera Nietzsche, de toute évidence. Il faut bien avouer que son système est probablement l’un des plus beaux esthétiquement mais aussi l’un des plus démentiels et des plus délirants qu’on ait jamais vu fleurir sur terre. Ce n’est pas dans le cadre de cette critique que nous allons le prouver : cela fait trois siècles que la cause est entendue. Qu’on soit idéaliste ou réaliste, dans les deux cas, le spinozisme est une folie aberrante qui n’est pas vraie et encore moins satisfaisante. Sade avait le sens de l’humour noir et faisait volontiers citer Spinoza par ses héros les plus intellectuels à l’appui de leurs démonstrations les plus ardentes. Déjà le Père Malebranche avait dit son «dégoût» profond pour le spinozisme; Bayle l’avait ridiculisé en une formule célèbre quelques années plus tard tandis que Leibniz, faisant comme d’habitude feu de tout bois, s’y était intéressé au point de le considérer comme une extension logique du cartésianisme : considération totalement fausse même si Les Origines cartésiennes du Dieu de Spinoza furent en effet étudiées avec bonheur et bien plus d’objectivité par l’excellent Pierre Lachièze-Rey. La note 62 de la partie II (p. 388) écrite par Misrahi confirme d’ailleurs bien en quoi Leibniz se trompait et nous lui en savons gré.Sa note 12 de la Partie V sur l’idée de sujet (p. 452) est elle-même… sujette à discussion : on lui confrontera utilement le commentaire – orienté dans un sens davantage logique et physique – de l’Axiome en question par Pierre Macherey (op. cit., supra, p. 246). La note 44 de la Partie V (p. 462) sur l’éternité de l’esprit (qui passe par celle de l’éternité de l’essence du corps puisque l’esprit est l’idée du corps) est assez croustillante : on la comparera utilement avec la critique de cette même idée chez Raymond Ruyer, Néo-finalisme (édition P.U.F., coll. B.P.C., 1952, p. 174). La note 26 de la partie II consacrée à la «doctrine du parallélisme» (p. 373) est passible d’une intéressante comparaison avec Pierre Macherey (op. cit., supra, paragraphe intitulé Le Problème des attributs, p. 131). «La finitude, au sens où l’emploie la philosophie existentielle chrétienne, n’a pas son équivalent chez Spinoza» écrit Misrahi à la note 10 de la Partie II (p. 368) : c’est le moins qu’on puisse dire !Enfin, il convient tout de même de comparer la note 37 de la Partie I (p.341) sur le problème crucial de la divisibilité et de l’infini au très célèbre article de Martial Guéroult, «La Lettre de Spinoza sur l’infini – Lettre XII à Louis Meyer», in Revue de Métaphysique et de Morale 71ème année n°4, octobre-décembre 1966, pp.385-411. Guéroult avait donné à la R.M.M. la primeur de ce qui allait constituer l’Appendice IX de son Spinoza - tome I Dieu alors sous presse aux éditions Aubier-Montaigne.Soit dit en passant, on signale que le second paragraphe de la note 25 de la Partie I (p. 333) mentionne «Hildesheim G. Olms, 1968» comme éditeur du livre de Guéroult. Il ne faut pas se moquer du monde ! Georg Olms est un charmant monsieur (ou une enseigne éditoriale représentant de charmants messieurs !) qui rééditent des fac-similés très soignés d’éditions originales épuisées ou introuvables. Il a ainsi réédité en 1984 l’admirable La Théorie platonicienne des Idées et des Nombres d’après Aristote – Étude historique et critique (1908) de Léon Robin et peut-être aussi (nous avons un doute ?) le non moins rare Le Problème moral dans la philosophie de Spinoza et l’histoire du spinozisme du grand Victor Delbos. Mais on ne savait pas qu’un livre de Guéroult édité pour la première fois en 1968 (ce n’est tout de même pas si loin !) était déjà épuisé : on doit d’ailleurs en trouver de temps en temps des exemplaires en état neuf ou d’occasion chez Vrin, Le Chemin des philosophes, Joseph Gibert ou Gibert Joseph (il paraît que ce sont deux entités différentes !), la Fnac ou Virgin uniquement à Paris. J’inclus ces deux dernières librairies car elles ont parfois de belles occasions en état neuf, dos non cassé – ce qui comme chacun sait, est le minimum requis pour constituer un bel exemplaire. Bref, l’édition originale du Spinoza de Guéroult en deux volumes, c’est Aubier-Montaigne et pas Georg Olms.Quant à l’ensemble des notes politiques, il convient de les comparer en permanence, afin de se remettre un peu les idées en place, à deux études : celle citée supra du Dr. Francis Pasche – une de ses plus admirables études psychanalytiques d’histoire de la philosophie – qui résume d’une manière percutante l’essentiel et celle de Ferdinand Alquié, Servitude et liberté selon Spinoza (édition du Centre de Documentation Universitaire). Le point de passage de Spinoza à Hegel étant que, dans le Tractatus politicus de Spinoza, la moralité est postérieure à l’État, ce qui signifie concrètement qu’il n’y a rigoureusement aucune autre moralité que l’obéissance aux lois édictés par l’État ou alors (mais réservée à une élite restreinte) l’éthique au sens de L’Éthique – dont l’ironie est qu’elle signe la mort de l’idée de valeur puisque dans l’éthique spinoziste il n’y a que de l’être… mais strictement aucune valeur (Cf. Spinoza, Œuvres complètes, édition Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1954, p. 1439).«Ci-gît Spinoza; crachez sur sa tombe !» écrivait vulgairement un anonyme vers 1729, selon le précis Joseph Moreau. C’était tout de même bien excessif : l’homme était un honnête citoyen respectueux des lois, un ami fidèle, un citoyen courageux et sincèrement dévoué au bien public, un travailleur utile à la société (il polissait des verres de lunettes pour gagner sa vie !) qui méprisait les honneurs et l’argent, et avait refusé tous les postes universitaires qu’on lui avait proposé. Tous ces aspects secondaires, ajoutés à son mysticisme si original, empêchent encore aujourd’hui, bien évidemment, de souscrire à telle assertion. Mais intellectuellement, métaphysiquement, il faut hélas se rendre à l’évidence : Spinoza était bel et bien fou à lier. Et son système parfaitement insuffisant à rendre compte de la vérité et de la réalité. Ce qu’Hegel dira en termes plus diplomatiques : «La seule réfutation du spinozisme ne peut donc consister, en premier lieu qu’à reconnaître essentiellement et nécessairement son point de vue et, en deuxième lieu, faire en sorte que ce point de vue s’élève de lui-même à un niveau plus élevé» (Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Pierre Macherey, cité in op. cit., supra, p. 18). On dit souvent que Hegel n’a rien compris à Spinoza : personnellement nous pensons qu’il l’a beaucoup mieux compris qu’on ne veut bien le reconnaître.PS : Misrahi ne l’a pas établi mais le travail est fait depuis belle lurette : on confirme au lecteur qu’il trouvera la liste des meilleures études spinozistes parues en France depuis 150 ans aussi bien chez Alain ou Léon Brunschvicg que chez Émile Bréhier, Joseph Moreau ou Ferdinand Alquié. On consultera aussi avec profit la belle étude de Karl Jaspers, même si elle «tire» Spinoza un peu trop. Il faut dire que le système de Spinoza est un souvent, pour les historiens, l’équivalent d’une auberge espagnole : on y trouve ce qu’on y apporte. Et rien n’est faux dans ce qu’on y trouve. Pourtant Hegel a raison, il lui manque QUELQUE CHOSE…Note(*) Enfin pas tout à fait, comme je le découvre assez tardivement en feuilletant ce soir lundi 29 septembre 2008 le catalogue internet de la librairie parisienne Le Chemin des philosophes, rue des feuillantines à Paris, qui propose ceci : Éthique (Description : introduction, traduction, notes et commentaires de Robert Misrahi, 2e édition - P.U.F., Paris 1993, in-8°, br., 499 pages.
Sur Spinoza, L’Éthique (traduction française, introduction générale, notes et commentaires de Robert Misrahi, éditions de l’Éclat, collection Philosophie imaginaire dirigée par Patricia Farrazi et Michel Valensi, Paris / Tel-Aviv, 2005).«J’ai quelquefois donné à des étudiants, comme exercice de logique, à prendre une proposition dans le quatrième ou le cinquième livre de L’Éthique et à reconstituer, en suivant les références de Spinoza lui-même, la chaîne des démonstrations qui est censée la relier aux axiomes, définitions et postulats initiaux. Ceux qui ont tenté de le faire ont vite rencontré tant de ruptures, d’indéterminations, de «petits bonds» et même de grands qu’ils en ont été amusés ou rebutés.»André Lalande (et Société française de Philosophie), Préface (1902-1923) au Vocabulaire technique et critique de la philosophie (12eme éd. P.U.F., coll. Les grands dictionnaires des Presses universitaires de France, 1976, p. XVI).«Hegel a, il est vrai, déclaré que la méthode géométrique, telle que Spinoza l’a pratiquée, est celle qui convient le moins à l’absolu. [...] Plus sévères peut-être que Hegel [...] nous sommes enclins à dénoncer l’inadéquation radicale d’une telle méthode à l’objet que lui assignait Spinoza.»Victor Delbos, Le Spinozisme – cours professé à la Sorbonne en 1912-1913, Appendice § II Le cartésianisme et le spinozisme (éditions Vrin., coll. B.H.P., 1972, conforme à la première édition de 1916), p. 214.«Condillac a voulu démontrer que Spinoza n’a nulle idée des choses qu’il avance, que ses définitions sont vagues, ses axiomes peu exacts, et que ses propositions ne sont que l’ouvrage de son imagination, et ne renferment rien qui puisse conduire à la connaissance des choses.»Joseph Moreau, Spinoza et le spinozisme, § III intitulé Le spinozisme dans l’histoire (éditions P.U.F., coll. Que sais-je ? n° 1422, p. 108 – la citation provient de Condillac, Traité des systèmes, § X).«Je voudrais préciser mon propos en donnant un exemple, vous soumettre une brève lecture psychanalytique de Spinoza.J’ai choisi Spinoza pour maintes raisons dont la plus personnelle est qu’il me fascine à la façon d’un personnage de conte d’Hoffmann, fabricateur d’automates et marchand de lunettes (qui sont peut-être des yeux), lunettes qu’il fait passer de Dieu à moi et de moi à Dieu pour nous réunir enfin derrière la même paire. En somme une réplique dédramatisée de l’Homme au sable, sans effusion de sang, en deçà du complexe de castration, mais néanmoins, pour moi étrangement inquiétant.»Dr. Francis Pasche, L’Angoisse niée, Revue Française de Psychanalyse 1/1979 réédité dans Francis Pasche, Le Passé recomposé – Pensées, mythes, praxis § III (éditions P.U.F., coll. Le Fil rouge, préface de Didier Anzieu, 1999), p. 87.Voici une nouvelle* traduction française de L’Éthique de Spinoza. Une première remarque s’impose : il s’agit d’une traduction mais pas d’une édition du texte latin original accompagné d’une traduction. Pour connaître le texte latin original, le lecteur français doit donc toujours tenter de se procurer la seconde édition revue et corrigée en deux tomes du texte latin avec traduction française de L’Éthique par Charles Appuhn, à la Librairie Garnier, dans la célèbre collection des Classiques Garnier (1934).Le livre est plastiquement beau et très bien imprimé. Il s’ouvre par 55 pages d’Introduction générale mais la biographie de Spinoza est très brève et aucune bibliographie spinoziste n’est fournie. Cette introduction est divisée en deux parties distinctes : une justification historique et logique des innovations de Misrahi en matière de traduction d’une part, un résumé et une interprétation du spinozisme de l’autre. Il se poursuit par 265 pages contenant la Traduction proprement dite. Elle est parfois améliorée par rapport à la traduction Appuhn ou à celle de la Bibliothèque de la Pléiade, parfois identique, parfois discutable : dans une telle entreprise, il ne peut pas en aller autrement. Misrahi le sait puisqu’il faisait partie de l’équipe de La Pléiade en 1954 qui traduisit les Œuvres complètes (enfin presque complètes) de Spinoza en un épais volume – volume soit dit en passant aussi indispensable à l’étudiant français que les deux volumes d’Appuhn déjà cités, même s’il n’offre que des traductions. La note 1 de la Partie III (pp. 401-404) nous semble ainsi très convaincante et précise : elle rectifie d’ailleurs un terme qui semblait à notre professeur J. Castaing (cf. son cours d’agrégation sur Spinoza à l’université Paris-I Sorbonne du 20 novembre 1997) le seul défaut de la traduction d’Appuhn : c’est dire ! Comme souvent, le choix entre chiffres arabes et chiffres romains (numérotant les Définitions, les Axiomes, les Propositions) est un peu aléatoire et ne respecte jamais absolument l’original. Suivent 150 pages de Notes historiques et critiques souvent très précises et soigneuses mais parfois aussi très agaçantes, et pour cause… Misrahi pense que le système de Spinoza est le meilleur du monde et cela fait cinquante ans qu’il le dit ! Enfin on trouve un Index des notions de 30 pages environ mais certaines notions sont absentes (par exemple «indivisibilité», «négation», «pression») et on ne trouve pas d’Index nomini. Ce dernier point est très regrettable car l’appareil de notes cite de très nombreux noms propres : comment les retrouver aisément ? Nous suggérons momentanément une solution. Il suffit de constituer soi-même cet Index nomini en le reportant manuellement à la page 474 qui est blanche et située juste après cet appareil critique ou bien en l’imprimant et en glissant l’imprimé juste entre les pages 474 et 475.Misrahi a écrit bien des choses depuis sa collaboration aux Œuvres complètes de Spinoza à La Pléiade en 1954. Pages 505 et 506, on en trouve la liste et la lire est une source, parfois, d’amusement. Rien d’étonnant : Misrahi ne cesse d’utiliser les termes «joie» et «bonheur» dans les titres de ses ouvrage ! Enfin cela concerne une partie d’entre eux. À vrai dire, notre homme navigue depuis cinquante ans entre La Condition réflexive de l’homme juif, La Philosophie politique et l’État d’Israël, Existence et démocratie, Un Juif laïque en France et des idées plus gaies comme celles de L’Enthousiasme et la joie au temps de l’exaspération (sic), Un combat philosophique pour la joie, 100 mots pour construire son bonheur. Et bien sûr, l’esquif sur lequel il navigue entre ces notions bien hasardeuses c’est, vous l’avez compris, le système de Spinoza ! On ne sait pas ce que Spinoza aurait pensé du marxisme, de Martin Buber, du sionisme, du choix des sionistes de créer un État juif en plein milieu de terres palestiniennes (provoquant ainsi des guerres à répétition et des actions terroristes continuelles depuis plus de cinquante ans qui menacent régulièrement l’ordre et la sécurité du monde, pour paraphraser le beau titre d’un film de Claude d’Anna), ni de la condition des Juifs laïques en France en 2004. On sait aussi assurément (derniers paragraphes conservés du Tractatus politicus) qu’il n’aurait pas apprécié la candidature de Ségolène Royal ! Par contre, en lisant les notes de Misrahi on sait ce qu’il pense de Spinoza. Selon Misrahi, Spinoza «dépasse» l’antiquité, la philosophie médiévale, le cartésianisme et même tout ce qui vient après lui : ce verbe, «dépasser» est utilisé assez souvent. Il est particulièrement agaçant dans le contexte. À noter tout de même aussi que sa bibliographie comporte, en 1998, un Spinoza et le spinozisme (édition Armand Colin : est-ce Misrahi ou Armand Colin qui a eu l’idée de ce titre déjà utilisé par le regretté Joseph Moreau pour son propre livre – comme toujours remarquable – de 1971 ?) Bref, passons… Si les éditeurs de philosophie font des «remake» et rachètent les droits des titres (ou les volent) comme à Hollywood, les bibliographies vont contenir autant de titres homonymes que les filmographies tant l’imagination des uns et des autres semblent limitée ! Cette pratique est récurrente et on pourrait en citer tant d’exemples….Et puis finalement, on se demande en fin de compte à quoi il sert à Misrahi d’avoir lu Wolfson, Guéroult (qu’il critique constamment avec un acharnement qui nous semble tout de même suspect) et les autres si c’est pour arriver à ce résultat : considérer que Spinoza exprime «l’humanisme le plus exigeant et le plus qualitatif» (p. 466), et qu’il n’est surtout pas passible d’une interprétation déïste ou théologique. On croirait lire du Michel Onfray : Spinoza humaniste mais surtout pas mystique ! Et pourtant il y a un Dieu de Spinoza, et Spinoza croyait sincèrement en ce Dieu, au point de lui sacrifier sa vie privée comme publique. Il était absolument mystique et a vécu pratiquement comme un mystique. Mais son Dieu était un Dieu très particulier – sive natura. Une «natura» assez curieuse, elle aussi. Pas la nature de Lucrèce ou d’Épicure non plus ! Ce Dieu «ne crée pas, il ne pond pas, il n’émane même pas à la façon plotinienne, il reste gravide pour l’éternité. Il «exprime» comme dit G. Deleuze. Ce Dieu est une déesse, grosse d’un réel dont elle n’accouche jamais» (Francis Pasche, op. cit., supra). Joseph Moreau faisait probablement fausse route en pensant trouver chez Plotin le paradigme, la clef du spinozisme : le fait est assez rare pour être signalé puisque, d’une manière générale, Moreau fait bien partie de cette rare catégorie d’historiens français de la philosophie qui étaient capables d’écrire sur tous les sujets sans jamais commettre une erreur de fait ou de jugement, ainsi que nous l’avait fait une fois remarquer à juste titre le professeur Rémy Brague. Joseph Moreau : encore un de la génération d’avant-guerre ! On savait former les gens, à cette époque !Revenons à Misrahi qui, en dépit de sa précision et du soin méticuleux qu’il a apporté à la rédaction de ses notes, n’est pas tout à fait de la même trempe. Il cite parfois un peu approximativement : sa note 80 au livre I (p. 357) mentionne Aristote, De Anima III, 9, 432b comme source du finalisme critiqué par la théorie de la causalité efficiente chez Spinoza. En réalité, ce n’est que l’amorce de la discussion. Il faut aller à III, 10, 433 a pour y trouver posé le problème de la faculté motrice, source de toute discussion sur la finalité. Le reste est parfaitement correct mais la fin de cette même note 80 signale que «Maïmonide, comme Thomas d’Aquin, pense que Dieu agit par finalité, et qu’il a institué une finalité naturelle dans les choses». La dernière phrase de la quatrième page de couverture assimilant L’Éthique au Guide des égarés de Maïmonide est donc un peu abusive même si on devine qu’elle se cantonne au niveau moral davantage que métaphysique.C’est surtout du point de vue métaphysique que Misrahi nous pose des problèmes. «Pour posséder la vie éternelle, il nous faut croire, disait saint Paul, que Jésus est le fils de Dieu; il nous faut savoir, dit Spinoza, que nous sommes Dieu» écrivait en 1934 Charles Appuhn à la fin de l’ultime note du second volume de la seconde édition de sa propre traduction. Et cette belle et claire comparaison résume tout de même assez bien le problème. «Ainsi, après avoir, dans la Partie I, fait la critique du dualisme ontologique et du Dieu personnel, Spinoza, dès le début de cette partie II, fait la critique rigoureuse du dualisme psychologique (et de son substantialisme animiste) et de l’immortalité qu’il fonde. Contestant la Bible, le platonisme, l’aristotélisme, tout le Moyen Âge et Descartes, le spinozisme est aussi l’annonce d’une anthropologie philosophique et unitaire» écrit pour sa part bravement Misrahi à la fin de sa note 39 de la Partie II. Cela fait tout de même pas mal de belles et bonnes choses contestées tout de même, non ? Et c’est cela qui permet de traduire «individu» par «chose» comme le fait plus honnêtement Pierre Macherey, Hegel ou Spinoza (édition Maspéro, 1979, lorsqu’il cite le texte latin d’une phrase de la Partie II, Scholie de la Proposition 13, p. 182 !) On signale aussi la page 215 de Macherey concernant ce problème de la détermination / délimitation de ce qu’est un individu/chose/mode fini chez Spinoza : les lectures en regard du commentaire de Macherey et de cette note-là de Misrahi (ainsi que de ses notes 10 et 11 de la Partie II) sont instructives.Spinoza ne croit absolument pas aux religions monothéistes constituées à son époque car il refuse l’idée de création, celle d’un Dieu personnel, et dénie à l’homme toute liberté réelle. Il reconnaît cependant l’utilité des religions et des lois, bien que leurs objets soient fondamentalement des fictions réservés aux ignares et aux esclaves. En cela il influencera Nietzsche, de toute évidence. Il faut bien avouer que son système est probablement l’un des plus beaux esthétiquement mais aussi l’un des plus démentiels et des plus délirants qu’on ait jamais vu fleurir sur terre. Ce n’est pas dans le cadre de cette critique que nous allons le prouver : cela fait trois siècles que la cause est entendue. Qu’on soit idéaliste ou réaliste, dans les deux cas, le spinozisme est une folie aberrante qui n’est pas vraie et encore moins satisfaisante. Sade avait le sens de l’humour noir et faisait volontiers citer Spinoza par ses héros les plus intellectuels à l’appui de leurs démonstrations les plus ardentes. Déjà le Père Malebranche avait dit son «dégoût» profond pour le spinozisme; Bayle l’avait ridiculisé en une formule célèbre quelques années plus tard tandis que Leibniz, faisant comme d’habitude feu de tout bois, s’y était intéressé au point de le considérer comme une extension logique du cartésianisme : considération totalement fausse même si Les Origines cartésiennes du Dieu de Spinoza furent en effet étudiées avec bonheur et bien plus d’objectivité par l’excellent Pierre Lachièze-Rey. La note 62 de la partie II (p. 388) écrite par Misrahi confirme d’ailleurs bien en quoi Leibniz se trompait et nous lui en savons gré.Sa note 12 de la Partie V sur l’idée de sujet (p. 452) est elle-même… sujette à discussion : on lui confrontera utilement le commentaire – orienté dans un sens davantage logique et physique – de l’Axiome en question par Pierre Macherey (op. cit., supra, p. 246). La note 44 de la Partie V (p. 462) sur l’éternité de l’esprit (qui passe par celle de l’éternité de l’essence du corps puisque l’esprit est l’idée du corps) est assez croustillante : on la comparera utilement avec la critique de cette même idée chez Raymond Ruyer, Néo-finalisme (édition P.U.F., coll. B.P.C., 1952, p. 174). La note 26 de la partie II consacrée à la «doctrine du parallélisme» (p. 373) est passible d’une intéressante comparaison avec Pierre Macherey (op. cit., supra, paragraphe intitulé Le Problème des attributs, p. 131). «La finitude, au sens où l’emploie la philosophie existentielle chrétienne, n’a pas son équivalent chez Spinoza» écrit Misrahi à la note 10 de la Partie II (p. 368) : c’est le moins qu’on puisse dire !Enfin, il convient tout de même de comparer la note 37 de la Partie I (p.341) sur le problème crucial de la divisibilité et de l’infini au très célèbre article de Martial Guéroult, «La Lettre de Spinoza sur l’infini – Lettre XII à Louis Meyer», in Revue de Métaphysique et de Morale 71ème année n°4, octobre-décembre 1966, pp.385-411. Guéroult avait donné à la R.M.M. la primeur de ce qui allait constituer l’Appendice IX de son Spinoza - tome I Dieu alors sous presse aux éditions Aubier-Montaigne.Soit dit en passant, on signale que le second paragraphe de la note 25 de la Partie I (p. 333) mentionne «Hildesheim G. Olms, 1968» comme éditeur du livre de Guéroult. Il ne faut pas se moquer du monde ! Georg Olms est un charmant monsieur (ou une enseigne éditoriale représentant de charmants messieurs !) qui rééditent des fac-similés très soignés d’éditions originales épuisées ou introuvables. Il a ainsi réédité en 1984 l’admirable La Théorie platonicienne des Idées et des Nombres d’après Aristote – Étude historique et critique (1908) de Léon Robin et peut-être aussi (nous avons un doute ?) le non moins rare Le Problème moral dans la philosophie de Spinoza et l’histoire du spinozisme du grand Victor Delbos. Mais on ne savait pas qu’un livre de Guéroult édité pour la première fois en 1968 (ce n’est tout de même pas si loin !) était déjà épuisé : on doit d’ailleurs en trouver de temps en temps des exemplaires en état neuf ou d’occasion chez Vrin, Le Chemin des philosophes, Joseph Gibert ou Gibert Joseph (il paraît que ce sont deux entités différentes !), la Fnac ou Virgin uniquement à Paris. J’inclus ces deux dernières librairies car elles ont parfois de belles occasions en état neuf, dos non cassé – ce qui comme chacun sait, est le minimum requis pour constituer un bel exemplaire. Bref, l’édition originale du Spinoza de Guéroult en deux volumes, c’est Aubier-Montaigne et pas Georg Olms.Quant à l’ensemble des notes politiques, il convient de les comparer en permanence, afin de se remettre un peu les idées en place, à deux études : celle citée supra du Dr. Francis Pasche – une de ses plus admirables études psychanalytiques d’histoire de la philosophie – qui résume d’une manière percutante l’essentiel et celle de Ferdinand Alquié, Servitude et liberté selon Spinoza (édition du Centre de Documentation Universitaire). Le point de passage de Spinoza à Hegel étant que, dans le Tractatus politicus de Spinoza, la moralité est postérieure à l’État, ce qui signifie concrètement qu’il n’y a rigoureusement aucune autre moralité que l’obéissance aux lois édictés par l’État ou alors (mais réservée à une élite restreinte) l’éthique au sens de L’Éthique – dont l’ironie est qu’elle signe la mort de l’idée de valeur puisque dans l’éthique spinoziste il n’y a que de l’être… mais strictement aucune valeur (Cf. Spinoza, Œuvres complètes, édition Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1954, p. 1439).«Ci-gît Spinoza; crachez sur sa tombe !» écrivait vulgairement un anonyme vers 1729, selon le précis Joseph Moreau. C’était tout de même bien excessif : l’homme était un honnête citoyen respectueux des lois, un ami fidèle, un citoyen courageux et sincèrement dévoué au bien public, un travailleur utile à la société (il polissait des verres de lunettes pour gagner sa vie !) qui méprisait les honneurs et l’argent, et avait refusé tous les postes universitaires qu’on lui avait proposé. Tous ces aspects secondaires, ajoutés à son mysticisme si original, empêchent encore aujourd’hui, bien évidemment, de souscrire à telle assertion. Mais intellectuellement, métaphysiquement, il faut hélas se rendre à l’évidence : Spinoza était bel et bien fou à lier. Et son système parfaitement insuffisant à rendre compte de la vérité et de la réalité. Ce qu’Hegel dira en termes plus diplomatiques : «La seule réfutation du spinozisme ne peut donc consister, en premier lieu qu’à reconnaître essentiellement et nécessairement son point de vue et, en deuxième lieu, faire en sorte que ce point de vue s’élève de lui-même à un niveau plus élevé» (Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. Pierre Macherey, cité in op. cit., supra, p. 18). On dit souvent que Hegel n’a rien compris à Spinoza : personnellement nous pensons qu’il l’a beaucoup mieux compris qu’on ne veut bien le reconnaître.PS : Misrahi ne l’a pas établi mais le travail est fait depuis belle lurette : on confirme au lecteur qu’il trouvera la liste des meilleures études spinozistes parues en France depuis 150 ans aussi bien chez Alain ou Léon Brunschvicg que chez Émile Bréhier, Joseph Moreau ou Ferdinand Alquié. On consultera aussi avec profit la belle étude de Karl Jaspers, même si elle «tire» Spinoza un peu trop. Il faut dire que le système de Spinoza est un souvent, pour les historiens, l’équivalent d’une auberge espagnole : on y trouve ce qu’on y apporte. Et rien n’est faux dans ce qu’on y trouve. Pourtant Hegel a raison, il lui manque QUELQUE CHOSE…Note(*) Enfin pas tout à fait, comme je le découvre assez tardivement en feuilletant ce soir lundi 29 septembre 2008 le catalogue internet de la librairie parisienne Le Chemin des philosophes, rue des feuillantines à Paris, qui propose ceci : Éthique (Description : introduction, traduction, notes et commentaires de Robert Misrahi, 2e édition - P.U.F., Paris 1993, in-8°, br., 499 pages.
14/07/2006 | Lien permanent

























































