Rechercher : francis moury george romero
Martin Heidegger par lui-même, par Francis Moury

 Martin Heidegger dans la Zone.
Martin Heidegger dans la Zone.Notes de lecture sur :
- Martin Heidegger, Réflexions II -VI / Cahiers noirs (1931-1938, 535 pages), présentées et traduites par François Fédier, postface de Peter Trawny.
- Martin Heidegger, Réflexions VII -XI / Cahiers noirs (1938-1939, 458 pages), présentées et traduites par Pascal David, postface de Peter Trawny.
- Martin Heidegger, Réflexions XII - XV / Cahiers noirs (1939-1941, 310 pages), présentées et traduites par Guillaume Badoual, postface de Peter Trawny, éditions Gallimard, coll. NRF-Bibliothèque de philosophie, collection Œuvres de Martin Heidegger, Paris, 2018-2021).
«Verrais-tu avec plus d'orgueil arriver dans tes murs ces guerriers rassemblés de contrées diverses, tous redoutables à la lance ? [...] Mais que dis-je ? Les antiques vertus sommeilleraient dans la nuit des temps et les hommes en perdraient la trace si la rapide éloquence de nos vers, fruits de la sagesse, ne fixaient sur elles les regards de la renommée.»
Pindare (518-438 avant J.-C.), Isthmiques, VII, Au thébain Strepsiade, vainqueur au pancrace (fragment, traduction R. Tourlet, éditions Madame veuve Agasse, 1818, page 109). Ancienne traduction française d'un fragment cité en grec par Heidegger au début des Réflexions XIII (mais traduit en 2021 de la manière suivante «Mais, antique, bel et bien sommeille la lueur toute offrande de la stricte grâce» qui ne laisse pas d'être certes sans doute heideggerienne mais n'en reste pas moins curieuse. Je préfère l'ancienne traduction française, nettement plus compréhensible).
«L'histoire est en second lieu le bien de l'homme qui veut conserver et vénérer le passé, de celui qui jette un regard fidèle et aimant vers ses origines, vers le monde où il a grandi; par cette piété il s'acquitte en quelque sorte de sa dette de reconnaissance envers le passé. [...] Et parfois, au-delà des espaces ténébreux et confus des siècles, il salue l'âme de son peuple en qui il reconnaît sa propre âme.»
Friedrich Nietzsche, Considérations inactuelles (1873-1876), II, §3, traduction Geneviève Bianquis (éditions Aubier, 1964, page 239).
«Le secret de ce qui est allemand — que ne soit pas porté atteinte au souvenir de ceux qui sont tombés à la guerre; chacun doit savoir, y compris celui qui en discourt après coup, que le porteur de glaive était plus essentiel que pourrait jamais l'être celui qui porte la plume. [...] Devenir ceux qui, à l'avenir, sauront être chez eux [...] est la destination gardée en réserve, des Allemands qui le sont en secret. Ils se tiennent en dehors de tous les espaces politico-historiques et religieux jusqu'ici en vigueur [...]. Je «n'ai» aucune philosophie, je tente au contraire toujours et seulement de penser quelque chose d'essentiel [...]. La guerre est-elle un ébranlement de l'essence même de l'humanité occidentale ? Cette deuxième guerre mondiale l'est tout aussi peu que la première dont elle est indissociable. Mais la deuxième guerre mondiale va amener un nouvel ordre de la «Terre», c'est-à-dire de l'espace humain organisé techniquement. […] L'ordre nouveau est la victoire décisive de la «puissance» en tant que pleine essence de l'être, et, comme tel, il est le début du déploiement de cette pleine essence dans la forme de son extrême achèvement.»
(Martin Heidegger, Réflexions XII & XIV / Cahier noirs 1939-1941 (op. cit. supra, pp. 47-9 & 214-5).
 Voici achevée la traduction française des tomes 94, 95 et 96 de l'édition allemande intégrale, comprenant la totalité des Réflexions (qu'on eût pu traduire aussi par «considérations» ou par «idées» : j'aurais pour ma part favorisé sans hésiter le terme «considérations» à cause de son évidente teneur nietzschéenne pour le lecteur français de Nietzsche) inscrites sur les 14 premiers Cahiers noirs de Heidegger, rédigés d'octobre 1931 à la fin de l'année 1941 : la collection débute au Cahier noir II car le premier est, nous assure-t-on, perdu.
Voici achevée la traduction française des tomes 94, 95 et 96 de l'édition allemande intégrale, comprenant la totalité des Réflexions (qu'on eût pu traduire aussi par «considérations» ou par «idées» : j'aurais pour ma part favorisé sans hésiter le terme «considérations» à cause de son évidente teneur nietzschéenne pour le lecteur français de Nietzsche) inscrites sur les 14 premiers Cahiers noirs de Heidegger, rédigés d'octobre 1931 à la fin de l'année 1941 : la collection débute au Cahier noir II car le premier est, nous assure-t-on, perdu. On sait que les tomes 94 à 102 de l'édition allemande intégrale comprendront l'intégralité des 34 Cahiers noirs conservés : leur rédaction couvre au total quarante années de vie intellectuelle, du début des années 1930 aux années 1970. Heidegger avait interdit qu'on éditât ces cahiers avant la publication de ses œuvres complètes, distinguant soigneusement les deux ensembles. Ses héritiers ont décidé de passer outre cette interdiction, un peu comme, sous la haute autorité d'Henri Gouhier, ceux de Bergson passèrent outre la sienne d'éditer ses cours de lycée et certains autres articles, pour les mêmes raisons fondamentales (1) : Bergson comme Heidegger appartiennent en effet, dorénavant, à l'histoire de la philosophie française et à l'histoire de la philosophie allemande, davantage qu'à eux-mêmes. Leur volonté posthume individuelle doit donc céder le pas à l'intérêt de la culture et à la complétude du génie national. Dans le cas des Cahiers noirs de Heidegger, notons cependant que la transgression est tout de même augmentée d'un cran puisqu'il s'agit d'un journal confidentiel, nullement de cours prononcés ni d'articles rédigés en vue de publication ou publiés ni de mémoires universitaires potentiellement destinés à lecture par des tiers sinon à publication, comme dans le cas des Mélanges et des Cours de Bergson. La sévérité intellectuelle de Heidegger à l'égard des écrivains et penseurs contemporains, sa sévérité à l'égard de la nature artificielle et populiste du régime national-socialiste (qu'il estime avoir trahi sa visée révolutionnaire originelle) expliquent très probablement pourquoi Heidegger voulait laisser reposer ses notes en paix tant qu'il était vivant et que ses œuvres à vocation publique n'étaient pas encore intégralement publiées : il fallait laisser du temps au temps pour décanter l'effet que la lecture de certaines notes pouvaient produire. Ernst Jünger par exemple, n'est pas épargné en 1939-1941 par une critique sévère mais privée qui n'était pas destinée à devenir publique du vivant de Heidegger. Par égard pour Jünger, certainement, car lorsque Heidegger jugeait l'adversaire comme intellectuellement méprisable — ce fut par exemple la cas concernant Oswald Spengler (2) —, il ne se faisait pas faute de le critiquer publiquement lors de ses cours universitaires.
Un mot sur le titre Réflexions, suivi du sous-titre Cahiers noirs, dans l'édition allemande comme dans la traduction française. Réflexions est, en réalité, un simple sous-titre éponyme abusivement élevé au rang de titre. En effet, les Cahiers noirs rassemblent des «Réflexions» (14 cahiers), des «Notes» (9 cahiers), «Quatre cahiers» (2 cahiers), des «Vigiliae» (2 cahiers), un «Notturno» (1 cahier), des «Signes» (2 cahiers), un «Provisoirement» (4 cahiers), des «Paroles fondamentales» (1 cahier), enfin un hellénisant «Megiston» (1 cahier). L'éditeur allemand aurait dû simplement conserver comme unique titre Cahiers noirs qui recouvre habituellement l'ensemble au lieu de titrer le tout du nom d'une de ses parties. La note de Heidegger «datant probablement des années 1970» (sic, II-VI, page 532) et qu'il a recopiée au début du Cahier noir II, confirme ma remarque puisque Heidegger y désigne à nouveau cet ensemble par son véritable titre, Cahiers noirs. Le véritable titre est donc le sous-titre adopté en petites lettres sur la couverture, pas ce titre redondant, transparent, neutre et totalement inutile (voire source d'inexactitudes puisque ce titre est déjà celui d'une partie du tout) dont la traduction française aurait pu faire l'économie. Heureusement, les éditions Gallimard compensent cela en imprimant un bandeau rouge mentionnant le véritable titre original en gros caractères, au moins dans le cas du troisième volume récemment paru en cette année 2021 et consacré aux Cahiers noirs 1939-1941 (Réflexions XII-XV).
Faut-il affirmer avec l'éditeur allemand que leur forme est unique dans l'histoire de la philosophie du vingtième siècle, ainsi qu'il l'écrit dans sa Postface à II-VI, page 532 ? On pourrait pourtant aisément la comparer, mutatis mutandis, à celle du Journal métaphysique (1913-1923) de Gabriel Marcel (3) ou bien encore à celle des Fiches (1929-1948) de Ludwig Wittgenstein (4). Faut-il affirmer, en outre, que ces cahiers à la couverture noire (d'où leur nom, purement matériel et qui n'a pas d'autre signification) ne nous apprennent rien sur le Heidegger intime et sa vie privée ? Si on s'en tient à la période 1931-1941 ici présentée, ces Cahiers noirs II-XV comportent pourtant de nombreuses remarques, parfois incidentes ou davantage développées mais toujours concrètes, brossant un tableau bref mais assez vivant de l'Allemagne contemporaine sur les plans intellectuel, moral et politique et sur ce que le penseur Heidegger... en pense dans le secret et l'intimité de ces notes relatant un événement parfois daté. Certaines notes précisent sa position philosophique concernant l'actualité ou à partir de cette actualité : ce sont des considérations inactuelles au sens nietzschéen, donc tout aussi bien inaltérablement actuelles ! C'est, évidemment, encore plus vrai de la période du rectorat d'avril 1933 à avril 1934, chargée de soucis administratifs et pédagogiques. Des traits régulièrement savoureux sont ainsi disséminés au fil de ces presque 1300 pages (compte non tenu des préfaces des traducteurs français, des postfaces de l'éditeur allemand).
 Concernant la position politique de Heidegger, ces Cahiers noirs permettent de distinguer avec assez d'évidence une période pré-rectorat donc pré-1933 quantitativement représentée par la section II qui débute en octobre 1931 puis par une partie de la section III qui débute à l'automne 1932 (mais une partie seulement dans la mesure où la section IV semble assurément datée 1934-1935) de la période postérieure. L'éditeur allemand assure (II-VI, page 534) que la rupture fondamentale entre Heidegger et la pensée politique nationale-socialiste interviendrait «pendant l'été 1936 au plus tard» tandis que François Fédier soutient, pour sa part, dès son introduction (page 12) que ces Cahiers noirs manifestent une critique «non-dissimulée» et «page après page» du régime et de ses théories : en réalité, in medio stat virtus : certains points de rupture y sont tout du long inextricablement mêlés à certains points de convergence. Heidegger méprise ainsi régulièrement les thèses racistes biologiques nazies (III, n°195 + VII, n°35 + XI n°47, n°56 + XII, n°26) mais il considère (III, page 125, n°10) que «le Fuhrer a éveillé une nouvelle réalité, laquelle donne à notre pensée la droite voie et le pouvoir d'impact». Il se définit fréquemment, notamment durant les réflexions couchées sur papier durant son rectorat, dans la situation d'un révolutionnaire déçu par l'embourgeoisement qu'il constate autour de lui, à commencer par celui de ses étudiants (III, page 130, n°33 + III, n°83 et n°84, page 160) :
Concernant la position politique de Heidegger, ces Cahiers noirs permettent de distinguer avec assez d'évidence une période pré-rectorat donc pré-1933 quantitativement représentée par la section II qui débute en octobre 1931 puis par une partie de la section III qui débute à l'automne 1932 (mais une partie seulement dans la mesure où la section IV semble assurément datée 1934-1935) de la période postérieure. L'éditeur allemand assure (II-VI, page 534) que la rupture fondamentale entre Heidegger et la pensée politique nationale-socialiste interviendrait «pendant l'été 1936 au plus tard» tandis que François Fédier soutient, pour sa part, dès son introduction (page 12) que ces Cahiers noirs manifestent une critique «non-dissimulée» et «page après page» du régime et de ses théories : en réalité, in medio stat virtus : certains points de rupture y sont tout du long inextricablement mêlés à certains points de convergence. Heidegger méprise ainsi régulièrement les thèses racistes biologiques nazies (III, n°195 + VII, n°35 + XI n°47, n°56 + XII, n°26) mais il considère (III, page 125, n°10) que «le Fuhrer a éveillé une nouvelle réalité, laquelle donne à notre pensée la droite voie et le pouvoir d'impact». Il se définit fréquemment, notamment durant les réflexions couchées sur papier durant son rectorat, dans la situation d'un révolutionnaire déçu par l'embourgeoisement qu'il constate autour de lui, à commencer par celui de ses étudiants (III, page 130, n°33 + III, n°83 et n°84, page 160) :«C'est hélas en tant qu'il est étudiant que l'étudiant actuel n'est pas national-socialiste, mais un philistin consommé [...] Ces simagrées «socialistes» ne sont que le masque sous lequel se cache une dérobade devant la véritable tâche qui nous incombe, et l'aveu que nous sommes incapables de l'affronter. [...] c'est le moment de sonner la fin de la pseudo-révolution à l'Université. [...] Que reste-t-il ? Former une ligne de front – fixer l'objectif de la lutte, repérer les positions de l'ennemi (ne pas se contenter d'y compter uniquement la «réaction»; l'ennemi se trouve même parmi les tenants de ce qui se passe aujourd'hui); il faut développer les forces; maintenir de fond en comble ce qui a déjà été acquis historialement».
Sans oublier celui de ses collègues (III, n°114, page 175). Victor Farias avait déjà noté (5) le fait que Heidegger souhaitait une orientation politique davantage révolutionnaire et que sa démission du rectorat s'expliquait en partie par son insatisfaction sur le plan politique. On en aura confirmation dans ces remarquables notes heideggeriennes, justifiant sa démission du rectorat, prises à l'occasion de la rédaction de son Discours d'adieu du 28 avril 1934 in III, n°112-n°115, pages 173-175. Sa ligne nationaliste demeura constante de 1910 à 1945, jamais reniée par la suite mais au contraire profondément maintenue y compris dans son entretien posthume où il affirmait que les Français, lorsqu'ils veulent penser, doivent parler allemand (et grec et latin, car Heidegger a une formation philologique classique d'un niveau presque équivalent à celle de Nietzsche). Lire par exemple les réflexions n°237 et n° 238 (II, page 116) qui constituent une amère critique d'un nationalisme qui croit revivifier le peuple alors qu'il ne fait que donner des gages à des esprits obtus et frivoles (n°236, ibid.). La réflexion n°16 (XI, page 375) considère même, à propos de Ernst Jünger (ici défini comme «le premier et le seul à considérer les choses pensivement», traduction d'ailleurs peut-être améliorable : «le seul à penser correctement la réalité des choses» me conviendrait tout de même mieux, quitte à malmener la syntaxe allemande), que l'esprit du front (comprendre : celui des combattants de la Première Guerre mondiale) n'est pas encore éprouvé «pour de bon», qu'il n'a pas été «retenu» et que les Allemands de 1939 sont encore inaptes, en raison de l'absence de profondeur de leur être, à se confronter au «mystère» de cette expérience.
À partir de 1939, Heidegger critique Ernst Jünger (concernant aussi bien La Guerre comme expérience intérieure que La Mobilisation totale et que Sur les falaises de marbre) d'une manière notable car relativement sévère.
«Une époque qui se fait une nécessité de gravir les «Falaises de marbre» n'est pas encore libre pour le questionnement essentiel; et une jeunesse qui trouve que son «sentiment de la vie» est exprimé «sur les falaises de marbre» n'est pas encore mûre pour penser». Sur ces trois œuvres de Jünger, lire notamment Heidegger, op. cit. supra, XII, 12 + XIV, pages 201 et 213 : la citation précédente provient de XIV, page 213. Critique reprise et affirmée en 1941 en XV, pp. 295-6 : «L'unique «homme de lettres», et sous tous les aspects le premier d'entre eux aujourd'hui en Allemagne, est Ernst Jünger. Homo literatus. Là où règne aujourd'hui, en masse, l'absence de toute pensée, ce n'est même plus un tour de force, pour qui se munit d'une demi-pensée — en soi plus dévastatrice que «pas de pensée du tout» — , que de parvenir à un succès «littéraire» et de trouver des «lecteurs». Cet état de fait produit en retour son effet sur l'écrivain. Car, par voie de conséquence, sa production propre devient progressivement plus vide de pensée, et plus vaniteuse, en proportion. Les frères «Jünger» (sic pour les guillemets entourant le nom de famille de Ernst et Friedrich) sont un bon exemple de la soumission servile à la superficialité. Et cependant — (fragment interrompu à cet endroit)».
Critique qui eût probablement été adoucie à la suite du tiret final, demeuré sans suite ? Ce sont les prochains cahiers qui nous donneront éventuellement la réponse à cette question.
S'y ajoutent en 1940 et 1941 de très savoureuses analyses de la perversion de l'âme nationale russe par le bolchevisme communiste de Lénine. D'une manière générale, durant la période 1939-1941, Heidegger apparaît déçu par l'évolution du régime national-socialiste qu'il considère comme un des avatars de l'évolution calculatrice (celle des temps modernes, à partir du seizième siècle jusqu'au vingtième siècle inclus) ayant mené tout aussi bien au communisme qu'à la démocratie libérale. Il espérait une authentique révolution qu'il juge, à cette époque, presque trahie.
Sur le plan de l'histoire de la philosophie, l'ensemble est d'une attendue mais très grande richesse : on assiste à la naissance en temps réel du dialogue heideggérien avec les grands philosophes et les grands écrivains qui ne cessent d'alimenter sa méditation et, aussi bien, ses cours contemporains d'histoire de la philosophie. C'est ainsi le cas avec G.W.F. Hegel (VIII, n°50, page 179) et Friedrich Hölderlin, deux des sources majeures de la pensée de Heidegger. Très intéressantes aussi sont les précisions sur Descartes (VIII, n°48, page 177), pas seulement sur le plan métaphysique car il faut se souvenir qu'en 1927, Être et temps l'avait pris pour cible première et qu'en 1937, la France rendait officiellement hommage au tricentenaire du Discours de la méthode (1937). Heidegger se plaint qu'on n'ait pas compris le sens de son attaque et réitère son admiration pour Descartes. Il ajoute cette remarque, risquée dans le contexte effervescent de 1938-1939, si elle avait été publiée : «C'est pourquoi cette attaque (encore qu'elle n'ait pas manqué d'être exploitée de manière tout aussi virulente par des Juifs que par des nationaux-socialistes, sans pour autant avoir été comprise quant au cœur du propos) n'a rien de commun avec la mesquinerie bête et méchante qui trouve à redire à Descartes, telle qu'elle prolifère de nos jours à partir de points de vue «politiquement populistes», venant de professeurs encore en attente de leur titularisation pour enseigner «la philosophie», et qui en font trop» (cf. en outre VIII, n°53, page 181).
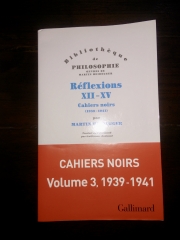 Les philosophes modernes (Nietzsche) et contemporains (Karl Jaspers, Oswald Spengler) sont constamment étudiés, soit nommément, soit par allusions qu'un terme ou une expression permet de reconnaître : «morphologie des cultures» in VI, n°29, page 436 désigne évidemment Oswald Spengler (6). Là encore, certaines remarques risquées sont jetées sur le papier, par exemple celle-ci in VI, n°41, page 448 : «Il faut peut-être que cette œuvre, après avoir été libérée du vacarme, passe par un temps d'oubli, pour ensuite connaître un renouveau. Que Wagner et [Houston Stewart] Chamberlain à présent l'emportent haut la main sur Nietzsche ne saurait surprendre, et doit être interprété comme l'amorce d'une sauvegarde dont son œuvre va bénéficier pour être mise à l'abri de la propagande officielle.»
Les philosophes modernes (Nietzsche) et contemporains (Karl Jaspers, Oswald Spengler) sont constamment étudiés, soit nommément, soit par allusions qu'un terme ou une expression permet de reconnaître : «morphologie des cultures» in VI, n°29, page 436 désigne évidemment Oswald Spengler (6). Là encore, certaines remarques risquées sont jetées sur le papier, par exemple celle-ci in VI, n°41, page 448 : «Il faut peut-être que cette œuvre, après avoir été libérée du vacarme, passe par un temps d'oubli, pour ensuite connaître un renouveau. Que Wagner et [Houston Stewart] Chamberlain à présent l'emportent haut la main sur Nietzsche ne saurait surprendre, et doit être interprété comme l'amorce d'une sauvegarde dont son œuvre va bénéficier pour être mise à l'abri de la propagande officielle.» Concernant les traductions de certains termes métaphysiques heideggériens (notamment celle de «Dasein») je renvoie
08/11/2021 | Lien permanent
Le positivisme spiritualiste d’Aristote, par Francis Moury

Les cinq métaphysiques d'Aristote, par Francis Moury.
 À propos de Félix Ravaisson, Essai sur la «Métaphysique» d’Aristote,
À propos de Félix Ravaisson, Essai sur la «Métaphysique» d’Aristote,un vol. in-8° de 755 pages, réédition en un seul gros volume de l’édition originale en deux volumes de 1845, couronnée par l’Institut (Académie des Sciences morales et politiques), avertissement de Maxence Caron, Éditions du Cerf, coll. La Nuit surveillée, 2007).
Préliminaire : fragments d’histoire de la philosophie
Félix Ravaisson fonde le positivisme spiritualiste à partir de son étude d’Aristote
«Auguste Comte, cependant, entra peu à peu dans une voie toute différente de celle où M. Littré et M. Stuart Mill s’étaient engagés sur ses traces; de son positivisme primitif, il passa par degrés à une métaphysique et à une religion. […] Prend-on pour cause un idéal tout à fait en dehors de la réalité, on n’a rien qui suffise à expliquer la nature. C’est cet idéalisme contre lequel s’est élevé, non sans raison, le positivisme. Ne veut-on, au contraire, rien reconnaître de réel que le phénomène seul, comment y trouver, ainsi que le positivisme lui-même l’a établi, aucune causalité, aucune explication d’un autre phénomène ? Considérer enfin le phénomène d’un ordre supérieur comme la raison du phénomène inférieur, précisément parce qu’il présente la perfection de ce dont celui-ci n’a que le commencement, c’est nécessairement, quoique peut-être sans s’en rendre compte, sous-entendre dans la perfection une action efficace, et la théorie d’Auguste Comte, sous sa dernière forme, explique la conception de la cause finale, si ce n’est telle que l’expose l’ordinaire idéalisme, qui représente la nature d’après le type de l’art humain, telle du moins qu’on la trouve dans ce qu’on peut appeler le réalisme ou positivisme métaphysique qu’Aristote fonda, en lui donnant pour base l’idée expérimentale et supra-sensible en même temps de l’action.»
Félix Ravaisson, De l’habitude (1838, édition de 1894), suivi de Rapport sur la philosophie en France au XIXe siècle (1867, édition de 1895) et de Le Scepticisme dans l’antiquité grecque (1884) (Éditions Fayard, coll. Corpus des œuvres de philosophie en langue française, 1984), pp. 118 et 133-134.
Jules Lachelier actualise l’interprétation d’Aristote par Ravaisson
«Ainsi, de l’aveu même d’Aristote, nous ne concluons pas des individus à l’espèce, mais nous voyons l’espèce dans chaque individu; la loi n’est pas pour nous le contenu logique du fait, mais le fait lui-même, saisi dans son essence et sous la forme de l’universalité. L’opinion d’Aristote sur le passage du fait à la loi, c’est-à-dire sur l’essence même de l’induction, est donc directement opposée à celle que l’on est tenté de lui attribuer. […] Ainsi l’empire des causes finales, en pénétrant, sans le détruire, dans celui des causes efficientes, substitue partout la force à l’inertie, la vie à la mort et la liberté à la fatalité. L’idéalisme matérialiste auquel nous nous étions arrêtés, ne représente que la moitié ou plutôt que la surface des choses : la véritable philosophie de la nature est, au contraire, un réalisme spiritualiste, aux yeux duquel tout être est une force et toute force une pensée qui tend à une conscience de plus en plus complète d’elle-même. Cette seconde philosophie est, comme la première, indépendante de toute religion : mais, en subordonnant le mécanisme à la finalité, elle nous prépare à subordonner la finalité elle-même à un principe supérieur et à franchir par un acte de foi morale les bornes de la pensée en même temps que celles de la nature.»
Jules Lachelier, Du Fondement de l’induction [1871] suivi de Psychologie et métaphysique [1885] et de Notes sur le pari de Pascal [1901] (6e Éditions Félix Alcan, coll. B.P.C., 1910, tirage de janvier 1914), pp. 7 et 101-102.
Émile Boutroux : comment Ravaisson avait unifié son objet et sa méthode
«Félix Ravaisson aborda son sujet avec une entière liberté d’esprit. Il ne demanda qu’à Aristote la signification et la tendance de la doctrine d’Aristote. Mais il le lut en entier, avec un soin, une érudition, une méthode, un effort et une puissance de réflexion qu’on n’eût pas attendus d’un si jeune homme. Il aboutit à des résultats très différents de ceux que prévoyait [Victor] Cousin. Sans doute, dit-il, à l’opposé des premiers philosophes, qui prétendaient expliquer toute chose par la matière, Platon est venu montrer que la matière ne se comprend que par l’Idée. Mais Platon n’a pas dépassé le seuil du spiritualisme. Aristote montre que son Idée, qui n’est en somme que le général, laisse inexplicable un élément essentiel à l’être réel, à savoir le mouvement vers une forme déterminée, la vie avec sa finalité, l’individualité. Et il cherche le principe premier dans l’intelligence, source de l’Idée, activité véritablement suprasensible et réelle. Loin donc qu’il ait rétrogradé vers le sensualisme et le matérialisme, Aristote a, bien plus complètement que son maître, surmonté ces doctrines : il est le véritable fondateur de la métaphysique spiritualiste.»
Émile Boutroux, Nouvelles études d’histoire de la philosophie, § La Philosophie de Félix Ravaisson [1900] (Éditions Librairie Félix Alcan, coll. B.P.C., 1927), pp.195-196.
Henri Bergson : aux sources du bergsonisme, un fil rouge positiviste spiritualiste reliant Aristote à Ravaisson
«Car l’opposition qu’il établit ici entre Platon et Aristote, c’est la distinction qu’il ne cessa de faire, pendant toute sa vie, entre la méthode philosophique qu’il tient pour définitive, et celle qui n’en est, selon lui, que la contrefaçon. L’idée qu’il met au fond de l’aristotélisme est celle même qui a inspiré la plupart de ses méditations. A travers son œuvre entière résonne cette affirmation qu’au lieu de diluer sa pensée dans le général, le philosophe doit la concentrer sur l’individuel. […] «La peinture, disait Léonard de Vinci, est «chose mentale». Et il ajoutait que c’est l’âme qui fait le corps à son image. […] Comment ne pas être frappé de la ressemblance entre cette esthétique de Léonard de Vinci et la métaphysique d’Aristote telle que M. Ravaisson l’interprète ? […] Toute la philosophie de M. Ravaisson dérive de cette idée que l’art est une métaphysique figurée, que la métaphysique est une réflexion sur l’art, et que c’est la même intuition, diversement utilisée, qui fait le philosophe profond et le grand artiste. […] La thèse sur L’Habitude, comme d’ailleurs L’Essai sur la Métaphysique d’Aristote, eut un retentissement de plus en plus profond dan le monde philosophique».
Henri Bergson, La Pensée et le mouvant – Essais et conférences, § IX, La Vie et l’œuvre de Ravaisson 1813-1900 [1904 puis 1932] (91e Éditions P.U.F. coll. B.P.C. 1938-1975), pp. 259-267.
L’Essai sur la Métaphysique d’Aristote comme moyen-terme entre le positivisme et le spiritualisme dans l’histoire de la philosophie française
Les extraits ci-dessus manifestent assez – des points de vue critique et technique de l’histoire de la philosophie – la manière remarquable par laquelle Félix Ravaisson (1813-1900) fut à l’origine de deux évènements distincts mais convergents : d’une part, la fondation de l’histoire française moderne de la philosophie, et d’autre part, celle du courant positiviste spiritualiste qui, comme son nom l’indique, allie le positivisme de Comte au spiritualisme, en réunissant désormais sous cette rubrique les principaux noms, dans l’ordre chronologique, de Ravaisson, Lachelier, Boutroux et Bergson.
L’occasion de ces deux fondations fut un concours organisé en 1832 par l’Institut, sur proposition de Victor Cousin, récompensant d’un Prix la meilleure étude générale du système d’Aristote. Il ne s’agissait pas seulement de savoir ce qu’il était, il s’agissait aussi de savoir ce qu’on en pouvait conserver et ce qu’on devait en critiquer au temps présent. On peut s’en étonner en songeant à l’immense influence qu’avait eue sur l’université parisienne le Stagirite mais il faut savoir que le système d’Aristote avait été, depuis le moyen-âge, progressivement méconnu, travesti, déformé. Au point que Victor Cousin et l’Institut avaient cru nécessaires de faire justice des accusations de sensualisme et de matérialisme qu’on portait à son encontre, à la lumière des récents progrès philologiques venus d’Allemagne. En effet, l’Académie de Berlin venait de publier en 1831 les trois premiers volumes de la célèbre édition Bekker contenant le texte grec original d’Aristote, certaines de ses traductions latines, et certains de ses principaux commentaires grecs. Ravaisson remporta le prix en 1835 et transforma deux ans plus tard en 1837 son manuscrit en mémoire imprimé. Ce premier volume contenait la description du système et une traduction de nombreux extraits, soutenues par les citations constantes du texte original grec en notes, par des discussions philologiques brèves mais étayées et pertinentes. De 1837 à 1846, il travailla au second volume, qui est une interprétation philosophique monumentale du système lui-même et une étude de sa place dans l’histoire générale de la philosophie antique jusqu’à Proclus : les conséquences morales, politiques, sociales du système sont historiquement pesées dans cette quatrième partie. Ce second volume paru en 1846 [selon Bergson, Léon Robin et Charles Devivaise] (1) ou en 1845 [selon Caron]. Ravaisson prévoyait d’en publier un troisième puis un quatrième qui ne virent pas le jour mais dont il nous reste un certain nombre d’éléments, notamment les admirables Fragments du tome III : Hellénisme, Judaïsme, Christianisme chez Vrin, en coll. B.T.P., dans l’édition établie en 1953 par Ch. Devivaise. Le projet final de Ravaisson, tel qu’il l’annonçait en 1846, était d’interpréter l’ensemble de l’histoire de la philosophie à la lumière du dynamisme spirituel, métaphysique, qu’il avait mis au jour dans l’aristotélisme. Devivaise cite la p. VI du second volume de l’édition originale de l’Essai : «Le troisième [volume] contiendra l’histoire de la Métaphysique, dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islamisme, en Orient et en Occident jusqu’à la fin du moyen âge. Le quatrième volume contiendra l’histoire de la Métaphysique dans les temps modernes et la Conclusion de tout l’ouvrage.»
Projet grandiose dont les Fragments restituent de fulgurantes intuitions, décomposées en formules tantôt synthétiques tantôt analytiques, toujours historiquement et philologiquement étayées mais aussi portées par une pénétrante intuition métaphysique, et dans lesquelles il faut voir l’origine des travaux d’histoire de la philosophie de Ravaisson lui-même (à commencer par son Rapport de 1867 sur la philosophie en France au XIXe siècle), de Jules Lachelier, d’Émile Boutroux (qui, outre son enseignement à la Sorbonne, ses conférences, ses admirables Études d’histoires de la philosophie de l’antiquité à 1920 environ, prolongea le rapport de son maître par son propre rapport sur La Philosophie en France depuis 1867 et rendit directement hommage à ses maîtres Ravaisson et Lachelier par deux admirables études reprises dans ses Nouvelles études d’histoire de la philosophie), de Bergson (la conférence prononcée à Bologne en 1911 sur L’Intuition philosophique comme source première de l’histoire de la philosophie, reproduite dans La Pensée et le mouvant). Plus près de nous, comment ne pas voir que les travaux d’histoire de la philosophie d’un Lucien Lévy-Bruhl (sur Comte par exemple; peut-être Lévy-Bruhl a-t-il écrit la meilleure étude jamais parue en France sur Comte et il serait grand temps de la rééditer), d’un Henri Gouhier (sur Comte bien sûr, inclus dans sa grandiose histoire philosophique du sentiment religieux en France), d’un A.-J. Festugière et d’un P.-M. Schuhl (antiquité grecque), d’un Étienne Gilson (Moyen Âge) et d’un Claude Tresmontant (philosophie de la religion), découlent directement de la méthode et de l’esprit de Ravaisson ?
Au début du XXe siècle, une partie de l’élite universitaire se détourna du positivisme spiritualiste. Léon Robin ne cite pas une seule fois Ravaisson dans sa thèse monumentale de 1908 sur La Théorie platonicienne des Idées et des nombres d’après Aristote (1908). Son maître Octave Hamelin le citait, en revanche, à quatre reprises avec sympathie dans son Système d’Aristote, série de cours donnés à l’E.N.S. et scrupuleusement édités (sauf quelques lacunes, notamment dans l’index alphabétique où il manque ces quatre références à Ravaisson) après sa mort par le même Léon Robin en 1920. Robin ne cite pas davantage Ravaisson, sauf son unique mention bibliographique déjà signalée en note, dans son assez complet Aristote de 1944. Si Robin était platonisant et voulait tirer Aristote vers le platonisme (2) son maître Hamelin ne pouvait pas être soupçonné d’une telle volonté. Son respect de la pensée d’Aristote est, en effet, admirable : qu’on compare les sections rédigées par Ravaisson puis par Hamelin sur l’histoire des écrits d’Aristote et la constitution du corpus aristotélicien, notamment la constitution du corpus nommé dorénavant Métaphysique, ou bien encore sur la théologie d’Aristote, et on verra aisément qu’Hamelin reprend la méthode de Ravaisson, avec une rigueur confortée par une documentation philologique naturellement supérieure mais avec la plus belle fidélité et des conclusions souvent proches, par exemple celle sur la logique comme forme de la science où Hamelin donne raison à Ravaisson contre Zeller.
Par un étrange détour, survenu à la fin des années 1930, Alain (alias Émile Chartier) renverse l’intuition ravaissonienne; il ne craint pas d’écrire, le 21 avril 1939,dans son Avertissement au lecteur qui ouvre son sévère et beau volume Idées – Introduction à la philosophie : Platon, Aristote, Descartes, Hegel, Comte (3), que «l’Aristote des temps modernes»… c’est Hegel ! On attendait d’un si fervent comtien qu’il écrivît «Comte». Alain, après s’être excusé de n’avoir pas traité autant d’Aristote qu’il l’aurait voulu, fait ensuite un parallèle historique entre Hegel éducateur de l’élite allemande au moment même où Comte est l’éducateur de l’élite française. Parallèle chronologiquement exact qu’il serait malvenu de vouloir discuter mais qui ne suffit pas vraiment à nous consoler ni à nous convaincre que Hegel soit considéré comme un moyen-terme entre Aristote et Comte. Hegel aurait, sans doute, estimé que cette phrase d’Alain était une savoureuse ruse de la raison ! Pourtant il faut se rendre à l’évidence : Hegel appartient à la lignée idéaliste fondée par Platon, Comte appartient à la lignée positiviste (et positiviste spiritualiste, bien entendu) fondée par Aristote. Le rationalisme à tendance idéaliste d’Alain – rationalisme ambitieux, exigeant, de valeur et constamment nourri d’une admiration fervente pour le fondateur du positivisme (4) – soutient cette tentative intéressante d’assimiler Aristote et Hegel, mais c’est une assimilation analogique. Or il faut se méfier de la connaissance par analogie.
Ravaisson revient en grâce en 1962 lorsque le plus grand exégète aristotélicien du XXe siècle, Pierre Aubenque, Le Problème de l’être chez Aristote (Éditions P.U.F., coll. B.P.C., 5e éd. 1962-1983), tient à qualifier d’emblée d’admirable la synthèse de Ravaisson, dans l’Avant-propos qui constitue, comme on le sait, un résumé critique par Aubenque des études aristotéliciennes des origines à 1960. La seule critique précise qu’Aubenque prodigue, dans la suite de son épais volume, à Ravaisson concerne (op. cit., p. 199) la question – il est vrai, importante - de l’analogie. Quant à la remarque un peu ironique d’Aubenque (p. 7) concernant la place excessive accordée à Plotin et Schelling dans l’Essai sur la Métaphysique d’Aristote, elle nous semble inexacte. Il suffit, pour faire justice du premier point concernant le néoplatonisme, de relire le fragment de Ravaisson édité par Devivaise (op. cit., p. 47) : «Malgré l’immense circuit qu’il embrasse, malgré tant de détours et de délais inutiles, le néoplatonisme est venu tomber épuisé au pied de la Métaphysique péripatéticienne. C’est la dernière phase de la philosophie de l’antiquité. Le cycle qu’il lui a été donné de parcourir est accompli, il se ferme au point même où l’aristotélisme l’avait brisé, en ouvrant à la pensée une nouvelle et plus vaste carrière.» Quant au second point concernant Schelling, le grand philosophe allemand de l’idéalisme objectif, Devivaise avait déjà précisément montré en 1953 (op. cit., pp. 12 et sq.) aux paragraphes II et III de son Introduction aux Fragments du tome III, en quoi la pensée de Ravaisson lui doit certaines inspirations, en quoi elle est originale. Les points communs ne concernent pas, de toute manière, l’analyse technique par Ravaisson de la Métaphysique d’Aristote mais plutôt la manière dont cette Métaphysique est ensuite comprise dans le cadre d’une histoire générale de la philosophie qui doit aussi être une histoire des religions, philosophie et religion étant étudiées comme faits objectifs et historiques, succession réelle d’êtres constitués par un mouvement qu’il s’agirait de définir en remontant à sa source, en découvrant sa dynamique.
L’Essai sur la Métaphysique d’Aristote de Ravaisson demeurait, par-delà ces citations, ces critiques ou ces silences, une référence mythique à nos yeux mais devenue curieusement inaccessible. Le temps passait et les deux volumes de l’édition originale (ou ceux de sa réédition de 1913) devenaient hors de prix, uniquement consultables en bibliothèque universitaire. Comment un tel monument pouvait-il demeurer oublié des éditeurs philosophiques français alors qu’il avait non seulement réorienté d’une manière déterminante les études aristotéliciennes en France mais encore donné naiss
08/09/2010 | Lien permanent
Dracula, 9 : Dracula et les femmes de Freddie Francis, par Francis Moury

 Dracula has risen from the grave [Dracula et les femmes] (Grande-Bretagne, 1968) de Freddie Francis est la suite directe de Dracula Prince of Darkness [Dracula prince des ténèbres] (Grande-Bretagne, 1965) de Terence Fisher qui est lui-même la suite directe de Horror of Dracula [Le cauchemar de Dracula] (Grande-Bretagne, 1958) de Terence Fisher. Le vampire finissait noyé dans une eau glacée en 1965 et c’est de cette même eau glacée qu’il est libéré en 1968 par le remarquable scénario de John Elder, de son vrai nom Anthony Hinds / Anthony Hammer. La filiation est cependant ténue, et l’intrigue de Dracula et les femmes n’a strictement plus rien à voir avec celle du roman original. (*)Dracula et les femmes prolonge et renouvelle d’une manière novatrice la géniale trilogie de Terence Fisher (1958, 1960, 1965) dans le sens d’une dialectique ultra-violente des apparences, en approfondissant l’idée d’une possession démoniaque de la réalité par le mal, assortie d’un érotisme encore plus agressif. On a dit que Francis était l’anti-Fisher par excellence : force est de convenir que c’est faux. On a reproché à Elder et Francis d’avoir trop humanisé le vampire en lui donnant un sentiment : celui de la vengeance. Mais une telle dualité «humain-inhumain» était bien au cœur de l’anthropologie vampirique fishérienne. Même si on peut reprocher à Francis son insistance banalisante, il maintient néanmoins l’équilibre entre animalité et humanité du vampire et maintient le personnage dans sa consistance cauchemardesque. La réflexion de Elder sur le pouvoir du mal s’inscrit aussi dans la lignée fishérienne la plus directe : un prêtre possédé prenant fonctionnellement la place du Renfield original du roman (et du film de 1965) c’est déjà une idée grandiose. Un évêque et un jeune athée qui devront finalement s’unir ensemble à ce prêtre déchiré, au péril commun de leurs vies pour sauver la nièce du premier : c’en est une autre ! Ce délirant scénario qui semble né d’une fumerie d’opium, eh bien, on y croit absolument et tout du long. L’évidence soignée des détails et la force de chaque séquence donnent à l’ensemble une puissance de conviction qui demeure étonnante. Francis n’est certes pas Fisher : il filme avec moins de génie, moins de beauté mais avec une force brute récurrente et quelques idées poétiques qui en assurent une efficace continuité tout en parvenant à renouveler la donne d’une manière originale. Le scénario de Elder – basé au fond sur l’idée de recherche de la vérité par delà les opinions et les préjugés comme unique moyen de réunion et de sauvegarde de la communauté humaine – entretient sans cesse l’angoisse par un retournement d’alliances. Ces modifications constantes, sources de suspense et de terreur, sont mises en scènes avec une simplicité qui renforce leur effet parfois fulgurant. Sur ce film, on peut dire que Francis a eu du génie. Lui qui avouait régulièrement son mépris du genre (à l’occasion de divers entretiens ou déclarations publiques) l’a ici magnifiquement servi. La restriction obsessionnelle des décors, le rythme du montage sont à l’image de la musique paroxystique et expressionniste de Bernard : des suites d’attaques, de coups de force sauvages, de ruptures hallucinantes, de fascinations-répulsions débouchant sur le vertige du cauchemar.Quelques séquences mémorables d’horreur et d’épouvante dans Dracula et les femmes : la découverte du cadavre ensanglanté d’une femme pendue dans une église et celle de la résurrection du comte (ces deux premières séquences constituant à elles deux l’ouverture globale assez extraordinaire) puis celle du cadavre d’une victime de Dracula brûlée dans un four par le prêtre …sous l’emprise du vampire mais horrifié par ce qu’il est contraint de faire, celle de la marche nocturne de la belle Veronica Carlson vers le château de Dracula, celles des deux morts de Dracula dont l’une est inefficace parce que la prière rituelle d’exorcisme n’a pas été prononcée assez tôt mais dont l’autre réussit par la grâce d’un «hasard divin» inverse du «hasard démoniaque » qui avait provoqué sa renaissance. Un mot sur l’interprétation : la vedette féminine Veronica Carlson (dont le physique est assez proche de celui d’Ursula Andress mais dont les yeux sont très différents) trouve ici son premier grand rôle, le second étant celui qu’elle tiendra l’année suivante dans le génial Frankenstein Must Be Destroyed [Le Retour de Frankenstein] (Grande-Bretagne, 1969) de Terence Fisher. Christopher Lee poursuit la montée en puissance pure du personnage, alternant immobilité cauchemardesque et frénésie violente : il renouvelle remarquablement ses créations antérieures en dépit de sa réticence bien connue à reprendre le rôle qu’il estimait avoir définitivement épuisé. Ce ne sera pas encore la dernière fois qu’il le tiendra et il nous surprendra plusieurs fois encore, notamment pour les cinéastes Peter Sasdy, Roy Ward Baker et Jesus Franco. Quant aux seconds rôles, Barry Andrews est un jeune premier honorable mais sans grande personnalité tandis que Ewin Hooper compose en revanche un prêtre halluciné très étonnant qui est la grande surprise du film, son fil rouge dramatique. Rupert Davies est la quatrième ligne de force du casting : sa découverte d’une région sous l’emprise de la peur et sa marche vers le château avec son prêtre ainsi que la dispute du dîner avec Paul sont de très beaux moments dramatiques.Dracula et les femmes est l’unique contribution de Freddie Francis à la lignée cinématographique du personnage créé par Stoker sur la vingtaine de films fantastiques qu’il aura signés comme réalisateur mais l’un des «Dracula» non fishériens les plus importants. Enfin, historiquement, le film négocie le virage esthétique désiré par la productrice Aida Young vers un surcroît de violence graphique et d’érotisme mais maintient la présence au générique de quelques-uns des grands collaborateurs artistiques des années 1955-1965 : Arthur Grant à la photo, Bernard Robinson comme directeur artistique notamment. Sa trace la plus évidente de modernité est son générique constitué d’agressives équidensités animées dont l’effet poétique est, encore aujourd’hui, d’une étrange beauté.(*) Le vampire du The Brides of Dracula [Les maîtresses de Dracula] (Grande-Bretagne, 1960) de Terence Fisher n’était pas, en dépit de ses titres anglais et français d’exploitation, le comte Dracula mais un de ses disciples : le baron Meinster, et il n’appartenait donc déjà plus tout à fait à la pure lignée des adaptations stokerienne produites par la Hammer Film bien qu’il fût cohérent avec l’univers romanesque de Stoker.
Dracula has risen from the grave [Dracula et les femmes] (Grande-Bretagne, 1968) de Freddie Francis est la suite directe de Dracula Prince of Darkness [Dracula prince des ténèbres] (Grande-Bretagne, 1965) de Terence Fisher qui est lui-même la suite directe de Horror of Dracula [Le cauchemar de Dracula] (Grande-Bretagne, 1958) de Terence Fisher. Le vampire finissait noyé dans une eau glacée en 1965 et c’est de cette même eau glacée qu’il est libéré en 1968 par le remarquable scénario de John Elder, de son vrai nom Anthony Hinds / Anthony Hammer. La filiation est cependant ténue, et l’intrigue de Dracula et les femmes n’a strictement plus rien à voir avec celle du roman original. (*)Dracula et les femmes prolonge et renouvelle d’une manière novatrice la géniale trilogie de Terence Fisher (1958, 1960, 1965) dans le sens d’une dialectique ultra-violente des apparences, en approfondissant l’idée d’une possession démoniaque de la réalité par le mal, assortie d’un érotisme encore plus agressif. On a dit que Francis était l’anti-Fisher par excellence : force est de convenir que c’est faux. On a reproché à Elder et Francis d’avoir trop humanisé le vampire en lui donnant un sentiment : celui de la vengeance. Mais une telle dualité «humain-inhumain» était bien au cœur de l’anthropologie vampirique fishérienne. Même si on peut reprocher à Francis son insistance banalisante, il maintient néanmoins l’équilibre entre animalité et humanité du vampire et maintient le personnage dans sa consistance cauchemardesque. La réflexion de Elder sur le pouvoir du mal s’inscrit aussi dans la lignée fishérienne la plus directe : un prêtre possédé prenant fonctionnellement la place du Renfield original du roman (et du film de 1965) c’est déjà une idée grandiose. Un évêque et un jeune athée qui devront finalement s’unir ensemble à ce prêtre déchiré, au péril commun de leurs vies pour sauver la nièce du premier : c’en est une autre ! Ce délirant scénario qui semble né d’une fumerie d’opium, eh bien, on y croit absolument et tout du long. L’évidence soignée des détails et la force de chaque séquence donnent à l’ensemble une puissance de conviction qui demeure étonnante. Francis n’est certes pas Fisher : il filme avec moins de génie, moins de beauté mais avec une force brute récurrente et quelques idées poétiques qui en assurent une efficace continuité tout en parvenant à renouveler la donne d’une manière originale. Le scénario de Elder – basé au fond sur l’idée de recherche de la vérité par delà les opinions et les préjugés comme unique moyen de réunion et de sauvegarde de la communauté humaine – entretient sans cesse l’angoisse par un retournement d’alliances. Ces modifications constantes, sources de suspense et de terreur, sont mises en scènes avec une simplicité qui renforce leur effet parfois fulgurant. Sur ce film, on peut dire que Francis a eu du génie. Lui qui avouait régulièrement son mépris du genre (à l’occasion de divers entretiens ou déclarations publiques) l’a ici magnifiquement servi. La restriction obsessionnelle des décors, le rythme du montage sont à l’image de la musique paroxystique et expressionniste de Bernard : des suites d’attaques, de coups de force sauvages, de ruptures hallucinantes, de fascinations-répulsions débouchant sur le vertige du cauchemar.Quelques séquences mémorables d’horreur et d’épouvante dans Dracula et les femmes : la découverte du cadavre ensanglanté d’une femme pendue dans une église et celle de la résurrection du comte (ces deux premières séquences constituant à elles deux l’ouverture globale assez extraordinaire) puis celle du cadavre d’une victime de Dracula brûlée dans un four par le prêtre …sous l’emprise du vampire mais horrifié par ce qu’il est contraint de faire, celle de la marche nocturne de la belle Veronica Carlson vers le château de Dracula, celles des deux morts de Dracula dont l’une est inefficace parce que la prière rituelle d’exorcisme n’a pas été prononcée assez tôt mais dont l’autre réussit par la grâce d’un «hasard divin» inverse du «hasard démoniaque » qui avait provoqué sa renaissance. Un mot sur l’interprétation : la vedette féminine Veronica Carlson (dont le physique est assez proche de celui d’Ursula Andress mais dont les yeux sont très différents) trouve ici son premier grand rôle, le second étant celui qu’elle tiendra l’année suivante dans le génial Frankenstein Must Be Destroyed [Le Retour de Frankenstein] (Grande-Bretagne, 1969) de Terence Fisher. Christopher Lee poursuit la montée en puissance pure du personnage, alternant immobilité cauchemardesque et frénésie violente : il renouvelle remarquablement ses créations antérieures en dépit de sa réticence bien connue à reprendre le rôle qu’il estimait avoir définitivement épuisé. Ce ne sera pas encore la dernière fois qu’il le tiendra et il nous surprendra plusieurs fois encore, notamment pour les cinéastes Peter Sasdy, Roy Ward Baker et Jesus Franco. Quant aux seconds rôles, Barry Andrews est un jeune premier honorable mais sans grande personnalité tandis que Ewin Hooper compose en revanche un prêtre halluciné très étonnant qui est la grande surprise du film, son fil rouge dramatique. Rupert Davies est la quatrième ligne de force du casting : sa découverte d’une région sous l’emprise de la peur et sa marche vers le château avec son prêtre ainsi que la dispute du dîner avec Paul sont de très beaux moments dramatiques.Dracula et les femmes est l’unique contribution de Freddie Francis à la lignée cinématographique du personnage créé par Stoker sur la vingtaine de films fantastiques qu’il aura signés comme réalisateur mais l’un des «Dracula» non fishériens les plus importants. Enfin, historiquement, le film négocie le virage esthétique désiré par la productrice Aida Young vers un surcroît de violence graphique et d’érotisme mais maintient la présence au générique de quelques-uns des grands collaborateurs artistiques des années 1955-1965 : Arthur Grant à la photo, Bernard Robinson comme directeur artistique notamment. Sa trace la plus évidente de modernité est son générique constitué d’agressives équidensités animées dont l’effet poétique est, encore aujourd’hui, d’une étrange beauté.(*) Le vampire du The Brides of Dracula [Les maîtresses de Dracula] (Grande-Bretagne, 1960) de Terence Fisher n’était pas, en dépit de ses titres anglais et français d’exploitation, le comte Dracula mais un de ses disciples : le baron Meinster, et il n’appartenait donc déjà plus tout à fait à la pure lignée des adaptations stokerienne produites par la Hammer Film bien qu’il fût cohérent avec l’univers romanesque de Stoker.
05/04/2010 | Lien permanent
Au-delà de l'effondrement, 70 : L'Apocalypse frénétique d'Ernest Pérochon, par Francis Moury

 Tous les effondrements
Tous les effondrements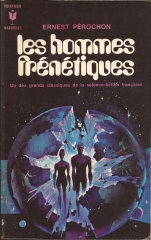 «L'humanité ne comprit pas, tout d'abord, qu'elle venait de recevoir le coup de grâce. [...] La civilisation avait sombré. A part quelques rares avions, quelques installations privées de cinétéléphonie, tout était à peu près disparu de ce qui avait fait la puissance et l'orgueil de la société moderne. [...] De vastes régions étaient jonchées de paralytiques gémissants qui mouraient de faim et de soif; en d'autres lieux, on ne trouvait plus guère que des aveugles. Des hallucinés, des fous, des monstres qui n'avaient même plus figure humaine erraient à l'aventure. Aucun des groupes sociaux n'avait subsisté. L'individu assurait sa subsistance au jour le jour et vivait en état de perpétuelle alerte.»
«L'humanité ne comprit pas, tout d'abord, qu'elle venait de recevoir le coup de grâce. [...] La civilisation avait sombré. A part quelques rares avions, quelques installations privées de cinétéléphonie, tout était à peu près disparu de ce qui avait fait la puissance et l'orgueil de la société moderne. [...] De vastes régions étaient jonchées de paralytiques gémissants qui mouraient de faim et de soif; en d'autres lieux, on ne trouvait plus guère que des aveugles. Des hallucinés, des fous, des monstres qui n'avaient même plus figure humaine erraient à l'aventure. Aucun des groupes sociaux n'avait subsisté. L'individu assurait sa subsistance au jour le jour et vivait en état de perpétuelle alerte.»Ernest Pérochon, Les Hommes frénétiques (Éditions Plon 1925, puis nouvelle Édition belge Gérard & Cie., Bibliothèque Marabout, section science-fiction, Verviers 1971), page 210. NB: la pagination indiquée est celle de la seconde édition Marabout.
On s'en souvient mal aujourd'hui mais la première moitié du vingtième siècle fut une période faste pour la littérature française de science-fiction. Certes, Jules Verne avait ouvert la voie durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle (De la Terre à la Lune en 1865 et Vingt Mille Lieues sous les mers en 1869-1870) mais la popularité du genre devint considérable dès la génération suivante. L'apocalypse fut un de ses thèmes majeurs : qu'on se souvienne de Jacques Spitz (La Guerre des mouches en 1938) et d'Ernest Pérochon (Les Hommes frénétiques en 1925) ! Nous avons déjà consacré un article au livre de Spitz; intéressons-nous ici et maintenant à celui de Pérochon.
Son cas est d'autant plus curieux que rien ne le prédestinait à ce genre auquel ce fut, semble-t-il, son unique contribution parfois négligée, voire passée sous silence, dans les quelques maigres notices bio-bibliographiques qu'on lui a consacrées sur Internet. Ernest Pérochon (1885-1942) avait, en 1920, obtenu le prix Goncourt pour Nène, un roman paysan (ou de mœurs champêtres, comme on disait à l'époque) totalement oublié et il donna en 1927 un L'Instituteur non moins oublié. C'était sa profession initiale puisqu'il avait été normalien (pas Normale Sup, précisons : Normale... tout court) et qu'il devait, par la suite, signer quelques manuels scolaires élémentaires. Son roman Les Gardiennes (1924) qui raconte l'histoire, durant la Première Guerre mondiale, de quelques femmes françaises de l'Arrière, privées des hommes envoyés au front et devant donc assurer la sauvegarde des champs, des cultures et des usines par leurs propres moyens, a été récemment adapté (2017) au cinéma. Il en a écrit d'autres qu'il faudrait peut-être redécouvrir mais, assurément, le roman de science-fiction Les Hommes frénétiques occupe une place singulière, unique, particulière dans cet ensemble partiellement englouti.
L'histoire racontée par Les Hommes frénétiques est assez simple : elle imagine une guerre mondiale survenue (pour un motif absurde et futile) en 2145 et mettant un terme à une civilisation techniquement si avancée qu'elle utilise les méridiens et les parallèles comme lignes de séparation et de transport tout à la fois, alimentant de puissants réseaux de télécommunications et de transmissions d'énergie. Ce n'est pas tant la description de cette guerre mondiale (essentiellement aérienne, effectuée par l'emploi de curieux tourbillons modifiant l'éther et / ou l'atmosphère) et de ses nouvelles techniques de destruction (occupant pratiquement les deux premières parties du livre) qui retiendra ici mon attention, en dépit de son caractère régulièrement spectaculaire, que celle du remplacement de la race humaine par une quasi nouvelle race, survenant durant la troisième et dernière partie du livre (pages 207 à 245), intitulée Une genèse. Les critiques contemporains du livre furent, pour leur part, d'abord et essentiellement sensibles aux effets d'anticipation scientifique : on créditait même parfois Pérochon d'avoir surpassé, sur leur propre terrain, les inventions techniques les plus prophétiques et / ou les plus folles déjà portées sur le papier par Jules Verne, J.-H. Rosny aîné, sans oublier l'inévitable Herbert-George Wells. Aucun des maigres extraits critiques cités dans la Postface (même pas celui signé par l'académicien Henri de Régnier qui aimait beaucoup le livre et l'avait écrit dans Le Figaro) de Jean-Baptiste Baronian, ne mentionne pourtant l'originalité si remarquable de cette troisième partie.
Cette genèse d'une nouvelle race, dérivant de celle des hommes mais moins intellectuelle et davantage poétique, qui s'avère bientôt physiquement plus apte à la survie dans un monde revenu à l'état sauvage que la race déclinante puis malade puis vouée à la disparition des hommes anciens, est discrètement (mais assez dialectiquement — au sens hégélien et non pas au sens platonicien car il s'agit non pas d'une contrariété initialement érigée en contradiction logique puis ontologique mais d'une germination quasiment botanique) annoncée par la situation modeste de Samuel et Flore, leurs fondateurs que le début du livre nous montre, alors encore enfants, aux côtés du plus grand savant de l'époque, Harrisson : «C'était [Samuel] un enfant curieusement arriéré, sans aucun symptôme morbide, cependant; les experts psychologues voyaient en lui, non un malade, mais un spécimen de l'humanité aux âges néolithiques. En sa cervelle obscure, les mots les plus simples éveillaient seuls de fugitives images. D'une beauté parfaite, l'harmonie naturelle de ses gestes était une joie pour les yeux. [Flore et Samuel] étaient totalement dépourvus de ce courage agressif, de cette férocité que l'on attribuait — peut-être gratuitement — à l'homme préhistorique» (pages 9 et page 101).
Le savant Harrisson qui les héberge à proximité de son laboratoire privé, se compare, pour sa part, assez volontiers, sur le plan de la philosophie des sciences, à «quelque aventureux coureur des âges primitifs, quittant la horde pour pénétrer seul, toujours plus avant dans le mystère d'une forêt inconnue. La forêt était sans bornes, peuplée de formes inimaginables et d'une mobilité telle que les images glissantes d'un rêve saugrenu eussent paru, en regard, choses stables, nettes, admissibles. Royaume de folie, plein de l'immense tremblement des chimères. La folie ! Un savant des siècles précédents et même, à l'heure présente, un penseur trop habitué aux vieilles règles en eussent peut-être senti le vent sur leur face. Mais lui, Harrisson, regardait, sans trouble, chavirer les idoles, s'évanouir les systèmes qui, depuis des siècles, formaient les assises de l'esprit humain» (page 10).
Pour le lecteur cultivé de 1925, de tels fragments évoquent inévitablement à la fois le positivisme (le culte de l'histoire, y compris et surtout celui de l'histoire anthropologique autant que celui de l'histoire des sciences et des civilisations), son rameau darwiniste évolutionniste (1), Nietzsche et son Crépuscule des idoles. S'y greffe aussi, fugitivement mais réellement, quelque chose du Victor Hugo poète, celui de La Légende des siècles. L'idée du rapport philogénétique et ontogénétique de l'individu à une horde est déjà scientifiquement exploitée en Angleterre par James G. Frazer dans Totémisme et exogamie (1910-1937) et en Autriche par Sigmund Freud dans Totem et tabou (1913), ce dernier titre étant le véritable prélude aux études d'anthropologie psychanalytique de Geza Roheim. Elle découle en droite ligne d'une autre intuition nietzschéenne (2). Tel est le contexte, plus ou moins connu en France, auquel Pérochon ajoute son expérience personnelle d'ancien combattant de la Première Guerre mondiale et celle du pessimisme philosophique qui s'ensuivit. Paul Valéry (3) et bien d'autres savaient, bien avant 1918, que la civilisation européenne était mortelle et qu'elle avait fourni techniquement aux autres civilisations les moyens de la surpasser matériellement, voire de la détruire.
Dès lors, rien d'étonnant si Harrisson, le savant triomphant et énergique du début du livre, finit supplanté (par hasard ou par une obscure nécessité renversant les anciennes philosophies humaines de l'histoire) par des enfants innocents, graines d'une race future bien plus vigoureuse car bien moins philosophe mais peut-être plus essentiellement humaine que ne le furent ses anciens maîtres. Il y a quelque chose de réellement nietzschéen dans les derniers chapitres de Les Hommes frénétiques, non seulement à cause de la critique fondamentale, ici bien évidemment reprise, de la civilisation occidentale ébauchée puis systématisée par Nietzsche mais encore en raison de l'idée finale d'un recommencement presque pré-temporel, presque mythique et d'essence poétique, recommencement pérochien qui pourrait bien s'assimiler à l'éternel retour (4).
Un des grands moments du livre est probablement celui de la lecture, par Harrisson, d'une imaginaire et ridiculement scientiste «Histoire générale de la civilisation, du dix-huitième siècle chrétien au cinquième siècle de l'ère universelle». L'historien y soutient naïvement que ni les philosophes, ni les moraliste, ni les poètes, ni les guerriers, ni les légistes ne dirigent l'humanité : seuls les savants méconnus, auteurs modestes d'inventions ponctuelles purement techniques, provoquent de réels changements. Toute la suite du livre affirme bien entendu le contraire d'une manière assez ironique : la fin du monde est activée par la folie d'une poétesse fanatique laotienne (joliment nommée Lia-Té) et la technique n'est pas ici l'objet des imprécations philosophiques d'un Oswald Spengler, d'un Martin Heidegger ou d'un Nicolas Berdiaeff. Elle est un simple facteur neutre, constaté, observé mais n'impliquant aucun gain particulier sur le plan stratégique, encore moins tactique puisque toutes les parties du globe sont supposées être à niveau égal, n'impliquant pas non plus un quelconque déficit ontologique ou spirituel. Harrisson, le plus grand savant du monde honoré par cette époque, ne pourra d'ailleurs rien faire pour empêcher la catastrophe.
Ce sont Samuel et Flore qui (in troisième partie, §II L'Odyssée de Samuel et Flore, pages 217-234) enfantent, contre toute attente, cette nouvelle race «chanteuse, paresseuse et douce» qui supplante l'humanité ancienne, décimée par la maladie. Cette genèse est racontée d'une manière progressivement non seulement biblique mais franchement mythique à mesure que le récit progresse, à partir de la page 217. L'histoire, la science, la culture humaine ont disparu : une sorte de rapport immédiat des données factuelles à la conscience les remplace. Il ne s'agit certes pas d'objectivité ni de courant de conscience au sens défini par les œuvres littéraires supérieures de James Joyce (1882-1941) ou de William Faulkner (1897-1962) ; ce n'est pas non plus ce que Henri Bergson entendait lorsqu'il inventait le titre de sa thèse de doctorat : Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), dédiée à Jules Lachelier. Il s'agit simplement, pour Pérochon, de décrire la progression du crépuscule d'une race maudite vouée à la disparition et la naissance inédite d'une nouvelle ère primitive au sens où Lucien Lévy-Bruhl étudiait entre 1910 et 1935 la mentalité primitive et l'âme primitive réelles.
Il faut noter un point décevant : Pérochon s'arrête trop tôt et ne mentionne aucune création de mythe, de rite, de culture. Il laisse sa place à l'infini du possible, y compris, peut-être, à l'émergence d'une contre-culture telle que l'avait imaginée Wells dans La Machine à explorer le temps (1895) : une humanité demeurant au stade infantile, des livres inexorablement voués au retour à l'état de poussière faute de conservation correcte, faute d'entretien, faute d'éducation.
Cette crépusculaire troisième partie est décrite par de simples notations factuelles, ponctuelles, écrites dans un style volontairement plus enfantin que adulte, en raison de sa syntaxe dénuée de tout artifice, de tout parement stylistique ou allusif. L'ébauche d'une ultime alliance entre l'ancienne race humaine et cette nouvelle race échoue dramatiquement, encore une fois autant par hasard que par une obscure nécessité à laquelle les ultimes protagonistes sont insensibles, car devenus ignorants, inconscients des tenants et aboutissants de leur propre histoire. C'est le sens du titre du dernier chapitre, Le Chant du matin, (pages 235 à 245) qui est une sorte de poème en prose, s'achevant sur une simplicité biblique au sens poétique mais aussi stylistique, au sens où un Victor Hugo pouvait l'entendre dans certains de ses poèmes écrits pour La Légende des siècles : on peut songer, à l'occasion des descriptions de nature et d'impressions épidermiques qu'elle engendre dans une conscience rêveuse, à peine éveillée, à certaines strophes de la seconde partie de Booz endormie (1859), si on veut une comparaison d'histoire de la littérature qui n'est certes pas raison, mais qui fut peut-être bien présente à l'esprit de Pérochon qui avait grandi en lisant les Parnassiens autant qu'Hugo. Ce sont peut-être, d'ailleurs, précisément ces dernières pages qui plaisaient le plus à Henri de Régnier, bien davantage que le lourd assemblage futuriste de prospective stratégique et militaire auparavant déployée dans les deux précédentes parties.
Pérochon déclarait en 1925 à Frédéric Lefèvre qui l'interrogeait pour Les Nouvelles littéraires : «Nous accueillons avec une étonnante insouciance les nouveautés scientifiques les plus ahurissantes. Nous ne semblons pas remarquer que la science est une grande révolutionnaire. Je crains que le réveil ne soit terrible. Tant mieux si cette crainte est ridicule ! Mais enfin j'appréhende avec angoisse un évanouissement catastrophique de notre jeune civilisation. Le coeur des hommes est encore trop barbare, trop orageux pour qu'ils puissent utiliser sans danger les forces secrètes de la nature. Sincèrement, si j'ai composé cette affreuse et folle histoire, c'est dans l'espoir d'avoir un démenti» (cité in Postface de Jean-Baptiste Baronian, pages 248-249). Il mourra en 1942, trois ans avant que les bombes atomiques ne tombent sur Hiroshima et Nagasaki, provoquant des conséquences matérialisant d'une manière assez précise et fidèle certains des pires cauchemars qu'il avait imaginés dans Les Hommes frénétiques.
Notes
(1) Cf. Francis Moury, Le Pragmatisme de John Dewey (2017).
(2) Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, V, § 354 Du «Génie de l'espèce» (1882-1887, traduction 1950 par Alexandre Vialatte aux Éditions Gallimard, NRF + retirage Idées-Gallimard 1972), pages 305 à 309 : «À quoi bon la conscience si elle est superflue pour l'essentiel de l'existence ? [...] Je pense, comme on le voit, que la conscience n'appartient pas essentiellement à l'existence individuelle de l'homme, mais au contraire à la partie de sa nature qui est commune à tout le troupeau [...] etc.» Cet article 354 'est l'un des plus longs du livre V et sa démonstration, dense et serrée, exige qu'on s'y reporte intégralement pour être correctement appréciée. Il a certainement inspiré une partie de la théorie freudienne de la horde en 1913.
(3) Paul Valéry, Regards sur le monde actuel (Éditions Gallimard, NRF, 1945 + reprise Idées-Gallimard, 1967), page 8 : «Je ne sais pourquoi les entreprises du Japon contre la Chine et des États-Unis contre l'Espagne qui se suivirent d'assez près, me firent, dans leur temps (1895 et 1898), une impression particulière. [...] Je ressentis toutefois ces événements non comme des accidents ou des phénomènes limités, mais comme des symptômes ou des prémisses, comme des faits significatifs dont la signification passait de beaucoup l'importance intrinsèque et la portée apparente. L'un était le premier acte de puissance d'une nation asiatique réformée et équipée à l'européenne ; l'autre, le premier acte de puissance d'une nation déduite et comme développée de l'Europe, contre une nation européenne.»
(4) Clifford D. Simak, Demain les chiens (City), sera lui aussi inspiré, en 1952, par une telle critique d'essence nietzschéenne. Le brillant philologique de la construction de l'intrigue (des chiens, philologues du futur, étudient un antique manuscrit dont certaines leçons pourraient prouver l'existence d'une race humaine ayant dominé la Terre) pouvant éventuellement constituer un hommage ironique direct à Friedrich Nietzsche qui avait été, comme on sait, le premier critique dévastateur de la discipline qu'il enseignait si brillamment au début de sa carrière universitaire. Sur le mythe lui-même et son rapport à la philosophie de l'histoire, à l'histoire de la philosophie et aux religions, cf. Mircea Eliade, Le Mythe de l'éternel retour – Archétypes et répétition (Éditions Gallimard, Les Essais XXXIV 1949 + nouvelle édition revue et augmentée Idées-Gallimard, 1969).
19/01/2024 | Lien permanent
Bellum civile, suite : Syriana ou cinq guerres en une, par Francis Moury

 Bellum civile ou Civil War in France.
Bellum civile ou Civil War in France.«Guerres et batailles nous semblent terribles, mais non pas aux dieux : car la divinité réalise toute chose en pensant à l’harmonie de tout le reste et de l’ensemble (1). Arès est la guerre à l’échelon cosmique : il préside au conflit des éléments qu’Empédocle baptisait neikos. Il est la guerre entre les peuples et au cœur des cités. Mais il est aussi, en chaque cœur d’homme, cet instinct qui pousse à la bataille, aux discordes, ce thymoeides, cette agressivité, dont Homère a fait le grand ressort psychologique de ses héros.»
Félix Buffière, Les Mythes d’Homère et la pensée grecque (troisième partie, § IV, section 1, Les Belles lettres, 1956), p. 298
«Il faut avoir des tyrans contre soi pour devenir soi-même un tyran, c’est-à-dire un homme libre. Ce n’est pas un petit avantage que d’avoir cent épées de Damoclès suspendues sur sa tête; cela enseigne à danser, cela donne la liberté de mouvements. […] Le penseur qui a reconnu qu’en nous, à côté de toute croissance, règne en même temps la loi de la destruction, et qu’il est indispensable que toute chose soit anéantie et dissoute sans pitié afin que d’autres puissent être créées et naître, celui-là devra apprendre à trouver dans cette contemplation une sorte de joie, s’il veut pouvoir en supporter l’idée; faute de quoi il ne sera plus apte à la connaissance.»
F. Nietzsche, La Volonté de puissance (traduction française de Geneviève Bianquis, Gallimard-NRF en 2 volumes, 1947), cité par André Glucksmann, Les maîtres penseurs (Grasset, 1977, p. 274).
«Il est curieux que nous n’utilisions pas les gaz asphyxiants, dans ces occasions. En bombardant les habitations, on n’a les femmes et les enfants que par îlots, et notre infanterie encourt toujours des pertes en tirant sur les hommes. Avec des attaques par les gaz, on pourrait anéantir proprement toute la population des régions en faute et comme méthode de gouvernement, ce ne serait pas plus immoral que le système actuel.»
T. E. Lawrence, La France, l’Angleterre et les Arabes, article publié dans The Observer du 8 août 1920, repris comme lettre n°130 in T. E. Lawrence, Lettres (traduction française d’Etiemble et Yassu Gauclère, Gallimard-NRF, 1948), p. 265
«Donc la conclusion de la première lettre était que l’homme, étant une guerre civile, ne pouvait être mis en harmonie avec lui-même ou unifié logiquement… et l’aboutissement de celle-ci est que l’homme, ou l’humanité, étant un produit naturel, quelque chose d’organique, est inéducable : il ne peut dévier de son caractère et de sa teinte première, ni dépasser la chair, ni donner naissance à rien qui ne soit mortel et charnel.»
T. E. Lawrence, Lettres, extrait de la lettre n°206 à Lionel Curtis, in op. cit., p. 362.
La Syrie, en cette fin août 2013, offre l’exemple d’un crime contre l’humanité parmi les plus ignobles jamais commis par un État depuis la Seconde guerre mondiale, commis durant une guerre civile résultante de l’entrelacement virtuel de cinq guerres différentes qui sont en train, pour certaines d’entre elles, de passer du domaine du possible au domaine du réel, et qui pourraient toutes, à terme, se confondre en une seule guerre mondiale :
- Une guerre civile limitée stricto sensu puisqu’elle oppose deux fractions du peuple syrien, l’une soutenue et l’autre réprimée par l’armée nationale.
- Une guerre classique limitée entre blocs de nations ou États, entre États ou alliances d’États, alliances et inimitiés créées par l’histoire et la géographie.
- Une guerre de religions, divisible en deux guerres distinctes, une limitée, l’autre illimitée donc mondiale : celle des Sunnites contre les Chiites limitée par définition au monde musulman, celle illimitée par principe des fractions musulmanes combattantes d’Al-Quaïda contre les autres religions du monde afin d’instituer l’Islam sunnite comme religion dominante et dominatrice, le règne de leur idée de Dieu sur la Terre.
- Une guerre policière : les Occidentaux assurent vouloir utiliser leur puissance militaire non pas comme force d’intervention classique (annexion ou libération) mais comme force de police internationale afin de réprimer ponctuellement un crime (de guerre) commis par le gouvernement syrien : le gazage par l’armée de Bachar el-Assad de 1 500 hommes, femmes et enfants alors que les armes chimiques sont interdites depuis longtemps.
- Une guerre mondiale potentielle : USA, France, Australie, Turquie, Ligue arabe formant un bloc géopolitique occidental et oriental anti-gouvernement syrien contre Russie, Iran et d’autres composantes d’un bloc géopolitique pro-gouvernement syrien. Avec des exceptions : certains Français refusant qu’on aide objectivement les Sunnites, certains Iraniens condamnant el-Assad pour le crime de guerre commis, de l’avis actuel de tous les services de renseignement, par son armée contre les populations rebelles et les victimes innocentes vivant à leur proximité.
Un sympathique naïf nommé Jean Fourastié avait publié à la NRF un livre au titre savoureux : Le Grand espoir du XXe siècle. Graphiques et statistiques à l’appui (le nombre de quintaux de blés produits à l’hectare aux USA en 1870, en 1910, en 1930, en 1940 étant censé nous révéler l’alpha et l’oméga du sens de l’histoire), ce brave homme s’évertuait à nous faire croire que le progrès technique engendrant la croissance et le machinisme technique était en train de modifier notre civilisation d’une manière irréversible. Ce livre eut un grand succès, connut de nombreuses traductions et de nombreuses rééditions au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En lisant celle de 1963 parue dans la collection de poche Idées-Gallimard, sa niaiserie rétrospective apparaît si clairement qu’elle en est comique et qu’elle nous dispense de tout commentaire. Jean Fourastié avait certes bien compris que les crises économiques, financières, sociales, sont des phénomènes naturels (à condition de considérer la vie économique comme une vie naturelle, ce qu’elle n’est pas tout à fait non plus) mais il hésitait à les qualifier : normaux ou pathologiques ? C’est ici qu’il eût fallu relire Les Règles de la méthode sociologique d'Émile Durkheim. Durkheim était un esprit systématique mais il savait aussi être fin à l’occasion : le suicide n’est pas anomique. C’est sa quantité statistique qui peut le devenir et le transformer en phénomène pathologique social. Bref…
Le contre-titre de Grand désespoir du XXIe siècle auquel on songe inévitablement en lisant ce vieux volume de Fourastié, à la trop sereine et trop sérieuse clarté évoquant bien plus, rétrospectivement, le crépuscule que l’aube, en observant ses graphiques prospectifs devenus des objets archéologiques voire fantasmatiques pour certains d’entre eux, provient peut-être du fait annexe, parallèle mais ahurissant tant il semble clair, que Fourastié a oublié la religion, l’histoire, la politique, la philosophie : croissance, machinisme oui… mais quid de la guerre universelle aussi universellement installée ici et maintenant en 2013 qu'elle l’était, selon Joseph de Maistre, au lendemain de la Genèse, du niveau du ciron à celui de l’éléphant en passant par l’homme ? Un autel sanglant où des innocents sont journellement sacrifiés : la Terre du XXIe siècle ne diffère en rien, de ce point de vue, de celle des siècles antérieurs ! Fourastié croyait que les quintaux de blés récoltés feraient disparaître le mal : chassez le marxisme de l’université française, il revenait au galop, durant l’après-guerre.
Il y a pourtant quelque chose de nouveau concernant le concept de guerre au XXIe siècle : une clarification surgie durant le dernier tiers du XXe siècle mais qui apparaît à présent avec encore davantage de puissance.
On se souvient, si on a lu les Mémoires d’une jeune fille rangée, que Sartre, «le Castor» et leurs amis, lorsqu’ils préparaient ensemble l’agrégation de philosophie, se gaussaient du sujet classique : «Le concept de notion et la notion de concept». La polémologie est-elle l’étude de la guerre comme notion ou de la guerre comme concept ? Bonnes questions pour un agrégatif de philosophie ! L’homme de la rue se contente de se poser cinq questions : «À quelle guerre avons-nous affaire en Syrie : une guerre civile ? Une guerre de religion ? Une guerre classique ? Une guerre mondiale ? Une guerre policière ?».
Je voudrais montrer ici qu’il y a un lien philosophique secret, inédit mais bien réel entre ces multiples guerres potentiellement ou réellement simultanées en Syrie et la simple guerre civile française de 2004-2014 menée par les forces françaises de sécurité contre les barbares.
Octave Hamelin disait que la philosophie pouvait se résumer à une tentative d’élimination du concept de chose en soi telle que Kant le concevait. On pourrait, paraphrasant cette formule, dire que l’ONU et les institutions diplomatiques internationales peuvent se résumer à l’idée d’une tentative d’élimination du concept de mal au profit de celui du droit. André Glucksmann l’avait dit au moment de la dernière guerre des Balkans : les innocents protégés par l’ONU sont certains d’être massacrés et la faillite morale de l’ONU est patente. La faillite de la Société des Nations puis de l’ONU comme concept juridique est peu probable tant le projet illusoire d’une paix kantienne perpétuelle entre les nations est vivace : c’est même l’une des illusions les plus vivaces depuis trois siècles. Leur faillite morale est avérée : les pires crimes se commettent sous nos yeux en Syrie tandis que les diplomates de l’ONU votent chaque semaine. La démocratie juridique de l’ONU est en faillite. Exactement comme la démocratie pénale et juridique française est en faillite face à la barbarie de la criminalité quotidienne qui ensanglante les rues du Grand Paris, de Marseille, de Lyon ou de Grenoble. Les mêmes illusions formalistes produisent les mêmes effets.
Seul le réalisme peut nous sauver. Les bourreaux doivent connaître la peur de la mort, la seule peur capable de les tenir en respect. Et s’ils persistent à agir en bourreau, il faut les tuer pour que le monde soit enfin débarrassé d’eux. Il faut donc redonner à la police française le droit de tuer sans sommation, exactement comme la gendarmerie française peut déjà le faire. Il faut redonner à la justice européenne l’instrument de la peine de mort, ultima ratio seule applicable à un certain nombre de crimes barbares. Il faut, en présence d’un État criminel, avoir le courage de l’attaquer pour l’abattre. Face à un homme mauvais armé, le seul recours est un homme de bien lui aussi armé, et de préférence supérieurement armé. La formule de la NRA vaut universellement car elle dérive non pas tant du protestantisme des pères fondateurs de la Nouvelle-Angleterre que de la sagesse antique des nations.
Les raisons données par les partisans de l’attentisme concernant la Syrie, notamment le fait que des combattants d’Al-Quaïda font la guerre aux côtés de l’Armée Syrienne Libre, ne tiennent pas : on ne regarde pas la couleur d’un chat qui mange des souris. Encore moins la couleur de celui qui mange un rat dangereux, porteur de la peste. Le régime d’Assad tue des enfants en les gazant : il porte la peste. Fournir des armes à ses opposants est bien mais cela ne suffit plus. Le premier État qui aura le courage d’aider les combattants de l’ALS en attaquant militairement et officiellement le régime d’Assad sauvera l’honneur du monde libre occidental. Il sera ensuite toujours temps de laisser l’ALS et les partisans d’Al-Quaïda discuter de l’après-Assad : le monde musulman est un monde où religion et politique, religion et diplomatie sont liées. La guerre de religion entre Sunnites et Chiites que certains clans ou partis veulent mener ne concerne pas d’abord l’Occident : l’Occident doit laisser le destin, Dieu, l’Histoire ou le Progrès hypostasié par Léon Brunschvicg (désillusionné de justesse lorsqu’on lit son Agenda retrouvé, fascinant de lucidité désabusée) décider qui l’emportera là-bas. Ensuite nous pourrons traiter avec les vainqueurs, d’égal à égal. En revanche, on ne peut pas laisser les mêmes instances décider à notre place qu’Assad pourrait demeurer impuni après un tel crime. Si la démocratie s’avère incapable de punir les crimes de guerre, il faut abandonner la démocratie pour un régime présidentiel supérieur en efficacité. Si la démocratie s’avère incapable de protéger les citoyens dans les rues, il faut abandonner le système juridique démocratique pour prendre des mesures d’exception policière. Le même phénomène est ici visible : l’abandon de l’illusion, le renoncement à l’imaginaire en faveur de l’appréhension de la vérité, de la décision d’agir réellement. La guerre se transforme en opération de police autant que l’opération de police se transforme en guerre lorsqu’elle atteint un certain degré. Ce n’est pas la paix perpétuelle qu’il faut donc viser idéalement mais la guerre perpétuelle contre le mal actif sur la Terre. Guerre contre le crime dans les rues, contre les États assassins de leur population sur la carte géopolitique : il s’agit en réalité d’une même guerre qui ne peut pas être éludée. Renoncer à une telle guerre serait précisément renoncer à notre humanité : l’essence de l’humanité est la capacité de faire la guerre. L’idée kantienne récente du Pape de renoncer à la guerre est une idée non pas catholique mais kantienne : ironie insigne de l’histoire du catholicisme. La croix réelle ne peut être qu’une épée : la noblesse médiévale occidentale l’avait bien compris. Avant elle la noblesse antique jusqu’aux temps primitifs les plus anciens.
De cette manière le piège établi par la constitution formelle et juridique des blocs géographiques, politiques, historiques, religieux serait systématiquement déjoué par le courage individuel et la noblesse d’un dirigeant conscient de la nécessité de combattre le mal sur la Terre, ou par la noblesse d’un groupe d’hommes convaincus de la même nécessité au niveau local : un chef authentique et son armée. Il faut donc punir Assad, armer les ennemis d’Assad, y compris les partisans d’Al-Quaïda. On sait que la Ligue arabe, du moins certains de ses membres, arme les milices de l’ALS et arme aussi les partisans d’Al-Quaïda. Le réalisme commande de les laisser agir en ce sens, et il nous commande, en tant que Français, de les aider militairement. Le problème dépasse ici l’opposition Sunnites contre Chiites : tout Chiite comme tout Sunnite sain d’esprit ne peut que vouloir la chute d’Assad après un tel crime.
De la sorte, le concept de guerre civile (pour le contrôle d’un État-nation), celui de guerre classique (pour le contrôle d’un territoire appartenant à un autre État-Nation), celui de guerre de religion (pour le contrôle d’un territoire mental) peuvent s’effacer au profit de ceux d’une guerre à la fois mondiale et policière. Guerre mondiale et policière permanente, au sens où on pouvait autrefois parler de «Révolution permanente», car cette guerre mondiale est une guerre policière contre le crime et contre le mal au niveau individuel comme au niveau étatique. Alors que l’ONU et les diplomates, alors que les assemblées élues et les chefs de partis, alors que les journalistes commentent des votes, discutent des points de formulation ou des hypothèses, discutent sur des mots… seule l’armée d’un chef conscient peut prendre la chose réelle en compte réel, faire régner réellement la justice sur Terre lorsqu’elle est particulièrement menacée, dans son essence même. L'expression esprit munichois est donc bien adaptée face à des députés qui assistent avec patience ou attentisme à la mort en direct d’enfants gazés.
La patience du concept : oui, il y a une patience du concept de guerre, du concept d’histoire chez G. W. F. Hegel ! Gérard Lebrun l’avait étudiée en son temps. Mais à présent je dis qu’il y a une impatience du concept et qu’il ne faut plus l’étudier mais l’agir ! Le Royaume-Uni a perdu l’occasion de prouver son efficacité légendaire : occasion d’autant plus incompréhensible que la Syrie était liée à l’Angleterre à l’époque de T. E. Lawrence, que l’histoire constitue des liens entre les nations qui peuvent s’avérer utiles. Les États-Unis ont perdu aussi cette occasion alors qu’ils sont les défenseurs de la liberté. La France peut sauver l’honneur du monde libre en attaquant la première et j’appelle à une union nationale pour seconder son action, quoi qu’il en coûte. Damas et le monde doivent être débarrassés d’Assad et de son clan criminel autant que les rues françaises doivent être débarrassées des barbares criminels qui les défigurent. Face à une guerre civile criminelle, il faut une guerre classique mais par essence policière. Face à des criminels agissant en clans organisés, il faut une police agissant essentiellement comme une armée. Ce sont les deux faces d’un même combat que l’Occident ne peut pas perdre.
Note
(1) Traduction par Buffière d’une scholie du manuscrit Venetus B à Homère, Illiade, IV, 4.
09/09/2013 | Lien permanent
Kiss me deadly de Robert Aldrich, par Francis Moury

Los Angeles, une nuit de 1955 : le détective privé Mike Hammer fait monter dans son coupé Christina, une jeune femme terrorisée, évadée d’un asile d’aliénés où elle lui assure qu’on la séquestrait. Christina assassinée, Hammer enquête mais il n’est pas le seul à s’intéresser au secret de Christina et on lui fait comprendre qu’il doit rester secret. A mesure que se précise le danger et que les cadavres s’accumulent, Hammer pressent puis dévoile la terrifiante vérité… apocalyptique.
Kiss Me Deadly [En quatrième vitesse] (États-Unis, 1955) produit et réalisé par Robert Aldrich, est adapté d’un roman de Mickey Spillane mais ce n’est pas pour cette raison – que Larry Cohen nous pardonne : il assure le contraire dans le supplément du Blu ray Carlotta paru le 20 novembre 2013, respectant magnifiquement le format original large 1.66, restituant en vidéo sa splendeur plastique chimique initiale ! – qu’il constitue une date dans l’histoire du film noir américain.
C’est d’abord une œuvre d’Aldrich producteur-réalisateur et c’est son premier grand film noir. Aldrich a touché à tous les genres mais il signera par la suite quelques autres œuvres appartenant au film noir entre 1960 et 1975, notamment les thrillers angoissants au N&B d’un noir d’encre, au clair-obscur expressionniste que sont Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? et Chut… chut, chère Charlotte, puis les films policiers en couleurs des années 1970 : The Grissom Gang [Pas d’orchidée pour Miss Blandish] adapté de James Hadley Chase, The Mean Machine [Plein la gueule], Hustle [La Cité des dangers], The Choirboys [Bande de flics]. Sans oublier le curieux mélange de film de guerre et de film noir que constitue Twilight’s Last Gleaming [L’Ultimatum des trois mercenaires] (1977) que Carlotta vient également d’éditer en version intégrale restaurée.
Raymond Borde et Étienne Chaumeton ont considéré Kiss Me Deadly, dans leur Panorama du film noir américain (Éditions de Minuit, 1979) comme marquant la fin de la période classique, comme étant une sorte d’hommage crépusculaire, pervers et fantasmatique au genre et à sa structure. Kiss Me Deadly – il faut décidément préférer le titre original à son débile titre français d’exploitation – reprend en effet, quinze ans plus tard, la structure du Faucon maltais de John Huston mais en en augmentant d’un cran la violence graphique, d’un cran l’érotisme, d’un cran le sordide et l’insolite. Cette approche critique demeure exacte et permet en outre de bien situer historiquement le film. Mais elle ne suffit pas.
Ce qui constitue surtout l’originalité et la puissance de Kiss Me Deadly, c’est la construction de son scénario. Cette enquête maudite est encadrée (au sens étymologique du terme : Mike Hammer agit, au fond, comme un inquisiteur médiéval mais un inquisiteur qui ne saurait pas ce qu’il cherche) entre deux séquences, d’ouverture et de fin, célèbres par leur innovation scénaristique et technique, avec lesquelles le film de Huston ne pouvait rivaliser techniquement. Larry Cohen a tort de considérer que Kiss Me Deadly perd en puissance, entre la séquence d’ouverture et la séquence finale : c’est précisément l’enquête et la montée graduelle des périls qu’elle illustre qui donnent au spectateur, rétrospectivement, le sens profond de la course à la mort de la jeune femme dénudée du début, le sens profond de la boîte de Pandore ouverte qui conclut le film. Le thème de l’eschatologie atomique au cinéma a été souvent traité par le cinéma de science-fiction, plus rarement par celui du film noir américain : Kiss Me Deadly est un des grands exemples d’alliage réussi des deux genres. Aldrich reviendra explicitement au thème de la fin du monde dans son splendide péplum Sodome et Gomorrhe (États-Unis-Italie,1961 coréalisé par Sergio Leone) et dans l’inégal mais ambitieux Twilight’s Last Gleaming. En réalité, le thème traverse presque toute son œuvre, quel que soit le genre qu’il illustre. Aldrich est bien, d’abord, un peintre de la fin du monde et des derniers instants qui la précèdent : sa peinture en a la fièvre, l’elliptique sécheresse, la puissance prophétique. Ce «baiser de la mort» (le titre américain est aussi une allusion à cette pratique de Cosa Nostra et le dialogue l’emploie aussi dans ce sens) précédant la fin du monde, seul Aldrich pouvait lui donner cette dévastatrice intensité.
04/12/2013 | Lien permanent
Pierre Boutang ex cathedra, par Francis Moury (Infréquentables, 2)

 Pierre Boutang dans la Zone
Pierre Boutang dans la ZoneCe texte a paru sous le titre Ma rencontre avec Pierre Boutang comme professeur de philosophie à la Sorbonne (1983 – 1984) dans la revue Dialectique n°10 (Lyon, février 2003) en guise de préface autobiographique à l’édition des Notes manuscrites prises à trois séminaires de doctorat (Recherches sur les noms divins) et à un cours d’agrégation (La nature et les espèces de l’irrationnel) inédits de Pierre Boutang, professés à Paris-IV Sorbonne en 1983-1984. Nous en donnons ici une version revue et corrigée, qui n'a pu trouver sa place, par sa taille, dans le dossier consacré aux infréquentables publié dans la revue La presse littéraire parue en 2007.
Dans sa toute récente biographie sur Pierre Boutang, Stéphane Giocanti, s'il cite ce texte de Francis Moury, oublie fort opportunément de rappeler qu'il a par deux fois, d'abord dans sa version papier puis dans la Zone, été publié dans des supports dont il ne pouvait, cet auteur malmené dont nous n'avons jamais beaucoup goûté la préciosité royaliste, que connaître le propriétaire. Je remets ce précieux témoignage de Francis en une, étant donné que 2016 est l'année du centenaire de la naissance de Pierre Boutang.
Prologue
«Les Pères de l’Église d’Occident ne se groupent pas, comme ceux d’Orient, en écoles compactes et bien tranchées. Dans les pays latins, il n’existait aucun grand centre littéraire, où l’enseignement fût donné par des professeurs et des maîtres, comme S. Pantène, Clément et Origène, à Alexandrie, ou Diodore de Tarse, à Antioche. Privés de ce secours, les docteurs des Églises d’Italie, d’Afrique et des Gaules, séparés d’ailleurs, la plupart, les uns des autres par le temps comme par les lieux, se sont formés eux-mêmes d’une manière indépendante. Aussi, en dehors de l’unité doctrinale commune, ils ont puisé leurs opinions particulières, sur les questions qui n’étaient pas décidées par l’Église, dans l’étude, la lecture et leurs réflexions personnelles. Les écrits de leurs devanciers, grecs et latins, ont naturellement exercé sur leurs esprits une grande influence, et souvent, quand ils ne les ont pas trouvés d’accord ensemble, ils ont cherché à les concilier par des opinions moyennes, comme nous allons en voir des preuves nombreuses.»
F. Vigouroux, Mélanges bibliques – La Cosmogonie mosaïque d’après les Pères de l’Église, suivie d’études diverses relatives à l’Ancien testament et au Nouveau testament, § V Les Pères latins, seconde éd. Berche & Tralin revue et augmentée, 1889, p. 89.
«Quand nous disons – ainsi que le Christ l’a dit lui-même – qu’il faut tout abandonner et se dépouiller de tout, il ne nous est point permis de l’entendre au sens où l’homme n’aurait plus besoin de travailler ni de rien faire. L’homme ne sera jamais libéré de sa tâche et de ses soucis tant qu’il vivra. Mais il faut entendre par là que nul pouvoir chez l’homme, quoi qu’il fasse ou qu’il ne fasse pas, quoi qu’il connaisse ou qu’il sache, quand bien même on y ajouterait celui de toutes les créatures, n’est capable de produire l’Unité.»
L’Anonyme de Francfort, citation présentée et traduite par Jean Chuzeville, Les Mystiques allemands du XIIIe au XIXe siècle, Grasset, 1935 - 1956, p. 184.
«Quel nom donner à cette puissance inconnue qui fait hâter le pas des voyageurs sans que l’orage se soit encore manifesté, qui fait resplendir de vie et de beauté le mourant quelques jours avant sa mort et lui inspire les plus riants projets, qui conseille au savant de hausser sa lampe nocturne au moment où elle éclaire parfaitement, qui fait craindre à une mère le regard trop profond jeté sur son enfant par un homme perspicace ? Nous subissons tous cette influence dans les grandes catastrophes de notre vie, et nous ne l’avons encore ni nommée, ni étudiée : c’est plus que le pressentiment, et ce n’est pas encore la vision. »
Honoré de Balzac, Œuvres complètes, Scènes de la vie parisienne, Histoire des Treize § 1, Ferragus, chef des Dévorants, éd. Michel Lévy frères, 1865, p. 64.
«D’ailleurs, observons la Blatte à la sortie de son abri sous faible éclairement, au moment de ses premières explorations sur un labyrinthe étroit, entouré d’eau qui l’empêche de se déplacer en dehors : sa démarche est hésitante, pleine de «circonspection», sa tête se déplace à gauche et à droite, tandis que ses antennes brassent l’air en tous sens et inspectent la sortie de son gîte ; elle monte dessus, le contourne pendant que sa vitesse s’accroît progressivement. Enfin, elle se précipite sur le plateau et fonce droit devant elle, le corps parallèle au plateau, les palpes maxillaires dirigées vers le sol, jusqu’à ce qu’elle rencontre un obstacle frontal qu’elle longe pendant quelques fractions de seconde avant de repartir dans une autre direction. […] Ce n’est qu’après un long séjour sur le labyrinthe que la démarche de l’Insecte devient moins rapide, plus sinueuse, qu’elle est entrecoupée de haltes plus nombreuses aux carrefours. Parallèlement, les «mimiques» de la Blatte évoluent : aux arrêts, elle se dresse sur ses pattes, de sorte que la tête domine tout le corps et que les antennes inspectent l’environnement. Souvent même elle avance dans cette position : les traces sont alors ondulées.»
Roger Darchen & Paul-Bernard Richard, Quelques recherches sur le comportement explorateur “chronique” de Blatella germanica, in Journal de psychologie normale et pathologique, 57e année, n°1, Conduites des animaux et intelligence animale, éd. P.U.F., janvier-mars 1960, pp. 83-84.
Introduction
 Photographie de Louis Monier prise dans la bibliothèque de Pierre Boutang.
Photographie de Louis Monier prise dans la bibliothèque de Pierre Boutang.On me demande souvent :
«– Pourquoi aviez-vous choisi Boutang comme directeur de thèse ?» ou plus brièvement encore mais plus directement, comme me l’avait autrefois demandé Régis Debray : «– Pourquoi vous et Boutang ?».
À cette question je ne crois possible de répondre qu’en évoquant, d’une part, l’ambiance intellectuelle, sociale et politique de l’époque et le retentissement qu’elle pouvait avoir sur un apprenti philosophe «lambda» et, d’autre part, en brossant succinctement mon itinéraire personnel. Je préviens cependant le lecteur : ces deux réponses fournies avec autant d’honnêteté que possible, il n’est pas encore certain que cette rencontre puisse être finalement placée davantage sous le signe de la nécessité que sous celui de la contingence.
Pour un élève philosophe préparant en 1979 le concours d’entrée à l’E.N.S. à Louis-le-Grand, on peut dire sans risque d’erreur que les perspectives étaient assez sombres. Le métier de fonctionnaire était à l’époque totalement déconsidéré par la société civile. Cette dernière était caractérisée par certaines expressions : «les années-fric», «la montée de l’individualisme», la «dégradation de la cohésion sociale». Quant à ceux qui ne rêvaient que d’en gagner, du fric, on ne peut pas dire que les perspectives étaient mirobolantes non plus : la montée du chômage en flèche, la crise économique et sociale avaient amené la chute de Giscard et l’élection de Mitterrand, entraînant une panique boursière mémorable en raison, notamment, des nationalisations et de la présence de ministres communistes au gouvernement.
Dans ce contexte, je me rappelle très bien notre professeur d’histoire Jean Mathiex nous disant (je cite de mémoire) : «– Vous autres les khâgneux littéraires, vous devez bien avoir conscience que vous avez le choix : soit poursuivre dans les différentes disciplines que vous avez choisies et crever de faim, soit devenir crémiers et gagner de l’argent !» et d’ajouter une autre fois : «– Vous aurez sacrifié les meilleures années de votre vie à la préparation du concours le plus difficile : pour les rares d’entre vous qui le réussiront, ils en seront récompensés, mais le sort des autres sera si pénible qu’il vaut mieux que vous n’y pensiez pas»… jouissant malicieusement du frisson collectif qu’une telle déclaration avait produit dans nos rangs.
En outre, d’un point de vue purement philosophique, mon professeur Barnouin m’avait fortement impressionné. Davantage même qu’Hubert Grenier l’année suivante. Barnouin nous avait cité Épicure : «La philosophie, c’est le plaisir et la peine, c’est la vie et la mort» ! Barnouin nous avait demandés : «– Quelle est la question que pose Kant ?» et il avait ajouté, avec un souverain mépris : «– Ne me répondez surtout pas par les trois questions qui servent à résumer son système dans les mauvais manuels – que pouvons-nous connaître ? que devons-nous faire ? que nous est-il permis d’espérer ? – car je vous préviens que cela ne suffira pas ; ce n’est pas cela, la véritable question kantienne. Alors, qui d’entre vous la dira, qui d’entre vous la connaît… personne ?». J’avais levé timidement le doigt. « – Oui ? Nous vous écoutons…»
«– Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ?»
«– Très bien ! Votre nom ?»
Cela avait créé un lien entre nous : nous nous étions reconnus immédiatement et c’est de la reconnaissance que naît l’estime, jamais autrement. Descartes le savait : l’admiration est la passion la plus noble.
Barnouin, enfin et surtout, nous avait fait découvrir, à l’occasion d’un cours magnifique sur l’idée de méditation chez Descartes, la perfection du système de Hegel.
Et à l’époque je pensais, en mon for intérieur : «– Ou bien le système de Hegel est vrai, et alors tout est déjà dit, inutile même de lire un autre que lui. Ou bien il a tort, le réel n’est pas rationnel et le rationnel n’est pas le réel. Et dans ce cas, ce ne sont pas le social ou la politique qui peuvent sauver l’homme, mais éventuellement la communion esthétique ou mystique. Sans que pour cela on doive d’ailleurs renoncer au rationalisme, à condition qu’il ne prétende pas réduire l’aporie».
Avec comme conséquence que la société civile ne pouvait guère offrir d’autre alternative de salut social que d’être artiste ou prêtre.
Quant à l’idée d’enseigner… enseigner à qui ? Dans quel but ?
Ceux qui savaient lire pouvaient bien lire par eux-mêmes, comprendre ce que nous avions nous-même compris, se sauver par eux-mêmes. Ce n’était pas l’idée de passer trente ans dans une classe de terminale à répéter chaque année trois formules de Kant ou de Descartes ou du père Bachelard qui me semblait vaine, c’était l’idée de corriger des milliers de dissertations dont une ou deux par an seraient valables et de servir un système et une société que j’abominais et méprisais chaque jour davantage. Impitoyable adolescence.
Après deux classes de Première supérieure (1980 et 1981), au cours desquelles nous avions, tous, perdu un ou deux kilogrammes d’une année sur l’autre en raison des soixante heures de travail hebdomadaire que nous fournissions en moyenne, aussi après deux échecs au concours – dont le Président du Jury, en philosophie, était en 1981 le maître hégélien Bernard Bourgeois que je devais retrouver en 1997 à Paris-I donnant un cours de licence sur Fichte et un cours d’agrégation sur… Nietzsche, tous deux formulés dans le plus pur langage hégélien: le temps retrouvé ! –, je me retrouvais une licence en poche et un peu fatigué à la Sorbonne. À ce stade, il fallait penser à la maîtrise : c’était le moment de faire son choix parmi les professeurs de la Sorbonne. On nous serinait sans cesse, de l’autre côté de la rue Saint Jacques, que la vraie Sorbonne, c’était Paris-IV et non pas Paris-I, excroissance récente et sans grande valeur qui avait surtout – Dicunt, narrant, tradunt – donné lieu à d’homériques mais véridiques luttes de chiffonniers entre les Directeurs d’U.E.R. lorsque s’était posée la question du partage des volumes en dotation dans les Bibliothèques respectives de chaque organisme ! Bref on devait s’inscrire, si on était fidèle à notre récent passé, à Paris-IV pour y préparer l’agrégation, quitte à suivre de temps en temps les cours de Paris-I qui trouveraient grâce à nos yeux d’élite.
Donc choisir un professeur pour diriger sa maîtrise, et un professeur de Paris-IV…
Ce fut d’abord Maurice Clavelin : j’aimai sa rigueur, la netteté et la clarté de son enseignement de la philosophie des sciences et de la connaissance. Il donnait des cours de licence sur la «philosophie de la physique» et la «philosophie des mathématiques» que l’on comprenait aisément. C’était un grand pédagogue. Lorsque je lui avais expliqué que j’aimais bien les Positivistes spiritualistes, il m’avait proposé Émile Meyerson, ce qui m’avait passionné. Il dirigeait l’U.E.R. de philosophie de Paris-IV à l’époque où Raymond Polin (celui de La Création des valeurs des années 40, qui venait de publier en 1977 chez Vrin dans la collection Problèmes et controverse une critique amère et désabusée de la société giscardienne et sa mérécratie intitulée La Liberté de notre temps) était président de la Sorbonne. Mais sa discipline, et son enseignement dans les terminales des lycées, était elle-même en crise, soumise à des attaques dont les causes étaient internes et externes. Il suffit de lire l’article de Polin paru dans Le Figaro du mercredi 20 juin 1979 intitulé Quel avenir pour la philosophie ? – Point de vue : Régénérer l’enseignement, pour avoir une mise au point détaillée de ces deux types de cause, à ce moment précis.
L’enseignement en général était en crise, ouverte, déclarée et ce n’est pas la réforme du ministre Savary qui allait arranger les choses. Elle donna lieu aux manifestations de «Mai 83», qui fut notre «Mai» à nous et auxquelles je pris part sur le pont Alexandre III et au Quartier latin. Nous étions réticents à l’idée que le personnel chargé de l’entretien des locaux universitaires puisse se voir attribuer un droit de vote identique en valeur à celui d’un enseignant. Cette perversion démocratique nous semblait la marque indubitable d’un début de dictature communiste qu’il convenait de mettre au pas. Le ministre socialiste Alain Savary fut contraint de retirer son projet. Et elle donna surtout lieu à un article de Bernard Bourgeois lui-même dans Le Monde du vendredi 7 octobre 1983, dialectique, vigoureux, glacé et définitif dont le titre décourageant était L’École sans sa République ? En fait, face à la démocratie socialo-libérale marchande et barbare, ses arguments pour défendre l’enseignement humaniste et son fleuron, la philosophie, étaient déjà ceux employés par Léon Brunschvicg dans un discours de remise des prix au lycée Condorcet le 31 juillet 1902 (paru dans Les études philosophiques – 4e année, n°2 – avril-juin 1949, pp. 118 et sq. sous le titre Le Devoir des éducateurs puis dans Nature et Liberté sous le titre L’Éducation de la liberté; cf. : Brunschvicg, Écrits philosophiques, t.III, § bibliographie complète, n°28 de la p. 258, éd. P.U.F., coll. B.P.C., 1958). Régis Debray lui-même les a en somme repris dans un admirable article publié à l’adresse du débile Claude Allègre dans Le Monde du 3 mars 1998. Comme si chaque grand philosophe d’une génération passait à son successeur le flambeau tout au long du XXe siècle, flambeau condamné à l’obscurité et arguments qui ne touchent jamais l’oreille du ministre, dont seul le nom change.
À la fin de l’année universitaire 1982, Clavelin me donne la maîtrise avec mention «bien» (Paris-IV n’accordait la mention «très bien» qu’aux Normaliens) et me dit : «– Je ne puis vous garder avec moi pour une thèse de doctorat en philosophie des sciences car vous avez une formation littéraire.» Je me demandai si Léon Brunschvicg m’eût chassé de son domaine pour la même raison mais j’acceptai l’argument. Il me semblait aussi que j’avais fait le tour, grâce à Clavelin, de la philosophie des sciences et de la connaissance. Et puis, Boutroux, Poincaré, Hamelin, Le Roy, Bergson, et tant d’autres avaient déjà dit le dernier mot sur le rapport entre science et philosophie, entre science et réalité... Ce qui m’avait plu chez Meyerson, c’est qu’il les résumait tous : l’irrationnel recule devant l’assimilation de la raison mais n’est pas réductible. Mon démon philosophique me réclamait une autre source où m’abreuver. Il fallait chasser à nouveau, non pas l’être, comme chez Platon, mais un professeur !
La rencontre
C’est dans ce contexte que mon parrain, le Dr Francis Pasche (1910-1996), ancien Président de la Société Psychanalytique de Paris, lorsque je lui cite le nom de Boutang (qui avait à Paris-IV une chaire d’Ontologie et de métaphysique : le degré le plus élevé des matières philosophiques) me dit son admiration pour sa culture et son intelligence. Ils avaient passé des vacances en voisins sur une île grecque, Skorpios ou Délos, quelques années ou mois plus tôt…
Pour moi, Boutang, c’était le disciple de Charles Maurras, les « Camelots du roi » : lointain même si j’avais lu et annotée in extenso en 1978 la petite étude de Pol Vandromme, Maurras, L’église de l’ordre (éd. du Centurion, coll. Humanisme et religion, 1965). Et même si j’ai, par la suite, découpé pour l’y ranger dedans, pliée dans un rabat du verso, la critique de René Rémond sur le Maurras, la destinée et l’œuvre de Boutang qui devait paraître chez Plon en 1984, donc un an plus tard. J’avais même poussé le zèle étudiant jusqu’à y inclure un autre découpage d’un article de Gilbert Comte sur une biographie de Jacques Bainville par Jean Montador.
Boutang, c’était aussi sa prestation chez un Pivot narquois qui lui disait :
« – Bravo pour cet imparfait du subjonctif ! » et à qui Boutang répondait : « – Ah bon, parce que ça aussi, ça doit disparaître ? »
La grande classe.
Et Boutang, ce fut surtout – médiatiquement parlant, le dialogue télévisé en direct avec Steiner (en sueur, très excité, pathétique pour tout dire) où il nous promenait comme en se jouant sur les sommets les p
15/03/2016 | Lien permanent
Blow-Up de Michelangelo Antonioni, par Francis Moury

Londres 1966 : Thomas est un riche, célèbre et jeune photographe de mode qui prépare aussi un livre d’images sur la misère urbaine. Il croit capter la réalité grâce à sa technique. Un après-midi pourtant, lassé des mannequins et de la mode, il va prendre l’air dans Maryon Park. Il photographie à la volée quelques beaux plans de nature déserte puis un couple qui se trouve là. La femme exige nerveusement le négatif, tente même de le lui arracher mais Thomas refuse : le rouleau contient aussi des photos professionnelles qu’il doit développer. Son examen approfondi lui fait comprendre qu’il a photographié un meurtre et qu’il est, du même coup, devenu un témoin gênant…
Écrit pendant deux mois, réalisé à Londres d’avril à août 1966 en six semaines, monté durant un mois, Blow Up (Ital.-USA 1966) de Michelangelo Antonioni obtint la Palme d’or au Festival de Cannes de mai 1967 (1) ainsi que le Prix de la Fédération Internationale des Ciné-Clubs.
Son scénario avait été inspiré à Antonioni par une nouvelle de Julio Cortazar (1914-1984) qui flirta régulièrement avec la littérature fantastique. Antonioni n’en retint que le personnage du photographe interprété par David Hemmings. C’était le premier film qu’il tournait hors d’Italie.
Si la version française d’époque est bonne à tous points de vue, c’est bien la version anglaise (et non la version italienne) qu’il faut privilégier comme piste-son de référence car le film fut tourné avec des acteurs anglais et les dialogues originaux conçus pour cette langue. Aux USA le copyright mentionné sur les copies américaines est 1967 mais la date du film est d’un an antérieur. Là-bas, le titre s’orthographie Blowup sans trait d’union et en un seul mot tandis qu’en Angleterre il s’orthographie Blow Up en deux mots mais sans trait d’union : les affiches françaises l’ont ajouté systématiquement, ce qui donne Blow-Up.
La richesse de signification du film est déjà inscrite dans le verbe (intransitif ou transitif suivant le sens) anglais qui lui donne son titre original : «to blow up» veut dire aussi bien «éclater», «exploser», «gonfler», «agrandir une photographie» que «sermonner, tancer». Cette étymologie renvoie bien à la dynamique profonde du film.
L’univers vain et désespéré dans lequel se mouvait avec une certaine sensation d’étouffement Thomas, le héros photographe du film, va être «explosé» par la «révélation» chimique de l’agrandissement. Thomas passe à travers le miroir, par-delà les apparences, jusqu’à avoir confirmation qu’il a bel et bien photographié un meurtre. Dès lors, il comprend aussi qu’il a vu ce que personne n’aurait dû voir, été témoin de ce dont personne n’aurait dû être témoin. Mais son désir de devenir un témoin encore plus actif se heurte à sa propre peur d’une part (son appartement a été fouillé : on sait donc qu’il sait, de l'autre au désintérêt étrange de ses amis et relations. La célèbre scène finale de mimétisme qui le remet en présence d’un groupe qu’il avait déjà croisé au début du film achève de donner le sens de la «révélation» : la réalité s’est dissoute dans sa représentation. Et si telle représentation intéresse tel groupe, alors elle existe. Sinon, elle ne renvoie à rien. Critique morale absolue de la société anglaise permissive de 1967 qui laisse Thomas seul, en marge, témoin menacé, apeuré, effrayé de l’inhumanité de son propre milieu. Le film «tance», «sermonne» intérieurement ce délaissement profond qui caractérise le monde moderne et en assène un symbole sur lequel on glosa beaucoup à l’époque de sa vision.
Cette boucle toute platonicienne d’une réflexion métaphysique sur la perception, les apparences et la réalité dont un homme d’image est le héros – héros dont la vie s’écroule à cause d’une image de mort qu’il n’a nullement préméditée ni mise en scène, qui est venue à lui par hasard : revanche terrible du réel le plus aporétique –, est soutenue par une mise en scène impressionnante. Les images de Carlo Di Palma (l’un des collaborateurs réguliers d’Antonioni) et le montage de Frank Clarce organisent sournoisement le piège dont Thomas était déjà la victime puisqu’il participait à son économie. En prend-il conscience à cette occasion ? Oui, si l’angoisse est déjà prise de conscience. Il y a un existentialisme chez Antonioni, une visée métaphysique appuyée. Qu’on se souvienne simplement de l’argument du premier grand film d’Antonioni, L’Avventura (Italie, 1960) ! On y racontait une disparition qui était peut-être une mort (celle d’Anna) et qui contaminait métaphysiquement l’être et des êtres, en annihilant toute possibilité d’amour pour ceux qui en avaient été témoins, les laissant seuls face à la peur de la mort. Cet argument n’était-il pas, en fin de compte, la stricte inversion de la résurrection du Christ qui est une mort niée, transformée en présence, fondant toute possibilité future d’amour ? Blow Up creuse plus avant encore dans la même direction que L’Avventura dans la mesure où il pose d’emblée une vision de cadavre, une concrète trace de mort, puis de meurtre qui elle-même risque de s’annihiler, de disparaître sauf pour celui qui l’a indirectement révélée. Antonioni était le cinéaste de l’apophatisme : il devient celui de l’aporie. Il joue concrètement avec les notions d’être et de néant d’une manière qui les rend présentes, concrètes, compréhensibles.
Remarquons, d’un strict point de vue esthétique, que Blow Up qui semble a priori réfléchir sur l’espace, réfléchit en fait sur le temps et affirme la supériorité efficace du temps sur l’espace comme moyen d’appréhender le réel. C’est pendant que la femme brune est venue trouver Thomas que le meurtre a eu lieu. Ce laps de temps a suffi pour que Thomas ne s’aperçoive de rien. Et s’il n’avait pas repris une ou deux photos par la suite, le deuxième cliché lui serait resté inconnu. D’autre part, elle connaît son domicile : comment ? Peut-être parce que le meurtrier est son voisin peintre dont une peinture évoque étrangement la scène du meurtre, comme son épouse jouée par Sarah Miles le fait remarquer à Thomas. Le visage du peintre ressemble vaguement au visage esquissé en noir et blanc sur le premier des deux clichés révélant le meurtre. Hypothèses invérifiables parce que le temps aura repris au héros d’un même mouvement ce que son appréhension de l’espace lui avait donné par hasard. Ce combat du temps signifiant contre un espace dénué de sens, et de l’image contre la vacuité du langage : c’est tout le cinéma d’Antonioni.
Dans la filmographie d’Antonioni, cette critique globale d’un monde risquant de devenir – déjà presque devenu ! – inhumain et désespérant prolongeait directement celle de son précédent long-métrage, Deserto Rosso [Le Désert rouge] (Italie-France, 1964) et sera elle-même prolongée avec la même beauté plastique dans son film suivant Zabriskie Point (Italie-États-Unis, 1969) dont le cadre sera cette fois-ci la société américaine et aussi le désert. Le désert comme retour du temps sur lui-même : paix et résolution possible de tout conflit et de toute représentation. Une tentation permanente pour Antonioni consiste à figer l’espace afin d’échapper au temps : certains plans pourraient être, si on les immobilisait, de parfaites photos de plateau ou d’exploitation. Mais elles sont mouvantes et échappent à toute possibilité d’immobilisation : l’angoisse demeure vivante.
Dans l’histoire du cinéma, une filiation possible : Dario Argento se souviendra de toute évidence de Blow Up lorsqu’il reprendra Hemmings pour son beau film fantastique Profondo Rosso [Les Frissons de l’angoisse] (Italie, 1976) que l’on peut considérer comme un hommage sincèrement thématique (qu’il soit conscient ou non, d’ailleurs) à Antonioni à défaut d’être un hommage plastique. À noter enfin, pour les connaisseurs de cinéma-bis, que le cinéaste Piers Haggard – le futur réalisateur de ce classique du cinéma fantastique anglais des années 1970 qu’est Satan’s Skin / Blood on Satan’s Claw [La Nuit des maléfices] (Grande-Bretagne, 1972) avec Linda Hayden – est crédité comme «assistant dialogues» sur le générique.
Note :
(1) : «[…] Honneur au cinéma anglais qui reçoit le Grand Prix pour «Blow up» et le prix spécial pour «Accident», mais le premier film est de l’italien Michelangelo Antonioni et le second de l’américain Joseph Losey[…]» comme le remarque justement Robert Chazal in Cannes Memories 1946-1992 (éditions Media-Planning, Montreuil 1992), p. 124.
01/09/2007 | Lien permanent
L’alchimie du mystère chez Jean Ray, par Francis Moury

 À propos de Arnaud Huftier, Jean Ray, l’alchimie du mystère (Éditions Encrage – Les Belles Lettres, coll. Travaux, 2010).
À propos de Arnaud Huftier, Jean Ray, l’alchimie du mystère (Éditions Encrage – Les Belles Lettres, coll. Travaux, 2010). 22/09/2010 | Lien permanent
La Ferme de la terreur de Wes Craven, par Francis Moury

29/11/2010 | Lien permanent

























































