Rechercher : francis moury george romero
Bellum Dei : Guerre sainte, martyre et terreur de Philippe Buc, par Francis Moury

«Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice.»
Saint Paul, Épitre aux Éphésiens (vers 60 à 61 après Jésus-Christ), versets 6-12 à 6-14, traduction Louis Segond (1910).
«Un prêtre, nommé Pierre Barthélémy, raconta que saint André lui avait montré dans l'église de Saint-Pierre l'endroit où l'on trouverait le fer de la lance qui avait percé le côté de Notre-Seigneur. Il l'avait assuré que ce fer sacré serait pour les croisés un gage certain de leur prochaine délivrance, pourvu qu'ils fissent pénitence de leurs péchés. Ce prêtre offrait de passer au travers d'un feu pour confirmer la vérité de ce qu'il annonçait. Le comte Raymond de Saint-Gilles (1) envoya à la recherche de la lance plusieurs seigneurs, parmi lesquels était Ponce de Balazuc. On creusa à l'endroit indiqué et, après toute une journée de travail, on trouva en effet un fer de lance dont la vue exalta le courage des croisés. Ceux-ci, ranimés par l'évènement, firent une sortie et triomphèrent des Musulmans dans une bataille célèbre. Pendant tout le combat, Raymond des Agiles porta la sainte lance devant Adhémar de Monteil son évêque, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans son histoire (2). La ville d'Antioche fut délivrée (fin de juin 1098), et l'armée chrétienne put continuer sa marche vers Jérusalem.»
Abbé Fillet, Un chevalier du Vivarais à la première croisade : Ponce de Balazuc (Imprimerie centrale de l'Ardèche, 1895), pages 6 et 7.
Quel est le point commun historique, sur une longue échelle temporelle couvrant la période de l'Ancien Testament à nos jours, entre des faits en apparence aussi hétérogènes que la Guerre de Judas Maccabée, la Guerre des Juifs selon Flavius Josèphe et Tacite au 1er siècle après Jésus-Christ, les martyrs chrétiens puis païens de la période impériale romaine, la première Croisade armée médiévale en Terre sainte de 1096, le procès de Jeanne d'Arc en 1431 puis son procès en réhabilitation en 1456, les guerres de religion anglaises et françaises des années 1550-1700, la Terreur de l'année 1793 durant la Révolution française, la Guerre américaine de Sécession de 1861-1865, les purges staliniennes soviétiques de 1937-1938, les exactions de la Fraction Armée Rouge ouest-allemande entre 1970 et 1980, la première guerre d'invasion américaine de l'Irak en 2003 ?
Fascinante car très ample question dont l'étude fut initiée (voir p. 9) par l'auteur au Maroc en 2001 dans une contribution (écrite en arabe) intitulée Violence et terreur dans la culture chrétienne occidentale puis dans une conférence prononcée à l'École française de Rome en 2003 sur La vengeance de Dieu. Parmi les historiens revendiqués comme inspirateurs valables, durant la rédaction principale du livre à l'université de Stanford puis à celle de Yale, Philippe Buc cite d'emblée, et dans cet ordre : Norman Housley, Jean Flori, Jay Rubinstein, Gerard E. Caspary, Denis Crouzet. De tous, c'est Caspary qui semble son mentor : ce dernier avait été, en 1979 à l'université de Berkeley, l'auteur d'une étude sur les relations de la politique et de l'exégèse chez Origène.
Philippe Buc utilise, pour y répondre, deux types de sources. Les sources primaires sont la patristique grecque et latine, les mémoires médiévaux, les minutes de procès, les articles de journaux, les libelles et les pamphlets, les entretiens, les discours, les correspondances. Les sources secondaires sont les thèses et mémoires universitaires, les livres, les articles de revues ayant tenté de ramener cette diversité historique à l'unité théorique. Philippe Buc prévient le lecteur que sources primaires et secondaires, distinguées pour la forme par une dichotomie bibliographique en fin de volume, se recoupent cependant parfois inévitablement : saint Paul, saint Augustin ou bien encore Tertullien sont, de toute évidence, parties prenantes sur les deux plans, historiques et théoriques.
Philippe Buc met, en outre, en garde contre une méprise possible du lecteur : le sujet sélectionné n'épuise pas la matière dans la mesure où il aurait pu choisir d'étudier les formes chrétiennes du pacifisme en Occident, non moins prégnantes et avérées que les formes chrétiennes de la violence en Occident. Dans la mesure aussi où toutes les violences historiquement repérables en Occident n'ont pas leur source unique dans le christianisme : autre évidence qui allait sans dire mais qui va mieux en la disant. Cette face sombre et tourmentée de la religion n'annule ni ne remplace donc sa face lumineuse et paisible : le lecteur doit avoir conscience que toutes deux existèrent et existent encore simultanément. Cette double face présume d'une possible dialectique philosophique dans l'interprétation du phénomène religieux, dialectique au sens le plus étymologique du terme, à savoir celui de la science des contraires (la tension théologique entre l'ancien et le nouveau, entre la lettre et l'esprit, entre la guerre et la paix, entre l'élection singulière et l'universalisme, entre l'idée de contrainte et celle de liberté) mais aussi (c'est moi qui l'ajoute car Philippe Buc ne lui accorde pas assez de place à mon goût) dialectique au sens moderne hégélien puisque G.W.F. Hegel fut peut-être le premier philosophe occidental à pleinement penser l'ambivalence du sacré avant même qu'elle soit, par la suite, confirmée par les travaux sur les religions primitives étudiées sociologiquement et psychologiquement par Frazer, Freud, Lévy-Bruhl, Mauss, Durkheim ou bien encore, plus près de nous, Mircea Eliade et Roger Caillois. Qu'on se souvienne que Roger Caillois faisait, dès 1950, de cette ambivalence une des caractéristiques essentielles du sacré (3), On sait aussi que le sacré est souvent doté, dans les religions primitives ou archaïques comme dans les religions monothéistes plus récentes, d'une charge ambivalente, source de vie mais aussi dispensatrice de mort. Elle est ici symbolisée très concrètement et historiquement par l'ambivalence du martyre qui perdure depuis la Rome antique en passant par la Guerre de Sécession jusqu'aux purges staliniennes en apparences purement athées mais, si j'ose dire, martyrologiquement comme structurellement influencées par le martyre chrétien antique : victime offerte à Dieu mais aussi victime permettant de déclencher la vengeance divine sur ses bourreaux, voire d'anticiper l'Apocalypse selon saint Jean. Les démonstrations sont souples, nuancées, parfois inattendues et toujours admirablement étayées.
Un exemple permet d'ailleurs de s'en rendre compte, sans pour autant verser dans le plus niais des relativismes. L'écrivain espagnol catholique Juan Ginès de Sepulveda (1490-1573) justifia les guerres menées par les conquérants espagnols contre les peuples primitifs américains par plusieurs arguments (p. 368), d'ailleurs inévitablement repris plus tard partiellement par les colons protestants de la Nouvelle Angleterre. Outre les attaques régulièrement atroces dont étaient victimes les colonisateurs, outre les blasphèmes occasionnels dont se rendaient coupables les colonisés, des cas avérés de cannibalisme et de sacrifices humains avaient été constatés; le christianisme devait donc y mettre fin, d'une manière (paisible) ou d'une autre (armée). La conscience morale occidentale contemporaine, ainsi que Philippe Buc le signale (aussi p. 368), n'approuverait probablement pas aujourd'hui l'idée qu'il faille faire la guerre pour une raison religieuse mais elle prendrait certainement en considération l'idée qu'il faille faire la guerre pour supprimer le cannibalisme. La conception médiévale de la loi naturelle (et de son contenu conceptuel) n'est, alors, plus tout à fait une étrangère pour la diplomatie internationale contemporaine : il y a une curieuse continuité dont les solutions formelles sont méticuleusement relevées.
En somme, de l'histoire religieuse à l'histoire des religions puis à la philosophie de la religion, la conséquence existe et le dialogue entre disciplines s'avère enrichissant. Un tel livre fait regretter que l'auteur ait fait l'impasse sur les «religions politiques» (sic) du vingtième siècle que sont, aux yeux d'un certain nombre de ses confrères, le nazisme, le fascisme et le communisme mais il s'en justifie (à la page 78). Sur le plan strictement philosophique, Philippe Buc adopte une sorte de néo-kantisme renonçant à l'explication causale pour se concentrer sur les formes des phénomènes. Les thèses, sinon étiologiques du moins partiellement explicatives de Sigmund Freud (4) ne sont même pas évoquées mais celles de René Girard, de Max Weber, d'Ernst Kantorowicz, de Michel Foucault et d'autres sont citées, parfois rapidement mais justement écartées (Foucault, p. 23). Globalement, Buc se veut modeste : il n'est ni G.W.F. Hegel ni Auguste Comte qui pensaient, l'un comme l'autre, détenir la clé permettant de comprendre les causes de l'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt de fournir au lecteur contemporain les clés lui permettant de comprendre la manière dont les hommes passés ont eux-mêmes envisagé le sens de leur action.
Passons à l'aspect matériel du livre. Cette traduction française diffère de l'édition originale américaine et de sa traduction allemande de deux manières. Elle est dénuée de son «lourd apparat critique de notes» (sic) bibliographiques de bas de page (apparat bien évidemment publié dans l'édition américaine originale Holy War, Martyrdom and Terror. Christianity, Violence and the West (Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2015) et dans sa traduction allemande Heiliger Krieg (Darmstadt, Wissenchaftliche Buchgesellchaft, 2015) mais elle est munie d'une Postface inédite (pp. 449 à 465) proposant «quelques réflexions préliminaires d'histoire comparée sur violence et religion, entre Byzance, l'Islam, le Japon et le Mexique précolombien (5). Elles visent à faire ressortir par contraste les spécificités du monde que le corps du livre explore, chrétiennes comme postchrétiennes». Je recommande évidemment les intéressantes pages sur l'Islam (454 à 458) qui sont d'une actualité brûlante et celles non moins passionnantes sur le bouddhisme japonais qui connut au moins une école, celle du moine médiéval Nichiren (1222 à 1282), prônant l'étude de la sagesse et la lutte armée pour la faire appliquer par la force. Byzance est un cas intéressant : ce rameau de l'arbre catholique ne fut pas violent comme le furent les autres branches du même arbre. Philippe Buc tente d'expliquer pourquoi. Le cas du Mexique précolombien qui occupe les dernières pages me semble totalement différent des précédents et, en cela, pas tout à fait à sa place car il relève en effet de la mentalité primitive que Jean Cazeneuve (disciple de Lucien Lévy-Bruhl dont il résuma soigneusement la pensée) préférait dénommer mentalité archaïque (6).
La question qui se pose n'est pas tant de savoir si le lecteur français appréciera de disposer d'une postface inédite de quinze pages (munie pour sa part, enfin, de ses riches et précises notes bibliographiques de bas de page, faisant ainsi davantage regretter l’absence de ces mêmes notes dans les sections précédentes) que celle de savoir comment Philippe Buc, professeur français enseignant dans les universités américaines et européennes les plus prestigieuses (Stanford, Yale, Vienne, etc.) a osé accepter que la Bibliothèque des Histoires fournisse aux étudiants français une édition amputée de son apparat critique. En quoi le «pari éditorial» (p. 7) de Pierre Nora, le directeur de la Bibliothèque des histoires, d'offrir une édition allégée se justifie-t-il ? S'imagine-t-on que pour habiller Paul (un éventuel et mythique grand public cultivé ou curieux) il faille déshabiller Pierre (le très réel public universitaire, premier destinataire naturel d'un tel livre) ?
La conséquence étant que, lorsque Buc cite saint Augustin – et il le cite assez souvent : c'est même un des auteurs les plus évoqués, ainsi qu'en témoigne l'index des noms cités, p. 530 – le lecteur doit se reporter à la bibliographie pour deviner, entre les différents titres de saint Augustin qui s'y trouvent rangés comme «source primaires», de quelle page de quel texte précis peut bien provenir la citation qu'il vient de lire : du De Doctrina christiana, du De Genesi ad litteram libri duodecim, du Enarratio in Psalmos, des Scripta contra Donatistas, d'un autre titre parmi la dizaine mentionnée ? Mystère ! En l'état, sur le plan universitaire, ce livre est donc – je le dis à regret mais avec la plus grande fermeté – inutilisable tant pour l'étudiant français que pour le professeur français qui devront se reporter systématiquement à son édition américaine ou allemande s'ils veulent connaître précisément l'origine des nombreuses citations qui enrichissent constamment ce texte passionnant. Inutile de dire que ni Jacques Le Goff ni Georges Dumézil, tous deux cités avec admiration par Philippe Buc parmi les auteurs publiés en Bibliothèque des histoires et en Bibliothèque des idées à la NRF, n'auraient approuvé une telle mutilation. J’espère sincèrement qu’une nouvelle édition, rétablissant les notes de bas de page, verra le jour.
La bibliographie, intégralement conservée (frissonnons tout de même rétrospectivement en songeant qu'elle était, si on tient compte de la même logique éditoriale, passible d'un allègement) est riche et mentionne des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Certaines de ces mentions ne sont cependant, sur le plan bibliographique francophone, pas à jour. L'auteur cite, par exemple, le Manuel de l'inquisiteur de Bernard Gui (1261-1331) dans une édition du texte latin parue en 1886 alors que nous disposons depuis 1926 de l'excellente édition critique du texte latin avec traduction française, apparat critique, présentation et notes de G. Mollat et G. Drioux, d'abord éditée en deux volumes chez Champion puis reprise en un seul volume aux éditions Les Belles lettres (collection Classiques de l'histoire de France au Moyen Âge, dernier tirage 2012). Même chose pour saint Augustin dont les livres sont cités d'après d'obscures éditions allemandes ou autrichiennes du texte latin alors qu'il existe depuis 1933 une Bibliothèque augustinienne francophone munie d'excellentes éditions critiques (texte latin + traduction française, introduction, variantes et notes) publiée par l'Institut d'études augustiniennes, actuellement éditée chez Brepols et dont le site est consultable ici.
L'index des noms cités est riche, globalement fiable et bien établi mais parfois lacunaire et, dans deux cas au moins, partiellement erroné. Certains noms cités dans le livre n'y figurent pas alors qu'ils le devraient ou bien l'index fournit certaines pages où le nom est cité mais n'en fournit pas certaines autres où il l'est pourtant. Voici quelques exemples : Christine de Pizan citée p. 289 ne figure pas dans l'index; idem pour Dante pourtant cité p. 132 ainsi que pour Lactance pourtant cité p. 337, le curieux témoin Phinéas pourtant cité p. 189, l'historien allemand Ernst Troeltsch pourtant cité p. 319 (d'une manière qui me semble un peu légère sur le plan théorique : sa position méritait d'être discutée plus amplement). L'historien américain Michael Gaddis est, pour sa part, cité (p. 149) et bien référencé dans l'index mais sa référence lui confère (p. 533) le faux prénom de «John» alors que la bibliographie lui restitue (p. 502) son correct prénom Michael ! Même configuration pour Joseph-François Michaud (1767-1839) correctement nommé dans la bibliographie mais rebaptisé «Jean-François» Michaud (p. 410) dans le corps du livre et ainsi référencé dans son index des noms (p. 536) ! (7) Le reste est impeccable.
Notes
1) Raymond IV, comte de saint Gilles et de Toulouse, commandait fin octobre 1096 l'armée d'environ 100 000 soldats, levée par l'évêque du Puy Adhémar de Monteil, prenant acte des prêches du pape Urbain II environ un an plus tôt.
2) Raymond des Agiles (ou d'Aguilers), Historia Francorum qui ceperunt Hierusalem éditée par Migne in Patrologie latine, CLV, 591. Il était le chapelain du comte Raymond de saint Gilles avec qui il ne faut évidemment pas le confondre. Il existe une belle édition critique bilingue d'un autre témoin, un chevalier italien rallié aux troupes de Bohémond de Tarente, à savoir Histoire anonyme de la première croisade [Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum] (1096-1099), présentation, édition latine et traduction française par Louis Bréhier (éditions Les Belles lettres, Classiques de l'histoire de France au Moyen Âge, dernier tirage 2007).
3) Roger Caillois, L'Homme et le sacré (éditions Gallimard, NRF, 1950).
4) Philippe Buc aurait dû au moins citer, dans son chapitre 3 intitulé Folie, martyre et terreur, la célèbre étude freudienne de psychanalyse appliquée sur Une névrose démoniaque au dix-septième siècle (initialement parue dans Imago, tome IX, fascicule 1, Vienne et Leipzig 1923) traduite par Marie Bonaparte dès 1927, traduction revue et approuvée par Freud lui-même, puis reprise dans Freud, Essais de psychanalyse appliquée (éditions Gallimard, NRF, 1933 puis collection Idées Gallimard, 1971). Cette lacune est difficilement excusable.
5) En somme, Philippe Buc retrouve in extremis le thème ethnographique qui était au cœur de l'étude anthropologique si célèbre de Georges Bataille, La Part maudite (éditions de Minuit, 1949 puis réédition posthume augmentée, 1967).
6) Jean Cazeneuve, La Mentalité archaïque (éditions Armand Colin, 1961).
7) J'en profite pour signaler que l'ahurissante coquille «Victor Deblos» dans la bibliographie finale de mon Introduction à la philosophie des sciences d'Émile Meyerson (1859-1933) n'est, évidemment, pas de mon fait : il faut lire Victor Delbos, l'un des trois grands Victor de l'histoire française de la philosophie et de l'histoire de la philosophie française tout autant, avec Victor Cousin et Victor Brochard.
09/05/2019 | Lien permanent
L’humanisme classique de Michel Desgranges ou l’actualité des Belles Lettres, par Francis Moury

05/11/2007 | Lien permanent
2001 : l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, par Francis Moury

 Critiques cinématographiques de Francis Moury parues dans la Zone.
Critiques cinématographiques de Francis Moury parues dans la Zone.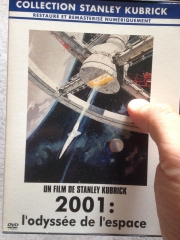 Acheter 2001 : l'odyssée de l'espace (livres + DVD et bluray) sur Amazon.
Acheter 2001 : l'odyssée de l'espace (livres + DVD et bluray) sur Amazon.2001 : l’odyssée de l’espace [2001 : A Space Odyssey] (États-Unis, 1968) de Stanley Kubrick est sa seule contribution à la science-fiction cinématographique puisque Shining (États-Unis, 1980) appartient pour sa part au fantastique. La surprise n’était, certes, pas totale pour le spécialiste de science-fiction. Les deux thèmes principaux du film, à savoir l'existence d'une intelligence extra-terrestre d'une part, la conquête spatiale d'autre part, avaient déjà été traités par la science-fiction au cinéma et en littérature. En outre, l’histoire contemporaine du cinéma a formellement identifié, concernant 2001, un certain nombre de sources plastiques directes : En route vers les étoiles (U.R.S.S., 1958) de Pavel Klushantsev, Universe (Canada, 1960) de Roman Kroitor et Colin Low, d'autres titres encore dont certaines images furent reprises, parfois par plan ou détails de plans, par Kubrick dans 2001. En outre, la même année, sortait le très réaliste du point de vue technique, au point d’en être prémonitoire, Les Naufragés de l’espace [Marooned] (États-Unis, 1968) de John Sturges. Quant à la séquence préhistorique avec ses acteurs humains déguisés en singes anthropoïdes, elle est remarquable mais strictement contemporaine de la première adaptation cinéma de La Planète des singes (États-Unis, 1968) de F. J. Schaffner d'après le roman de Pierre Boule, dotée d'un maquillage tout aussi réussi.
L’originalité de 2001 est pourtant patente en raison de l'intellectualisme revendiqué de son scénario et de l'intelligence de sa syntaxe, mais aussi par l'ampleur budgétaire et le soin scientifique apporté à la prospective et au design. Il s’ouvre sous les auspices sonores du poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, composé d’après le poème philosophique de Friedrich Nietzsche. Indication majeure immédiatement fournie, presque gracieusement, par un film réputé difficile mais dont le symbolisme est, au fond, assez évident. Adapté d’une nouvelle de Arthur C. Clarke (1917-2008), The Sentinel, elle-même transformée en roman durant les années 1964-1968 à mesure que Clarke travaillait avec Kubrick au scénario, le film 2001 est divisé en quatre parties.
La première partie évoque la naissance de l'intelligence aux temps préhistoriques, intelligence apportée aux singes anthropoïdes par la hiérophanie d'un mystérieux monolithe minéral noir, intelligence se traduisant simultanément et dialectiquement par l'invention de l'outil et de l'arme, enclenchant le processus de l'histoire humaine.
La deuxième partie rapporte, des siècles plus tard (en 1999) et alors que la conquête spatiale de l'univers est engagée par des moyens techniques stupéfiants, la présence du même monolithe (âgé, selon les analyses, d'environ 4 millions d'années) enterré «volontairement» dans le sol du cratère lunaire Tycho. Présence tenue secrète par les autorités terrestres mais révélée à une poignée de scientifiques triés sur le volet, qui font le voyage depuis la base lunaire de Clavius pour le contempler. Il s'agit toujours d'une hiérophanie (musicalement portée à nouveau par le Requiem de György Ligetti), mais dans un contexte fonctionnel et technique paradoxal puisque son effet semble nul sur les hommes qui la contemplent alors qu'il était actif sur les anthropoïdes. Le suspense naissant de cette seconde révélation est le suivant : que présage cette réapparition pour les hommes ?
La troisième partie débute 18 mois plus tard, en 2001. Durant une mission spatiale vers la planète Jupiter, des astronautes comprennent que l’ordinateur gérant leur fusée a décidé de les assassiner car il est le seul à en connaître le but et il en pressent un mystérieux bénéfice. Il échoue de justesse car le dernier survivant parvient à le déconnecter. C'est alors seulement qu'un message enregistré lui révèle l'objet de la mission : découvrir pourquoi le monolithe lunaire émet des ondes radios, donc des signaux, vers Jupiter. C'est la plus excitante et la plus réussie des quatre parties du film dans la mesure, aussi, où elle pourrait constituer un film à elle seule, ce qui n’est pas le cas des trois autres parties. L'ambivalence dialectique de l'histoire de cette troisième partie consiste en ceci : l'homme assassine une machine quasi-humaine se considérant supérieure à l'homme bien que l'homme l'ait créée. C'est donc, ironie de l'histoire, à nouveau par un meurtre que l'homme (le dernier homme vivant du vaisseau, en l'occurrence) progresse, s'appropriant la connaissance dont rêvait la machine, parvenant au terme d'un voyage initiatique qui le modifie à tout jamais, et qui aurait peut-être modifié aussi la machine si elle l'avait effectué à sa place. Il s’agit d’un meurtre par lequel la machine voulait progresser elle aussi, en s'appropriant les bénéfices gnoséologiques de la mission.
Il faut d'ailleurs bien noter que l'ordinateur se comporte, au début de cette troisième partie, non comme l'enfant des hommes mais comme leur père quasi divin, omniscient et père soupçonneux sous un aspect amical. La perfection d'une entité organisée quelconque, assure-t-il, consiste à réaliser le maximum de ses possibilités : cette assertion est à la fois leibnizienne et nietzschéenne, selon qu'on lui accorde métaphysiquement une portée davantage logique ou davantage morale. On a souvent signalé que le début de la révolte de l'ordinateur dans 2001, les prémices de la revendication de son autonomie, l'imminence de l'assassinat collectif qu'il ourdit, sont connotés par le fait qu'il pose brusquement une question (psychologique) au lieu de répondre aux questions (techniques) des hommes. Inversement, il retrouve sa position originale d'enfant pendant qu'on détruit sa mémoire, entraînant de facto sa régression puis sa «mort». Mort qui permet enfin au message enregistré d'être délivré au survivant humain, dès lors embarqué dans une odyssée sans retour réel, à la différence de l'odyssée homérique.
La quatrième et dernière partie raconte cet ultime voyage qui aboutit à une transformation métaphysique : par-delà le temps et l'espace, arrivé en vue de Jupiter, l'astronaute se retrouve sans solution de continuité, comme en un étrange rêve, mi angoissant, mi apaisant, face à lui-même vieilli puis agonisant alors qu'émerge un bébé mutant contemplant, avec un étrange sourire, la Terre. Ce voyage – au sens argotique des années 1965-1970 : hallucination provoquée par la drogue (l'œil en gros plan filmé en équidensités était déjà un «ultimate trip» selon le slogan publicitaire allusif du film) – décontenança la majorité des spectateurs en dépit de sa beauté plastique et de son ampleur narrative aboutissant à rien moins que la naissance ultime d’un surhomme, voulue par une puissance supérieure à l’homme, puissance à nouveau incarnée par le monolithe énigmatique, impassible, solide à la perfection géométrique, épure à l'aspect solide, se jouant de l'espace et du temps, ordonnant un projet final inconnaissable mais manifesté par les étapes dramatiques précédentes que le film n'a pour unique but que d'organiser lui-même comme hiérophanie tétralogique dont l'homme apparaît l’instrument, le vecteur, le témoin et l’acteur tout à la fois. Un sacré muet, sans parole mais se manifestant par une apparition concrète et par l'émission d'un signal, vécu en actes à quatre moments clés de l'histoire elle-même symbolisée comme un voyage de l'humanité vers un terme extrême : la surhumanité. Le poème symphonique de Richard Strauss composé d'après le Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche est, ainsi, un accompagnement musical que le dernier plan de 2001 justifierait d'une manière grandiose. L'esclavage de l'homme par la machine ayant échoué, on saisit alors que le monolithe annonçait une autre péripétie, une nouvelle étape de l’évolution : après l'homme-animal devenu homme par la simple grâce de l'apparition monolithique, après l'homme devenu père de la machine puis de machines devenues elles-mêmes rivales de l'homme, une troisième étape est annoncée par l'échec de la machine, par le fait qu'un unique survivant parvienne au terme du voyage prévu : la transformation finale de l'homme en surhomme. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de noter que le vaisseau spatial a la forme anthropologique d'une tête attachée à une colonne vertébrale elle-même arrimée à une sorte de bassin, ce qui, sous certains angles dans certains plans, donne l'impression qu'un curieux squelette humain privé de membres s'avance dans l'espace.
2001 apparut à la critique comme aux spectateurs tantôt grandiose mais incompréhensible, tantôt vain et formaliste. Tous furent évidemment séduits par la beauté plastique du format Cinérama (SuperPanavision 70mm) et par l’ambition métaphysique évidente du propos, ambition par ailleurs pessimiste : l'homme ne peut, s'il veut survivre, demeurer simplement homme, il doit être dépassé, se nier (les cosmonautes, dans 2001, ont des rapports abstraits avec leurs familles qu'ils ne voient que par écrans interposés, images ectoplasmiques, lointains reflets des présences terrestres dont ils sont irrémédiablement distants) ou accepter d'être nié (sinon par une machine, du moins par une puissance supra humaine résidant près de Jupiter) pour se transformer... En quoi ou en qui ? Le suspense ultime de 2001 est que le spectateur n'a pas la réponse à cette question, le film se clôt donc sur un ultime mystère.
L'idée d'un monolithe agissant à des moments clés de l'histoire humaine, émettant des signaux vers une source elle-même mystérieuse, dont on ne s'approche qu'en risquant sa raison et sa vie, empruntait autant à la science-fiction qu'à l'histoire et à la sociologie des mythes et des religions. Elle renvoyait donc, en dépit des apparences, autant au passé qu'au futur. Nietzsche avait parfaitement conscience de cette solidarité trans-historique entre les différents moments de l'expérience humaine : il avait lu soigneusement G.W.F. Hegel, connaissait l'histoire comparée des religions, la sociologie et la psychologie des religions, ainsi que l'histoire de la philosophie. Nietzsche voulait, avec une ironie supérieure, dépasser l'homme en pleine connaissance de cause, afin de retrouver un rapport immédiat au sacré sous une forme inédite, enfin purifiée, enfin pure.
Était-ce le cas des auteurs et producteurs de 2001 ? Rien n'est moins sûr. Leur souhait était, à partir d'un schéma assez simple, de créer un suspense esthétiquement novateur, intellectuellement ambitieux mais qui fût – et il le fut – une auberge espagnole où chaque spectateur mettrait ce qu'il souhaitait mettre en guise de signification. On connaît la formule de l'écrivain Arthur C. Clarke qui disait, en substance : si vous pensez avoir compris 2001, c'est que nous avons échoué. Il y a, dans cette formule, l'aveu d'une indécision qui frise la désinvolture et qui n'est, philosophiquement, pas acceptable car elle contredit dans les termes l'ampleur revendiquée de l'entreprise.
2001 ? Ambitieux mais trop désinvolte, spectaculaire mais peut-être un peu maniéré et formaliste dans sa présentation qu'on peut estimer autant décevante que gratifiante, in fine. Il faut noter d'ailleurs que le film le plus réaliste de 1968 ne fut pas celui de Kubrick – en dépit de ce que s'évertuent à vouloir prouver les suppléments (riches en témoignages de première main sur la production du film de 1964 à 1968) du bluray de l'édition collector française – mais celui de John Stuges qui, lui, fut réaliste au point d'annoncer un événement qui devait se produire par la suite.
Sur le thème d'une origine de l’homme remontant à une entité ou à une race supérieure contrôlant ou déterminant, volontairement ou accidentellement, sa destinée possible, on peut donc préférer les non moins authentiques mais plus modestes tentatives que sont Les Monstres de l’espace [Quatermass and the Pit] (G.-B., 1967) de Roy Ward Baker ou Alien Vs. Predator (États-Unis, 2004) de Paul W.S. Anderson. Quant à la conquête spatiale, une foule de films de science-fiction l'avait déjà prise pour thème central, depuis les métrages fantastiques de Georges Méliès au très sérieux La Femme sur la Lune (All., 1927) de Fritz Lang et La Conquête de l'espace (États-Unis, 1955) de Byron Haskin. Le thème de l'espace et du temps modifiés par un voyage spatial induisant une transformation irréversible de l'homme, fut, l'année suivante, le sujet non moins métaphysique du remarquable Danger : planète inconnue [Journey To the Far Side of the Sun] (G.-B., 1969) de Robert Parrish. C'est, encore une fois, probablement le thème transhumaniste de la révolte cybernétique de l'ordinateur, se considérant comme plus humain que l'homme et destiné à lui succéder, qui était sinon le plus original, du moins le plus novateur dans son traitement dramaturgique. Sans la troisième partie de ce Kubrick de 1968, nous n'aurions probablement pas eu des films reposant sur un thème similaire ou utilisant ce thème d'une manière directe dans le scénario, tels que Le Cerveau d'acier [The Forbin Project] (États-Unis, 1970) de Joseph Sargent, Generation Proteus [Demon Seed] (États-Unis, 1977) de Donnald Cammel, Alien (États-Unis, 1979) de Ridley Scott, Terminator (États-Unis, 1985) de James Cameron qui en constituent la postérité la plus évidente. La quatrième partie, quant à elle, se situe, dans l'histoire du cinéma, au carrefour du documentaire spatial (surchargé d'effets spéciaux et de trucages qui contredisent son réalisme par ailleurs revendiqué en d'autres parties du métrage) et du cinéma expérimental de la nouvelle vague underground des années 1965-1970, raison pour laquelle elle semble avoir aujourd'hui assez mal vieilli, ou du moins vieillir plus mal que les trois parties précédentes, en dépit de la belle puissance symbolique du plan final.
10/08/2016 | Lien permanent
Night of the Demon de Jacques Tourneur, par Francis Moury

Angleterre 1957 : Julian Karswell, riche fondateur d’un culte sataniste, est menacé par une enquête publique à son encontre, menée par le professeur Harrington à la suite du meurtre commis par Rand Hobart, un de ses disciples. Harrington assure un soir à Karswell qu’il mettra un terme à l’enquête à condition que Karswell le protège de la terrible menace qui pèse sur lui. Karswell sait exactement de quoi il s’agit et le lui promet mais ne peut pas ou ne veut pas tenir sa promesse. La mort atroce de Harrington provoque la reprise de l’enquête par son ami américain le Dr. Holden, venu à Londres la poursuivre publiquement à l’occasion d’un congrès de pychologie et de parapsychologie. Karswell menace Holden de subir un sort analogue à celui de Harrington : être déchiqueté par un démon venu de l’Enfer, au terme échu de la malédiction qu’il a lancée sur lui, suivant une technique médiévale occulte dont il détient la maîtrise. Joanna Harrington, la nièce du professeur, est persuadée que Holden court le même danger que son oncle. Elle tente de l’aider, avec l’aide de la propre mère de Karswell, effrayée par les agissements de son fils. Le temps accordé à Holden, avant sa mort annoncée par Karswell, est de quelques jours. D’abord incrédule, Holden ne peut que prendre en compte les signes maléfiques qui s’accumulent rapidement autour de lui : il devient bientôt persuadé lui aussi qu’il mourra durant la terrible «Nuit du démon». La question qui se pose à lui n’est plus, dès lors, de savoir si elle existe mais de savoir comment y survivre.
Critique
«Because he knows, a frightful fiend
Doth close behind him thread.»
Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, §VI (1798).
Night of the Demon / Curse of the Demon [Rendez-vous avec la peur] (Angleterre, 1957) de Jacques Tourneur est un cas limite dans sa filmographie. Son édition en coffret Bluray et DVD, parue le 27 novembre 2013 dans la collection Classics Confidential de Wild Side Vidéo, assortie d’un livret rédigé par Michael Henry Wilson, permet de mieux prendre sa mesure.
Adapté d’une nouvelle de l’écrivain universitaire anglais Montague Rhodes James (1862-1936) intitulée Casting the runes (1), le scénario de Charles Bennett – auquel Cyril Enfield aurait travaillé – lui assure une efficacité originale. Bennett avait été scénariste de Alfred Hitchcock : il transforme la nouvelle de James en un hallucinant suspense, à l’architecture symétrique impeccable, émaillée de moments plastiquement cauchemardesques alors que le récit de James était, comme d’habitude, très retenu et allusif mais distillant une peur calculée d’autant plus insidieuse. Toute la distance qui sépare l’art fantastique de la littérature fantastique : distance nécessaire en raison de la concision temporelle du récit cinématographique. Pourtant, l’essentiel de l’ambivalence effrayante, fondatrice de la peur essentielle au genre fantastique, du récit de James est magnifiquement préservé sinon amplifié par Tourneur.
Certes, on sait depuis longtemps que l’apparition du démon à l’ouverture du film a été réalisée (peut-être par le cinéaste Michael Gordon crédité ici du seul montage) à la demande du producteur contre l’avis de Tourneur qui ne voulait le montrer que d’une manière ambivalente en un plan bref vers la fin. Pourtant, cette ouverture, telle qu’elle est montée et filmée, ménage aussi l’ambivalence : qui nous dit que le démon médiéval n’est pas l’effet d’une hallucination, que Harrington n’est pas simplement électrocuté ? C’est la suite du film qui nous fera reconsidérer notre point de vue, tout comme Holden reconsidère le sien. Wilson écrit dans son livret que le spectateur a un temps d’avance sur le héros à cause de cette séquence : ce n’est pas à cause de celle-là qu’il en a un mais à cause du générique. Nous y reviendrons. Tourneur maintient l’ambivalence in-extremis : Karswell meurt –il écrasé par un train ou déchiqueté par le même démon ? Voit-il le parchemin brûler par lui-même ou croit-il le voir alors que le parchemin brûle sur un charbon ardent rejeté par une locomotive ? La stricte objectivité de ces deux séquences spectaculaires maintient l’ambivalence. On sait que Sabatier admirait le plan de la fumée sortant de la locomotive dans laquelle le démon apparaissait aux yeux de Karswell : il y voyait l’essence du génie plastique de Tourneur et l’essence de sa thématique reposant sur l’incertitude, l’inquiétude, ici la terreur pure face au destin.
Bien sûr, Night of the Demon est un film d’épouvante : entre l’ouverture et la fin, certaines séquences semblent rompre l’équilibre mais à y regarder de près, rien n’est certain. Holden assailli par un «démon mineur» félin dans la bibliothèque, puis par un «démon majeur» dans le bois de Lufford Hall est-il vraiment assailli ou bien seulement victime d’un charme psychologique, d’un envoûtement hallucinatoire, voire d’une machinerie comme il le suggère à Joanna dans le bureau de Scotland Yard ? Aux yeux des producteurs et du grand public, une telle ambivalence n’était pas tenable : il fallait montrer le démon, faire savoir qu’il existait, montrer quelles techniques l’évoquaient, quelles techniques pouvaient permettre d’en venir à bout. Dont acte : au premier degré, Night of the Demon affirme la réalité du démon au sens théologique du terme, en reprenant sa tradition picturale. Au second degré, le film va plus loin.
Ici encore, le thème tourneurien du cercle (2) est illustré : Night of the Demon repose sur le rapport entre le pré-générique filmé à Stonehenge d’une manière documentaire par Tourneur et la séquence située vers le milieu du film où Holden visite Stonehenge à la recherche de l’emplacement gravé du parchemin : le plan comparant le parchemin et les caractères runiques gravés dans la pierre monolithique, manifeste que les Démons de l’enfer sont aujourd’hui aussi actifs qu’ils le furent lorsque les monolithes furent érigés, monolithes témoins d’une mentalité primitive qui les craignait et y croyait absolument. Il faut remarquer que la fiction transforme ici, pour les besoins de la cause, Stonehenge en Pierre de Kensington dans la mesure où aucun message runique n’est inscrit sur les pierres de Stonehenge : Wilson n’en dit pas un mot dans son livret. Ce n’est donc nullement le démon vu par Harrington qui nous donne un véritable cran d’avance par rapport au héros, c’est ce pré-générique documentaire filmé à Stonehenge. C’est parce que l’action du film contraint Holden de venir précisément là, en plein milieu du film, examiner un signe dont dépend dorénavant sa vie qu’une première boucle est bouclée, que le destin manifeste clairement sa terrible emprise (3). Autre boucle, celle-là purement plastique : Karswell sera à terre face au démon sur la voie ferrée comme Holden l’a été dans le bois de Lufford Hall, sous le même angle. Enfin le dialogue insiste sur l’idée de la circularité terrifiante de l’économie démoniaque : «Si ce n’est pas sa vie, ce sera la mienne qui sera prise» dit en substance Karswell à sa mère. Le récit de James reposait aussi dessus puisque c’était cet effet qui en déterminait la conclusion. Enfin c’est l’évocation hypnotique – une technique qui inspira la psychanalyse de Freud et qui contribue ici à sauver la vie de Holden – de la «Nuit du démon» de Hobart qui permettra à Holden d’apprendre comment résister à la «Nuit du démon» de Karswell.
Sur le plan purement théologique, il faut remarquer que Montague Rhodes James ne donnait qu’une seule définition précise de Karswell dans sa nouvelle : Karswell ne pardonne jamais les offenses qu’on lui fait. Ce qui suffit à en faire une sorte d’Antéchrist. Le Karswell de Bennett, Enfield et Tourneur est moins ample et lointain : humanisé, il devient une victime de sa propre démesure, par la faute annexe de sa propre mère qui enclenche – alors qu’elle voudrait son bonheur– un processus le menant à sa perte, permettant également à Holden de renverser la situation. Ce n’est pas cet aspect psychanalytique sur lequel Tourneur insiste mais il fait aussi partie du film : Karswell n’est pas marié, il vit seul avec sa mère désolée d’un tel célibat. A défaut de procréer, Karswell – lorsqu’il ne se déguise pas en clown pour amuser les enfants et s’amuser lui-même : clown terrifiant capable de provoquer une tornade ! – évoque : il fait jaillir des ténèbres une lumière démoniaque capable d’anéantir celui qui la visionne ! Cette survirilité inhumaine le détruira lui-même lorsque le processus sera retourné contre lui. C’est alors son essentielle passivité qui sera mise en lumière et qui le perdra. Karswell n’avait rien fait d’autre que rechercher sa vie durant un code lui permettant de décrypter un langage primitif. Mais ce langage était un langage magique lui permettant la toute-puissance jusqu’à un certain point : le point précis où Holden le rattrape logiquement. La sémantique vue comme une passivité démoniaque : savoureuse amorce de critique psychanalytique. On songe à l’article de Francis Pasche, Le psychanalyste sans magie, paru dans Les Temps modernes n°50, qui répondait à l’article de Claude Lévi-Strauss, Le Sorcier et sa magie, paru dans la même revue la même année 1949 et qui comparait le psychanalyste au chaman des sociétés primitives, comparaison indue et non avenue contre laquelle Pasche s’était clairement inscrit en faux (4).
Le discours manifeste de Night of the Demon est bien, au final, que le Démon existe mais s’agit-il du démon intime, subjectif, imaginé au point d’être tout-puissant aux yeux des protagonistes principaux ou bien s’agit-il du démon objectif médiéval ? Les effets de circularité entre l’espace et le temps, effets implantés par la mise en scène de Tourneur et le script de Bennett, concourent à rendre finalement impossible une délimitation totale. Devant l’irrationnel, la raison doit s’avouer limitée. Au terme du film, le spectateur et le héros se retrouvent donc, cette fois-ci assurément, sur le même plan ontologique et gnoséologique. Et lorsque le hurlement d’un second train déchire le silence de la nuit, les deux frissonnent dorénavant de concert. La transmutation spectaculaire opérée par la mise en scène de Jacques Tourneur aboutit à cet effet final : transformer le réel le plus banal en un élément démoniaque, pour tout dire expressionniste au sens que Goethe donnait à ce terme et au sens où Lotte H. Eisner l’avait employé. Alors que Tourneur avait filmé, jusqu’à 1956 inclus avec Nightfall, le fantastique d’une manière strictement réaliste, la poésie gisant davantage dans le scénario que dans sa mise en scène très concrète. C’est en cela aussi que Night of the Demon est un cas limite stylistique dans sa filmographie (5) : il prolonge l’esprit de la série Val Lewton tout en modifiant profondément sa forme, son style. Tourneur donnera par la suite encore quelques films au genre, notamment son savoureux et plastiquement beau Comedy of Terrors, parodie shakespearienne de la série Edgar Poe de Roger Corman.
Notes
(1) Le Document secret [Casting the runes], faisait partie du recueil original More ghost stories (1911); Michael Henry Wilson signale dans son livret que sa traduction française se trouve dans les Histoires de fantômes anglais, anthologie rassemblée et préfacée par Edmond Jaloux (Éditions Gallimard, 1962).
(2) Voir notre critique de Nightfall (États-Unis, 1956) de Jacques Tourneur, réalisé l’année précédente, qu’il ne faut pas confondre avec le moyen-métrage fantastique Nightcall (1964) du même Jacques Tourneur, tourné pour la série Twilight Zone de la télévision américaine.
(3) Le titre américain Curse of the Demon renvoie à cette pérennité. Certaines affiches de 1957 et 1958, reproduites dans le livret, allaient plus loin : on y voyait une silhouette en assaillir une autre à l’aide d’une arme blanche ou d’un gourdin dans Stonehenge alors que rien, dans le film, n’y correspond. Profitons-en pour préciser que seule la version anglaise Night of the Demon est la version intégrale du film : c’est bien elle qui fut présentée en France, uniquement en VOSTF, dans les salles de cinéma et dans les cinémathèques françaises ainsi qu’à la télévision française. La version américaine titrée Curse of the Demon est une version plus ou moins gravement mutilée par ses divers distributeurs. C’est elle, si on en croit les affiches belges mentionnant le titre original américain, qui fut distribuée en Belgique francophone sous le titre Rendez-vous avec la peur. Je profite de ces précisions pour signaler que seule la VOSTF de Night of the Demon mérite d’être entendue à cause du fait que Tourneur attachait un soin particulier à la direction phonique des acteurs qu’il sélectionnait aussi en raison de leur voix. Son attachement filmographique à l’acteur Dana Andrews était, pour partie, certainement motivé par la tonalité très particulière de la voix de cet excellent acteur. Idem pour les autres acteurs du film, tous excellents à commencer par Niall MacGinnis dont c’est le plus grand rôle.
(4) Cet article de Pasche est l’un de ceux qui furent oubliés dans la bibliographie établie par Michèle Bertrand, Francis Pasche (P.U.F., 1997, collection Psychanalystes d’aujourd’hui) et il fait partie du groupe de ceux qui sont absents des trois recueils d’articles de Pasche parus, de son vivant ou posthume, chez Payot (1969) et aux P.U.F. (1988 et 1999).
(5) Cet expressionnisme ontologique se manifeste plastiquement dans Night of the Demon par la direction de la photographie N&B telle que Tourneur l’exigeait : effets de clair-obscur, trucages optiques, trucages physiques, contraste obsédant, décors d’intérieur admirablement dessinés. La direction artistique très soignée du cinéma britannique de 1955-1960 le permettait : c’est aussi l’époque des premiers grands Hammer Films anglais. Bizarrement, Tourneur ne semble pas avoir vraiment mesuré ce tournant esthétique, unique dans son œuvre et très particulier même s’il disait que Night of the Demon lui avait montré la voie à suivre. On sait que nul n’est moins bien placé que le créateur pour juger de son œuvre. Qu’on en juge puisqu’il rêvait au même moment d’un documentaire réaliste sur les maisons hantés, avec ordinateurs et appareils de physique permettant les mesures des ectoplasmes. En somme, tout le contraire de l’expressionnisme esthétique et thématique de Night of the Demon ! Tourneur voulait faire ce que font les protagonistes du The Legend of Hell House [La Maison des damnés] (Angleterre, 1973) de John Hough, adaptation plus ou moins fidèle du roman de Richard Matheson mais aussi remake technocratique et technologique du beau The Haunting [La Maison du diable] (États-Unis, 1963) de Robert Wise. Cf. la critique assassine de Jean-Marie Sabatier sur le film de Hough in Saison cinématographique.
02/02/2014 | Lien permanent
Sur des illusions perdues... et sur des illusions à entretenir !, par Francis Moury

12/09/2006 | Lien permanent
Nightfall de Jacques Tourneur, par Francis Moury

 Résumé du scénario
Résumé du scénario Wyoming et Californie, Los Angeles, 1956 : la vie de James Vanning, un homme ordinaire qui campait dans les montagnes avec son ami médecin, bascule après leur rencontre avec deux gangsters meurtriers qui viennent de voler 350 000 dollars. Ils abattent le médecin et laissent Vanning pour mort mais oublient le sac contenant le butin à côté de son corps inanimé. La nuit venue, Vanning se réveille… alors qu’ils reviennent pour l’achever et récupérer le sac. Vanning n’a que le temps de s’enfuir. Les deux criminels le traquent jusqu’à Los Angeles…
Critique
«De tels retournements de situation, de tels écarts entre la cause et l’effet, sont la règle sur ce théâtre d’ombres où rien n’est jamais définitivement acquis, où les puissances trompeuses se jouent de nos facultés de jugement, où l’esprit vacille au seuil de vérités insoutenables. Le concept de suspense, impliquant une libre détermination de la créature, n’a plus cours ici car le Destin ne frappe jamais à l’endroit ni au moment où on l’attend : il surgit au détour d’un plan, inexplicable, imprévisible. […] Comme cet accident de voiture sur une route enneigée du Wyoming qui livre James Vanning aux angoisses d’une chasse à l’homme (Nightfall d’après David Goodis).»
Michael Henry, fiche Jacques Tourneur, in Dossiers du cinéma, Cinéastes, 3 (Casterman, Belgique, 1974), p. 194.
Réalisé par Jacques Tourneur presque dix ans après son film noir américain RKO La Griffe du passé / Pendez-moi haut et court [Out of the Past / Build My Gallows High] devenu un classique du genre, Nightfall (1) est co-produit par l’acteur Tyrone Power et distribué par la Columbia en 1956. Dans la filmographie générale de Jacques Tourneur (1904-1977), Nightfall précède son génial Night of the Demon / Curse of the Demon [Rendez-vous avec la peur] (G.-B., 1958). De même que le roman de David Goodis Nightfall [Vicious Circle] adapté par Stirling Silliphant, la nouvelle fantastique anglaise de Montague Rhode James adaptée par Tourneur dans Night of the Demon décrira elle-aussi un «cercle vicieux» : l’une des figures les plus habituelles du destin lorsqu’il tourmente les pauvres humains, créatures semblables, sinon à des ballons de papier comme dans le titre d’un film japonais classique, du moins à la boule rebondissant sans cesse en équilibre sur le jet d’eau du bassin de la petite ville frontalière mexicaine où rôde L’Homme léopard, peut-être le chef-d’œuvre absolu de Tourneur bien qu’il soit moins connu que La Féline [Cat People] et que Vaudou [I’ve Walked With a Zombie], tous trois produits par le grand Val Lewton et distribués par la RKO Pictures en 1942-1943. Le thème du cercle est patent dans la filmographie de Tourneur : un de ses films a d’ailleurs pour titre original Circle of danger [L’Enquête est close] (États-Unis, 1951). À partir du thème cauchemardesque (classique dans la littérature et le film noir américain) du fugitif innocent basculant dans une vie de peur et d’angoisse, David Goodis avait, de son côté, déjà traité en 1946 le sujet, en adjoignant déjà à son héros l’aide d’une «anti-femme fatale» : Dark Passage (1947) adapté au cinéma par Delmer Daves sous le même titre (2).
Ni pour le romancier Goodis, ni pour le scénariste Stirling Silliphant, ni pour le cinéaste Jacques Tourneur un tel sujet n’a donc rien de spécialement nouveau mais il est ici, comme souvent dans les bons films de Tourneur, sous-tendu par autre chose que son discours manifeste : un discours latent analogue à celui des rêves et des cauchemars nous y parle, et nous y parle un ton plus bas – comme Henry l’avait déjà bien noté en 1974 – que dans les productions habituelles d’Hollywood. La structure anamnésique du script de Silliphant permettant d’alterner ville et montagne alors que le roman de Goodis était majoritairement urbain voire statique, d’alterner déplacements et transferts avec des moments de réflexion ou d’absences (au sens physique, parfois : le regard cherche un objet ou une personne qu’il ne trouve pas et le suspense nait de cette absence, de ce vide presque ontologique), la cruauté insigne de la mort du second gangster et celle de la torture dont on menace Aldo Ray, la rencontre improbable des deux solitudes que sont Ray et Anne Bancroft (cette dernière alors au sommet de son érotisme et de sa beauté) : tous ces éléments concourent à créer cette sensation de (parfois) mauvais rêve baigné par une musique à la mélodie curieusement envoûtante, baigné aussi par une photo aux registres très heurtés (neige nocturne, neige diurne, ville nocturne, ville diurne) sans solution de continuité sauf durant l’aube, le crépuscule, seules périodes indécises laissant un répit possible aux héros. Ce dernier terme est d’ailleurs, on le sait, lui-même inadéquat : il n’y a pas de héros chez Tourneur, du moins pas dans le sens où on l’entend ordinairement. Jean-Marie Sabatier pensait qu’un cinéaste tel que Mario Bava se situait du côté des Tragiques grecs, des Présocratiques et de la poétique de Gaston Bachelard : l’univers de Jacques Tourneur n’en est pas si éloigné, dimension nécrophilique (le cinéma de Bava étant autant une physique qu’une métaphysique aristotélicienne de la mort, comme nous l’avons rappelé à propos de son Ecologia del delito / Reazione a catena [La Baie sanglante]) mises à part. Car chez Tourneur aussi, le Destin, la Némésis, l’Ananké, les quatre éléments composent d’étranges tableaux, oscillant constamment entre volonté et représentation, comme eût dit Arthur Schopenhauer. L’oscillation tourneurienne, par sa modulation très particulière, l’aurait d’ailleurs sûrement passionné.
Jacques Tourneur a irrégulièrement mais admirablement servi le cinéma fantastique – genre qu’il tenait pour majeur : ses entretiens en témoignent – entre 1940 et 1965 : il y a une esthétique et des traces thématiques relevant du fantastique dans certains de ses autres films. Nightfall en fournit un parfait exemple. En tant que film noir américain, Nightfall est probablement mineur par comparaison avec Out of the Past. En tant que film de Jacques Tourneur, Nightfall lui est peut-être supérieur à cause du degré supérieur de fantastique qu’il recèle.
Notes
(1) La Nuit tombe, traduction française chez Gallimard (coll. Série blême, 1950). Pour le film, je me réfère au DVD édité en juin 2012 par Wild Side dans la collection Confidential Classics, comprenant un livret illustré et relié de 80 pages, Le noir n’est pas si noir : le cinéma de David Goodis par Philippe Garnier. Riche en informations de première main et contenant l’ensemble du matériel publicitaire de l’époque mais aucune déclaration de Jacques Tourneur lui-même concernant son film, sauf erreur de lecture. Ce décentrage du livret vers le scénario de Silliphant et le roman de Goodis plutôt que vers le cinéaste Jacques Tourneur est un pari bien tenu dans la mesure où il permet à Garnier de spécifier, à propos de nombreux détails, la thématique et l’esthétique de Jacques Tourneur. Celui qui ne s’intéresse absolument pas à Goodis mais beaucoup à Tourneur (c’est notre cas) y trouve donc tout de même une ample nourriture.
Entretien avec Michael Henry Wilson, auteur d’un livre sur Jacques Tourneur ou la magie de la suggestion (Éditions du Centre Pompidou, 2004). Michael Henry avait aussi écrit un excellent article d’ensemble sur Jacques Tourneur pour les Dossiers du cinéma, Cinéastes, 3 (op. cit. ), l’un des meilleurs parus dans notre langue avec celui de Jean-Marie Sabatier intégré comme fiche à son musée imaginaire dans Les Classiques du cinéma fantastique (Balland, 1973). Jacques Tourneur (1904-1977) fut réellement redécouvert au crépuscule de sa carrière par son pays d’origine puisque c’est seulement vers 1965 que les revues Midi-Minuit Fantastique, Positif et Présence du cinéma lui consacrent entretien et articles.
Galerie affiches et photos de presque 50 documents, la plupart d’entre eux également imprimées sur le livret.
(2) Dark Passage porte le titre français d’exploitation Les Passagers de la nuit et le livre traduit en français porte le titre Cauchemar chez Gallimard (Série blême, 1949).
22/09/2012 | Lien permanent
Phantom de F. W. Murnau, par Francis Moury

16/12/2010 | Lien permanent
Les cinq métaphysiques d’Aristote, par Francis Moury
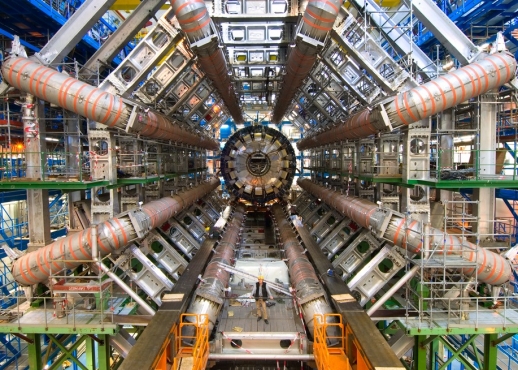
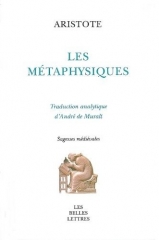 À propos d’Aristote, Les Métaphysiques, un volume in-8° de 528 pages, traduction analytique des livres Γ, Z, Θ, I, Λ, introduite, commentée et annotée par André de Muralt, avec bibliographie, index nominum et rerum, Éditions Les Belles lettres, huitième volume de la collection Sagesse médiévale, 2010.
À propos d’Aristote, Les Métaphysiques, un volume in-8° de 528 pages, traduction analytique des livres Γ, Z, Θ, I, Λ, introduite, commentée et annotée par André de Muralt, avec bibliographie, index nominum et rerum, Éditions Les Belles lettres, huitième volume de la collection Sagesse médiévale, 2010. 30/05/2010 | Lien permanent
Faust de F. W. Murnau, par Francis Moury

17/07/2010 | Lien permanent
Matérialisme et terreur chez Alain Badiou, par Francis Moury


 À propos de Alain Badiou et Nicolas Truong, Éloge de l’amour (Éditions Flammarion, coll. Café Voltaire, 2009); Alain Badiou et Fabien Tardy, La Philosophie et l’événement (Éditions Germina, 2010).
À propos de Alain Badiou et Nicolas Truong, Éloge de l’amour (Éditions Flammarion, coll. Café Voltaire, 2009); Alain Badiou et Fabien Tardy, La Philosophie et l’événement (Éditions Germina, 2010).04/06/2010 | Lien permanent

























































