« François Bayrou ou les impasses de l’extrême centre, par Germain Souchet | Page d'accueil | L'irresponsable crétinisme de Technikart »
13/02/2007
Tzvetan Todorov en péril ou Tartuffe onaniste

«Dans mon esprit – aujourd’hui comme naguère –, l’approche interne (étude de la relation des éléments de l’œuvre entre eux) devait compléter l’approche externe (étude du contexte historique, idéologique, esthétique). La précision accrue des instruments d’analyse allait permettre des études plus fines et rigoureuses; mais l’objectif ultime restait la compréhension du sens des œuvres.»
Tzvetan Todorov, La littérature en péril (Flammarion, coll. Café Voltaire, 2007), pp. 28-29.
 Terminant de lire le superbe volume de Lewis Mumford consacré à Herman Melville édité par Sulliver (1), méditant justement sur l'étrangeté (les mauvaises langues parleraient plutôt de vieillissement, la première édition de ce livre datant de 1929, la présente et remarquable traduction s'appuyant sur l'édition revue par l'auteur publiée en 1962 aux États-Unis) de pareil ouvrage qui ne peut se résoudre à séparer l'analyse des livres et la vie de celui qui les a écrits, je me suis dit que je ne pouvais rêver plus subtile (et ironique) liaison avec le dernier essai de Todorov lequel, à sa façon, tente, bien maladroitement, d'opérer le même mélange entre la vie et la littérature censée en chanter les joies et les affres.
Terminant de lire le superbe volume de Lewis Mumford consacré à Herman Melville édité par Sulliver (1), méditant justement sur l'étrangeté (les mauvaises langues parleraient plutôt de vieillissement, la première édition de ce livre datant de 1929, la présente et remarquable traduction s'appuyant sur l'édition revue par l'auteur publiée en 1962 aux États-Unis) de pareil ouvrage qui ne peut se résoudre à séparer l'analyse des livres et la vie de celui qui les a écrits, je me suis dit que je ne pouvais rêver plus subtile (et ironique) liaison avec le dernier essai de Todorov lequel, à sa façon, tente, bien maladroitement, d'opérer le même mélange entre la vie et la littérature censée en chanter les joies et les affres. Curieux petit livre en effet, que cette Littérature en péril de Tzvetan Todorov, publié par Flammarion dans la collection, se voulant polémique et l'étant finalement si peu, intitulée Café Voltaire. On y apprend bien peu de choses, beaucoup moins par exemple que dans Le Démon de la théorie d'Antoine Compagnon ou même dans quelque honnête exemplaire de Lagarde et Michard puisque l'ouvrage, fort policé, ouaté (il s'agit, je le rappelle, de l'adjectif préféré de Patrick Kéchichian, autre polémiste pour rire), se déroule comme un placide exposé d'hypokhâgne, risquant, sur les terres rudes de la polémique, un bref regard, depuis une tour aussi solidement protégée que l'est la forteresse de Bastiani depuis laquelle le sous-lieutenant Drogo observe un horizon vidé de ses étiques Tartares.
Comme si cela ne suffisait pas, dès les premières pages, deux noms, ceux de Roland Barthes et Gérard Genette, nous indiquent par quelle lumière louche l'ensemble de cet opuscule pourra être éclairé : la mauvaise foi la plus délicieusement minaudière, l'insincère repentance appelant, en guise de contrition, le cilice de soie, l'in-pace de velours, d'où il s'agira tout de même, en guise d'aménagement de peine, de continuer à écrire. C'est que, soyons précis, nous ne pouvons tout de même parler, à propos de ce livre, de mauvaise foi sartrienne, donc peu ou prou de la mauvaise foi, éclatante, du salopard intégral, absolument décomplexé, comme si elle était gravée, avec un burin de diamant, sur le marbre éternel du mensonge le plus lourdement établi dans les consciences, pulvérisant ces dernières si le besoin s'en faisait sentir. Non point même une palinodie, le mot est encore trop fort, qui aurait présenté tout de même quelque incontestable panache : moi, Tzvetan Todorov, comme Rimbaud je jette aux ordures tout le fatras de livres bavards et inutiles que j'ai produits sur la littérature, et j'affirme qu'il ne s'agissait que de «rinçures». Que l'on me pardonne, je veux ne plus retomber dans mes erreurs passées, que j'abjure. Mais Todorov, il s'en faut de quelques mètres, n'a tout de même point la formidable stature d'un Gilles de Rais se consumant sur le bûcher de ses vices. Rien de tel, non, chez notre placide universitaire amoureux des livres (nous répète-t-il à chacune des lignes de son ouvrage qui en compte finalement peu) et qui en a pourtant si mal parlé. Alors, qu'est-ce donc que La littérature en péril ? Je dirai qu'il s'agit presque d'une résipiscence inchoative ou complexée, disons prépubère, précoce pour tout dire, dans le sens où l'on évoque une éjaculation de la même mauvaise qualité qui, pressée de conclure pour se coller à l'émail d'une cuvette anonyme, se préoccupera bien peu de donner une goutte de plaisir autre que strictement intéressé, avant de se diluer dans quelque énorme canalisation en charriant des milliers de mètres cubes.
Tzvetan Todorov, en somme, que l'on me pardonne cette image, pas même filée, se soucie davantage, en écrivant sa demi-confession d'une vague erreur de jeunesse, confession qui est encore une apologétique masquée, poudrant discrètement son nez de clown savant d'un fard de modestie, Todorov, en commettant cet onanisme aussi stérile qu'insignifiant, de nous étaler l'évidence (subitement révélée après des années d'un règne sans partage qui a fait vivre des centaines de milliers d'élèves et d'étudiants sous le joug d'une parole autoritaire, la sienne, celle de ses chers amis) de son minuscule plaisir, aussi consistant que le nectar infantile d'une pollution nocturne. Notre propre plaisir, n'est-ce pas, ne le regarde guère, Todorov aurait même plutôt tendance à s'en moquer bien qu'il nous jure, ô Tartuffe monocorde, que la littérature doit, avant toute autre considération ridiculement universitaire, s'adresser à des femmes et à des hommes plutôt qu'à des docteurs en sémiologie de l'accent circonflexe. Fort bien, il a raison. Mais, plutôt qu'évoquer les si peu passionnantes correspondances entre Flaubert et Sand, que n'a-t-il analysé les remarquables réflexions, sur ce sujet complexe, d'un Canetti, d'un Broch, d'un Sábato, d'un Bernanos même, qui délaissa l'écriture romanesque pour se consacrer à ses écrits de combat ? Todorov, tout simplement, ne sait rien de ces auteurs et, quand d'aventure ils en évoque d'autres, nous constaterons que son analyse est tout simplement pratiquement nulle, seul l'encre dépensé pour barbouiller sa mauvaise copie lui ayant évité le zéro pointé. Much ado about nothing en somme, cher «termite de la réduction», selon l'expression savoureuse qu'un Milan Kundera utilisait pour désigner vos congénères affairés au percement de minuscules tunnels.
Délaissant ces fiers noms, il apparaît ainsi que ceux, beaucoup moins virils, de Roland Barthes et de Gérard Genette trouvent leur justification, donnés je le disais en ouverture de notre ouvrage, comme s'ils constituaient quelque très précieux sésame d'une caverne aux trésors éventés, pour l'unique raison qu'ils sont les apôtres diserts s'il en est d'une littérature conçue strictement comme un sordide solipsisme dont il s'agira de démonter (le but que se propose la derridologie, cette grammatologie du vide) les subtils mécanismes actantiels, sans aucun, inutile que j'insiste sur ce point, sans le moindre rapport avec la réalité, quel vilain mot et encore moins, cette fois il s'agit d'une franche insulte, la vérité.
C'est pourtant, ô comble de l'ironie la plus jouissive, contre cette littérature idiote (au sens étymologique de l'adjectif évoquant la prostration de celui qui, ne communiquant plus avec le monde, en est réduit au filet de bave du monologue), c'est pourtant contre cette littérature idiote ou plutôt, à mon sens, parfaitement imbécile (selon le sens le plus courant de ce mot) que Tzvetan Todorov, lui-même le reconnaît pour atténuer sans doute sa très vénielle faute, responsable (mais évidemment pas coupable) de ce lamentable état de fait, s'insurge désormais, menant sa charge avec la cavalerie ultra-légère que représente un livre de 90 pages à peine (en police 12, avec d'amples marges...), tout en ayant soin de consacrer la moitié de son essai à un dédouanement de la modernité critique jargonneuse puisqu'il nous rappelle que l'idée d'une littérature détachée de toute préoccupation terrestre est fort ancienne, tout en ayant bien soin encore de ne pas stigmatiser ses petits collègues et bien sûr amis théoriciens d'une structurantologie apophatique du néant.
Le néant paraît d'ailleurs obséder notre auteur qui, dans un article intitulé Connaissance du vide : Cœur des ténèbres, recueilli dans Poétique de la prose (Seuil, coll. Points essais, 1999), évoque
le roman le plus connu de Joseph Conrad pour en dégager... rien d'autre que le néant qui serait, in fine, l'unique leçon délivrée par l'histoire de Marlow et de Kurtz. Voici, servi dans un bol de toute petite contenance, un peu du brouet insipide censé rassasier notre faim réactionnaire, je veux dire ridiculement désireuse de grandeur, de vie, de courage, de ténèbres, d'actions d'éclat et de hautes paroles, tout ce que la littérature, comme Todorov le découvre à près de 70 ans (il écrit dans son livre, p. 72 : Le lecteur ordinaire, qui continue de chercher dans les œuvres qu’il lit de quoi donner sens à sa vie, a raison contre les professeurs, critiques et écrivains qui lui disent que la littérature ne parle que d’elle-même, ou qu’elle n’enseigne que le désespoir), le génie étant l'enfance retrouvée à volonté, devrait être, a toujours été en fait avant que les petits pions de sinistre espèce ne nous aient, de force, obligé à y débusquer le mécano diacritique de leurs minables lubies de fanatiques mous. Lisons donc la prose pécheresse de Tzvetan Todorov, avant que, sur son chemin de Damas pénitentiel et tout proche de retourner en enfance, il ne soit cloué par l'éclair de la stupéfaction extradiégétique : «Ainsi l’histoire de Kurtz symbolise le fait de la fiction, la construction à partir d’un centre absent. Il ne faut pas se méprendre : l’écriture de Conrad est bien allégorique, comme en témoignent des faits multiples […], mais toutes les interprétations allégoriques du Cœur des ténèbres ne sont pas aussi bien venues. Réduire le voyage sur le fleuve à une descente aux enfers ou à la découverte de l’inconscient est une affirmation dont l’entière responsabilité incombe au critique qui l’énonce. L’allégorisme de Conrad est intratextuel […]. Le sens dernier, la vérité ultime ne sont nulle part car il n’y a pas d’intérieur et le cœur est vide: ce qui était vrai pour les choses le reste, à plus forte raison, pour les signes; il n’y a que le renvoi, circulaire et pourtant nécessaire, d’une surface à l’autre, des mots aux mots» (op. cit., p. 173).
J'imagine que, confronté à son propre texte, Todorov nous avouerait éprouver quelque subite gêne puisque cette pseudo-analyse du chef-d'œuvre conradien se contente de pointer la spécularité de l'écriture du romancier, son intratextualité uniquement préoccupée de références littéraires internes (une chaîne de signes que le romancier modifiera à sa guise, sans même qu'il ait pleine conscience de son propre travail) ou externes (Cœur des ténèbres considéré comme une île appartenant à un archipel purement littéraire d'ouvrages que Conrad a lus... ou pas, là se trouve l'astuce fièrement exhibée par nos petits singes savants).
Bien évidemment, pas un mot ne sera écrit ni même chuchoté à notre oreille pourtant extraordinairement sensible sur la portée résolument métaphysique du roman de Conrad (2). Tzvetan Todorov, voici donc qui peut-être dessillera vos yeux chassieux qui semblent ne jamais s'être ouverts sur cette consternante banalité : la littérature est le discours de l'Être et, par voie de conséquence, la critique littéraire qui prétendrait n'en rien dire n'est absolument rien de plus que le pet de trouille que ne peut s'empêcher de retenir le vieux clown lorsqu'il dégringole, pitoyablement, de son tabouret de sophiste complexé.
Prenant des notes sur l'ouvrage de Lewis Mumford qui, par certaines de ses pages, ressemble aux Abeilles d'Aristée de Weidlé, après m'être empressé de refermer puis d'oublier celui de Todorov, je ne puis résister au plaisir de citer ce passage (p. 376 de notre ouvrage), que les tristes laborantins de la dogmatique littéraire universitaire ne manqueront pas de juger affreusement impressionniste. C'est pourtant ce même impressionnisme de Mumford, fondé sur aucune pesante et vaine compilation des cent mille variantes d'un manuscrit qui jamais ne toucheront la réalité charnelle d'un roman, impressionnisme dont les analyses subtiles sont d'un bon sens admirable, qui creuse infiniment plus profond que les plus puissantes foreuses de la criticologie, en affirmant que Melville se trouva en quelque sorte contraint d'observer la déréliction d'un monde de plus en plus oublieux du sacré : «Dans cet Âge d’Or écrit ainsi Mumford, le triomphe de Melville, comme celui de ses contemporains, fut l’expression ultime d’une société provinciale, et le premier accomplissement prophétique d’une culture rénovée plus profonde. Son échec fut un emblème de la destruction de cette société, et de la plaie de la culture nouvelle qui, conçue tout entière en esprit, ne recevait ni aliments, ni chaleur, ni protection de la société étroite, mécanisée, tournée vers l’argent, qui succéda à cette société provinciale. Pour que le monde intérieur ne soit pas un fantasme, il doit être uni à un monde extérieur qui le nourrit et le soutient; même quand il présente des oppositions ou des antinomes. Ce lien avait existé avant la guerre civile; lorsque le milieu externe s’appauvrit, ce lien cessa d’être […].» Bien sûr, il y a fort à parier que de telles notations jugées, dans le meilleur des cas, sans le moindre fondement épistémologique par nos savants tartuffes, seraient balayées d'un revers de main formaliste et pourtant, Mumford, en quelques mots, en a dit davantage, non seulement sur un écrivain mais encore sur l'espèce de radicale malédiction qui, désormais, ne peut plus qu'être sa plus banale croix, que Todorov en une bonne trentaine de livres et plusieurs centaines d'articles...
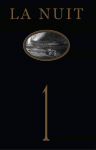 Notes :
Notes :(1) : Signalons par ailleurs que les éditions Sulliver ont publié, dans le premier numéro de leur très belle revue La Nuit, quelques poèmes peu connus de Melville.
(2) : pareille tentative critique peut bien sûr être menée, comme l'a fait le très (à vrai dire, beaucoup trop) derridien Richard Pedot dans Heart of Darkness de Joseph Conrad, le sceau de l'inhumain, en évoquant tout un réseau d'ouvrages dont s'est inspiré Conrad ou, comme je l'ai fait ici, en évoquant des auteurs qui se sont inspirés du roman de l'auteur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, structuralisme, déconstruction, derrida |  |
|  Imprimer
Imprimer




























































