« Banalité chevillardienne | Page d'accueil | Témoins du futur de Pierre Bouretz »
08/05/2009
L'invitation chez les Stirl de Paul Gadenne
 Paul Gadenne dans la Zone.
Paul Gadenne dans la Zone.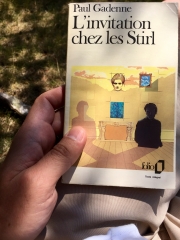 Acheter L'invitation chez les Stirl sur Amazon (dans la collection L'Imaginaire).
Acheter L'invitation chez les Stirl sur Amazon (dans la collection L'Imaginaire).C’est Pierre Poligone officiant sur le site Zone critique qui m’a dernièrement suggéré de rapprocher Paul Gadenne de Henry James. Ce rapprochement peut de prime abord sembler évident, bien qu’il n’ait point fait l’objet, à ma connaissance du moins, d’une étude d’ampleur. Il est en effet vrai que l’un et l’autre, au rebours de nos pornographes contemporains qui tiennent absolument à tout nous dire, donc à tout nous montrer, ne cherchent jamais qu’à suggérer une évidence, ou bien le mal qui rôde, une vérité éblouissante qui pourtant résiste à toutes les révélations, comme une bête tapie dans la jungle qui, lorsqu’elle sauterait, ne serait même pas vue de celui qu’elle va dévorer, réduire à la perplexité monumentale, à la honte définitive d’une révélation qui n’avait même pas besoin d’advenir pour être patente, obvie, certaine, irrécusable et pourtant, résolument cachée, secrète, invisible.
Paul Gadenne l’affirme d’ailleurs lui-même dans une note placée avant son roman, où il écrit que l’intérêt de son ouvrage se trouve «uniquement dans l’ambition [qu’il a eue, et qu’il] dévoile sans [se] faire prier, de composer un ouvrage où ce qui compte est tout ce qui n’est pas dit», alors que son personnage, le peintre Olivier Lérins, se demande si le drame qu’il a vécu n’a pas «été tout entier dans [son] esprit». Relisant l’étude (1) que j’avais incluse dans ma Littérature à contre-nuit, je me dis que je n’insisterais peut-être pas autant sur la thématique du démoniaque, ni même sur celle d’une absence du divin, mais me concentrerais davantage sur la thématique de la perte d’une pureté perdue, d’une «lacune, oui, d’une immense lacune», partant du rêve de la combler et de reconquérir cette pureté, mais aussi évoquerais la question complexe de l’ambiguïté voire du fantastique, du secret ou plutôt de la procrastination de ce dernier, et de la certitude que, plus d’une fois, nous avons approché cette révélation. Olivier ne vit-il pas ainsi «dans l’idée que d’autres choses allaient infailliblement se produire, auxquelles il était nécessaire, que la situation allait s’éclairer, ou tout au moins que les fausses apparences allaient se dissoudre» ?
 Acheter La Bête dans la jungle et Le Motif dans le tapis sur Amazon.
Acheter La Bête dans la jungle et Le Motif dans le tapis sur Amazon.C’est en explorant cette dimension faite de frôlements et d’attentes déçues, c’est lorsqu’Olivier ne cesse «d’avoir le sentiment que tout cela cachait autre chose», que nous sommes au plus près de deux des plus célèbres nouvelles d’Henry James, l’une parue en 1896, Le Motif dans le tapis, l’autre en 1903, La Bête dans la jungle. La première, géniale figuration des relations complexes unissant l’écrivain et ses lecteurs, particulièrement ses lecteurs professionnels, c’est-à-dire les critiques, ne nous intéresse pas directement, même si Olivier, finalement, est comme un lecteur critique du texte que lui envoie l’amie de son hôtesse, Ethel, et qu’il cherche en conséquence à percer le secret du comportement de son amie, lisant «ces longues pages d’affilée, sans souffler, et suspendant même sa pensée, espérant, comme on le fait pour les lectures difficiles, que l’ensemble lui ferait comprendre le détail», tout comme le narrateur du texte de James cherche à percer le secret des écrits de Hugh Vereker. Il n’y parviendra pas, et il semble bien que ceux-là même qui l’ont percé soient, tous, morts, de Hugh Vereker lui-même à George Corvik, le confrère journaliste du narrateur, en passant par la femme de ce même journaliste, Gwendolen Erme qui ne confiera point ce qu’elle ne pouvait manquer de savoir, de par sa proximité avec son époux, à son second mari, Drayton Deane, comme si le secret de l’œuvre de Vereker, le motif dans le tapis, ne pouvait être transmis qu’au prix d’un scellement immédiat, et définitif dans notre cas.
«Il avait la sensation de reprendre une histoire dont il avait manqué le début», nous dit le narrateur de la seconde nouvelle de James, et ces mots, d’autres encore qui tentent de cerner l’atmosphère propre à «état d’attente» sans but précis, subsistant «seulement comme suspendu dans le vide environnant», pourraient servir de premières lignes à bien des textes de Paul Gadenne, et c’est encore une image de La Bête dans la jungle, aussi évocatrice que superbe, qui le mieux figure l’univers enchâssé du romancier de La plage de Scheveningen : «C’était comme si ces profondeurs, que franchissait toujours un échafaudage suffisamment solide malgré sa légèreté et ses quelques oscillations dans l’air vertigineux, les invitaient en l’occurrence à se calmer les nerfs en lançant une ligne plombée pour mesurer le gouffre».
Ces gouffres ne sont bien évidemment jamais mesurés, et pour cause, mais ils ne peuvent que renforcer le sentiment constamment prégnant d’un danger qui rôde, «bête embusquée» dont il importe finalement assez peu de savoir si elle est «destinée à le [John Marcher) massacrer ou à être massacrée» tout autant que chiens qu’Ethel, selon le narrateur de Gadenne, a semble-t-il pervertis. Dans les deux cas aussi, c’est comme si nos personnages étaient affublés d’une «bosse dans le dos», la différence provoquée «à chaque minute de la journée» existant «indépendamment de toute discussion, la présence d’une bosse, ajoute James, faisant «bien sûr qu’on discutait comme un bossu, car on présentait toujours au moins un visage de bossu». Cette caractéristique aussi visible qu’invisible, puisqu’il faut cacher ce qu’on ne peut toutefois point totalement ne pas montrer, trouble du coup sans cesse le monotone déroulement des jours me faisant songer, et cette référence vaut pour les deux écrivains, à Kierkegaard, non point parce qu’il était bossu, que parce qu’il a été le penseur de ces signes secrets trahissant, parfois, la présence d’un espion de Dieu, et, de John Marcher comme du peintre Olivier Lérins, nous pourrions ainsi dire que c’était comme s’ils portaient «un masque de simagrées sociales, par les trous duquel perçait un regard dont l’expression ne s’accordait nullement avec le reste des traits».
En tout cas, si Le Motif dans le tapis semble préserver toute forme de divulgation du secret, comme L’invitation chez les Stirl, La Bête dans la jungle, elle, se clôt sur une forme de révélation parodique, John Marcher venant de comprendre que la femme qui l’a aimé l’a attendu toute sa vie avant de mourir, voyant donc, avant, peut-être, de sombrer dans la folie ou le désespoir, «la Jungle de sa vie et il vit la Bête embusquée; et, en la regardant, il la vit, comme par un mouvement de l’air, se dresser, énorme et hideuse, pour bondir et le terrasser», comme si le pauvre imbécile qu’est John Marcher, méritait, au moins, de connaître la vie de son existence misérable, un privilège, ou une punition, qui ne sont pas accordés au critique littéraire du Motif dans le tapis et au peintre de L’invitation chez les Stirl.
Note
(1) Je me suis servi de la version de poche donnée par ce même éditeur en 1982 pour mon préambule, mais je n’ai pas cru devoir systématiquement indiquer les pages des citations utilisées. J’ai utilisé la bonne édition fournie par la collection GF chez Flammarion pour les deux textes d’Henry James : Le Motif dans le tapis, La Bête dans la jungle (traduction par Jean Pavans, présentation par Julie Wolkenstein, 2004). Là aussi, je n’ai pas indiqué les numéros de pages des extraits cités.
«Que le nocturne débouche brutalement au grand jour, le fait surprend chaque fois. Il révèle pourtant une existence d'en dessous, une résistance interne jamais réduite.»
Michel de Certeau, La possession de Loudun.
«Tout cela ne semblait-il pas surgi du fond des âges ?… Une chose en rapport avec la nuit des temps, avec la nuit tapie au fond de nous, bien ensevelie, avec ses serpents et ses larves… Il songea tout à coup aux civilisations mortes, aux cataclysmes originels, à leur retour possible, puis aux troncs des palmiers, prêts à s'enfoncer tout droits dans le sol, déjà parés pour le sacrifice, sous leur carapace de fibres noires» (1).
Lorsqu’Olivier, le personnage principal de L'invitation chez les Stirl, a la soudaine révélation de cette noire évidence, on peut dire qu'il est bel et bien pris au piège, même si sa victoire ludique sur Mme Stirl (puisqu'il dispute contre elle une partie d'échecs à ce moment-là) peut lui donner le change. La maison étrange de ses hôtes, comme le château de Néréis sur le mystérieux Ouine, semble s'être refermée sur Olivier Lérins, qui n'en sortira qu'au prix d'une mort, celle du mari de Mme Stirl et d'une fuite, celle de sa hiératique hôtesse, partie se réfugier chez l'une de ses amies qui enverra à Olivier une lettre – ou plutôt, selon le mot du personnage, une espèce de bizarre dossier – accentuant encore un peu plus l'opacité de l'aventure qu'il vient de vivre. Nous ne saurons ainsi jamais si Mme Stirl et Olivier sont tombés amoureux l'un de l'autre et, du reste, peu nous importe puisque l'érotisme rentré du neuvième chapitre vaut toutes les confessions, bat en brèche les dénégations de l'un ou l'autre des protagonistes. Nous ne saurons jamais non plus quelle sorte de force mauvaise a étreint le personnage principal durant son séjour : la froideur de son hôtesse, l'air bizarre, «toni-sédatif», de sa villégiature, ou bien encore l’étrangeté de la demeure où il loge, ou bien enfin le comportement intrigant et possessif des chiens de Mme Stirl ? Peu nous importe.
J'ai écrit le mot essentiel : rentré, emprunté au vocabulaire aurevilien des Diaboliques. Tout, dans ce conflit qui oppose sourdement Mme Stirl à son invité, est tu, camouflé, soupçonné, étouffé, comme le mal qui tenaille Lasthénie de Ferjol, comme les turpitudes que nous cachent et nous révèlent troublement les diablesses de l'auteur d'Une Histoire sans nom. Affleurant perpétuellement à la surface, le mystère de ces âmes, que l'on croit parfois saisir, a pourtant vite fait de se dégrader en secret jalousement gardé : le mystère, auréolé des prestiges du torve et du louche, n'est plus que secret, rien de plus que chose cachée, c'est-à-dire, selon la stricte équivalence posée par Edgar Poe dans sa Lettre volée, exposée à tous les regards. Le secret est ainsi ce qui est le plus visible, mais d'une visibilité tronquée, artificielle, spécieuse, qui jamais, dans l'esprit de celui qui contemple, n'évoque la plénitude, le recueillement : «Non !», se dit constamment Olivier, «il doit y avoir autre chose !» : voici la phrase de celui qui soupçonne et furète, rejette ce qu'il voit, jauge ce qui l'entoure et, l'ayant soupesé, estime à bon droit qu'il a été floué. Car qui contemple le mystère l'accepte et l'accueille pleinement, comme un don. Mme Stirl, elle, n'a aucun mystère : elle n'a rien à dire (c'est-à-dire qu'elle parle tout le temps) et, si quelque tache a flétri son être ou son passé, Gadenne n'en prononce mot. Devons-nous alors penser que son mystère reste entier ? Rien n'est moins évident. Nous pouvons en effet placer ce court roman sous la lumière interlope de l'ambiguïté, à laquelle, après quelque hésitation de pure forme, l'auteur attribue un père, Satan : «Le diable a reçu bien des noms à travers l'histoire, et tous les jours les cris effrayés des saints attestent sa présence dans un coin du monde. Mais non, ce n'est pas là le visage de Satan. Ce serait plutôt... Peut-être que l'Ange aussi aime torturer. Et quelle torture plus exquise que celle de l'Ambiguïté ?» (2). Olivier Lérins, perpétuellement inquiet, se torturant sans relâche comme le bourreau baudelairien, ne peut s'empêcher de se poser des questions : quel charme a donc ensorcelé Mme Stirl, quel envoûtement l'a donc transformée ? Ne peut-il rien faire pour la sauver ? Le démon ? Mon lecteur pensera que je vais trop vite en besogne et que, là où Gadenne tait, soupçonne, cache et ne fait que soulever un coin du voile, je dévoile, pour le coup, trop vite et maladroitement. Le démon… Le diable alors que, jamais, dans L'invitation chez les Stirl, l'auteur ne prononce ni n'évoque semblable personnage ?
Tue et seulement soupçonnée, la présence maligne n'en est pas moins réelle, car c'est la réalité du démoniaque (celui-ci compris comme catégorie esthétique) que de se laisser appréhender par son insignifiance, son apparente banalité, sa ruse, bref, son érotisme. Si Mme Stirl est donc mystérieuse, si l'aventure d'Olivier Lérins est elle-même mystérieuse, c'est la catégorie du démoniaque qui les fait basculer dans l'ambigu du secret. Ce démoniaque, qui ne se donne jamais tout entier mais morcelé, dans une inévitable complexité qui mime pour la parodier l'étendue lumineuse de la grâce, autre nom de la simplicité selon Simone Weil, trame autour de nos personnages la toile de tous les doutes, des questions sans réponses, des incompréhensions mutuelles : ainsi le démon se cache mais ne cesse de nous laisser soupçonner sa présence, derrière la toile en somme, comme un Horatio maléfique. Le peintre Lérins se culpabilise inutilement en croyant que l'attitude de son hôtesse dépend grandement de son manque d'attention : s'il gardait les yeux perpétuellement ouverts, le personnage assailli par la suspicion du bizarre et de l'étrange, voire du maléfique, contemplerait dans son horrible réalité le morceau de la toile qu'il n'a fait qu'entrevoir : «Il se disait qu'avec un peu de chance, d'attention, il allait surprendre là un mystère, peut-être celui de la triste métamorphose de Mme Stirl» (p. 68). Un mystère ? Je crois que le mot secret eût davantage convenu. Je laisse à Enrico Castelli le soin de dévoiler la tactique diabolique par excellence : «Le démoniaque est au contraire une surprise non absolue, la surprise de l'attraction. Se laisser entrevoir, c'est-à-dire se cacher pour être cherché, agir sur le levier de la curiositas et de la science de la recherche de l'occulte. Se laisser entrevoir signifie attirer, car si quelque chose fait signe – donne un indice de son être – et révèle la possibilité d'une existence, la nature humaine veut en prendre connaissance, connaître pour participer; convoiter» (3). Si l'on me permet une digression dans le domaine philosophique, je crois que la catégorie définie par Günther Anders comme étant le supra-liminaire, conviendrait parfaitement à notre propos : étant ce qui dépasse l'imagination mais ne l'excède toutefois pas, le supra-liminaire est comme une attente angoissée, à vide, d'une horreur que nous ne pouvons définir avec certitude mais qui, assurément, rôde autour de nous, nous cerne, nous épie comme les regards des ancêtres peints des Stirl épient Olivier Lérins.
De sorte que L'invitation chez les Stirl peut recevoir un nouvel éclairage qui, j'en ai bien peur, est aussi louche que le précédent. Une horreur qui excède l'imagination mais que cette dernière ne peut s'empêcher de soupçonner ? Voyons, n'est-ce pas une des définitions possibles du fantastique, indécision perpétuelle entre la Raison et son vacillement selon Todorov ? Avouons que l'œuvre de Gadenne hésite et, bien que tentée par la possibilité d'en franchir le seuil, renonce toutefois à pénétrer définitivement dans le domaine du fantastique. Lorsqu'elle s'y engage d'ailleurs tout entière, il me semble que le dessous des cartes est trop vite et maladroitement révélé aux lecteurs, comme lorsque le narrateur, au milieu de ses amis, tente d'expliquer son aventure en ayant recours à la sorcellerie (4). Beaucoup plus fins, à mon sens, sont l'ouverture du roman, l'impression que l'étrange demeure des Stirl produit sur Olivier Lérins ainsi que les passions intellectuelles du couple (surtout celle de Mme Stirl, grande lectrice des théories du Père Lesobre ironiquement nommé, laquelle nourrit, nous dit Gadenne, «un certain culte de l'énergie spirituelle») qui, inévitablement, nous font songer aux impressions ressenties par le narrateur de Poe à l'approche de la Maison Usher. Ainsi, si l'étang corrompt lentement la triste demeure des Usher et creuse peu à peu ses fondations qui s'écrouleront à la fin du conte, la maison des Stirl, elle aussi, révèle bien vite au curieux son état de délabrement (cf. p. 20) ainsi que, «sous un effondrement de lierre, une inscription où les insectes pondaient leurs œufs dans les lettres gravées qui composaient le glorieux nom des Stirl» (Ibid.). La pourriture demeure tapie dans l'ombre, sous l'éclat artificiel que les Stirl, au sommet de leur réussite sociale, tentent de maintenir. Reprenant une image de La Plage de Scheveningen (5), nous pourrions écrire que, dans L'invitation chez les Stirl, le cadavre, qui est invisible, n'en dégage pas moins sa pestilence. En somme, L'invitation chez les Stirl se tient à la lisière : sa réussite esthétique provient du fait que, frôlant le fantastique et l'horreur, elle ne s'en approche jamais complètement, refusant d'y pénétrer trop facilement. C'eût été son échec patent, comme nous l'assure une note de l'auteur : «Au reste, l'intérêt de ce récit n'est pas là [dans l'illusion référentielle], mais uniquement dans l'ambition que j'ai eue, et que je dévoile sans me faire prier, de composer un ouvrage où ce qui compte est tout ce qui n'est pas dit» (p. 11). Fausse est donc la lecture de Bruno Curatolo qui écrit, à propos de notre roman : «Si les couloirs de la maison représentent les allées labyrinthiques, ils s'apparentent également aux fleuves des enfers dont la traversée à rebours permet de regagner les rives de la vie, de reprendre pied sur le sol de la Création» (6). Trop simplement nous est déroulé le tapis rouge d'une lecture symbolique. Or, je l'affirme, rien n'est moins symbolique que l'enfer dans lequel, réellement, Olivier Lérins est pris au piège, bien que temporairement : l'être paradoxal du Mal se donne dans une espèce de monstrueuse déhiscence qui jamais n'abolit l'être véritable, la Création, mais s'ente sur lui, comme un cancer ronge d'abord, patiemment et sans être décelable, l'organe qu'il dévorera pour le détruire. Il ne faut donc pas dire que la demeure des Stirl est symboliquement l'antichambre de l'Enfer, son porche où la source de ses fleuves, mais, proprement, qu'elle est l'Enfer… La représentation symbolique refuse en effet toute ambiguïté, puisque le sum-bolon est toujours lu, quelles que soient par ailleurs la richesse et la complexité de cette lecture, comme le témoignage et l'assurance d'un ailleurs parfaitement identifiable. Devenus symboles, les palmiers qui entourent et hantent l'esprit du narrateur (et celui du peintre qu'il est) seraient tout simplement synonymes d'emprisonnement, de froideur, de dureté, d'incompréhension. Ne sont-ils que cela ? À l'évidence non, puisqu'ils appartiennent, comme les chiens ou le couple de singes de Mme Stirl, à cette Nature que Lérins ne peut s'empêcher d'éprouver menaçante, hostile à son endroit. Pourtant, celle-ci ne cesse d'évoquer, dans l'esprit du narrateur, une invincible nostalgie, bien connue des lecteurs de l'œuvre gadennienne, que nous pourrions nommer une nostalgie du futur : le regret d'avoir été chassé du Paradis et la tentative forcenée de recréer, fût-ce pour quelques instants trop courts, une communion véritable. Disons alors que Lérins, plutôt que de symboles, est entouré de signes, de figures, dans le sens qu'Yves Ledure leur prête. Ces figures, Lérins ne parvient pas à les déchiffrer, puisque, comme nous le rappelle l'auteur, aucune d’entre elles n'est arrêtée (7), le monde dans lequel elles font signe étant, proprement, défiguré.
La défiguration du monde dans lequel vit le narrateur de Paul Gadenne a une incidence directe sur lui : la perception, partout envahissante et triomphante, du simulacre : «Tout dans cette maison était duperie» (p. 124), dit ainsi Lérins. Le Mal qui se donne dans son obliquité, dans une feinte constante qui mime cette apparition fantomatique ayant frôlé, une nuit, le personnage principal, n'a rien touché au décor, mais l'a perverti, dédoublé, retourné en somme. Je crois que Gadenne a retrouvé la grande idée de Léon Bloy (lui-même héritier de Joseph de Maistre), pour qui, depuis la Chute, notre univers est renversé. Renversé et perverti comme le sont les deux chiens de Mme Stirl qui, séparés d'elle, retrouveront leur être véritable. Nous ne savons rien de l'autre retour au naturel, celui de Mme Stirl une fois qu'elle a quitté son étrange demeure : est-elle redevenue celle dont Olivier Lérins se souvient avec plaisir ou au contraire, l'initiative de son amie en témoignant, sa haine n'a-t-elle fait que redoubler à l'égard de son invité ? Nous ne le saurons pas, de même que nous ne saurons pas si le peintre de ce roman, Lérins, est redevenu, auprès de ses amis, celui qu'il était, s'est débarrassé de l'influence funèbre de la demeure qu'il a habitée quelque temps. Ce retour à la normale nous est de toute façon caché, puisqu'il a lieu à la fin du roman, ayant nécessité au préalable, si tant est qu'il se soit effectivement produit, l'élucidation (d'ailleurs avortée) d'une histoire bizarre, qui n'a peut-être pas été autre chose que le fruit d'une imagination fiévreuse d'artiste. La prise de parole se fait donc dans la nécessité absolue de dire, de tenter de dire le Mal mais il serait faux de penser que le silence de la littérature, c'est-à-dire la fin de notre roman, serait retour au Bien : comme la maison des Stirl, ce que nous laissent présager les derniers mots d'Olivier Lérins, est tout entier grouillant de larves.
Car la modernité remarquable de cette œuvre est de maintenir ouverte ce que nous nommerons, d'un terme barbare, l'énigmaticité de l'histoire racontée. Je l'ai dit, tout est suggéré, rien n'est donc affirmé péremptoirement : mais l'énigme de ce texte et la suggestion finale qu'il nous délivre comme un fruit sur tiennent sans doute au fait que, plongé dans les ténèbres, il refuse toute échappatoire, toute trouée salvatrice percée dans le cachot épais et noir de l'in-pace. Et pourtant, combien est tentante la vision, même trouble et confuse, du Bien, de l'harmonie perdue, de la réconciliation ! À ce titre, le poème de T. S. Eliot (Animula, extrait des Poèmes d'Ariel), qui sur l'esprit d'Olivier Lérins provoque le choc d'une véritable rencontre (cf. p. 92), occupe la même fonction, dans la trame de l'œuvre de Gadenne, que la chanson composée par le personnage du conte de Poe, Roderick Usher :
«Dans la plus verte de nos vallées,
Par les bons anges habitée,
Autrefois un beau et majestueux palais,
– Un rayonnant palais, – dressait son front.
C'était dans le domaine du monarque Pensée
C'était là qu'il s'élevait.»
Dans l'un et l'autre texte, cette intrusion d'un verbe qui chante le passé métaphorique et paradisiaque pour en décrire la splendeur dessille le regard des personnages : Lérins, immédiatement après sa lecture, contemple l'intérieur de la demeure des Stirl d'une façon désormais toute nouvelle, qui ne lui cachera plus rien de la laideur et de la corruption pleinement dévoilées : «La maison était vide, en suspens au-dessus d'une terre moite et vide, peuplée de larves, dans cette lumière glauque d'aquarium que lui délivraient des feuillages trop denses, trop rapprochés» (p. 93). Dans le conte de Poe, l'intrusion du Mal est signifiée dans le chant même :
«Mais des êtres de malheur, en robes de deuil,
Ont assailli la haute autorité du monarque.
[...]
Et, tout autour de sa demeure, la gloire
Qui s'empourprait et florissait,
N'est plus qu'une histoire, souvenir ténébreux
Des vieux âges défunts.»
Ce mythe d'une plénitude passée, d'un Âge d'or, qui résonne au sein des deux œuvres (8) est évocation d'une pureté perdue, assassinée; il va cependant contaminer le conte de Poe, tout comme le poème d'Eliot va, d'une certaine façon, accroître le Mal en le nommant : atteinte portée à notre âme, devenue, dans ce monde cassé, «ombre à ses propres ombres et spectre en sa ténèbre» (9). Déjà, dans le premier des poèmes du recueil d'Eliot précédemment cité intitulé Le Voyage des Mages (Journey of the Magi), la vision de la naissance du Christ provoque en retour chez les trois personnages le sentiment d'une dépossession ontologique : «Nous sommes revenus chez nous, en ces royaumes / Mais sans plus nous sentir à l'aise dans l'ancienne dispensation / Avec nos peuples étrangers qui se cramponnent à leurs dieux».
En somme, de la même façon que la Maison Usher est reliée par une fente sinistre à l'étang putride dans lequel elle s'engloutira, le conte de Poe est lui aussi relié, cette fois par un cordon invisible, à un inquiétant avant-texte principiel. De ce court texte, Pierre Boutang donne un commentaire lumineux mais incorrect (ou tout du moins trop optimiste) lorsqu'il écrit que : «le mythe de la maison Usher [...] nous renvoie à quelque unité, d'avant-hier et d'après-demain. Poe n'a décrit la chute de la maison [...], que dans l'étroite relation à l'autre temps du tenir, et se retenir, dans l'être : un temps qu'il peut chanter, donc vraiment "positif", qu'une ballade fait émerger comme une île fortunée au milieu du conte» (10). Dans le roman de Paul Gadenne tout comme dans la nouvelle de Poe, je ne pense pas que nous puissions, sans forcer ces textes, entrevoir une unité pour un après-demain; il n'y a peut-être même pas eu d'unité dans un avant-hier : car, comme dans ce superbe conte qu'est Le Masque de la Mort rouge, le Mal attend toujours-déjà-là comme l’écrit Paul Ricœur, tapi et secrètement à l'œuvre quelles que soient les précautions prises pour endiguer son irrésistible surrection, afin de saper définitivement les fondations de la maison Usher et celles de la demeure des Stirl. Si rencontre il y a et réconciliation, don d'une seconde de pureté au front fiévreux, ce ne sera pas dans L'invitation chez les Stirl que nous les trouverons, mais dans le remarquable roman posthume de Gadenne intitulé Les Hauts-Quartiers où nous pouvons lire : «L'homme se retourna, offrant à Dieu sa face ravagée […]. Didier crut voir le linge de Véronique» (11). Au rebours de la vision de la Face ensanglantée, L'invitation chez les Stirl, pour sa part, se contente de peu : une entente entre Olivier et les chiens de son hôtesse, naguère si hostiles, quelques jours de tranquillité où le personnage pourra se livrer à son occupation favorite, la peinture, dont le résultat (cf. p. 178) n'est pas ce que l'on peut raisonnablement nommer, en accord avec George Steiner évoquant l’œuvre d’art réussie, la certitude d'une réelle présence. Les chiens de Mme Stirl… Rien de plus : pas de quoi pavoiser ni embarquer les animaux pervertis, chiens et singes étranges et grimaçants, sur une nouvelle arche qu'Olivier Lérins, en moderne Noé, conduirait pour sauver la Création du Déluge (cf. p. 68). Car, dans un monde creux où pavoisent les hommes creux, dans une demeure qui a livré à Lérins son secret, ou plutôt son absence de secret (le vide, la «lacune», la «vacuité», cf. p. 113), la proclamation de la réalité divine est devenue impossible, comme Baleine nous le suggère, cette admirable nouvelle évoquant une figure éminemment biblique, la baleine, qui appelle moins le Ciel que la pourriture qui déjà commence à lentement corrompre sa carcasse.
Comment expliquer cette impossibilité de dire Dieu ? L'une des causes de cette éclipse divine est l'invasion du roman de Gadenne par le démoniaque, que j'ai défini dans l’Avant-propos. L'invitation chez les Stirl ne peut évoquer Dieu qu'en absence, en creux, parce que la place est déjà occupée par un Adversaire qui mime et parodie lui-même l'absence… Dans Baleine qui précède L’invitation chez les Stirl de quelques années (puisque la nouvelle a été publiée en 1949 par la revue Empédocle), la place, laissée vide (12), de Dieu, ne semble pas encore avoir été conquise par son Singe. Qui plus est, même si rien ne paraît devoir se lever du cloaque qu’est devenu le cadavre de la baleine échouée, la multitude des signes dispersés dans l’œuvre, la thématique du déchiffrement (ainsi que celle de son échec) de ces derniers, semble convoquer la présence en creux du divin. Là n’est pas notre propos mais je crois qu’il y aurait beaucoup à dire sur cette nouvelle, à condition de l’analyser en en relevant l’apophatisme hérité de la théologie négative, cette image d’une baleine qui est distance (donc icône) plutôt qu’idole, selon la distinction établie par Jean-Luc Marion. Inversement, Mme Stirl n’est-elle pas une idole qui a fasciné son entourage, chiens compris ?
Je vois une seconde raison à cette incapacité ou, mieux, interdiction. La brusque manifestation de Dieu, moins même, d'une grâce qui serait seule capable de lézarder le cachot où croupit l'âme d'Olivier, est strictement impossible dans L'invitation chez les Stirl, par l'évidence même avec laquelle notre monde proclame, aux yeux de l'auteur, l'échec d'une autre attente, d'un autre retour qui ne serait pas cercle vicieux («Turning and turning…» dit ainsi Yeats dans The Second Coming) mais réelle ouverture sur la pure possibilité : la reprise, éminemment kierkegaardienne, dont l'échec est illustré par chacune des tentatives avortées d'Olivier. Est-ce dire qu'Olivier est incapable de ce mouvement et est-ce dire encore, au-delà de ce personnage et de cette incapacité métaphorique, que Gadenne lui-même, comme le narrateur de Kierkegaard, ne parvient pas à trouver le point d'Archimède depuis lequel s'élancer ? (13) Car, à l'inverse d'une libération finale que le départ d'Olivier mime parodiquement, L'invitation chez les Stirl multiplie les figures de l'encerclement infernal, puisque, au moment de quitter la demeure des Stirl, le même chauffeur, la même voiture qui, quelques semaines plus tôt, ont amené Olivier à la villa vont à présent le conduire vers la gare. Allons plus loin. À rebours encore d'une échappée hors de l'envoûtement immobile, Gadenne se plaît à enfermer son roman dans et par l'évocation d'un temps ancestral, immémorial et maléfique, que la civilisation judéo-chrétienne a eu tort de croire vaincu, que Kurtz, l'aventurier du Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, a su retrouver pour en être possédé en quittant définitivement l'Occident : «Tout cela ne semblait-il pas surgi du fond des âges ?…», ai-je déjà mentionné plus haut, et encore, ironiquement pointé par Olivier Lérins qui a toujours espéré retrouver son amie telle qu'il l'avait connue autrefois : «[Mme Stirl] avait été absorbée, comme ces missionnaires perdus dans la brousse, qui finissent par se laisser envahir par l'esprit d'enfance et par concevoir leur Dieu sur le patron des idoles qu'ils sont venus combattre» (p. 181). La transposition est certes délicate, mais cette absorption, ou plutôt cette résorption (puisqu'il s'agit d'un retour aux premiers âges de l'humanité) de Mme Stirl me fait songer à celle de Kurtz, avalé par les ténèbres et la sauvagerie de l'innommable. L'idée est ancienne et, en littérature, elle a été illustrée de façon saisissante par le dernier roman de Bernanos, que Gadenne a lu avec une grande attention (14), Monsieur Ouine. L'agonie du christianisme, sous la fermentation de l'immense cadavre, nourrit les vieilles larves que l'on a pensé à tort anéanties comme peut-être, sous la carcasse de la baleine, ne se cache rien d'autre qu'un Léviathan débarrassé de son harponneur divin. Gadenne le dit ailleurs (dans La Rupture), et nous aurions quelque indélicatesse à ne pas croire une confidence personnelle qui n'était pas destinée à la publication : «Vingt siècles de christianisme n’ont pas affranchi l’humanité des retours de la barbarie primitive». Mais, plus que cela, vingt et maintenant vingt et un siècles ont surtout enfermé l'homme dans une prison interlope, aux signes troubles et louches, qui l'empêche d'attendre fermement ce Retour que l'œuvre de Gadenne implore.
Notes
(1) L'invitation chez les Stirl (Gallimard, coll. L'Imaginaire, 1999, préface de Didier Sarrou), p. 132. Sans autre indication, un numéro de page entre parenthèses renvoie à cette édition.
(2) Les Hauts-Quartiers (Seuil, coll. Points Romans, 1991), p. 448.
(3) Le Démoniaque dans l'art, sa signification philosophique (Vrin, 1958), p. 30.
(4) Cf. pages 180 et 181. Rappelons que, selon Didier Sarrou (Préface, p. 3, op. cit.), le premier titre de L'invitation chez les Stirl devait être L'Envoûtement.
(5) «Mais il y a ce cadavre tout frais, le premier cadavre, c'est quelque chose de tout à fait inguérissable» (Gallimard, coll. L'Imaginaire, 1986), p. 195.
(6) Bruno Curatolo, Paul Gadenne. L'Écriture et les signes (L'Harmattan, 2000), p. 173.
(7) À propos du roman (Actes Sud, 1983), p. 15 : «Il n'y a aucun être, aucun objet sur qui nous puissions poser notre regard sans apercevoir autre chose. Aucune figure n'est arrêtée, aucune situation n'est nette. Rien n'est fini, nous vivons dans un monde à double sens...».
(8) Ne serait-ce que, dans L'invitation chez les Stirl, par l'abondance des références, explicites ou implicites, à la thématique du Jardin perdu.
(9) «Shadow of its own shadows, spectre in its own gloom».
(10) Ontologie du secret (PUF, coll. Quadrige, 1988), p. 15.
(11) Les Hauts-Quartiers, p. 700.
(12) On pourrait relever par exemple l’abondance d’un vocabulaire renvoyant à la blancheur, à la solitude, au vide, etc.
(13) La Reprise (traduction et notes de Nelly Viallaneix, Flammarion, 1990, coll. GF), p. 130 : «Je peux bien faire le tour de moi-même; mais je ne peux pas sortir de moi pour m'élever au-dessus de moi-même; quant au point d'Archimède, je ne puis le découvrir».
(14) Comme en témoigne l'exemplaire de ce roman que Gadenne détenait dans sa bibliothèque, soigneusement annoté.






























































 Imprimer
Imprimer