« Le pourceau, le diable et la putain de Marc Villemain | Page d'accueil | Éric Bonnargent, François Monti, Juan Asensio : entretien sur la littérature, la critique littéraire, le langage, etc., annonce »
16/05/2011
Le gardien du verger de Cormac McCarthy

Crédits photographiques : Kevin Schafer (Getty Images).
 Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone.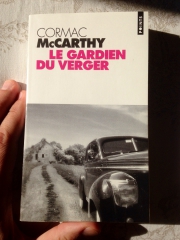 Acheter Le gardien du verger sur Amazon.
Acheter Le gardien du verger sur Amazon.Où vont ces hommes avares de mots dont nous savons si peu et que le romancier nous présente in medias res chassant, vidant un fusil sur une citerne abandonnée pour éloigner les contrebandiers, traversant la nuit à bord d'une voiture transportant des dizaines de bouteille d'alcool, de contrebande justement, John Wesley, Marion Sylder et Arthur Ownby, si ce n'est vers une destination inconnue et pourtant prévue de façon irrévocable par quelque démiurge qui les a lancés, sur le vaste territoire du monde, comme des marionnettes malhabiles et néanmoins obstinées, puisqu'en leur commencement réside leur fin ?
Ce serait une facilité journalistique que d'affirmer que le tout premier roman de Cormac McCarthy, publié en 1965 et traduit en français, une première fois, en 1968 (1), est prodigieusement riche des romans qui le suivront et, d'une certaine façon, illustre, mais en l'inversant, le vers de T. S. Eliot, «In my end is my beginning» extrait d'East Coker. Une facilité et pourtant une vérité car le moins que l'on puisse dire, c'est que Le Gardien du verger est un roman très dense, complexe, énigmatique même dans certains de ses épisodes et de ses images, en somme faulknérien en diable et pourtant, contre l'avis stupide que Richard Millet exprime dans l'un de ses innombrables pensums atrabilaires et de plus en plus poussifs (L'Enfer du roman), riche d'une matière qui n'a strictement rien à voir avec celle que le génial Sudiste a eu l'habitude de profondément malaxer pour en façonner ses inoubliables personnages.
Je ne citerai, pour différencier McCarthy de son grand aîné, que le seul motif de l'attente d'une catastrophe, que ce soit de la part des principaux personnages (surtout du sage Ownby, qui sait lire les signes les plus subtils) ou même d'une nature qui semble frémissante de bruits et d'indices nous annonçant la fin inéluctable, comme si le règne, totalement absurde, de l'homme trouvait logiquement son terme dans le déchaînement des éléments, lui qui a commencé, semble-t-il, après une autre catastrophe dont nous pouvons encore contempler les vestiges sans les comprendre : «Ils descendirent dans la combe et remontèrent de l'autre côté et continuèrent, à travers champs, leurs formes de brun et de blanc perdant leurs contours dans la boîte de bonbons du paysage de boue et de neige jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de les suivre qu'à leur mouvement, comme s'ils faisaient partie du sol lui-même donnant les premiers signes annonciateurs d'une catastrophe» (p. 159).
Comme prisonniers d'une nature incompréhensible, chargée de chiffres et de symboles et investie d'une aura sacrée remontant aux temps les plus lointains dont il ne reste plus que quelques traces mystérieuses, les trois principaux personnages du Gardien du verger ne vont nulle part, n'attendent rien si ce n'est ce qui ne peut manquer d'arriver, la fin de toute chose, leur vie est errance, violence (Marion Sylder tue un certain Kennet Rattner dont il jettera le corps dans un fossé se trouvant dans le verger abandonné que garde Arthur Ownby), leur existence est confrontation avec le Mal (2), étirement futile entre une première catastrophe (le meurtre, l'abandon, etc.) et une seconde qui ne peut manquer de venir et qui mettra un point final à leur maigre histoire, pulvérulente comme le verger abandonné et d'autres paysages de ce roman dont les foisonnantes descriptions, les fulgurances poétiques marquent durablement, je crois, le lecteur le plus exigeant.
Ce qui frappe également, ce sont les magnifiques et souvent surprenantes métaphores religieuses, même si Cormac McCarthy en modèrera le furieux débit dans La Route, sorte d'épure où s'invente, dans l'obscurité du dehors, le sacré parcimonieux des survivants. Dans le premier et le dernier (pour l'heure) roman de l'auteur, ces images, ces métaphores, ces comparaisons (3) me semblent avoir un rôle évident : il s'agit, face à la destruction qui gronde et menace de tout engloutir (une scène de déluge, remarquable, se trouve dans notre livre, dans sa quatrième partie), de préserver certains restes, au sens prophétique de ce terme, qui évoque des semences invisibles, peut-être même ridicules par leur petitesse mais qui seules, pourtant, survivront à l'universelle débâcle. Ainsi, il est frappant de constater que la sauvagerie que McCarthy dépeint dans son premier roman trouvera son aboutissement, le cannibalisme, dans le dernier. Voyons cette scène, en apparence anodine, distiller une discrète frayeur (4), finalement plus convaincante que ne le sont les nombreuses traces, dans notre roman, d'un fantastique gothique : «Devant des étalages d'échoppes de chaussures dont la misérable marchandise s'élevait en pyramides poussiéreuses, et des boutiques de vêtements avec sur le pas de leur porte des étagères en fer chargées de fripes, devant des caisses de chaussettes et de bas, devant un marché à la viande où jambons et carrés de côtes se balançaient comme des mécréants à leur gibet; avec dans les vitrines des plats carrés de porcelaine sur lesquels s'empilaient des viandes constellées de points blancs et infestées de trichine, des blocs de foie de la couleur de l'argile émergeant de douves de sang aqueux, un plateau de cervelles, des morceaux de viande d'origine inconnue éparpillés un peu partout» (p. 97).
Ce qui frappe encore le lecteur, c'est le soin qu'apporte McCarthy, dans sa première œuvre, à la description des paysages, comme s'ils avaient une âme ou plutôt, hypothèse qui se vérifiera pleinement dans l'oraculaire Méridien de sang qui nous semble être un roman tout entier prophétique, n'étaient que l'avant-scène d'un décor autrement prodigieux (et ils deviendraient alors, d'une certaine façon, paysages de l'âme), où les animaux (le chat ou le couguar dans notre roman, cf. pp. 71, 181, 262) font office de cicérones psychopompes.
Tout, en somme, pour le dire abruptement, est sas, territoire marqué, pour qui sait lire, faisant office de bordure entre notre monde et un outre-monde dont nous percevons, parfois, des échos troublants, des images étranges, monstrueuses, fascinantes.
Ainsi, nouvelle différence entre les romans de Faulkner et ceux de McCarthy, ce dernier ne me semble guère s'intéresser aux prodigieux débats de conscience que l'auteur de Parabole s'efforçait de mimer au moyen de phrases soufflées, gonflées d'une puissance destructrice et remarquable qui s'étendait à l'ensemble de la création, la fureur verbale du romancier paraissant vouloir plier l'effroyable complexité de l'univers jusqu'à le réduire et faire tenir sur une page noircie par une phrase infinie. La conscience, si elle existe bel et bien chez les personnages de McCarthy, ne paraît être qu'une émanation de ce qui l'entoure, ou plutôt, la cire, infiniment malléable, où la nature sauvage déposera son empreinte et peut-être ses secrets. Il faudrait évoquer, à titre d'exemple, ce que j'appellerai, faute d'expression plus appropriée, la nature iconique de certaines scènes du Gardien du verger, qui nous fait songer à telle toile où Georges de La Tour découpe l'obscurité en quartiers de lumière d'une finesse sans égale : «De temps à autre, il buvait une gorgée, tachant de brun sombre le crin blanc au-dessous de sa lèvre. La lampe à pétrole éclairait sereinement sa propre image, une molle corolle, enflammant la vitre noire de la fenêtre où une araignée desséchée pendait en boule à un fil poussiéreux» (p. 152, aussi p. 173). Dans cette scène en apparence banale, attachons-nous à observer la façon dont McCarthy découpe le tableau, faisant émerger, dirait-on, par couches, strates de peinture, la réalité que nos yeux ne savent même plus voir, parce qu'ils sont pressés de se jeter dans la scène suivante, qui elle aussi sera encadrée si je puis dire, par de nouvelles haltes où l'écrivain se fait peintre et nous donne à voir une scène de nature morte, «un gibier ésotérique découpé en quartiers et fumant sur la broche» (p. 146), une «citerne comme une grande icône d'argent, obèse et glabre et sinistre» (p. 109), des «visages laqués orange dans l'anneau de la chaleur comme des falots de carnaval découpés dans des coques de citrouille» (p. 57), ou encore dans «les grottes à la lueur des torches un congrès de démons et de sorcières en proie à une sinistre fringale [qui] entrechoque d'anciens ossement desséchés» (p. 79).
Chacune de ces haltes, chacune de ces descriptions usant abondamment de métaphores et de comparaisons (religieuses le plus souvent), chacune de ces toiles où notre peintre essaie de déposer la plus intime substance de la nature comme tamisée par la chair des personnages, nature dont ils ne semblent être qu'une émanation éphémère, chacun de ces jours ouverts dans l'épaisse muraille du récit constitue un essaim complexe de nœuds qui tisse un fin maillage (5), emprisonnant certes les êtres frustes décrits par McCarthy dans un réseau de contraintes, comme s'ils suivaient, à l'instar d'un chat, quelque rail invisible ou encore, comme s'ils étaient de toute éternité contraints de regarder «les grandes roues» de cette charrette qui «tournaient et oscillaient sur d'erratiques paraboles de pièces de monnaie projetées d'une chiquenaude» (p. 282), mais leur conférant, de facto, une importance primordiale. Chacun de ces véritables points de convergence de plusieurs trames, foyers par où passe et se concentre l'essence secrète du monde est en effet une trouée dans laquelle, l'espace de quelques minutes ou heures, tel ou tel personnage pourra jeter un regard puis s'estimer libre d'accomplir son destin, cette «force d'une insolite et déraisonnable pesanteur» (Ibid.) ou de le refuser, alors que le plus âgé d'entre eux, le sage (et un peu sorcier, à moins qu'il ne s'agisse, tout simplement, d'un homme venu d'une époque révolue), le sage Arthur Ownby, sente «le cercle des années se refermer, l'arc ultime de la courbe le ramener à l'origine, au flux prismatique des sons et des couleurs à l'intérieur duquel il avait dérivé jadis comme maintenant au-delà du monde des hommes» (p. 255), comme si, décidément, en nous souvenant une fois de plus du vers de T. S. Eliot, nous pouvions affirmer qu'en sa fin, où le jeune homme se recueille un instant sur la tombe de sa mère, Le gardien du verger évoque sa toute première scène, où des ouvriers constatent que des arbres ont recouvert les barreaux de fer d'une clôture, la nature, avant même que ne commence notre histoire, ayant en fin de compte repris ses droits.
Tout est fini puisque de ces gens rien n'est resté comme Cormac McCarthy ne cesse de nous le répéter, écrivant qu'ils «sont partis à présent. Enfuis, bannis dans la mort ou l'exil, perdus, défaits», puisque de ces gens «rien ne demeure, aucun avatar, aucun descendant, aucun vestige. Sur les lèvres de l'étrange race qui habite ici désormais leurs noms sont mythe, légende, poussière» (p. 284, toutes dernières lignes du roman qui rappellent celles de la page 16, où l'on peut lire : «Ils arrivaient et repartaient, sans plus de bagages que des oiseaux migrateurs, chaque famille de nouveaux venus était l'exacte réplique de la précédente et seuls changeaient les noms sur les boîtes à lettres, les derniers en date inscrits d'une écriture maladroite sur des couches successives de peinture qui replongeant les précédents occupants dans l'anonymat d'où ils avaient surgi»).
Notes
(1) L'édition de poche à laquelle nous renvoyons est celle donnée par les Éditions du Seuil dans sa collection de poche Points (1999) dans une nouvelle traduction (datant de 1996, puisque le livre a d'abord été publié par L'Olivier), comme toujours remarquable, due à Patricia Schaeffer et François Hirsch. Rappelons que la première traduction du Gardien du verger avait été établie par les Éditions Robert Laffont.
(2) Le Mal, chez Cormac McCarthy, n'est jamais aussi effrayant que lorsqu'il se revêt du masque de la banalité incarnée par Kenneth Rattner, celui-ci apparaissant à l'improviste, déjà installé dans la voiture de Marion Sylder, ce dernier comme immédiatement averti par la «profonde et inébranlable certitude de la présence du mal, la conviction qu'il lui faudrait au minimum défendre son bien contre l'homme qui avait déjà pris place à son volant» (p. 41). Le combat avec le Mal, lui, se signale par «une sorte d'hypnose», on ne sait «quelle défaillance des sens qui était comme une préparation à...» (p. 42). À quoi, justement, puisque l'ennemi de Sylder n'est que l'apparence d'un homme, au «visage apparemment sans ossature, une «masse d'abattis, une obscène matière résiduaire qui se décongelait et se dissolvait en longs plis contre la paume de sa main» (p. 47).
(3) Si toutes ne sont bien évidemment pas religieuses, elles n'en sont pas moins très souvent étonnantes, comme celle-ci : «À l'est une lune rouge et basse s'était levée et montait à travers les nuages, un sourire louche, un morceau de coquillage suspendu à l'oreille noire d'une gitane» (p. 56).
(4) Tout ce passage se trouve en italiques, marque, dans notre roman, d'une scène passée dont se souvient tel ou tel personnage. Notons que, quelques lignes avant ce passage, nous pouvons voir «un type qui poussait des hurlements incohérents et brandissait une bible en lambeaux» (p. 96).
(5) Fin maillage, motif dans le tapis aussi dans ces scènes où se croisent, sans soupçonner leur mutuelle existence, différents personnages qui ne font qu'observer les preuves du passage, tout près, de celui qu'ils ne voient pas mais soupçonnent de ne pas être très loin. Plusieurs fois Sylder et Ownby se tiennent tout près l'un de l'autre mais ne se rencontrent pas face à face.






























































 Imprimer
Imprimer