« Pier Paolo Pasolini par Serge Rivron (Infréquentables, 17) | Page d'accueil | Arthur Machen dans la Zone »
01/10/2011
Les souvenirs de David Foenkinos

Crédits photographiques : Jason Lee (Reuters).
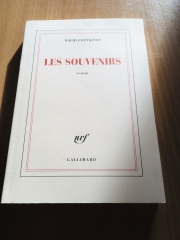 À propos de David Foenkinos, Les souvenirs (Gallimard, 2011).
À propos de David Foenkinos, Les souvenirs (Gallimard, 2011).LRSP (livre reçu en service de presse).
De toutes les formes de génie, David Foenkinos possède le plus rare, le génie de l'évidence. On peut même dire de David Foenkinos qu'il marche sur les évidences (cf. p. 257), comme le fait son personnage féminin, Louise.
Génie et évidence, si on y prête un peu d'attention, sont peut-être une seule et même chose, puisque l'homme génial peut être compris comme celui qui révèle une réalité inconnue de tous et qui pourtant se tenait là, sous leurs yeux : l'univers dans lequel Einstein a vécu et pensé n'a pas fondamentalement changé, dans ses structures physiques, par rapport à celui dans lequel Copernic a vécu et pensé et, pourtant, Albert Einstein a révolutionné les sciences par l'évidence qu'il a été le seul à voir et à comprendre, en découvrant que l'univers était d'une complexité infiniment supérieure à celle qu'avaient établie les savants calculs du génial Polonais.
À ce compte, Les souvenirs, le dixième roman de Foenkinos, est sans conteste le plus réussi de ses romans absolument tous gorgés d'évidences et même de banalités, puisqu'y éclate un génie qui confine à une simplicité délicieuse, parfois bouleversante.
Yann Moix, dans un papier rageur et surtout ridicule intitulé Foutriquet chez Thanatos paru dans telle récente édition du Figaro dit littéraire, et qui ne l'est assurément plus depuis qu'Étienne de Montéty en assure la direction (car, s'il l'était encore, littéraire, ce journal, il aurait dû commencer par remercier ledit Moix ou plutôt : ne pas l'embaucher du tout), Yann Moix qui a fait, nous dit-il, «quatre millions d'entrées au cinéma», accuse Les souvenirs de n'être qu'un «dicton de 266 pages», ce qui prouve que Moix sait compter au-delà de 10 et a peut-être même bien lu le livre de Foenkinos, ce dont nous aurions pu douter à ne lire que sa critique qui n'en est pas une, qui n'est même pas un billet d'humeur mais qui est, assurément, une chose sans importance voire un rien (res signifie... une chose !), un rien du tout, un texte de Yann Moix, c'est-à-dire quelques centaines de mots souvent vulgaires, toujours stupides, publiés, je le suppose tels quels, par Étienne de Montéty, ce qui n'est pas grand-chose tout bien réfléchi sinon de l'argent gaspillé, et gaspillé doublement : Yann Moix, aussi saugrenue que pourra paraître cette déclaration, est payé pour écrire ce qu'il écrit, c'est-à-dire rien du tout, et d'autres, que nous supposerons être des lecteurs peu attentifs, ont payé pour lire ce rien qu'a écrit Yann Moix et que Le Figaro paraît-il littéraire a osé publier tel quel, sans même corriger le français déplorable de ce piètre faiseur et critique à peu près nul qu'est Yann Moix.
Voilà sans conteste quelques évidences que David Foenkinos, à condition de l'imaginer perdre une seconde son calme et serrer ses petits poings, aurait pu coucher sur le papier, de sa plume tellement légère qu'elle semble ne même pas exister et qui tient pourtant de Michel Houellebecq et de Frédéric Beigbeder ses meilleures recettes. Du premier il semble goûter le désespoir discret, cependant débarrassé de sa misanthropie ridicule qui, comme une fine couche de poussière, recouvre absolument tout, ses personnages et le décor où ils se déplacent comme des automates. Dans vingt ans, si son désespoir n'a pas fini de le ronger d'ici-là, Houellebecq continuera à publier le même texte qui nous joue le rôle du dernier homme revenu de tout, et surtout de son propre insignifiant désarroi, alors qu'il faudrait que ce moderne continuateur des aventures de Folantin fasse comme son prédécesseur a fait (zut, Yann Moix m'a contaminé...) en se convertissant après avoir écrit Là-bas. Avec le second, Foenkinos partage la capacité, point si commune, de n'écrire que des évidences, mais des évidences qui finissent par composer un vrai roman, alors qu'on attend toujours, de notre didjay aux milliers de bonnes adresses nocturnes, un véritable texte.
En voici quelques-unes justement, des évidences, et de la plus belle eau : «Après l'enterrement [du grand-père du narrateur], ceux de ses amis qui avaient fait le déplacement m'ont raconté de nombreuses anecdotes, et j'ai compris qu'on ne connaît jamais vraiment la vie d'un homme» (p. 12), «On cherche toujours des raisons au manque d'amour qui nous ronge. Parfois, il n'y a simplement rien à dire» (p. 13), «On pleure pour montrer aux autres qu'on pleure» (p. 17), «Passer sa vie ensemble, c'est aussi mourir ensemble» (ibid.), «C'est toujours étrange de se dire que l'on peut continuer à avancer, même amputés de nos amours» (p. 19), «C'est l'inconvénient du rez-de-chaussée : on ne peut pas cacher son inactivité» (p. 24), «C'est ainsi; plus on meurt tard, plus on est seul le jour de ses funérailles» (p. 61) ou encore celles-ci, que nous qualifierons de belles évidences, ou d'évidences poétiques : «Veiller la nuit, c'est veiller l'amour des autres» (p. 20) et «D'une certaine manière, attendre quelqu'un, c'est le faire exister avant son apparition» (p. 195).
Ce n'est là qu'un assez maigre catalogue des innombrables évidences et autres facilités (1) qui émaillent ce texte qui, pourtant, et voici le point qui ne cesse de m'étonner, finissent par disparaître, se fondent dans l'ensemble, comme si, en fait, une écriture qui n'était qu'une juxtaposition d'évidences, pas toutes poétiques loin s'en faut, finissait par constituer non pas une écriture vide, non pas même une écriture blanche ou incolore, molle, inepte, forcée comme l'est celle d'un Casas Ros, castrat fluet qui se croit ténor, orgue de barbarie pensant jouer une musique bien supérieure à ses capacités réelles et probable imposture littéraire, mais bien au contraire une écriture évidente, au sens le plus commun de cette expression qui signifie que nous nous trouvons bien, lorsque nous lisons Les souvenirs de Foenkinos, devant une écriture.
J'en suis le premier étonné, et Foenkinos, s'il me lit, sera peut-être le second devant l'énormité que je profère : Les souvenirs, que Yann Moix, pour écrire sa rinçure, n'a probablement pas lu ou lu en diagonale ou alors qu'il a lu et auquel il n'a rien compris, n'est non seulement pas un roman inintéressant ou creux mais un texte parfaitement lisible, savoureux par endroits, drôle, toujours tendre, d'une justesse implacable même, à certaines occasions, qui font des constats de l'auteur des propos que n'eût point désavoués un Michel Houellebecq qu'on aurait débarrassé de sa raillerie si parfaitement banale qu'elle est devenue commerciale et de la platitude d'un désespoir lui-même gentiment dressé pour faire son numéro de caniche atrabilaire devant les caméras.
Ce qui me frappe dans le roman de Foenkinos, c'est moins la banalité de l'histoire évoquée, après tout la nôtre ou celle qui a fait la fortune de Michel Houellebecq, que la tendresse mélancolique (une «douceur un peu triste», p. 120) avec laquelle le narrateur évoque sa grand-mère, son père et sa mère, comme si cette tendresse était en fin de compte la seule réponse valable (et non point la projection dans quelque anticipation négative, comme celle que chérit l'auteur de La carte et le territoire) à la certitude que l'histoire, du moins pour la France, se trouve non point devant celles et ceux qui vivent sur son territoire et qui peut-être l'aiment encore sincèrement, d'un bel amour fatigué mais fidèle, que dans son passé, puisque nous ne sommes plus que dans l'époque de «l'hésitation permanente» (p. 251), un temps indéfiniment long et gris, où le passé est lettre morte et l'avenir un no man's land où nul n'ose s'aventurer.
À ce titre, un passage du roman de Foenkinos a retenu mon attention, que nous pourrions rapprocher d'une très belle idée, baptisée Loi de Sainte-Beuve, que Guy Dupré dit avoir découverte dans la lecture de Volupté, le roman de Sainte-Beuve : «Pauline me faisait reconnaître et vérifier ce que j’ai appelé la «loi de Sainte-Beuve» – loi qui régit la mémoire antérieure aux premiers souvenirs et fait découler la nostalgie primordiale (et la fantasmagorie érotique qui en procède), non de la petite enfance, mais du temps qui précède immédiatement le temps où nous sommes venus. Dans son unique roman, Volupté, l’amant d’Adèle Hugo a placé dans la bouche de son héros Amaury l’énoncé de sa théorie paramnésisque : Amaury, né dans les années qui ont précédé la Révolution, raconte à un jeune ami, né vingt-cinq ou trente ans après lui, les souvenirs de jeunesse de sa propre mère tels que les lui a rapportés son oncle maternel : «Comment les souvenirs ainsi communiqués nous font entrer dans la fleur des choses précédentes et repoussent doucement notre berceau en arrière !... Les plus attrayantes couleurs de notre idéal, par la suite, sont dérobées à ces reflets d’une époque légèrement antérieure où nous berce la tradition de famille et où nous croyons volontiers avoir existé» (2).
Dans le livre de Foenkinos, c'est à l'occasion de l'évocation d'un souvenir de Patrick Modiano que nous trouvons le passage suivant : «Dans Livret de famille, il y a surtout cette phrase qui me semble être une des clés de son œuvre, une phrase qui me touche particulièrement tant elle fait échos à des étrangetés que je peux ressentir, et qui confère au souvenir une folie qui nous échappe : «Je n'avais que vingt ans, mais ma mémoire précédait ma naissance» (pp. 23-4).
C'est peut-être cette découverte d'un passé qui est finalement le point commun, avoué ou secret, de tant de personnes qui va faire du narrateur des Souvenirs un écrivain conscient, dans un premier temps, de sa nullité et surtout de celle dans laquelle il vit, la nôtre bien sûr, comme il l'exprime dans un passage qui pourrait servir de bréviaire à quelque nouvelle confession d'un enfant du siècle : «Je faisais partie de mon époque, ce temps où aucune idée n'est plus suffisamment forte pour nous lier les uns aux autres. La guerre, la politique, la liberté, et même l'amour sont des luttes devenues pauvres, pour ne pas dire inexistantes. Nous sommes riches de notre vide. Et il y a quelque chose de confortable à tout ça, comme à la beauté d'un endormissement progressif. Mon mal-être n'a pas d'acidité. Il voyage légèrement, et sans bagages» (p. 92).
Mine de rien, l'air de ne pas y toucher, en quelques mots David Foenkinos vient de nous livrer l'essence du mal qui ronge nos contemporains et a réussi à inscrire, dans cette monotonie devenue vie quotidienne avachie, tous les textes d'un Houellebecq ou d'un Beigbeder, sans compter leurs sous-fifres plus ou moins identifiés.
Quelques pages plus loin, le narrateur poursuit en affirmant qu'il voudrait qu'on l'oublie : «Et subitement, en pensant tout ça, je me suis dit que cette volonté d'effacement était ce qui unissait notre famille» (p. 111) alors que, comble de malchance et d'ironie, «l'apparition du morne», dans la vie de son père devenu retraité, «avait eu quelque chose d'extrêmement brutal» (p. 114).
Pourtant, le paradoxe ne tarde pas à éclater car, si la vie présente du narrateur, entre déveines amoureuses et enterrements de vieillards, nuits de veille à faire le gardien d'hôtel et rêves d'écriture, est d'une banalité pas même confondante mais tout simplement réaliste et même juste, le passé, celui de sa propre enfance mais aussi celui de ses parents et de ses inconnus, célèbres ou réels, dont les souvenirs rythment le livre, est également terne, aussi fuligineux que le jour chiche qui accueille le voyageur au moment où il découvre devant lui la très vieille demeure de la famille Usher.
Va-t-il, comme cette dernière, s'enfoncer dans un étang putride s'il ne parvient pas à trouver les mots justes, «les plus durs à trouver», ceux qui «se cachent au fond de nous, mais ne laissent aucun indice quant au chemin à emprunter pour les toucher» ? (p. 121).
Cette dernière citation nous éclaire quant à l'intention profonde du livre de David Foenkinos : non point tant peindre les hésitations du narrateur sur sa capacité à être ou plutôt devenir écrivain (cf. p. 128), non pas également les belles pages où ce dernier s'élance à la recherche de sa grand-mère qui, désireuse de retrouver les lieux où elle fut écolière, s'est échappée de sa maison de retraite ou encore l'évocation, en quelques phrases, de la Collaboration (3), mais bien tenter de créer, bien sûr par l'écriture, une caisse de résonance infinie entre les vivants et les morts, entre le passé, le présent et le futur : «Trente années après, face à cette Auguste qui ne se souvenait plus de rien, face à cette Auguste qui allait le [Alois Alzheimer] rendre inoubliable, il repensait à l'Auguste de son enfance, et songea que chaque personne importante d'une vie porte en elle l'écho de l'avenir» (p. 158, l'auteur souligne).
Car, comme le narrateur le note, s'il est là, «à écrire, c'est uniquement parce que [s]on cœur a déraillé dans un dérapage des âges» (p. 129).
Cette volonté d'établir une communication poétique entre des destins que Foenkinos mêle assez habilement (voir par exemple l'épisode, plein de malice, où le narrateur évoque la première, puis la seconde rencontre entre son père et sa mère) n'a elle-même qu'un seul but, comme la fuite de sa grand-mère hors de sa maison de retraite, vers le paysage de côte où elle fut petite fille : il s'agit d'une «tentative de retrouver la beauté» (ibid.), cette beauté sans cesse agressée par ses inimitables croûtes que David Foenkinos disperse avec humour dans les différentes pièces où vivent ses personnages, qu'il s'agisse d'un tableau, monstrueusement laid, de vaches dans la maison de retraite de sa grand-mère ou d'une nature morte, mais alors franchement morte, dans une chambre d'hôtel où son narrateur passe quelques nuits.
Beauté, laideur ? L'opposition est trop facile et, pour le coup, caricaturale. Plus subtilement, David Foenkinos nous fait comprendre que l'une et l'autre sont irrémédiablement liées, non pas sous l'effet de quelque vague rapprochement d'esthète blasé mais par un lien vital, celui-là même que la plongée dans la mémoire des êtres et des choses qu'ils ont créées a rendu évident.
Finalement, je crois comprendre ce qui, dans le roman de Foenkinos, a si visiblement horripilé Yann Moix : aussi chétive qu'on le voudra, simpliste, facile, ne cédant jamais un pouce de terrain devant l'empilement des évidences, parfois des truismes, l'écriture des Souvenirs présente cependant une indiscutable unité organique. Non pas tant grâce à la simplicité, émouvante et réelle plutôt que surfaite, de l'histoire racontée (deux enterrements, un mariage, deux divorces, une naissance, rien de plus) ou bien grâce à la personnalité attachante des personnages campés par Foenkinos que grâce à une vision cohérente de ce qu'est l'écriture : un éternel passage sur des traces que d'autres que nous, avant nous, après nous, ont suivies ou suivront, s'il est vrai que le «génie traverse les jours, et Anita Ekberg interpelle encore Marcello Mastroianni» (p. 178) alors que je suis en train de rédiger ce texte ou bien que le narrateur de Foenkinos, finalement, a réussi à écrire le roman qui narre son apprentissage de la vie moderne, terne mais point dénuée de beautés et de fulgurances par où l'éternel glisse un sourire.
David Foenkinos le sait, lui qui, discrètement, à sa façon tout de même moins calculée que celle de Michel Houellebecq, se demande si nous ne passons pas notre temps «à faire toujours les mêmes choses» (p. 209), alors même que, belle idée bernanosienne, nous évoluons «sous le regard de l'enfant que nous avons été» (p. 221) et que nos «vies sont si rondes» (p. 179), cette toute petite phrase admirable étant peut-être la traduction moderne, donc nostalgique, un brin désespérée, du tout est grâce du curé de campagne.
En quelques mots, David Foenkinos, qui fait de son narrateur un écrivain qui n'écrira jamais jusqu'à ce que la mélancolie débloque quelque chose en lui (cf. p. 265), a écrit un roman, alors que Yann Moix n'a jamais rien écrit, mais, au contraire, n'a que fait, fait comme on fait à l'abri des regards, quelques livres idiots, quatre millions d'entrées et même, régulièrement, des torchons pour le Figaro Littéraire qui accepte et encourage cette nullité puante.
Notes
(1) Facilités qui concernent les images, comme celles-ci : «Mon cœur était comme une chaîne de vélo qui a déraillé; j'en avais assez de tourner dans le vide; je voulais que mon cœur batte enfin utilement» (p. 73) et «Ma vie sexuelle ressemblait à un film suédois. Parfois même sans les sous-titres» (p. 84). Mentionnons enfin ce passage, dont on ne sait s'il est stupide ou drôle : «Au moment de payer, je fus saisi par une intuition : si cet homme s'y connaissait en barres chocolatées, peut-être était-il aussi doué en femmes ? Il y avait beaucoup de points communs entre les deux finalement» (p. 209).
(2) Guy Dupré, Les Manœuvres d’automne (Olivier Orba, 1989; Le Rocher, nouvelle édition augmentée, postface de Maurice Nadeau, 1997), p. 77.
(3) Comme celles-ci, assez magistrales dans leur concision : «Dans leur immeuble, une famille juive avait été dénoncée par la gardienne. Giflée par mon grand-père, cette femme, béate dans son innocence française, ne comprit pas qu'elle avait mal agi» (p. 148), ou cette autre : «Il servait des Allemands polis accompagnés de petites putes opportunistes dont les cheveux seraient bientôt des souvenirs» (ibid.).






























































 Imprimer
Imprimer