« Excellences et nullités, une année de lectures : 2012 | Page d'accueil | L’obsession de la décadence dans l’œuvre de Jules Barbey d’Aurevilly : variation sur le thème de la Chute, par Jean-François Roseau »
01/01/2013
Relecture de Méridien de sang de Cormac McCarthy
 Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone. Cinq articles sur Méridien de sang.
Cinq articles sur Méridien de sang.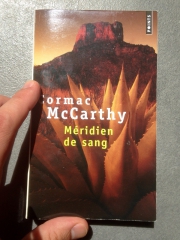 Acheter Méridien de sang sur Amazon.
Acheter Méridien de sang sur Amazon.Si un roman comme La Route comporte une dimension religieuse évidente (1) comme je l'ai établi (2), Méridien de sang, un texte que nous pouvons sans exagération qualifier de surécrit (3) car il est saturé d'une multitude de références (au manichéisme, à l'ésotérisme, à la Bible, à la géologie, à la faune et à la flore, à la géographie, à l'histoire, au vocabulaire des armes à feu, aux différents peuples indiens, etc.), se caractérise bien davantage par l'exploitation d'une thématique sacrée, augurale, qui ne saurait toutefois être séparée de la dimension religieuse, tant sont nombreuses les références, directes ou indirectes, à cette dernière (4).
Le sacré se distingue par son ambiguïté, le retournement constant du pur en impur, du profane en initié, du bien en mal, de l'obscurité en lumière et, pourrait-on dire, du passé en futur.
C'est peut-être par le biais de cette temporalité complexe que Méridien de sang signifie le plus habilement sa modernité, c'est-à-dire son ambiguïté, son ouverture à l'infini des possibilités de lecture, et l'étrange sentiment qu'il ne peut manquer de provoquer dans l'esprit de celui qui le lit, comme s'il s'était agi, pour l'écrivain, de proposer avec cet étrange et monstrueux roman plus qu'un roman, une propédeutique à un savoir qui pourtant se refuse, dont l'essence même est de ne pas se donner, comme le messianisme selon le judaïsme : «Trois sont ceux qui surgissent sans que l'on y prenne garde : le messie, une trouvaille et un scorpion» (Sanhédrin 97 a).
Il n'y a pas de scorpion, sauf erreur de ma part, dans Méridien de sang, et je n'oserais affirmer que les deux autres sont tout aussi absents. La pure surprise que constitue la lecture, et même la relecture d'un tel roman, aussi complexe et ambitieux que mystérieux, parfois hermétique, ne peut se départir de sa dimension déceptive : que nous donne-t-il qu'il ne cesse pourtant d'annoncer ? Rien. Méridien de sang de Cormac McCarthy est une apocalypse sans révélation, il frémit de multiples épiphanies dont, comme les peintures et les signes gravés sur les roches contemplées par le juge Holden, nous avons perdu la compréhension.
Ainsi la sauvagerie qui imprègne le texte de McCarthy comme le sang un suaire n'a-t-elle aucun sens. Ainsi, également, de la multiplication des signes : qu'annoncent-ils ? De quels dieux nous indiquent-ils la venue pleine de bruit et de fureur, alors que notre monde, parcouru par une bande d'hommes ne reculant devant aucun massacre, semble vidé des plus anciennes idoles ?
Le roman de McCarthy évoque un passé immémorial, précédant le temps de l'écriture, où l'humanité se caractérisait par son absolue sauvagerie, comme l'indique d'entrée de jeu l'une des trois exergues retenues par l'écrivain : «Clark, qui a dirigé l'année dernière une expédition dans la région des Afars dans le nord de l'Éthiopie, et Tim D. White, de l'University College de Berkeley, ont ajouté qu'un crâne fossile daté de 300 000 ans découvert précédemment, dans la même région, avait fait l'objet d'un nouvel examen. Les constatations faites à cette occasion permettent de penser que ce crâne a sans doute été scalpé. Yuma Daily Sun, 13 juin 1982» (p. 7).
Cette sauvagerie caractérise selon McCarthy les hommes qui osent s'aventurer, comme la bande de Glanton, sobrement décrite (cette sobriété volera vite en éclats) comme «une meute d'humains à la mine cruelle» (p. 102), sur les traces d'autres sauvages que sont les Indiens dont les atrocités sont peintes par le menu et sont à vrai dire assez dignes d'une eau forte de Goya, comme nous l'indiquent la vision d'un arbre où pendent sept ou huit nourrissons, «minuscules victimes [qui] avaient des trous percés dans la mâchoire et ainsi suspendues par la gorge aux branches cassées d'un mezquite elles contemplaient sans yeux le ciel nu» (p. 76) ou encore cette autre : «Certains devaient être des hommes à en croire leur barbe, mais ils portaient entre leurs jambes d'étranges plaies menstruelles et il n'y restait plus rien de leurs parties viriles car elles avaient été tranchées et pendaient sombres et insolites à leur bouche grimaçante» (p. 193) ou enfin, digne d'un film d'horreur, celle-ci : «[...] l'un des Delawares émergea de la fumée en tenant dans chaque main un nouveau-né qui se balançait et il s'accroupit devant la bordure de pierre d'une fosse à fumier et il les projeta chacun son tour par les talons et leur fracassa le crâne contre les pierres, faisant exploser la cervelle qui jaillit en bouillie sanglante par la fontanelle [...]», p. 198.
De telles scènes, à la grandiloquence certaine, accentuent sans doute la difficulté de porter à l'écran Méridien de sang, auquel plusieurs réalisateurs ont renoncé, même si d'autres scènes pourraient constituer de superbes chorégraphies cinématographiques, comme celle qui s'étend des pages 199 à 200, où les compagnons de Glanton, lancés à la poursuite d'Indiens, tour à tour descendent de leur cheval pour faire feu sur les montures sur lesquelles le cadavre du chef est ramené par les sauvages : «Cet homme c'était Sam Tate et il prit le fusil et tira si fort sur les rênes de sa monture qu'il faillit la renverser. Glanton et les trois autres continuèrent et Tate dégagea la baguette pour y appuyer l'arme et il s'accroupit et fit feu. Le cheval qui portait le chef blessé chancela puis continua. Tate fit tourner les canons et tira la deuxième charge et le cheval tomba à terre. Les Apaches raccourcirent les rênes en poussant des cris perçants. Glanton se pencha en avant et parla à l'oreille de son cheval. Les Indiens transportèrent leur chef sur une nouvelle monture et se mirent par deux en martelant leurs bêtes et repartirent. Glanton avait sorti son revolver et fit signe aux hommes derrière lui avec son arme et l'un d'eux arrêta son cheval et sauta à terre et se coucha à plat ventre et sortit et arma son propre revolver et abaissa le levier de chargement et le planta dans le sable et tenant l'arme à deux mains et le menton enfoui dans le sol il prit sa visée le long du canon» (p. 200).
Sauvagerie, errance, le romancier se fait le témoin, dirait-on prostré et hagard, de la randonnée meurtrière d'hommes livrés à eux-mêmes, avares de discours, n'ayant de comptes à rendre à quiconque comme si, sur les traces de Kurtz ou de Voulet, pourquoi pas de leur lointain ancêtre Aguirre, le narrateur, comme Marlow, devait suspendre son jugement moral et accepter de plonger, un temps du moins, dans les ténèbres, qui sont, nous le savons également depuis que Conrad nous a livré sa sombre parabole, remontée aux premiers âges de l'homme.
Le passé est sans cesse rappelé, par un grand nombre de comparaisons, comme celle qui concerne l'habitation d'un anachorète «qui a bâti son nid dans l'herbe comme un mégathérium» (p. 25) mais surtout par le biais de paysages le plus souvent désertiques, ces «brutales solitudes du Gondwana» (p. 218) que traversent la bande de chasseurs de peaux rouges menée par Glanton et qui, elle-même, est maudite, «condamnée à chevaucher sans fin pour expier une antique malédiction» (p. 191), alors que, à la suite d'un de ses forfaits, la troupe «qui chevauchait en loques et en sang avec ses ballots de pelleteries ressemblait moins à une troupe de vainqueurs qu'à l'arrière-garde harassée d'une armée détruite reculant à travers les méridiens du chaos et de l'ancienne nuit» (p. 206).
C'est l'avenir qui, outre la temporalité du passé, est le plus prégnant dans le roman ou, plus précisément, sa déchirure spécifiquement apocalyptique. Passé et avenir, tous deux caractérisés par la sauvagerie, sont liés par les paroles du mennonite qui affirme que la «colère de Dieu reste longtemps assoupie. Elle est restée cachée pendant un million d'années avant qu'il y ait des hommes et seuls les hommes ont le pouvoir de la réveiller» (p. 55).
De quel ordre est l'apocalypse dans Méridien de sang ? La réponse à cette question est pour le moins difficile : peut-être s'agit-il du destin, si souvent évoqué par McCarthy, dans ce roman (cf. p. 219) comme dans d'autres, la bande des chasseurs d'Indiens menés par Glanton allant «comme des hommes chargés d'un dessein dont les origines leur étaient antérieures, comme les héritiers naturels d'un ordre à la fois implacable et lointain» (p. 192)
C'est bien ce point qui est fascinant dans le roman de Cormac McCarthy, qui décrit un univers fondamentalement hostile aux hommes, bien que les actes et les paroles de ces derniers jouissent semble-t-il du pouvoir de réveiller les démons, qu'ils aient été ou pas affublés de noms, tant certaines forces occultes paraissent demeurer inconcevables pour des esprits humains. Ainsi, un jeune enfant, retrouvé le cou brisé un matin par la bande de Glanton (s'agit-il d'un crime perpétré par le juge, qu'on a «signalé tout nu grimpé sur les murs, immense et pâle dans les révélations des éclairs, paradant au faîte de l'enceinte et déclamant dans l'ancien mode épique», p. 150 ?), est-il entouré de «grandes quantités de vieux ossements. Comme s'il s'était à son insu, ajoute l'écrivain, de même que d'autres avant lui, aventuré en un lieu où gîtait quelque chose d'hostile» (p. 151).
De fait, Méridien de sang pourrait être analysé comme s'il s'agissait d'une espèce de membrane ou de sas métaphorique permettant, durant certains moments (de préférence la nuit, et pendant l'orage), une communication entre deux univers séparés, le monde dans lequel se déplacent les personnages violents de McCarthy étant comme creusé d'une profondeur qu'il vaut mieux ne pas tenter de sonder, et qui est suggérée par une multitude de signes que le juge Holden mieux que nul autre, sait parfaitement déchiffrer (5).
Ainsi, «l'hurlante obscurité» (p. 123) n'est jamais aussi terrorisante que ce que nous pouvons soupçonner à sa bordure (6), comme le suggère le beau passage où certains des hommes du gang de Glanton se font tirer les cartes : «Quelqu'un arracha le bandeau des yeux de la vieille femme et on les renvoya avec des coups elle et le jongleur et tandis que la compagnie se préparait au sommeil et que le feu faiblissant grondait dans la tempête comme une chose vivante ils restaient là tous les quatre accroupis à la limite de la lueur parmi leur étrange fourniment et contemplaient les flammes déchiquetées qui fuyaient au fil du vent comme aspirées par un maelström là-bas dans le vide, on ne sait quel tourbillon dans ce désert au regard duquel le passage de l'homme et ses calculs ne sont plus rien. Comme si au-delà de la volonté ou du sort l'homme avec ses animaux et ses bagages, en effigie sur les cartes comme dans sa substance, était en transit pour une tout autre destinée que la sienne» (p. 124).
Cette tout autre destinée est remarquablement suggérée par l'ex-prêtre Tobin qui, ce n'est sans doute pas un hasard, dresse du juge Holden un portrait que nous pouvons juger à bon droit démoniaque. Dans le passage suivant, la communication entre notre monde et celui d'en bas est très clairement exposée : «Je voudrais pas aller contre les Saintes Écritures mais qui sait s'il y a pas eu des pécheurs tellement endurcis dans le mal que les flammes les ont rejetés et je pourrais sans peine imaginer qu'en des temps très anciens des petits démons se sont élancés avec leurs fourches à travers ce vomi incandescent pour reprendre possession des âmes qui avaient été recrachées par erreur de leur lieu de damnation et rejetées sur les bords extérieurs du monde. Oui. C'est une idée, rien de plus. Mais quelque part dans l'ordre des choses ce monde-ci doit rejoindre l'autre» (p. 166).
Cet extrait est très intéressant parce qu'il entremêle les différentes thématiques que nous avons évoquées : la communication entre deux univers, le fait que notre monde n'est pas totalement imperméable à l'action de démons ou d'archontes tels que le juge Holden (lui qui manifeste une étonnante familiarité avec le feu, cf. pp. 124 ou 165), la possibilité de lire, dans le paysage, les signes complexes d'une réalité invisible comme, une fois de plus, le juge Holden est capable de le réaliser, lui qui déploie sur la création une connaissance encyclopédique, pratiquement surnaturelle, mais encore la résurgence du passé, comme une nappe souterraine de sauvagerie pressée de jaillir à la surface, les hommes du présent pouvant écouter «les herbes sèches [qui] sifflaient dans le vent comme si la terre eût répercuté dans un long écho de pieux et de lances le fracas d'anciennes joutes restées à jamais sans témoin» (p. 134).
Ces derniers mots, restées à jamais sans témoin, évoquent une dimension de Méridien de sang qui pourrait passer inaperçue si nous ne nous souvenions pas de l'ampleur que McCarthy lui a donnée dans son dernier roman, La Route, je veux parler de la transmission et, spécifiquement dans ce roman, de la filiation et de la piété.
Celle-ci est évoquée dès les toutes premières lignes, saisissantes, lorsque l'enfant, sorte de Rimbaud s'élançant sur les vastes territoires états-uniens, une «semaine et le voilà reparti, avec dans sa bourse quelques dollars qu'il a gagnés, [descend] seul les routes sablonneuses de la nuit du sud, les poings serrés dans les poches de coton de son manteau miteux» (p. 11), la syntaxe parataxique du début nous faisant songer à l'écriture de Trakl (7), tout comme, d'ailleurs, la problématique du vieillissement de l'humanité, sa déchéance : «Jamais le père ne prononce son nom, l'enfant ne le connaît pas. Il a en ce monde une sœur qu'il ne reverra pas. Il observe, pâle et pas lavé. Il ne sait ni lire ni écrire et déjà couve en lui un appétit de violence aveugle. Toute l'histoire présente en ce visage, l'enfant père de l'homme» (p. 9), les traits de l'enfant symbolisant ceux de l'humanité tout entière, comme l'écrivain le développera bien davantage dans La Route.
La fin du roman sera elle-même riche d'enseignements, qui décrit une «contrée [...] remplie d'enfants violents rendus orphelins par la guerre» (p. 401) ainsi que l'étrange lien qui, dans l'esprit du juge Holden du moins, l'unit au gamin qu'il finira par tuer selon toute probabilité, même si le dernier meurtre du juge, comme les autres qui ont très certainement émaillé le roman, nous demeure caché.
Il faut attendre le grand discours du juge Holden, alors que la troupe de Glanton se repose dans les ruines de l'ancienne civilisation des Anasazis, pour que le thème de la dégénérescence soit évoquée dans toute son ampleur, le juge commençant par raconter une histoire qu'il a peut-être inventée et dont il tire cette morale : «[...] il est mal parti ce fils né d'un père dont l'existence en ce monde est historique et douteuse avant même que le fils y ait fait son entrée. Toute sa vie il va porter devant lui l'idole d'une perfection à laquelle il ne pourra jamais atteindre. Le père défunt a exhérédé le fils de son patrimoine» (pp. 184-5).
Puis vient l'exemple des Anasazis, qu'il convient de citer dans son intégralité : «Le peuple qui vivait ici autrefois s'appelle les Anasazis. Les anciens. Ils ont abandonné ces régions, chassés par la sécheresse ou la maladie ou par des bandes errantes de pillards, abandonné ces régions depuis des siècles et il n'y a d'eux aucun souvenir. Ce sont des rumeurs et des fantômes dans ce pays et ils sont hautement vénérés. Les outils, l'art, la maçonnerie, tout cela porte condamnation des races qui sont venues après. Mais il n'y à rien à quoi elles peuvent se raccrocher. Les anciens s'en sont allés comme des fantômes et les sauvages rôdent à travers ces canyons au son d'un antique ricanement. Dans leurs huttes grossières ils sont tapis dans l'obscurité et ils écoutent la peur qui suinte de la roche. Tout mouvement d'un ordre supérieur à un ordre inférieur est jalonné de ruines et de mystères et des déchets d'une fureur aveugle. Voilà. Ici sont les ancêtres morts. Leur esprit est enseveli dans la pierre. Il repose sur cette terre avec le même poids et la même ubiquité. Car quiconque se fait un abri de roseaux et de peaux de bêtes s'est résigné dans son âme à la commune destinée des créatures et il retournera à la boue originelle avec à peine un cri. Mais celui qui bâtit avec la pierre s'efforce de changer la structure de l'univers et il en était ainsi de ces maçons aussi primitives que leurs constructions puissent nous paraître» (p. 185).
Aucun doute n'est possible sur les intentions que vise le juge Holden, afin, selon ses dires, de former une nouvelle civilisation capable d'échapper à la soue de la brute : «À un jeune âge, dit le juge, ils [les enfants] devraient être enfermés dans une fosse avec des chiens sauvages. Il faudrait les forcer à choisir entre trois portes avec leur propre flair la seule qui ne cache pas des lions furieux. Il faudrait les faire courir nus dans le désert jusqu'à...» (p. 186).
Ces propos rappellent ceux de Kurtz, du moins l'esprit dans lequel Kurtz s'adresse à Marlow, et que Francis Ford Coppola accentuera dans son célèbre film (peut-être ironiquement rappelé par McCarthy dans une image cocasse, cf. p. 212) : exterminez toutes ces brutes !, c'est-à-dire, évangélisons par la force les sauvages et ne gardons d'eux que leur farouche liberté, seule capable d'accomplir de grandes choses, et, d'abord, de nous débarrasser des faibles et des timorés, y compris dans nos propres rangs d'hommes blancs apôtres du progrès. L'un des personnages de Méridien de sang tient d'ailleurs des propos assez semblables à ceux de Kurtz lorsqu'il déclare au gamin : «Fils, dit le capitaine. Nous serons les instruments de la libération dans un pays ignorant et tourmenté. Oui, c'est ça. Nous serons le fer de lance de la campagne» (p. 48).
La plongée de la bande de Glanton dans la pure sauvagerie, l'errance de ces hommes violents étant ponctuée de massacres d'innocents et de forfaits en tout genre, n'est finalement que l'explicitation un peu trop appuyée des rites inimaginables que Marlow préfère taire. Ainsi, s'il existe un secret dans Méridien de sang, il n'est assurément pas dans ce que révèle la sauvagerie : qu'elle n'a aucun sens (car jamais McCarthy ne nous livre la moindre explication, de quelque ordre qu'elle soit, des actes des chasseurs d'hommes menés par Glanton) et qu'elle est sans limite dans sa monotonie même.
Il s'agit toutefois bien, par cette violence, coûte que coûte, de résister à l'effacement, celui dans lequel tombe par exemple une mule (8), celui encore que provoque le juge lui-même lorsqu'il gratte une gravure pariétale et l'efface complètement (cf. p. 219), non seulement par la perpétuation de l'espèce et, au sein de cette dernière, des plus forts et valeureux, mais encore par l'imposition d'une sélection naturelle impitoyable. Le juge Holden serait, bien davantage que l'épigone pour le moins accompli de Nietzsche, le mauvais démiurge étrangement occupé par le sort de ses ouailles, qu'il aurait tout loisir de tuer (il a tué puis scalpé (cf. p. 207) au moins une fois un enfant, et en a sans doute tué plusieurs autres) pourvu qu'elles le vénèrent, comme Tobin le confie au gamin : «Tu sais donc pas qu'il t'aurait emmené avec lui. Il t'aurait emmené, petit. Comme une fiancée à l'autel» (p. 205).
Rien ne peut résister à l'emprise du juge Holden, sa volonté de tout savoir du monde ne pouvant signifier qu'une lutte à mort avec la création, comme il l'explique à Toadvine : «Cette terre m'appartient, dit-il. C'est ma concession. Et pourtant ici même il y a partout des poches de vie autonome. Autonome. Pour qu'elle m'appartienne vraiment rien ne doit pouvoir s'y produire sans mon consentement» (p. 251), comme si, par cette explication, McCarthy insistait de nouveau sur l'identification possible entre son personnage et le Démon, dont la Bible rappelle qu'il possède la terre en héritage, qu'il arpente sans relâche, veillant à ce que la moindre parcelle de territoire ou d'âme ne s'échappe pas de son empire. Holden poursuit en déclarant : «Celui qui croit que les secrets de l'univers sont à jamais cachés vit dans le mystère et la peur. La superstition le mènera à sa perte. Les œuvres de sa vie seront érodées par les pluies. Mais celui qui s'est donné pour tâche de trouver dans la tapisserie le fil conducteur de l'ordre aura par cette seule décision assumé la responsabilité de l'univers et ce n'est qu'en assumant cette responsabilité qu'il peut trouver le moyen de dicter les clauses de son propre destin» (ibid.).
Une fois de plus, le juge Holden se fait le héraut d'une conception qui prône l'arraisonnement de l'univers tout entier, afin d'en éliminer toute forme d'inconnu, assimilé à un désordre seul capable de briser la logique absolue de la destinée.
Il n'est dès lors pas étonnant que ce soit cette capacité absolue de maîtriser, par le savoir, «la moindre entité» (p. 250) qui fasse de l'homme le seul véritable suzerain de la création. Le mot est important, puisque, selon le juge Holden, le suzerain est supérieur à toute autre forme de maître, toutes «les juridictions lui [étant] subordonnées» (p. 251). Quelques pages plus loin (cf. p. 253), c'est Glanton lui-même qui investit de son autorité un jeune garçon chargé de s'occuper des chevaux de la bande, en lui mettant «une main sur le sommet du crâne», comme si finalement l'autorité du chef était suffisamment mystérieuse pour que seule la violence dont il est capable, et par laquelle il a conquis, naturellement, son autorité sur les autres hommes qui le suivent sans broncher, puisse constituer un sacrement puissant, capable d'instaurer, d'instituer, partant : de transmettre. Il n'est ainsi pas anodin que, dès le début de leurs randonnée sauvage, une curieuse forme de complicité lie Glanton au juge Holden.
L'un des sens possibles du roman étrange et même, énigmatique, de Cormac McCarthy consisterait peut-être dans une tentative d'exploration périlleuse vers ce qui fonde, c'est-à-dire, en remontant le plus loin dans le passé (superbes sont les longues descriptions de paysages antédiluviens traversés par la bande puis par le gamin esseulé, cf. p. 267 par exemple), d'exposer non pas la fureur sacrée de l'antique mythologie mais la pure sauvagerie qui n'a pas moins que cette dernière son origine dans un domaine qui est supra-terrestre, les membres de la bande de Glanton étant sans cesse comparés à des pèlerins, ou bien décrits comme les «adeptes de quelque secte obscure envoyés là pour porter la bonne parole parmi les fauves de ces contrées» (p. 236). Quelle bonne parole, puisque ces hommes sont avares de mots ? La ruine pourrait-elle paradoxalement fonder quoi que ce soit voire, tout simplement, quelque chose ?
La volonté, elle aussi répétée, de maîtriser sans partage le monde, comme le juge Holden s'en fait le héraut et l'apôtre, ne peut qu'être le corollaire de la nécessité de survivre dans un milieu fondamentalement hostile à l'homme, et que celui-ci, sauf à posséder les connaissances mystérieuses du juge, ne peut ni ne pourra jamais vaincre, comme nous le voyons dans l'une des scènes les plus saisissantes du roman, lorsque le gamin, séparé du reste de la bande, est brutalement saisi par un événement banal et pourtant mystérieux, trouant les ténèbres d'une épaisseur inquiétante, et contemple un arbre, que l'écrivain qualifie d'«héraldique», brûlant dans la nuit parce qu'il a été touché par la foudre, alors même que d'autres créatures ont été attirées par l'étrange et fascinant spectacle, formant une constellation «d'yeux ignés qui délimitaient l'anneau de lumière, tous unis dans une trêve précaire devant cette torche dont l'éclat avait repoussé les étoiles dans leurs orbites» (p. 270).
Rite sans nom, baptême d'aucune sorte, vision inaccomplie : le gamin, au petit matin, se réveille «au pied du squelette fumant d'un moignon noirci» et recommence son errance. La révélation, comme je le disais, nous est refusée et l'apocalypse ne se déchire pas, l'irruption d'un événement convoquant l'un des éléments auxquels T. S. Eliot (rappelé p. 81) donne une si grande importance, le feu bien sûr, ne débouchant sur rien, si ce n'est l'interprétation ratée, le déchiffrement avorté des «étranges formes coralliennes de la fulgurite dans leurs sillons et creusés dans le sable fondu là où la foudre avait roulé sur le sol dans la nuit avec un sifflement et dans une puanteur de soufre» (p. 271).
Une fois de plus, nous nous trouvons confrontés à ce double mouvement d'avancée et de retrait, de dévoilement et de voilement.
Avancée de la création, dirait-on, devant l'homme, qui en est le centre, comme nous le voyons dans ces étonnantes métaphores où l'auteur convoque le paysage tout entier pour qu'il rayonne à partir et autour de l'un des protagonistes (9). Retrait d'autant plus brutal que, nous l'avons vu, ce même paysage ne semble qu'à regret porter sur son sol préhistorique des créatures qui paraissent, quelles que soient les images que McCarthy utilise pour évoquer leur brutale ancienneté (cf. pp. 291 et 296), beaucoup moins anciennes que lui.
Avancée qui est celle de la thématique, si prégnante dans le roman, du sacré, où l'un des personnages,Toadvine, sans que nous sachions pour quelle raison, trace des signes sur le sable (cf. p. 356), où chaque pierre du désert le plus aride semble encore être, potentiellement, un aleph de significations qui pourtant ne saurait se détacher de cette étrange «démocratie optique» ou «pas une araignée pas un caillou pas un brin d'herbe, qui pût revendiquer la préséance» (p. 311), où sans cesse les personnages sont décrits comme accomplissant des gestes auguraux (cf. p. 325), des initiés (cf. p. 277) où des êtres investis d'une énergie surnaturelle (10) qui font partie d'une bande plusieurs fois décrite comme ne constituant qu'un seul organisme (11) et provenant d'un passé légendaire (cf. p. 341) où le monde entier des choses semblait infiniment plus grand qu'il ne l'est à présent et qui pourtant se dissoudra comme si elle n'avait été qu'un rêve.
Avancée qui est celle où le Christ est plusieurs fois mentionné directement ou indirectement (y compris par la présence d'un Judas de foire, cf. p. 329) et où la seule présence visible de la religion semble être donnée par des églises en ruine où bien un Apache crucifié par des Maricopas (cf. p. 311), un ex-prêtre (en fait, pas tout à fait, comme le personnage lui-même le précisera) Tobin qui est un assassin comme ses compagnons et que le juge Holden ne craint absolument pas et auquel il dira, semblant le tenter : «Que pourrais-je te demander que tu ne m'as déjà donné ?» (p. 315).
Avancée qui est celle de la formidable liberté de ces hommes à peine civilisés, dont le sillage est de pure sauvagerie, et qui pourtant ne semblent destinés qu'à accomplir ce qu'ils doivent accomplir de toute éternité, comme cette unique évocation directe des pensées du chef Glanton l'indique : «Il contemplait le feu et s'il y voyait des présages ça ne comptait guère pour lui. Il vivrait assez longtemps pour voir la mer occidentale et il était indifférent à ce qui viendrait ensuite car il était à toute heure achevé. Que l'histoire de sa vie suive le cours des hommes ou des nations ou qu'elle prenne fin. Il avait depuis longtemps renoncé à toute interrogation sur les conséquences et tout en considérant que le sort de tout homme, comme il en était convaincu, lui est donné par avance il prétendait qu'il y avait en lui tout ce qu'il serait jamais et tout ce que le monde serait jamais pour lui et la charte de sa destinée fût-elle inscrite dans la pierre originelle il s'arrogeait l'autorité et le disait et il eût conduit l'inexorable soleil à son extinction définitive comme s'il l'avait tenu sous ses ordres depuis le commencement des temps, avant qu'il y eût ici ou là des chemins, avant qu'il y eût des hommes ou des soleils pour y passer» (p. 305).
Avancée qui est celle où McCarthy affirme que le feu est «tous les autres feux, le premier feu et le dernier feu qui sera jamais» (p. 307) et, nous venons de le noter, retrait puisque la contemplation du feu ne révèle rien à Glanton.
Avancée qui est où le juge Holden proclame le caractère infini du monde, comparé à «un tour de passe-passe dans une exhibition de charlatan, une fiévreuse hallucination, une transe peuplée de chimères sans analogies ni précédents, un carnaval itinérant, le spectacle d'un chapiteau nomade dont l'ultime destination après tant de tournées sur les bourbiers de tant de champs de foire est un cataclysme dont l'horreur dépasse l'entendement», l'univers n'étant selon le juge «pas une chose bornée et l'ordre qui y règne» n'étant pas limité par «je ne sais quelle liberté de conception autorisant à reproduire dans telle de ses parties ce qui existe dans telle autre» (p. 308), cette infinitude shakespearienne de l'univers, encore rappelée par la guerre comparée à un jeu (12) par Holden (cf. pp. 313-4) étant immédiatement battue en brèche par la parabole (et, pour le coup, le tour de passe-passe) qu'expose ce même personnage, lorsqu'il lance dans la nuit une pièce qui «revint du fond de la nuit en traversant le feu avec un grondement grêle et la main levée du juge était vide et l'instant d'après elle tenait la pièce» (p. 309), raillée encore par le juge qui reproduit dans son cahier d'un immense fémur tout en moquant la crédulité de ses compagnons et en leur délivrant cette phrase ouinienne : «Au fond de votre cœur vous voudriez qu'on vous parle de mystère. Le mystère c'est qu'il n'y en a pas" (p. 317).
Avancée qui est celle du juge Holden accompagné d'un idiot comparé à un «obscur pasteur paléolithique» (p. 360) qu'il a bien évidemment réduit en compagnon de jeu (cf. p. 371), s'approchant de deux des rescapés de la bande de Glanton, le gamin et l'ex-prêtre Tobin comme «des choses dont l'ambiguïté tient au présage même qu'elles signifient. Comme des choses tellement chargées de sens que leurs formes en sont brouillées» (pp. 352-3), et qui pourtant ne livreront aucun présage et n'apprendront rien au gamin, si ce n'est ce qu'il semble savoir depuis bien des années : seul survit, dans le désert implacable, le plus fort, le plus rusé, le plus téméraire.
Avancée jusqu'à la mer qui, comme dans La Route, n'apportera aux personnages aucune révélation, et retrait figuré par la belle scène où un «poulain se pressait contre le cheval avec la tête penchée et le cheval regardait au loin, là-bas où s'arrête le savoir de l'homme, où les étoiles se noient, où les baleines emportent leur âme immense à travers la mer sombre et sans faille» (p. 379).
Voilement et dévoilement constituent la problématique principale de Méridien de sang. Peut-être même serait-il plus juste d'affirmer que le dévoilement n'existe pas dans le roman, qui n'est riche de rien d'autre que de nous appâter et, immédiatement, de nous refuser ce pour quoi nous nous sommes avancés, comme le gamin devant l'arbre en feu, fascinés par ce que nous avons cru entrevoir.
Cette stratégie fondée sur la déception est la force principale du roman de McCarthy et aussi sa faiblesse, car le roman véritable se révèle peut-être par sa capacité à ne pas fuir devant la banalité, à l'exposer tout bonnement, alors que l'écriture de McCarthy, elle, est toujours nichée à quelques milliers de mètres au-dessus de nos têtes, décrivant des paysages inouïs, des actions dignes de batailles homériques, des meurtres qui semblent surgir de l'imagination même du Diable, des tournures apophatiques qui masquent l'horreur mais qui cependant, à force d'être surjouées, finissent par lasser (cf. p. 391), des rêves dont l'interprétation est pour le moins difficile, comme ceux du gamin pendant sa convalescence, où le juge Holden apparaît (cf. p. 386) auquel un forgeron forge une monnaie de singe qui serait acceptée pour le juge, et qui, peut-être, trouveront leur clé énigmatique dans la toute dernière page du roman, parabole fumeuse ou bien chiffre du rébus, on ne sait (cf. p. 419).
Roman augural, je l'ai dit, que Méridien de sang et qui, à sa façon, tente de colliger, comme le juge Holden la moindre pierre attirant son attention, les ultimes vestiges du sacré. Mais pour en faire quoi ? Ramasser les tessons de la poterie cassée pour tenter de reconstruire quel vase, selon une très vieille métaphore cabalistique qui nous enseigne que chacun d'entre nous peut, à sa mesure, participer à l’œuvre de restauration divine ?
Méridien de sang, truffé de vocabulaire et de références religieuses, est peut-être l'un des romans contemporains les plus vides de Dieu, et nous avons vu que le Christ y est toujours moqué, souillé, parodié, tué (cf. p. 392) alors même que triomphe l'esprit du juge Holden qui est celui de la guerre : «Si la guerre n'est pas une chose sainte l'homme n'est qu'une poussière grotesque» (p. 382), affirmation qui sera infléchie de manière bouleversante dans La Route, lorsque le narrateur affirme que, si l'enfant ne résume pas l'histoire de tous les prophètes, alors plus rien, en somme, n'a de sens.
Le dernier sens, le plus ésotérique, du roman de Cormac McCarthy est peut-être de nous confronter au vide, à l'absence de réponse, à la facilité de certains discours du juge Holden, et de tenter, aussi, par une voie pour le moins escarpée, de poser les premières bases d'une sacralité qui resurgirait, quasiment intacte, après deux millénaires de religion monothéiste, comme si le sacré était finalement la réalité irrécusable seule capable de résister à la destruction que le roman convoque sans relâche, par la désolation de son paysage ou par les incessantes tueries qui scandent ses pages comme le monotone staccato d'un boucher officiant sur un quartier de viande.
Mais, contrairement à ce que La Route, croyons-nous, enseignera, la résurgence du sacré et même, écrit McCarthy, de la sainteté, ne peut se faire ici que sur la traîne guerrière de l'horreur, et pour l'unique officiant et survivant de tous les carnages, ange malfaisant du Mal ou archonte de la violence, le juge Holden bien sûr, que les dernières pages du roman nous présentent, justement, en train de danser, après avoir consommé ses noces sataniques avec le gamin : «Écoute ce que je vais te dire. Plus la guerre sera déshonorée et sa noblesse mise en doute, plus ces hommes d'honneur qui reconnaissent la sainteté du sang seront exclus de la danse qui est le droit du guerrier, et ainsi la danse deviendra une fausse danse et les danseurs de faux danseurs» car «Celui-là seul qui s'est offert tout entier au sang de la guerre, qui a été jusqu'au fond de la fosse et qui a vu toute la plénitude de l'horreur et qui a compris enfin qu'elle parle au plus intime de son cœur, seul cet homme sait danser» (p. 412).
Notes
(1) Le jeune homme est ainsi décrit comme «le plus misérable candidat au baptême» lorsqu'il entre «dans l'eau [d'un] fleuve» (p. 39), un autre personnage affirme qu'il a été ressuscité «comme Lazare» (p. 42), alors que le diable est superbement évoqué aux pages 58-9 : «La poussière soulevée par le détachement était vite dispersée et perdue dans l'immensité de ce paysage et il n'y avait pas d'autre poussière car le pâle pourvoyeur qui les poursuivait se déplace sans être vu et son maigre cheval et sa maigre carriole ne laissent de trace ni sur ce sol-là ni sur un autre. Il garde sa provende près d'innombrables feux dans un crépuscule qui a la couleur bleue du fer et c'est un marchand cynique et grimaçant, habile à suivre n'importe quelle campagne ou à traquer les hommes dans leurs trous, de préférence dans ces régions calcinées où ils sont venus pour se cacher de Dieu.» Bien d'autres références existent, comme par exemple à la page 165, où le juge Holden, qui tient un sermon aux hommes de Glanton, «mais un sermon comme personne en a encore jamais entendu», réussit à faire de ces intrépides et brutaux chasseurs d'Indiens les «disciples d'une nouvelle foi».
(2) Dans deux notes, ici et là.
(3) Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner la multitude de sources historiques à laquelle Cormac McCarthy a puisé pour écrire ce roman : citons My Confession de Samuel Chamberlain évoquant ses aventures dans le Sud-Ouest des États-Unis à la fin des années 1840, le Adventures in Mexico and the Rocky Mountains de George Frederick Ruxton, un Anglais ayant décrit la ville de Vera Cruz au milieu du 19e siècle, mais encore Wild Life in the Far West : Personal Adventures of a Border Mountain Man de James Hobbs ou encore, du fils de l'artiste John James Audubon, John Woodhouse Audubon, Audubon's Western Journal : 1849-1950. Je dois ces informations à l'excellent ouvrage de John Sepich intitulé Notes on Blood Meridian (édition revue et augmentée, University of Texas Press, Austin, États-Unis, 2008).
(4) Évoquons ainsi les : «gouttes qui arrivaient au fond du canyon formaient à peine un filet d'eau et ils se penchèrent tour à tour sur la pierre avec les lèvres pincées comme des dévots dans un sanctuaire. Ils passèrent la nuit dans une grotte basse au-dessus de cet endroit, vieux reliquaire de débris de silex et d'éclats éparpillés sur le sol pierreux avec des grains de coquillages et des os polis et le charbon de bois d'anciens feux» (p. 75), ou encore : «Il n'y eut ni déjeuner ni sieste et l’œil cotonneux de la lune trônait au grand jour dans la gorge des montagnes à l'orient et ils étaient encore à cheval quand elle les devança sur son méridien de minuit, composant en bas sur la plaine un camée bleu avec ces pitoyables pèlerins qui s'en allaient vers le nord en bringuebalant sur leurs selles» (p. 113). Ce dernier exemple nous montre de quelle façon McCarthy mélange les sphères de la religion et d'un sacré venu de la nuit des temps. Ce dernier mélange d'ailleurs les polarités du bien et du mal par le biais de cette comparaison : «Les charognards étaient juchés dans les angles des toits avec leurs ailes déployées dans des attitudes d'exhortation comme de petits évêques noirs» (p. 77). C'est sans doute le fascinant personnage du juge Holden, qualifié par exemple de «grande déité pâle» (p. 119) qui condense le plus parfaitement l'ambiguïté que nous avons notée : «Le juge souriait. Il expulsait avec son pouce d'infimes créatures des replis de sa peau glabre et il garda la main levée avec le pouce et l'index joints dans un geste qui parut être de bénédiction jusqu'au moment où il jeta quelque chose d'invisible dans le feu devant lui» (p. 120). D'autres exemples peuvent être cités, comme celui d'un des chasseurs d'Apaches tué durant un règlement de compte, «l'homme sans tête était assis à la même place comme un anachorète assassiné, déchaux dans la cendre et en chemise» (pp. 136-7), «les montagnes dans leurs îles bleues se dressaient sans soubassement dans le vide comme des temples flottants» (p. 138), ou bien la scène nocturne où les rudes gaillards menés par Glanton sont décrits comme des «pyrolâtres» (p. 142), etc.
(5) La très ancienne thématique de la création comme livre de Dieu est d'ailleurs utilisée à la fois par l'ex-prêtre Tobin (cf. p. 157) et par le juge Holden (cf. p. 148), le premier affirmant que l'homme doit écouter la voix incessante de Dieu même s'il ne se rend pas compte qu'il l'écoute tout le temps et qu'il ne peut comprendre qu'il l'a perdue qu'au moment où elle se tait, le second disant de Dieu qu'Il ne saurait mentir puisque ses créations («les arbres et les pierres, les ossements des choses») ne sauraient mentir. Remarquons également que c'est le corps même des hommes de Glanton qui peut se lire comme un véritable livre d'atrocités : «Ils se rendirent aux bains publics où ils entrèrent dans l'eau un par un, chacun plus pâle que celui qui l'avait précédé et tous tatoués, flétris au fer, recousus, les grandes estafilades boursouflées inaugurées Dieu sait où par quels chirurgiens barbares, comme les traces de gigantesques mille-pattes sur les torses et les abdomens, et quelques-uns déformés, avec des doigts qui manquaient, des yeux, leurs fronts et leurs bras marqués de lettres et de chiffres comme des meubles à inventorier» (p. 211).
(6) La communication entre deux mondes étroitement imbriqués l'un dans l'autre (cf. p. 141) ne peut qu'être suggérée par plusieurs thématiques comme celle du voyage perpétuel, cf. p. 154 : «De sorte que les deux partis se séparèrent sur cette plaine nocturne, chacun refaisant le chemin par où l'autre était venu, accomplissant comme il arrive fatalement à tous les voyageurs des permutations sans fin sur les parcours des autres hommes»; ou bien les thématiques de la frontière et de la borne, cf. p. 70 : «comme ces créatures vaporeuses des régions inconnaissables», p. 134 : «le pourtour tremblant du monde» ou encore le juge Holden assit sur un rocher, véritable «borne pour marquer sa place dans ce néant» (p. 159). Une très belle scène nous montre enfin Glanton fixant la région où, sous le coup d'un mandat d'arrêt, il ne peut se rendre et où se trouvent «la femme et l'enfant qu'il ne reverrait pas» (p. 218); celle encore qui décrit les paysages traversés par les personnages comme des lieux infernaux, cf. p. 83 : «désolation de purgatoire», la réalité visible ayant laissé place à une topographie inconnue, cf. p. 85 : «toutes ces pierres d'un autre monde» ou p. 111 : «le soleil chauffé à blanc et la lune sa pâle réplique, comme s'ils avaient été les extrémités d'un même tube au-delà desquelles brûlaient des mondes qui défiaient l'entendement». Le mélange subtil entre deux plans d'une même réalité est également suggéré par plusieurs scènes magnifiques, comme celle par exemple où des cavaliers au galop sont, en raison de l'extrême chaleur qui accable le paysage, reflétés dans le ciel comme une horde diabolique (cf. p. 139), ou celle encore où la bande de Glanton est décrite comme «des migrateurs sous une étoile à la dérive et leur trace sur le sol reflétait dans sa vague courbure les mouvements mêmes de la terre» (p. 194). Page 396, le romancier évoque «l'obscur ourlet du monde».
(7) «Le bois de feu, les lessiveuses. Il part à l'aventure loin vers l'ouest jusqu'à Memphis, migrant solitaire sur ce paysage plat et pastoral. Des Noirs dans les champs, hâves et voûtés, leurs doigts d'araignée parmi les coques des cotonniers. Une souffrance d'ombre dans le jardin» (p. 10).
(8) «Elle rebondit le long de la paroi du canyon avec le contenu des paniers [...] et elle dégringola à travers la lumière du soleil et l'ombre, tournant sur elle-même dans ce vide solitaire et disparaissant dans un siphon de froide étendue bleue qui l'affranchissait à jamais du souvenir dans l'esprit de toute créature vivante» (p. 187). Ailleurs, les populations massacrées par la bande de Glanton sombrent elles aussi dans le néant : «Dans les jours à venir les fragiles rébus noirs du sang dans les sables allaient se lézarder et s'effriter et se disperser de sorte qu'après quelques révolutions du soleil toute trace de la destruction de ces gens serait effacée. Le vent salé du désert rongerait leurs ruines et il n'y aurait rien, ni fantôme ni scribe, pour dire au voyageur sur son passage que des humains avaient vécu ici et comment ils y étaient morts» (pp. 220-1).
(9) «Assis en tailleur dans l’œil de ce vide cratérisé il [le gamin] voyait le monde s'estomper sur ses marges dans une miroitante interrogation qui encerclait le désert» (p. 271).
(10) Qui toujours, chez McCarthy dont la formation est scientifique, s'explique de façon parfaitement rationnelle. Ainsi, il y a fort parier que telle scène trouve son origine dans de banales questions de charges électrostatiques : «Puis ils commencèrent à se débarrasser de leurs vêtements de dessus, les surtouts de cuir et les serapes de laine brune et les gilets, et ils propageaient autour d'eux un grand crépitement d'étincelles et chaque homme semblait porter un linceul fait du feu le plus pâle. Leurs bras levés pour retirer leurs vêtements étaient lumineux et chacune de ces âmes obscures était enveloppée de formes audibles de lumière comme s'il en avait toujours été ainsi» (p. 279).
(11) «Chaque homme balayait le terrain du regard et le mouvement de la moindre créature était enregistré dans leur perception collective, reliés qu'ils étaient par les invisibles filaments de leur attention, et ils progressaient sur ce terrain avec une seule et unique résonance» (p. 284).
(12) Toutefois, il est vrai qu'en affirmant que la «guerre c'est Dieu» (p. 314), le juge Holden semble placer les jugements les plus hauts de l'homme sous le regard d'une «instance suprême» devant laquelle «les considérations d'équité et de rectitude et de droit moral sont nulles et non avenues et les vues des parties sont traitées avec dédain» (pp. 314-5).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, cormac mccarthy, méridien de sang |  |
|  Imprimer
Imprimer





























































