« Le livre de ma mère d’Albert Cohen : une stèle pour l’éternité, par Gregory Mion | Page d'accueil | Un Cahier de l'Herne Joseph Conrad encalminé dans les eaux troubles de l'Université Lyon 2 »
01/03/2015
Virgile, père de l'Occident de Theodor Haecker
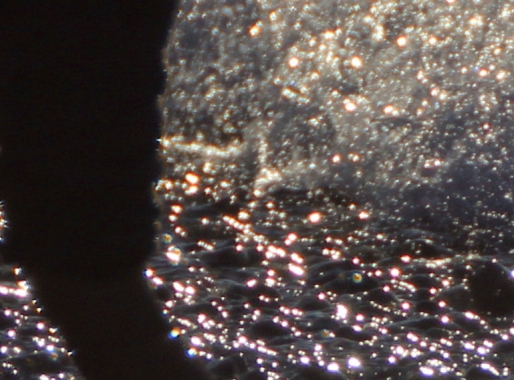
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Sur Le chrétien et l'histoire de Theodor Haecker.
Sur Le chrétien et l'histoire de Theodor Haecker. Virgile paraissant dans la collection de la Pléiade ne peut nous détourner de cette vérité : il n'est plus vraiment lu, encore moins enseigné, et il n'est donc pas très étonnant que ce soit Theodor Haecker, lui-même complètement ignoré ou peu s'en faut par le lectorat français, y compris savant, qui consacre au grand poète un très beau livre édité par Ad Solem (1). La préface que Rémi Brague a donnée à ce livre n'est pas très intéressante, même si elle évoque, utilement à nos yeux, le beau sentiment de piété, si incroyablement présent dans l'Énéide, comme je l'ai montré dans une de mes notes sentiment plus utile, alors que nous vivons dans un monde déraciné, cassé, que jamais (cf. p. 13), et si cette préface a également saisi l'enjeu de la thèse de l'auteur, qui fait de «Rome une civilisation essentiellement «adventiste», en attente de quelque chose qui doit l'accomplir et la dépasser» (p. 7). Rome ne peut mourir, puisque Rome se métamorphose au cours des âges, mais demeure le centre, de plus en plus invisible certes, du monde.
Virgile paraissant dans la collection de la Pléiade ne peut nous détourner de cette vérité : il n'est plus vraiment lu, encore moins enseigné, et il n'est donc pas très étonnant que ce soit Theodor Haecker, lui-même complètement ignoré ou peu s'en faut par le lectorat français, y compris savant, qui consacre au grand poète un très beau livre édité par Ad Solem (1). La préface que Rémi Brague a donnée à ce livre n'est pas très intéressante, même si elle évoque, utilement à nos yeux, le beau sentiment de piété, si incroyablement présent dans l'Énéide, comme je l'ai montré dans une de mes notes sentiment plus utile, alors que nous vivons dans un monde déraciné, cassé, que jamais (cf. p. 13), et si cette préface a également saisi l'enjeu de la thèse de l'auteur, qui fait de «Rome une civilisation essentiellement «adventiste», en attente de quelque chose qui doit l'accomplir et la dépasser» (p. 7). Rome ne peut mourir, puisque Rome se métamorphose au cours des âges, mais demeure le centre, de plus en plus invisible certes, du monde.Cette idée selon laquelle Virgile a annoncé plus grand que lui n'est pas à proprement parler originale, et le très grand écrivain Hermann Broch fera lui aussi de son personnage, Virgile, un homme et un artiste du pressentiment, de la prescience, de l'attente de plus grand que lui : le Christ, et c'est par le biais, aussi, de l'attente d'un langage dépassant celui dont disposait Virgile mourant que j'ai analysé ce magnifique roman.
Theodor Haecker développe cette thèse dès l'Avant-propos de son ouvrage, où il écrit : «Aussi bien, je ne veux pas parler de l’homme virgilien, au sein de l’homme occidental, comme d’un type particulier, isolé et clos, mais comme d’un membre qui a relation avec la totalité de l’humanité, de la même manière que l’on peut considérer un fleuve, non seulement en lui-même, mais en tant qu’il se jette dans la mer immense et commune» (p. 21). Évoquer Virgile, pour Haecker, ne peut avoir de sens que s'il l'inclut dans une Histoire qui elle-même n'a d'autre finalité que celle de célébrer une histoire plus grande, subsumante, invisible comme Rome devenue centre de la chrétienté, l'histoire prodigieuse du salut, puisqu'il «s'ensuit que chaque type réel est nécessairement en rapport, amical ou hostile, avec la préoccupation majeure de l'humanité : chercher le salut, le trouver, l'accueillir, le rendre efficace» (p. 20), Virgile étant l'exemple même de l'homme «qui est engagé, certes dans un temps historique précis, mais à la manière d'un très long fleuve qui change de nom selon les contrées qu'il traverse» (p. 21). Si Rome n'est plus, si la chrétienté n'est plus, alors cela signifiera probablement que Virgile ne sera plus lui aussi, ou bien qu'il ne sera plus qu'étant amoindri, non point monade païenne chantant l'amour et le travail, la beauté de la terre et de l'honneur mais, tout de même, grand poète amputé de son aura troublement mystique.
Cette herméneutique qui fait de Virgile un précurseur, quoique contestable même si elle a été avalisée d'une certaine façon par bien des auteurs, dont Sainte-Beuve lui-même (2), n'en demeure pas moins, selon Haecker, absolument vitale pour qui tente de comprendre ce que fut la grandeur véritable, réelle, du poète. Voici des phrases magnifiques : «Nul ne peut comprendre Virgile dans son intégrité et sa totalité s’il ne voit que Virgile est sous l’empire d’un absent et d’une nostalgie qui lui vient de l’attirance de cet absent, personne ne peut le comprendre, lui le païen adventiste, sans tenir compte de la foi qui advenait et du rôle que le poète a tenu jusqu’à ce jour où il devint le terreau naturel de cette foi. Celui qui distrait de Virgile cette absence de la Révélation et la nostalgie qui naît de cette absence en prend top à son aise : il néglige le plus grave de la vie, ne grandit qu’en apparence la mélancolie qui marque en l’âme la blessure de l’éternité et, confectionnant une poupée de chiffons, la donne pour une statue de pierre du poète» (pp. 26-7, l'auteur souligne).
Si Virgile attend plus grand que lui, c'est parce qu'il a «comblé toute la mesure assignée au paganisme, sans qu'une seule goutte du poison des Tantales, en moussant, ait débordé du précieux calice» (p. 25), et que sa poésie frémit d'une célébration plus joyeuse, ardente et pleine. C'est encore à partir de sa grandeur même, pourtant bornée, que ceux qui le suivront pourront être compris et, d'une certaine façon, comparés à lui. Virgile est une borne, un maître étalon, un patron, sur lequel certains génies, comme Dante, pourront tenter de prendre leurs propres mesures, découpant un habit qu'ils ne revêtiront qu'une fois qu'ils auront remercié leur maître, obéissant ainsi à l'impératif catégorique qu'exige la soumission à la piété (3), à celui qui vous a précédé, qui n'a peut-être pas vu plus loin que vous, mais qui vous a appris à voir : «L’unité et la continuité des fondements naturels et humains de l’Occident païen gréco-romain aussi bien que de l’Occident chrétien, c’est exactement ce qu’au seuil de la plénitude des temps authentifient un grand poète et son œuvre; non seulement parce que l’anima vergiliana, c’est-à-dire l’âme la plus sublime de l’ancienne Rome, devait au cours des siècles se retrouver fraternellement identique chez Dante, Racine ou Newman, mais, plus que cela, parce qu’à partir du baptême et de la foi les âmes chrétiennes allaient éclairer réversiblement de la lumière de la Grâce la plus parfaite anima naturaliter christiana de l’Antiquité : l’âme du grand poète Publius Vergilius Maro» (pp. 27-8, l'auteur souligne). Ajoutons, à ces trois grands noms, celui d'Augustin : «L’âme la plus riche de l’Antiquité chrétienne, de nature moins pure que celle de Virgile, mais cependant anima vergiliana, Augustin, nous a avoué que jusqu’à sa conversion il avait coutume de lire chaque jour la moitié d’un chant de l’Énéide» (p. 129).
Le texte de Theodor Haecker, parfois, bien souvent même mais c'est le propre de toute apologétique, devient irritant, à force de ne souligner que l'aspect adventiste de la poésie virgilienne, toute tendue vers la célébration du Verbe qui la dépassera. Il est vrai que, pour l'auteur, un génie artistique qui ne se place pas à l'ombre de la Croix n'est, au mieux, qu'un habile faiseur, puisque aucune brisure n'existe et ne saurait exister entre les premiers mots du poète et ceux du Christ, si ce n'est une miraculeuse continuité : «Entre le «Lallen» [balbutiement] et l’Alleluia s’étendent la vie de l’homme et son œuvre, la philosophie et l’art» (p. 33).
La langue bien sûr, est au centre du mystère de Virgile, sa pureté cristalline nous permettant de voir ce que lui-même, peut-être, n'a pas vu : ce qui la dépasserait en quelque sorte : «Il existe parmi les hommes des esprits plus fiers, en apparence moins attachés à la terre, des esprits qui n’ont pas besoin de la corde du langage pour se hisser jusqu’à la pensée, de la corde d’amour du langage, mais ils sont loin de la langue, marâtre pour eux, mais la plus tendre des mères pour les vrais poètes; ils sont loin de la plus grande affaire de ce monde, ils sont loin de la croix. Tandis que les vrais poètes n’ont jamais lâché la corde, grâce à laquelle ils se retrouvent, savent raconter, savent le dire aux pauvres hommes que nous sommes, quand bien même ce qu’ils disent serait moins que ce que ces fiers esprits plus détachés de la terre n’ont peut-être que pensé. Il n’est, en fait, pas question de plus ou de moins : c’est, ici l’absence et là la présence du Mystère. Le moindre des anges en sait incommensurablement plus que ces esprits orgueilleux, mais le plus élevé des anges écoute et s’étonne, parce que lui-même en est incapable, le «neuf » que dit dans sa langue pétrie de terre un pauvre homme mortel, car c’est par l’homme et non par l’ange que Dieu dit et redit toujours le «neuf»» (pp. 55-6). Haecker évoquera plusieurs fois la beauté de la langue latine, par exemple à propos du mot fatum, qu'il est d'ailleurs si difficile de traduire dans une autre langue : «Il [Virgile] est obscur dans la langue la plus claire du monde et par là donne précisément à entendre qu’il parle du mystère le plus obscur de tout être. Il est obscur parce qu’il se tient dans la lueur de l’Avent, il n’est pas obscur parce qu’il se tient dans les ténèbres de l’apostasie. Il balbutie parce qu’il est proche de l’origine du langage humain, origine qui est le langage de Dieu, qui est Dieu même, il ne balbutie pas parce qu’il rampe dans la superficialité sans voix du chaos antérieur à l’homme; c’est cela qu’il faut remarquer et examiner» (pp. 91-2). Ou encore, l'auteur opposant cette fois la langue de Virgile à celle de tant de ses médiocres imitateurs : «[…] la langue paraît versifier d’elle-même, les sons paraissent d’eux-mêmes faire de la musique, les couleurs d’elles-mêmes faire de la peinture, et les divergences fondamentales et les contradictions s’organiser d’elles-mêmes en satire, quand il suffit qu’un enfant, un pitre ou un faussaire habile y mette la main, mais de telles œuvres seront demain à la poubelle, et rêver que l’une d’elles puisse durer et subsister deux mille ans, est un cauchemar qui n’a connu ni réveil ni accomplissement» (p. 127).
Un message, angoissant, un cri d'alarme en fait, sourd dans ces pages, d'autant plus discret que l'auteur déploie sa puissance persuasive. Virgile précède le Christ, c'est un fait mais, surtout, l'annonce, et ce n'est sans doute pas sans raison que l'Énéide a pu être lu comme un oracle au cours des siècles (4). Il n'en demeure pas moins que nulle répétition n'est possible : Virgile est non seulement, évidemment, unique, mais il est désormais parfaitement impossible de lui trouver un maigre équivalent (5), et cela bien que l'Empire roman, selon l'auteur, soit immortel (6), car la répétition est impossible et la grandeur, règle absolue de toute position réactionnaire, se perd immanquablement au fil du temps, la beauté et la grandeur ne pouvant que s'inverser, être rejouées dans leurs parodiques défroques : «On ne peut pas mieux faire revivre le paganisme d’avant le Christ que le judaïsme d’avant le Christ. C’est l’énorme différence entre l’humanité obédientielle et adventiste d’un Virgile et l’humanisme anémié et décadent de ceux que l’on appelle les humanistes de la Renaissance : celle-là était une terre maternelle qui attendait d’être ensemencée; celui-ci une entreprise horticole qui cultivait en pots de jolies fleurs; celle-là un abîme d’ardent désir qui appelait l’abîme de son accomplissement et, d’ailleurs, ne resta pas sans réponse; celui-ci une règle précautionneuse de prudentes mesures, suffisante peut-être, au mieux et par hasard, pour garder les yeux fermés pendant quelques siècles sur les catastrophes à venir […]» (p. 90).
Notes
(1) Theodor Haecker, Virgile, Père de l’Occident (préface de Rémi Brague, traduit de l’allemand par Claude Martingay, Ad Solem, 2007).
(2) «La venue même du Christ n’a rien qui étonne quand on a lu Virgile», Sainte-Beuve, cité p. 83 par Theodor Haecker.
(3) La piété est très bellement évoquée par Theodor Haecker à plusieurs reprises, comme ici : «Pieux, Énée l’est originellement dans sa qualité de «fils». La piété romaine est là chez elle. Être pieux, c’est être fils aimant à en accomplir les devoirs. Aimer accomplir ses devoirs ou accomplir ses devoirs par amour signifie être pieux. Lui-même père et ancêtre de César et de César Auguste, Énée voit dans son propre fils et dans le fils de son fils des aïeux et des pères de fils qui sont pieux envers leurs pères et leurs aïeux. Le rapport mutuel entre père et fils avec la primauté du père est le fondement de la piété virgilienne. Ce n’est pas pour l’amante, ce n’est pas pour ravir la reine, ce n’est pas en vue d’une action héroïque, mais pour son père qu’Énée descend au royaume souterrain, à travers les Enfers jusqu’aux Champs Élysées, où son père le salue en pleurant [cf. Énéide, 6, 687-696]» (pp. 74-5). Cette pitié est garante de la cohésion la plus parfaite entre les générations de femmes et d'hommes, mais aussi entre ces dernières et la sphère divine : «Cette pité, qui a sa source dans la famille, et spécialement dans le rapport du fils à son père, du père à son fils, et qui est là intime, transparente et confiante, ne perd ni ses traits ni son caractère quand elle plonge dans le mystère de l’inconcevable et du divin où, face à la cause première de l’existence, elle se tient au service de la divinité» (p. 75).
(4) «Un Anglais amateur de Virgile nous a raconté que pendant la Grande Guerre il ouvrait parfois l’Énéide dans cette intention et qu’après la catastrophe de la Russie son regard tomba sur ces vers qui racontent la fin de Priam, le grand roi d’Asie : «Iacet ingens truncus, / Avulsumque humeris caput et sine nomine corpus». «Sur la rive, énorme, gît le tronc, / des épaules
La tête est arrachée; le cadavre est sans nom» [2, 557-8]» (p. 78).
(5) «On cherche aujourd’hui convulsivement «l’homme», mais on cherche quelque chose qui n’existe absolument pas : l’homme autonome. Viser tout l’homme ne signifie pas seulement que l’on se refuse à en prendre une partie pour le tout, mais, ce qui est beaucoup plus essentiel et décisif, que l’on reconnaisse sa totalité en ce qu’il est «l’homme », la créature entièrement, appelant donc sans cesse de ses cris le Créateur aussi longtemps qu’il n’est pas auprès de lui, tel l’enfant sa mère aussi longtemps qu’elle n’est pas auprès de lui» (p. 90, l'auteur souligne).
(6) Une idée que l'auteur évoquera p. 77 et répétera p. 87 : «Tous, nous sommes encore des membres de l'Empire romain, que nous tenions cette appartenance pour vraie ou pas, que nous la sachions ou pas, membres de cet Empire qui, après de cruelles erreurs avait embrassé de son plein gré, sua sponte, la religion chrétienne dont il ne pourra plus se dessaisir sans se dessaisir de lui-même et de l'humanisme» (pp. 87-8). Voici encore de quelle façon Theodor Haecker figure l'essentielle filiation, bien évidemment chrétienne à ses yeux, entre l'Empire romain et l'Europe dans laquelle nous vivons : «Le trône de Charlemagne est à Aix-la-Chapelle. Ce n’est pas un siège confortable, et ne l’était pas non plus au commencement. Il est fait de dalles de marbre qui furent transportées de Rome à Aix-la-Chapelle. Sur l’une des dalles se voit encore un jeu de marelle grossièrement gravé. Des soldats romains ou des enfants ont pu jouer sur cette dalle. Le siège de Charlemagne est dans une église dont la coupole s développe au-dessus et en avant du siège et sur laquelle est représenté sur son trône la Majestas Domini, le Seigneur en majesté. C’est de l’Imperium romanum qu’est issu le Sacrum Imperium de l’Occident chrétien» (pp. 116-7).






























































 Imprimer
Imprimer