« László Krasznahorkai dans la Zone | Page d'accueil | Louis Massignon dans la Zone »
17/06/2015
Sous le coup de la grâce de László Krasznahorkai
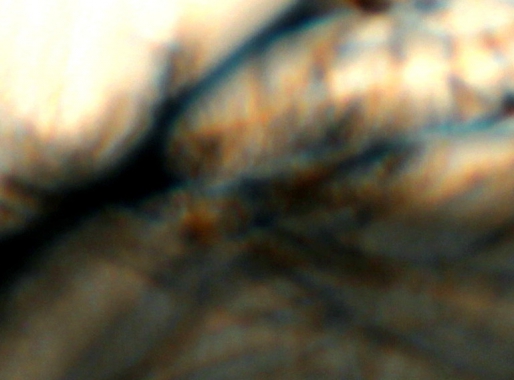
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 À propos de László Krasznahorkai, Sous le coup de la grâce (traduit du hongrois par Marc Martin, Éditions Vagabonde, 2015).
À propos de László Krasznahorkai, Sous le coup de la grâce (traduit du hongrois par Marc Martin, Éditions Vagabonde, 2015).LRSP (livre reçu en service de presse).
 Béla Tarr dans la Zone.
Béla Tarr dans la Zone. László Krasznahorkai dans la Zone.
László Krasznahorkai dans la Zone. Récent lauréat du Man Booker International Prize, László Krasznahorkai est un grand écrivain que, grâce au travail acharné de quelques passionnés (et jamais nous n'oublierons de remercier les deux excellents traducteurs français de ce Hongrois intimidant), nous commençons à mieux connaître en France, le pays des plus hautes gloires littéraires, qui a même réussi, double coup de génie, à donner au Prix Nobel l'un de ses plus mauvais et anodins écrivains, Jean-Marie Le Clézio, et permis à quelque journaliste bavard de se hisser sur les épaules d'un nain perpétuellement bronzé et souriant, signe que la grande littérature profite décidément à celles et ceux qui l'honorent de leur immarcescible talent et aux animalcules qui en mangent les innombrables et minuscules débris.
Récent lauréat du Man Booker International Prize, László Krasznahorkai est un grand écrivain que, grâce au travail acharné de quelques passionnés (et jamais nous n'oublierons de remercier les deux excellents traducteurs français de ce Hongrois intimidant), nous commençons à mieux connaître en France, le pays des plus hautes gloires littéraires, qui a même réussi, double coup de génie, à donner au Prix Nobel l'un de ses plus mauvais et anodins écrivains, Jean-Marie Le Clézio, et permis à quelque journaliste bavard de se hisser sur les épaules d'un nain perpétuellement bronzé et souriant, signe que la grande littérature profite décidément à celles et ceux qui l'honorent de leur immarcescible talent et aux animalcules qui en mangent les innombrables et minuscules débris.Il était temps, tout de même, que les lecteurs français puissent commencer à disposer d'une vue d'ensemble de l’œuvre de Krasznahorkai et qu'ils se disent, du moins pour les plus intrépides d'entre eux : voilà un univers, une vision, un souffle, un questionnement qui tranchent brutalement, merveilleusement, avec le manque total d'ambition de la création (pardon, production) romanesque française, à une ou deux exceptions près, que j'ai d'ailleurs de plus en plus de mal à identifier.
Publié en 1986 sous le titre Kegyelmi viszonyok, soit une année après le Tango de Satan, Sous le coup de la grâce. Nouvelles de mort est un recueil de textes qui se répondent par de discrètes allusions et le traitement polyphonique de thématiques communes ou bien par de plus francs motifs, comme pour la deuxième nouvelle (Herman le garde-chasse. Première variante) et la dernière de ces nouvelles (La fin du métier. Deuxième variante), même si diffèrent légèrement les situations, les faits, de même que les personnages et l'interprétation donnée de la parabole que constitue l'histoire du garde-chasse.
La première nouvelle, intitulée Le Dernier bateau a servi, avec une autre nouvelle intitulée Dans le main du barbier, de premier scénario pour un des courts-métrages de Béla Tarr, Le Dernier bateau qui date de 1990. Cette très courte nouvelle est énigmatique, et nous ne savons pas si elle décrit un exode de population dû à la guerre ou bien quelque échappée belle face à un cataclysme qui n'est jamais nommé. Les fugitifs sont décrit comme étant «pareils aux rats qui, en raison de leurs exceptionnelles capacités de survie, étaient peu à peu devenus pour nous une sorte d'animal sacré et, à ce titre, l'objet exclusif de notre attention» (p. 10).
Il y a, dans la deuxième nouvelle intitulée Herman le garde-chasse (Première variante) quelque chose de l'effroi surnaturel qui détache La légende de Saint-Julien l'Hospitalier de Flaubert sur une espèce de mandorle barbare, mais aussi, plus directement, de Guerre & Guerre, comme si le garde-chasse, décrit comme étant rongé de l'intérieur par une force hostile (cf. p. 28), une «puissance si destructrice qu'elle broyait tout au passage» (p. 39), était le terrain de jeu de puissances surhumaines, l'une de ces forces étant clairement diabolique, «oppressante et sourde" qui envahit, «irrépressible, les chemins bien entretenus», ronge les mangeoires, pourrit «belettières et assommoirs perchés» et s'insinue, «telles d'énormes tiges de ronce», dans «tout le sous-bois, de quoi tourner en dérision les convulsives ambitions humaines dont le simplisme tente, à sa propre manière héroïque, d'amoindrir tout ce qu'il y a de complexe et d'incompréhensible...» (pp. 30-1).
Herman n'est pas à ranger du côté du bien ou du mal, mais devient le serviteur d'une souffrance universelle, tour à tour dirigée contre les animaux puis contre leurs bourreaux, les humains. Il sera abattu, d'ailleurs, comme une espèce solitaire, unique en son genre, de Christ noir, labile, incapable «à soi seul de tenir à bout de bras le monde sur le point de s'écrouler» (p. 41). Sa soudaine compréhension de ce combat invisible est longuement décrite dans un beau passage qu'il convient de citer tout entier : «Puis, lorsqu'à Noël l'hiver s'installa pour de bon, il comprit qu'il avait jusqu'ici vécu dans l'inconscience la plus profonde et s'était laissé mener par le bout du nez, servile, tout le temps qu'il avait cru obéir à la volonté divine en séparant le monde entre êtres utiles et nuisibles, car en vérité ces deux catégories découlaient de la seule et même cruauté impardonnable que les feux de l'enfer, tout au fond, pavent si bien; il prit aussi conscience que, loin de diriger le monde des humains, la paix toujours si vulnérable et les «injonctions ancestrales du cœur» le sépareraient à peine, telle une fine membrane transparente, du «chaos destructeur» dont la masse se convulsait, spasmodique, juste là, sous ses pieds. La miséricorde l'entraîna du côté des victimes, si ardente et vive qu'il s'insurgea contre la loyauté qui l'avait enchaîné jusqu'ici à l'arbitraire du droit, et parce que l'existence d'une loi bien supérieure aux visées humaines lui semblait probable, il franchit la frontière au-delà de laquelle – se doutait-il – rien ne l'attendait d'autre qu'un isolement définitif» (p. 33).
C'est dans la dernière nouvelle du recueil, La fin du métier (deuxième variante) que l'auteur reprend le personnage du garde-chasse devenu fou aux yeux des hommes, considéré au travers du regard d'une petite société aux goûts paraphiliques travaillant «à la poursuite effrénée du plaisir et à l'incessante restauration d'un éden depuis si longtemps disparu que l'imaginaire humain en avait, même au plus profond de lui-même, perdu toute trace», société jouant cependant «un simple rôle d'avant-garde» en tant que «repoussoir du progrès en marche», Herman, lui, étant considéré comme «un maniaque des forces d'inertie et de freinage» (p. 182). Ces deux nouvelles, étroitement imbriquées et présentant pourtant des différences substantielles (ainsi, Herman ne meurt pas dans la seconde) semblent constituer l'une des matrices narratives de Guerre & Guerre, dont les pages sont hantées par un personnage énigmatique traversant les époques et les lieux.
Dans la main du barbier nous présente une fois encore la brutale surrection, dans l'esprit d'un des personnages vivant «en ces ténèbres de plomb dont il sentait l'emprise écrasante» (p. 46), de cette force qui écrase tout sur son passage : «Loin de se dire que seules sa faiblesse et son indolence l'avaient entraîné vers ce point nodal de son existence ou, qui sait, le terrible tourment de découvrir – peut-être à cause de son inquiétude accrue – que tout ce que la vie a de sain et de beau se brisait, se broyait constamment au creux de ses mains, il soupçonna plutôt l'existence d'un Dieu hostile ou indifférent qui se contentait de donner forme à ce qu'a d'inexorable et d'irrémédiable le monde tel qu'il s'engendre lui-même, de sorte qu'il ne s'effraya pas de suffoquer tôt ou tard sous le poids de la culpabilité, des remords ou de la douleur virulente de l'épouvante, voire, à force de geindre, lamentable, de se sentir si coupable, car ce qu'il avait fait ne pouvait se défaire – sans parler de l'échec annoncé de toute résistance, puisque nul ne peut vaincre l'incompréhensible» (p. 55).
Ainsi, une fois de plus, sommes-nous confrontés, par le biais de ce personnage, à l'évidence, comique et tragique, que «toute tentative de résistance serait vaine», l'ordre des choses lui étant «de toute manière hostile», car «cet ordre qu'orchestre la puissance invincible de l'irrévocabilité consume sans merci quiconque en reste à l'amertume de ne pouvoir se dominer» (p. 66), lui qui n'est «qu'un petit rien du tout, qu'un infime lambeau de néant, rien qu'un grain de poussière qu'un seul pas de Dieu avait balayé au passage et jeté de côté, dans l'ornière d'un incommensurable sentier de montagne» (p. 67).
Dans Rozi la piégeuse, l'auteur s'amuse à enchâsser plusieurs récits, comme si les différents personnages mis en scène se passaient le relai (mais quel relai, et à quoi bon de toute façon ?), tous aimantés par la mère Rozi, en accentuant l'impression d'inquiétante étrangeté propre à ses textes par de minuscules différences qui nous empêchent de les juxtaposer parfaitement. Une fois encore, les situations les plus grotesques n'ont d'intérêt que parce qu'elles constituent le miroir d'une lutte à mort entre des réalités invisibles, le principe entropique que nous avons évoqué et la tout aussi mystérieuse «bienveillance supérieure seule encore capable d'insuffler du sens à notre monde indolent dont, sinon, il ne subsisterait plus bientôt que des braises sur le point de s'éteindre» (p. 75). László Krasznahorkai évoque directement, sans se départir de son ironie glaciale qui semble immédiatement cerner de ténèbres cet îlot miraculeux, cette force dans ce beau passage : «J'étais certain en effet que le monde, qui se consumait sous l'emprise défaillante de l'amour, devait posséder un noyau vivant d'une plénitude infinie, un point nodal où toute forme de vie puisse refluer pour s'y ressourcer à l'inépuisable lumière de l'astre salvateur, tant il me semblait incontestable que lorsque, jour après jour, je me mêlais à mes semblables et inspirais, avide, le souffle de bonté qui se dégageait d'eux, la force trop souvent contenue de l'amour n'était plus, sur tous ces visages, qu'une ombre vague – le reflet d'une lointaine mais irrésistible splendeur créatrice» (pp. 80-1).
Chaleur pourrait, une nouvelle fois, constituer le cadre d'une histoire post-apocalyptique, où le faux héros Zbiegniew ne serait que le masque commode derrière lequel s'abriterait l'homme moderne, tournant dans sa cage, plus ou moins secrètement taraudé par la double postulation des «sereines lueurs du foyer» et des «ténèbres sans fond» (p. 97), alors que, dans Fuir Bogdanovich qui nous présente une situation typiquement krasznahorkienne où des personnages fuient un danger qui n'est jamais nommé, des forces cachées, irrépressibles, font immanquablement surface dans la conscience du personnage, pourtant absolument commun : «un monde à la destruction, au sapement et à la déliquescence duquel [...] je n'avais moi-même jamais cessé de prendre part...» (p. 125).
La bizarrerie des histoires que nous raconte le grand écrivain hongrois tient à ce décalage entre des personnages ridicules et grotesques, et la certitude qui se fait tôt ou tard jour dans leur esprit de n'être que le jouet de forces qui les dépassent, comme si le plus médiocre d'entre nous «ne pouvait que laisser transparaître et subir dans sa chair cette funeste clarté aurorale imbue du bleu des remords, cette lumière des tréfonds de l'enfer dont la quête nous hante tous depuis la nuit des temps» (p. 123), comme si chacun d'entre nous devait être tiré de sa torpeur parce qu'il sent «affluer de partout la puissance invincible du chaos dont même les débordements et tous les excès répondent à des règles rigoureuses» (p. 127), règles qui dans la nouvelle intitulée Le sélectionneur de fréquences ne semblent même plus exister, tant l'histoire est noire, et semble même engloutir la note, lumineuse et fragile, d'humour désespéré qui vacille encore dans les autres textes. L'apocalypse de Krasznahorkai a beau être joyeuse, ou plutôt profondément ironique et se jouant de nos petits intérêts, elle n'en demeure pas moins une révélation paradoxale : Dieu est une chimère, qui est absent, ou mort, ou ce que l'on voudra qu'il soit, mais il n'en reste pas moins que l'homme doit se dresser, se relever, pour se faire l'émissaire volontaire ou ridiculement pleutre et inconscient de forces cherchant qui dévorer.
C'est, en somme, en devenant le petit ou le grand véhicule, le héraut pathétique ou bien tragiquement condamné de ces puissances dont il ne sait rien qu'il gagne son nom d'homme. Krasznahorkai, c'est l'irruption de la farce dans le roman métaphysique.






























































 Imprimer
Imprimer