« Naufrage d'un prophète. Heidegger aujourd'hui de François Rastier | Page d'accueil | Apologia pro Vita Kurtzii »
03/02/2016
Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Á propos de Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (éditions Exils, 2015).
Á propos de Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (éditions Exils, 2015).LRSP (livre reçu en service de presse).
Acheter Contre les Français de Manuel Arroyo-Stephens sur Amazon.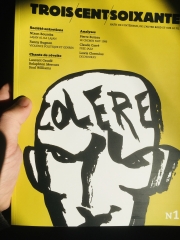 Je signale que mon article a été traduit en créole haïtien par Mehdi Chalmers pour la revue Trois cent soixante, présentée sur son site.
Je signale que mon article a été traduit en créole haïtien par Mehdi Chalmers pour la revue Trois cent soixante, présentée sur son site.Les coïncidences n'existent, en matière de lectures, pas davantage que dans le reste de nos occupations. Tout est signe, puisque l'univers n'est qu'une phrase immense, peut-être infinie. Venant de consacrer une note à la charge de François Rastier contre Heidegger et les heideggériens, quel n'a pas été mon amusement de constater que Manuel Arroyo-Stephens, dans son libelle aussi drôle et savant que témoignant d'une parfaite, donc fort méchante mauvaise foi, évoquait le Maître du Jargon ou plutôt, son influence néfaste en France, ce pays qui est si étonnamment perméable aux faux discours, des déclamations à prétentions universalistes des révolutionnaires coupeurs de têtes aux longues phrases larmoyantes de Renaud Camus et de Richard Millet, qui eux aimeraient bien raccourcir quelques têtes de métèques s'ils avaient le simple courage physique de leurs jivaresques et souchiennes opinions : «Comment la France, avec son culte de la raison et de l'humanisme, put-elle tomber dans le piège d'un charlatan qui considérait la clarté comme le suicide de la philosophie ? Dire que cela arriva au pays de Montaigne, de Descartes, de Pascal ! Que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, que ce qu'on ne peut dire, il faut le taire, que l'intelligibilité est la condition indispensable de la recherche de la vérité, tout cela l'escroc de Fribourg, le personnage le plus lâche qu'ait jamais cautionné la philosophie occidentale, n'en avait cure. Il monta dans le train du nazisme quand cela l'arrangea et garda un silence éternel sur les crimes de Hitler. Dans le fond, ils avaient quelque chose de commun. Heidegger séduisit les philosophes d'une bonne partie du monde tandis que Hitler séduisait les masses allemandes» (1).
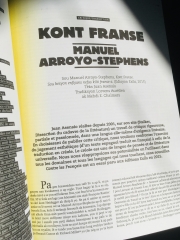 C'est au cours du XXe siècle que Heidegger a fait plonger la culture française dans le «marasme» (le titre du dernier chapitre du livre) et même «le culte du néant, l'apothéose du bavardage et du charabia», au travers, ajoute Manuel Arroyo-Stephens, de Heidegger, qualifié d'«imposteur», de «théologien déguisé en philosophe» et de «protonazi et antisémite répugnant, qui ne se gênait pas pour séduire ses élèves, fussent-elles juives» (p. 125). Il est amusant de constater que l'auteur n'a pas de mots assez durs contre l'esprit de clan qu'a favorisé l'existentialisme par le truchement de Jean-Paul Sartre qui, pas plus que Martin Heidegger, n'a les faveurs de Manuel Arroyo-Stephens : «Mêlant habilement les ingrédients de la métaphysique, du socialisme scientifique et de la psychanalyse, Jean-Paul Sartre créa son système philosophique et fonda sa propre tribu, les existentialistes», prétentieux et intraitables moutons obéissant à la vertu si typiquement française, donc condamnable, selon laquelle l'histoire de «la littérature et de toute la création artistique répond en France à des schémas récurrents qui se répètent de génération en génération depuis la Renaissance et qui se forment toujours autour de mouvements et de groupes». En effet, les Français, tout à la fois veaux et moutons, donnent «plus d'importance à l'histoire de la littérature et aux écoles littéraires qu'à la littérature elle-même», comme l'ont si bien compris «André Breton et tous les chefs de file de par le monde» (p. 128).
C'est au cours du XXe siècle que Heidegger a fait plonger la culture française dans le «marasme» (le titre du dernier chapitre du livre) et même «le culte du néant, l'apothéose du bavardage et du charabia», au travers, ajoute Manuel Arroyo-Stephens, de Heidegger, qualifié d'«imposteur», de «théologien déguisé en philosophe» et de «protonazi et antisémite répugnant, qui ne se gênait pas pour séduire ses élèves, fussent-elles juives» (p. 125). Il est amusant de constater que l'auteur n'a pas de mots assez durs contre l'esprit de clan qu'a favorisé l'existentialisme par le truchement de Jean-Paul Sartre qui, pas plus que Martin Heidegger, n'a les faveurs de Manuel Arroyo-Stephens : «Mêlant habilement les ingrédients de la métaphysique, du socialisme scientifique et de la psychanalyse, Jean-Paul Sartre créa son système philosophique et fonda sa propre tribu, les existentialistes», prétentieux et intraitables moutons obéissant à la vertu si typiquement française, donc condamnable, selon laquelle l'histoire de «la littérature et de toute la création artistique répond en France à des schémas récurrents qui se répètent de génération en génération depuis la Renaissance et qui se forment toujours autour de mouvements et de groupes». En effet, les Français, tout à la fois veaux et moutons, donnent «plus d'importance à l'histoire de la littérature et aux écoles littéraires qu'à la littérature elle-même», comme l'ont si bien compris «André Breton et tous les chefs de file de par le monde» (p. 128).Sartre, l'ordure Sartre qui, à la «grande surprise et admiration de ses collègues qui commençaient à célébrer son esprit», «ne tarda pas à expliquer qu'il avait vécu sous les Allemands dans une «clandestinité ouverte»», magnifique euphémisme par lequel cette ordure, «l'ineffable Sartre» (p. 134) donc, qualifia sa reptilienne faculté de résistance à l'Allemand. «Ce qu'on appelle généreusement le système philosophique de Jean-Paul Sartre», poursuit Manuel Arroyo-Stephens, «consistait en un salmigondis d'idées prises chez Husserl et Heidegger, plus tard assaisonnées de piment marxiste, bien agitées avec une phraséologie hégélienne et le tout servi dans le meilleur jargon parisien» (p. 135). Son «œuvre phare, aux dires des spécialistes, fut L’Être et le néant» et, ajoute l'auteur dans un de ces traits si chers à José Bergamín, si «l'on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il possède très peu du premier et beaucoup trop du second» (p. 136) tout comme, à en croire l'auteur, c'est parce que Mao Zedong, «cet affreux poète», voulait obliger «un milliard de ses compatriotes à lire ses vers infâmes, voire ses œuvres complètes», qu'il «a mené la guerre civile et la révolution culturelle» (p. 138).
Dès ces quelques lignes, nous comprenons quels sont les principaux travers (prétention que rien ne fonde, culte d'une raison asséchante menant aux dictatures, goût invétéré de la rhétorique, impuissance artistique qui s'ensuit) que Manuel Arroyo-Stephens prête aux Français, même s'il semble se dédouaner, aux dernières lignes de son libelle, d'avoir mené une charge aussi réjouissante que violente et, diront les prudents, injuste et d'une incroyable mauvaise foi, en affirmant que seul le complexe d'infériorité propre aux Espagnols (cf. p. 9), ainsi que leur envie et leur jalousie (cf. p. 118) peuvent l'expliquer. Il ajoute, malicieusement, qu'il a écrit «ce pamphlet à la manière des Français» (p. 140, l'auteur souligne), façon polie de dire qu'il s'est peut-être lui-même payé de mots, et que son écriture n'en est pas moins critiquable que celle dans laquelle les Français ont fait triompher partout dans le monde leur vanité et leur verbosité.
Né dans «un pays physiquement et moralement dévasté par la guerre civile que le général Franco avait gagnée avec l'aide directe de Mussolini et de Hitler», ainsi qu'avec, ne l'oublions pas, «la complicité lâche et aveugle de l'Angleterre et de la France», Manuel Arroyo-Stephens déclare qu'il a «vu les meilleures intelligences de [sa] génération abêties par la Théorie, par la déliquescence et la délinquance intellectuelles, par cet esprit auto-complaisant et stérile venu de France» (p. 9).
La vanité des Français a toujours été supérieure à leur talent, ce qui est une évidence qu'il est bon de rappeler, car «ils se sont lancés très tôt dans le commerce des idées et des modes, exploitant avec une habileté et une avidité notoires ce que les économistes appellent une rente de situation, et leur a fait croire, avec autant de prétention que de vanité, qu'ils étaient le centre du monde» (p. 15).
Comment pardonner à un peuple qui a fait des contes de La Fontaine son épopée, au détriment de la Chanson de Roland (p. 17) ? Si la raison, que les Français ont toujours préférée, à grand tort, à l'intuition (cf. p. 113) est «la mort de l'art», si «Don Quichotte doit perdre la raison pour trouver la vérité» et que personne, «et surtout pas un Français, n'a pu créer de l'art avec de la raison» (p. 37), comment ne pas moquer une nation composée de jardiniers royaux dont le rêve pas même inavouable est «que les feuilles des arbres tombent directement dans les corbeilles, tant ils veulent civiliser et polir la nature» (p. 46) ?
Manuel Arroyo-Stephens se place du côté des Espagnols, autrement dit du côté de la déraison, de la folie et de la passion, des feuilles qui jamais ne tomberont directement dans les corbeilles : «Il fallait que quelque chose fonctionne de travers en Europe pour que les Français, avec si peu de mérite, parviennent à devenir le centre artistique du continent. On a beau fouiller dans les dictionnaires, les manuels, les livres d'histoire, on ne trouve pas un seul seul écrivain ou artiste français qui puisse justifier cette hégémonie» au cours du XVIIe siècle car, en «l'espace de quelques années disparaissent du paysage artistique européen les grandes figures du baroque (Milton, Calderón, Le Bernin, Rembrandt, Velázquez). Ce moment de vide, la France va le remplir avec ses pauvres artistes maniérés, qui ne seront jamais que des décorateurs de la grande pâtisserie versaillaise. Le seul peintre français d'un certain mérite, Le Lorrain, vivait et travaillait à Rome, et ne pointa jamais son nez en France» (p. 44).
Nous arrivons au foyer d'infection, Voltaire, «miroir concave où ses compatriotes peuvent toujours se reconnaître» (p. 51), que l'auteur peint en jaloux épique de Shakespeare, tout comme il raille les prétentions à la belle langue, confortée par tout un appareillage de règles, de normes et d'instituts et, mais l'auteur n'en touche hélas mot, de prix dits littéraires, dont le plus navrant d'entre eux, le prix Goncourt, est un inimitable mélange de putanat et de nullité, comme nous avons pu le constater ne serait-ce que ces deux dernières années. Revenons au texte de Manuel Arroyo-Stephens : «On n'a pas découvert meilleur moyen pour donner de l'allure et de l'éclat aux artistes médiocres que de les obliger à suivre des règles qui cachent leur manque de talent : légiférer, en art, tue le créateur et produit des artisans. Il n'y a donc pas mieux, pour en finir avec la créativité d'un artiste, que de l'obliger à accepter des normes, des critères et des goûts émanant de ces vénérables institutions nommées académies. Rien n'est plus voisin de l'esprit français, conclut Manuel Arroyo-Stephens, que l'esprit académique» (p. 67-8) qui, du moins durant le ridicule XVIIIe siècle, peut se confondre assez facilement avec un concours de «perruques poudrées et [de] mouches sur le visage», ou encore avec cet «art du paysage en éventail», «le vicomte maniéré des défis et l'abbé idiot des madrigaux», cet art «cérémonieux, mesuré, de la pavane» (p. 69) qui a donné un verbe pronominal qui, si mes souvenirs sont bons, a quelque rapport étymologique avec le mot paon, jetant ainsi une lumière non point crue mais elle-même artificielle et molle sur les habitudes françaises.
Manuel Arroyo-Stephens balaie l'histoire de notre pays depuis ses premières gestes littéraires, que ce dernier n'a selon ses dires pas suffisamment portées au pinacles, lui préférant des fadaises poudrées ou étriquées, et caractérise la Révolution comme la matrice fournissant «le masque, la rhétorique et les méthodes abominables dont les absolutistes de toutes obédiences ont fait un usage si éloquent et sanglant tout au long des deux derniers siècles» (p. 79), Napoléon en étant lui aussi pour ses frais, la «tête pleine de grammaire et de syllogismes» (p. 83), occupé jusqu'à ses derniers jours en exil, «pendant que ses généraux s'amusaient à vendre aux enchères des biens si mal acquis» en Espagne, «au lieu de demander chaque jour pardon pour ses crimes», «à lire... une grammaire !» (p. 93).
Il n'y a pas à louvoyer, car les Français, «fanatiques de l'abstraction, malades de la logique», sont «capables de sacrifier quiconque pour un de leurs syllogismes» (p. 96), mais ne comprennent absolument rien aux véritables génies, comme Goya : «Certainement la violence de Goya, comme celle de Picasso, un siècle plus tard, aura aveuglé non seulement Mérimée, mais toute la peinture française. Ceux qui l'admirèrent, le copièrent et se laissèrent influencer par lui, comme Géricault et Delacroix, restèrent dans le geste, dans la pure rhétorique. Ils ne comprenaient pas la violence intérieure, radicale, le monde beaucoup plus complexe d'un peintre qui avait fait la sourde oreille à la peinture banale et académique en provenance de France. Les Français, y compris les révolutionnaires modernes, étaient, même s'ils croyaient le contraire, trop empreints du classicisme qu'ils avaient chevillé à l'âme, et le romantisme récemment acquis leur était en réalité étranger et lointain. Il n'était tout au plus qu'une réaction anticlassique. Cela faisait déjà trop longtemps qu'entre Ronsard et Rabelais, l'esprit français avait choisi le mauvais chemin» (pp. 98-9), c'est-à-dire Ronsard dans l'esprit de Manuel Arroyo-Stephens.
Ainsi, si le «romantisme allemand» dans sa totalité «se résume à une lutte titanesque pour se libérer du joug français», c'est encore une fois vers la peinture espagnole que l'auteur tourne son regard pour en affirmer la supériorité sur la française, supériorité découlant du fait que les peintres espagnols, eux, n'ont pas renoncé à la passion : «Quand ils [les Français] se trouvent face à la peinture espagnole et se mettent à l'admirer, alors qu'au fond elle leur reste incompréhensible, ils surréagissent et en perdent la mesure. Là où ils étaient habitués à chercher l'harmonie, ils se retrouvent face à une violence inusitée; là où ils cherchent la beauté idéale, ils tombent sur le réalisme le plus cru; éduqués à comprendre la séparation et la hiérarchie des genres picturaux, ils trouvent mélangés le sublime et le grotesque; au lieu d'un projet d'ensemble et d'une utilisation exubérante de la couleur, au lieu d'un dessin harmonieux et correct des postures, ils tombent sur un mouvement impulsif et incontrôlé. Habitués à peindre les morts comme s'ils étaient en train de rêver, ils se retrouvent face aux cadavres de Goya, masses de chair inerte, véritables cadavres» (p. 101). L'auteur va plus loin, car il ne supporte décidément pas la prétention française, d'autant plus appuyée qu'elle ne se fonde, à ses yeux, sur rien de valable, et cela en quelque domaine artistique que ce soit. C'est ainsi que le célèbre tableau de Goya intitulé Le 3 mai fusille de manière allégorique «toute la peinture française du XVIIIe siècle», tandis qu'un siècle plus tard, un autre Espagnol, Pablo Picasso, fusillera à son tour «la peinture française du XXe siècle» (p. 102) avec ses Demoiselles d'Avignon.
J'ai plus d'une fois souri en lisant Manuel Arroyo-Stephens, me souvenant de ma lecture, franchement ennuyée, des Salons de Diderot, comme lorsqu'il écrit par exemple : «Que pouvait-on voir dans la peinture indigeste de Watteau, de Fragonard, de Boucher, de Chardin, dans leurs coloris sensuels et charmants, dans leur bucolisme glouton, entre colonnes et plantes grimpantes, dans leurs figurines de porcelaine exhibant tantôt leur cheville, tantôt leur petit cul, que pouvait-on regarder de ce monde coloré, vain et frivole après avoir contemplé les morts de Goya ?» (p. 103). La réponse est évident et décidément seul un Philippe Sollers, inutile commentateur de tout, peut nous bassiner avec les fadaises pralinées d'un peintre aussi inintéressant que Watteau.
Si les écrivains français sont peu ou prou des apôtres de la rhétorique la plus creuse et sont parfaitement incapables, y compris mêmes lorsqu'ils se rendent au bordel ou dans des pays exotiques, de se libérer de leur grammaire (2), mais aussi de ces structures plus ou moins étatiques comme la Société populaire républicaine des arts (3) inventée par ce «Robespierre du pinceau» (p. 104) que fut David qui ne peignit jamais, dans sa trop fameuse Mort de Marat qu'un «Christ profane, très bien composé, très «bien peint», avec une lumière abstraite, idéalisée, très seyante, qui sanctifie cet apôtre de la guillotine», tableau dont la «rhétorique muette mais très parlante» est destinée à «émouvoir les masses, en transformant en modèle de vertu un délinquant peu ordinaire» (p. 105), nous devons aussi admettre qu'un Flaubert, dont chaque paragraphe, nous dit malicieusement l'auteur, «lui coûtait autant de sueur, de sang et de larmes qu'à Churchill de défendre l'Angleterre» (p. 116), tout comme d'autres écrivains réalistes parmi lesquels l'ignoble Zola, ne valent pas grand-chose comparés, par exemple, à un Dostoïevski : «Visiblement, personne n'eut l'idée de souffler à l'oreille de ces vaillants réalistes qu'un peu plus au nord un certain Dostoïevski était en train de préparer le grand parricide du siècle et que, quelque part dans l'Atlantique nord, le capitaine Achab poursuivait une baleine. Mais quelqu'un peut-il s'imaginer Flaubert décrivant le crime de Raskolnikov, ce personnage qui, au début du roman, n'a pas mangé depuis deux jours, alors que le romancier français a besoin de plusieurs pages pour décrire les huit étages de la pièce montée du mariage de madame Bovary ? Flaubert aurait fait quelque chose que le Russe ne perd pas une minute à faire : décrire la hache avec laquelle est perpétré le grand crime. Il y aurait consacré peut-être un chapitre, oubliant l'essentiel, qui est que la hache est juste le prolongement du bras qui la brandit. Et que la seule chose importante est ce qui se passe dans la tête qui actionne ce bras» (p. 122).
Saluons les éditions Exils pour avoir donné aux lecteurs francophones la possibilité et, je crois, la chance, de pouvoir lire ce court ouvrage de Manuel Arroyo-Stephens, libelle qui s'inscrit dans le sillage de ces livres érudits et fantomatiques, profonds et justes, comme Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes de László Földényi.
Notes
(1) Manuel Arroyo-Stephens, Contre les Français. De l'influence néfaste exercée par la culture française (traduit de l'espagnol par Philippe Thureau-Dangin, Éditions Exils, 2015), p. 126. Dans on édition originale, ce livre a été publié en 1980 sous le titre Contra los Franceses. O sobre la nefasta influenccia. Libelo. L'auteur, né en 1945 à Bilbao, avocat et économiste de formation, a fondé durant les années 70 la librairie Turner à Madrid, devenue Turner English Bookshop, qui lui valut quelques démêlés avec la police franquiste, lui reprochant de vendre des livres interdits. Il devint ensuite éditeur et publia l’œuvre complète du grand Basque José Bergamín. C'est de façon anonyme qu'il publia son premier livre, Contre les Français. Il vit aujourd'hui retiré de toute affaire éditoriale, partageant son temps entre Berlin et la sierra de Guadarrama. Le peu que j'ai appris sur cet homme me fait penser qu'il serait digne de figurer dans Bartleby et compagnie du très surestimé Vila-Matas ou, bien mieux, aurait pu servir comme modèle au personnage d'écrivain mystérieux de 2666 dont je n'ai pas besoin de préciser l'auteur. Ajoutons enfin que tout éditeur digne de ce nom devrait immédiatement se jeter sur le dernier ouvrage de Manuel Arroyo-Stephens, intitulé, bellement, Pisando ceniza, soit En marchant sur la cendre.
(2) Je note intégralement cet excellent passage d'une méchanceté féroce : «Devenir bohèmes et maudits, fumer de l'opium, fréquenter les bordels, faire des escapades dans des pays exotiques, et malgré tout, ne pas pouvoir se libérer de leur grammaire ! Ah, ces vers aux inévitables relents de colère adolescente ! Qu'ils avaient peu lu Milton, Dante et Quevedo ! S'il voulait échapper à l'honneur douteux de finir à l'Académie, un artiste honnête n'avait d'autre choix que de se réfugier au bordel ou d'émigrer dans des pays exotiques (l'idéal, évidemment, était de combiner les deux). Mais, dans les deux cas, on courait le risque d'attraper des maladies infectieuses, tropicales ou d'un autre genre. C'est cela qui alimenta et stimula le génie français, dans des proportions que l'on n'a sans doute pas encore assez étudiées. On imagine que les infections vénériennes furent plus stimulantes que les tropicales. De là à insinuer que c'en fut fini du génie français le jour où un Anglais découvrit la pénicilline, il n'y a qu'un pas» (pp.115-6).
(3) Plus d'une fois l'auteur comparera le goût des Français pour des organismes d’État censés favoriser l'exercice des arts avec des structures plus ou moins staliniennes (cf. p. 105).































































 Imprimer
Imprimer