« Armel Guerne l'annonciateur de Charles Le Brun et Jean Moncelon | Page d'accueil | Le Jour de l’effondrement de Michèle Astrud, par Gregory Mion »
10/08/2016
2001 : l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, par Francis Moury

 Critiques cinématographiques de Francis Moury parues dans la Zone.
Critiques cinématographiques de Francis Moury parues dans la Zone.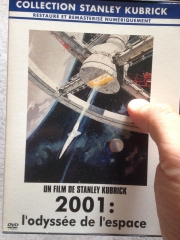 Acheter 2001 : l'odyssée de l'espace (livres + DVD et bluray) sur Amazon.
Acheter 2001 : l'odyssée de l'espace (livres + DVD et bluray) sur Amazon.2001 : l’odyssée de l’espace [2001 : A Space Odyssey] (États-Unis, 1968) de Stanley Kubrick est sa seule contribution à la science-fiction cinématographique puisque Shining (États-Unis, 1980) appartient pour sa part au fantastique. La surprise n’était, certes, pas totale pour le spécialiste de science-fiction. Les deux thèmes principaux du film, à savoir l'existence d'une intelligence extra-terrestre d'une part, la conquête spatiale d'autre part, avaient déjà été traités par la science-fiction au cinéma et en littérature. En outre, l’histoire contemporaine du cinéma a formellement identifié, concernant 2001, un certain nombre de sources plastiques directes : En route vers les étoiles (U.R.S.S., 1958) de Pavel Klushantsev, Universe (Canada, 1960) de Roman Kroitor et Colin Low, d'autres titres encore dont certaines images furent reprises, parfois par plan ou détails de plans, par Kubrick dans 2001. En outre, la même année, sortait le très réaliste du point de vue technique, au point d’en être prémonitoire, Les Naufragés de l’espace [Marooned] (États-Unis, 1968) de John Sturges. Quant à la séquence préhistorique avec ses acteurs humains déguisés en singes anthropoïdes, elle est remarquable mais strictement contemporaine de la première adaptation cinéma de La Planète des singes (États-Unis, 1968) de F. J. Schaffner d'après le roman de Pierre Boule, dotée d'un maquillage tout aussi réussi.
L’originalité de 2001 est pourtant patente en raison de l'intellectualisme revendiqué de son scénario et de l'intelligence de sa syntaxe, mais aussi par l'ampleur budgétaire et le soin scientifique apporté à la prospective et au design. Il s’ouvre sous les auspices sonores du poème symphonique Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, composé d’après le poème philosophique de Friedrich Nietzsche. Indication majeure immédiatement fournie, presque gracieusement, par un film réputé difficile mais dont le symbolisme est, au fond, assez évident. Adapté d’une nouvelle de Arthur C. Clarke (1917-2008), The Sentinel, elle-même transformée en roman durant les années 1964-1968 à mesure que Clarke travaillait avec Kubrick au scénario, le film 2001 est divisé en quatre parties.
La première partie évoque la naissance de l'intelligence aux temps préhistoriques, intelligence apportée aux singes anthropoïdes par la hiérophanie d'un mystérieux monolithe minéral noir, intelligence se traduisant simultanément et dialectiquement par l'invention de l'outil et de l'arme, enclenchant le processus de l'histoire humaine.
La deuxième partie rapporte, des siècles plus tard (en 1999) et alors que la conquête spatiale de l'univers est engagée par des moyens techniques stupéfiants, la présence du même monolithe (âgé, selon les analyses, d'environ 4 millions d'années) enterré «volontairement» dans le sol du cratère lunaire Tycho. Présence tenue secrète par les autorités terrestres mais révélée à une poignée de scientifiques triés sur le volet, qui font le voyage depuis la base lunaire de Clavius pour le contempler. Il s'agit toujours d'une hiérophanie (musicalement portée à nouveau par le Requiem de György Ligetti), mais dans un contexte fonctionnel et technique paradoxal puisque son effet semble nul sur les hommes qui la contemplent alors qu'il était actif sur les anthropoïdes. Le suspense naissant de cette seconde révélation est le suivant : que présage cette réapparition pour les hommes ?
La troisième partie débute 18 mois plus tard, en 2001. Durant une mission spatiale vers la planète Jupiter, des astronautes comprennent que l’ordinateur gérant leur fusée a décidé de les assassiner car il est le seul à en connaître le but et il en pressent un mystérieux bénéfice. Il échoue de justesse car le dernier survivant parvient à le déconnecter. C'est alors seulement qu'un message enregistré lui révèle l'objet de la mission : découvrir pourquoi le monolithe lunaire émet des ondes radios, donc des signaux, vers Jupiter. C'est la plus excitante et la plus réussie des quatre parties du film dans la mesure, aussi, où elle pourrait constituer un film à elle seule, ce qui n’est pas le cas des trois autres parties. L'ambivalence dialectique de l'histoire de cette troisième partie consiste en ceci : l'homme assassine une machine quasi-humaine se considérant supérieure à l'homme bien que l'homme l'ait créée. C'est donc, ironie de l'histoire, à nouveau par un meurtre que l'homme (le dernier homme vivant du vaisseau, en l'occurrence) progresse, s'appropriant la connaissance dont rêvait la machine, parvenant au terme d'un voyage initiatique qui le modifie à tout jamais, et qui aurait peut-être modifié aussi la machine si elle l'avait effectué à sa place. Il s’agit d’un meurtre par lequel la machine voulait progresser elle aussi, en s'appropriant les bénéfices gnoséologiques de la mission.
Il faut d'ailleurs bien noter que l'ordinateur se comporte, au début de cette troisième partie, non comme l'enfant des hommes mais comme leur père quasi divin, omniscient et père soupçonneux sous un aspect amical. La perfection d'une entité organisée quelconque, assure-t-il, consiste à réaliser le maximum de ses possibilités : cette assertion est à la fois leibnizienne et nietzschéenne, selon qu'on lui accorde métaphysiquement une portée davantage logique ou davantage morale. On a souvent signalé que le début de la révolte de l'ordinateur dans 2001, les prémices de la revendication de son autonomie, l'imminence de l'assassinat collectif qu'il ourdit, sont connotés par le fait qu'il pose brusquement une question (psychologique) au lieu de répondre aux questions (techniques) des hommes. Inversement, il retrouve sa position originale d'enfant pendant qu'on détruit sa mémoire, entraînant de facto sa régression puis sa «mort». Mort qui permet enfin au message enregistré d'être délivré au survivant humain, dès lors embarqué dans une odyssée sans retour réel, à la différence de l'odyssée homérique.
La quatrième et dernière partie raconte cet ultime voyage qui aboutit à une transformation métaphysique : par-delà le temps et l'espace, arrivé en vue de Jupiter, l'astronaute se retrouve sans solution de continuité, comme en un étrange rêve, mi angoissant, mi apaisant, face à lui-même vieilli puis agonisant alors qu'émerge un bébé mutant contemplant, avec un étrange sourire, la Terre. Ce voyage – au sens argotique des années 1965-1970 : hallucination provoquée par la drogue (l'œil en gros plan filmé en équidensités était déjà un «ultimate trip» selon le slogan publicitaire allusif du film) – décontenança la majorité des spectateurs en dépit de sa beauté plastique et de son ampleur narrative aboutissant à rien moins que la naissance ultime d’un surhomme, voulue par une puissance supérieure à l’homme, puissance à nouveau incarnée par le monolithe énigmatique, impassible, solide à la perfection géométrique, épure à l'aspect solide, se jouant de l'espace et du temps, ordonnant un projet final inconnaissable mais manifesté par les étapes dramatiques précédentes que le film n'a pour unique but que d'organiser lui-même comme hiérophanie tétralogique dont l'homme apparaît l’instrument, le vecteur, le témoin et l’acteur tout à la fois. Un sacré muet, sans parole mais se manifestant par une apparition concrète et par l'émission d'un signal, vécu en actes à quatre moments clés de l'histoire elle-même symbolisée comme un voyage de l'humanité vers un terme extrême : la surhumanité. Le poème symphonique de Richard Strauss composé d'après le Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche est, ainsi, un accompagnement musical que le dernier plan de 2001 justifierait d'une manière grandiose. L'esclavage de l'homme par la machine ayant échoué, on saisit alors que le monolithe annonçait une autre péripétie, une nouvelle étape de l’évolution : après l'homme-animal devenu homme par la simple grâce de l'apparition monolithique, après l'homme devenu père de la machine puis de machines devenues elles-mêmes rivales de l'homme, une troisième étape est annoncée par l'échec de la machine, par le fait qu'un unique survivant parvienne au terme du voyage prévu : la transformation finale de l'homme en surhomme. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de noter que le vaisseau spatial a la forme anthropologique d'une tête attachée à une colonne vertébrale elle-même arrimée à une sorte de bassin, ce qui, sous certains angles dans certains plans, donne l'impression qu'un curieux squelette humain privé de membres s'avance dans l'espace.
2001 apparut à la critique comme aux spectateurs tantôt grandiose mais incompréhensible, tantôt vain et formaliste. Tous furent évidemment séduits par la beauté plastique du format Cinérama (SuperPanavision 70mm) et par l’ambition métaphysique évidente du propos, ambition par ailleurs pessimiste : l'homme ne peut, s'il veut survivre, demeurer simplement homme, il doit être dépassé, se nier (les cosmonautes, dans 2001, ont des rapports abstraits avec leurs familles qu'ils ne voient que par écrans interposés, images ectoplasmiques, lointains reflets des présences terrestres dont ils sont irrémédiablement distants) ou accepter d'être nié (sinon par une machine, du moins par une puissance supra humaine résidant près de Jupiter) pour se transformer... En quoi ou en qui ? Le suspense ultime de 2001 est que le spectateur n'a pas la réponse à cette question, le film se clôt donc sur un ultime mystère.
L'idée d'un monolithe agissant à des moments clés de l'histoire humaine, émettant des signaux vers une source elle-même mystérieuse, dont on ne s'approche qu'en risquant sa raison et sa vie, empruntait autant à la science-fiction qu'à l'histoire et à la sociologie des mythes et des religions. Elle renvoyait donc, en dépit des apparences, autant au passé qu'au futur. Nietzsche avait parfaitement conscience de cette solidarité trans-historique entre les différents moments de l'expérience humaine : il avait lu soigneusement G.W.F. Hegel, connaissait l'histoire comparée des religions, la sociologie et la psychologie des religions, ainsi que l'histoire de la philosophie. Nietzsche voulait, avec une ironie supérieure, dépasser l'homme en pleine connaissance de cause, afin de retrouver un rapport immédiat au sacré sous une forme inédite, enfin purifiée, enfin pure.
Était-ce le cas des auteurs et producteurs de 2001 ? Rien n'est moins sûr. Leur souhait était, à partir d'un schéma assez simple, de créer un suspense esthétiquement novateur, intellectuellement ambitieux mais qui fût – et il le fut – une auberge espagnole où chaque spectateur mettrait ce qu'il souhaitait mettre en guise de signification. On connaît la formule de l'écrivain Arthur C. Clarke qui disait, en substance : si vous pensez avoir compris 2001, c'est que nous avons échoué. Il y a, dans cette formule, l'aveu d'une indécision qui frise la désinvolture et qui n'est, philosophiquement, pas acceptable car elle contredit dans les termes l'ampleur revendiquée de l'entreprise.
2001 ? Ambitieux mais trop désinvolte, spectaculaire mais peut-être un peu maniéré et formaliste dans sa présentation qu'on peut estimer autant décevante que gratifiante, in fine. Il faut noter d'ailleurs que le film le plus réaliste de 1968 ne fut pas celui de Kubrick – en dépit de ce que s'évertuent à vouloir prouver les suppléments (riches en témoignages de première main sur la production du film de 1964 à 1968) du bluray de l'édition collector française – mais celui de John Stuges qui, lui, fut réaliste au point d'annoncer un événement qui devait se produire par la suite.
Sur le thème d'une origine de l’homme remontant à une entité ou à une race supérieure contrôlant ou déterminant, volontairement ou accidentellement, sa destinée possible, on peut donc préférer les non moins authentiques mais plus modestes tentatives que sont Les Monstres de l’espace [Quatermass and the Pit] (G.-B., 1967) de Roy Ward Baker ou Alien Vs. Predator (États-Unis, 2004) de Paul W.S. Anderson. Quant à la conquête spatiale, une foule de films de science-fiction l'avait déjà prise pour thème central, depuis les métrages fantastiques de Georges Méliès au très sérieux La Femme sur la Lune (All., 1927) de Fritz Lang et La Conquête de l'espace (États-Unis, 1955) de Byron Haskin. Le thème de l'espace et du temps modifiés par un voyage spatial induisant une transformation irréversible de l'homme, fut, l'année suivante, le sujet non moins métaphysique du remarquable Danger : planète inconnue [Journey To the Far Side of the Sun] (G.-B., 1969) de Robert Parrish. C'est, encore une fois, probablement le thème transhumaniste de la révolte cybernétique de l'ordinateur, se considérant comme plus humain que l'homme et destiné à lui succéder, qui était sinon le plus original, du moins le plus novateur dans son traitement dramaturgique. Sans la troisième partie de ce Kubrick de 1968, nous n'aurions probablement pas eu des films reposant sur un thème similaire ou utilisant ce thème d'une manière directe dans le scénario, tels que Le Cerveau d'acier [The Forbin Project] (États-Unis, 1970) de Joseph Sargent, Generation Proteus [Demon Seed] (États-Unis, 1977) de Donnald Cammel, Alien (États-Unis, 1979) de Ridley Scott, Terminator (États-Unis, 1985) de James Cameron qui en constituent la postérité la plus évidente. La quatrième partie, quant à elle, se situe, dans l'histoire du cinéma, au carrefour du documentaire spatial (surchargé d'effets spéciaux et de trucages qui contredisent son réalisme par ailleurs revendiqué en d'autres parties du métrage) et du cinéma expérimental de la nouvelle vague underground des années 1965-1970, raison pour laquelle elle semble avoir aujourd'hui assez mal vieilli, ou du moins vieillir plus mal que les trois parties précédentes, en dépit de la belle puissance symbolique du plan final.




























































 Imprimer
Imprimer