« Georges Bernanos vu par Thomas Renaud | Page d'accueil | L’Amérique en guerre (10) : Des clairons dans l’après-midi d’Ernest Haycox, par Gregory Mion »
19/02/2019
Le divertissement selon Blaise Pascal : les mauvaises préoccupations, par Gregory Mion

 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.«Elle se demanda ce qu’elle allait faire maintenant, cherchant une occupation pour son esprit, une besogne pour ses mains.»
Guy de Maupassant, Une vie.
«Ma vie passée est ici tout entière et je n’ai pas cherché à la rendre théâtrale. Dieu, sans doute, y apparaît très tard. Je n’ai pas voulu inventer des signes ni exagérer Sa présence : Il a longtemps été absent de ma vie et je ne peux pas affirmer absolument que j’ai souffert de cette absence.»
Aurélien Bellanger, Le Grand Paris.
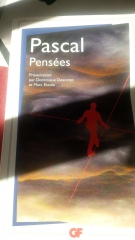 Pour éviter le vertige de la finitude et la douleur de penser que tout peut se terminer d’un instant à l’autre, les hommes ont inventé le divertissement afin de se prescrire un moyen relativement efficace d’être heureux. Mais outre les efforts que les hommes déploient pour améliorer l’industrie du divertissement et en faire un phénomène récurrent de la culture, le divertissement, à l’origine de la tradition pascalienne, s’enracine au cœur de l’instinct humain comme une tendance à détourner les individus de leur misérable condition (et comme une profonde rancune à l’endroit de cette condition). Ainsi l’homme tel qu’il est décrit par Pascal est moins le maître de ses distractions que la créature aliénée à d’autres formes de la misère de vivre. D’un côté nous imaginons que le divertissement nous guérit de la pensée de notre condition de fragiles mortels, mais, de l’autre, nous nous fragilisons d’autant plus dans des activités qui nous empêchent de songer vraiment à nous et de nous occuper en propre du grand mystère de l’existence. En sorte que le divertissement, dans ses premières conséquences, relève d’une insidieuse soustraction de l’homme à l’égard de lui-même : je crois que j’amplifie ma puissance de vivre en oubliant que la vie est courte, je crois que je m’amuse en accumulant des moments récréatifs, mais, en réalité, je m’amoindris et je passe à côté de moi-même, et tandis que je me figure volontiers que je me remplis de bonheur en mordant la vie à pleines dents, je demeure le patient inconscient d’une étrange conscience qui m’assujettit aux décrets de toutes les dissipations. Il s’agit finalement d’une vie de remplissage passif, condamnée à rejouer la parabole du tonneau des Danaïdes, une vie, si l’on peut dire, vécue par inadvertance, traversée dans une espèce de titubation permanente où rien ou presque n’a été senti avec la ferveur de ceux qui ne reculent pas devant le face-à-face que tous les hommes devraient avoir avec eux-mêmes.
Pour éviter le vertige de la finitude et la douleur de penser que tout peut se terminer d’un instant à l’autre, les hommes ont inventé le divertissement afin de se prescrire un moyen relativement efficace d’être heureux. Mais outre les efforts que les hommes déploient pour améliorer l’industrie du divertissement et en faire un phénomène récurrent de la culture, le divertissement, à l’origine de la tradition pascalienne, s’enracine au cœur de l’instinct humain comme une tendance à détourner les individus de leur misérable condition (et comme une profonde rancune à l’endroit de cette condition). Ainsi l’homme tel qu’il est décrit par Pascal est moins le maître de ses distractions que la créature aliénée à d’autres formes de la misère de vivre. D’un côté nous imaginons que le divertissement nous guérit de la pensée de notre condition de fragiles mortels, mais, de l’autre, nous nous fragilisons d’autant plus dans des activités qui nous empêchent de songer vraiment à nous et de nous occuper en propre du grand mystère de l’existence. En sorte que le divertissement, dans ses premières conséquences, relève d’une insidieuse soustraction de l’homme à l’égard de lui-même : je crois que j’amplifie ma puissance de vivre en oubliant que la vie est courte, je crois que je m’amuse en accumulant des moments récréatifs, mais, en réalité, je m’amoindris et je passe à côté de moi-même, et tandis que je me figure volontiers que je me remplis de bonheur en mordant la vie à pleines dents, je demeure le patient inconscient d’une étrange conscience qui m’assujettit aux décrets de toutes les dissipations. Il s’agit finalement d’une vie de remplissage passif, condamnée à rejouer la parabole du tonneau des Danaïdes, une vie, si l’on peut dire, vécue par inadvertance, traversée dans une espèce de titubation permanente où rien ou presque n’a été senti avec la ferveur de ceux qui ne reculent pas devant le face-à-face que tous les hommes devraient avoir avec eux-mêmes.Cette résistance que nous avons à nous observer et à nous interroger ici et maintenant s’explique par le fait «que le présent, d’ordinaire, nous blesse.» (1) L’homme qui répond à la convocation du présent est un homme qui doit surmonter son apparition dans le plus simple appareil. Non seulement il est dépossédé des vêtements de son passé, mais il est également délesté des éventuelles promesses de son avenir. Le présent est encore le temps brutal de l’affliction parce qu’il nous montre que le passé ne nous appartient plus et que le futur n’annonce réellement que l’assurance de mourir, aussi n’est-on pas grand-chose dans le présent, si ce n’est la créature dans sa plus tremblante nudité, seule et tourmentée de s’apercevoir si mal fichue en ce miroir direct. Céans le reflet souffre de ne pas contenir une densité rassurante. Le présent exhibe la vérité de l’homme en tant qu’il n’est qu’un homme de passage dans le monde, tandis que le passé, d’une part, a déposé sur le sujet humain des membranes artificielles, des raisons de se constituer une mythologie personnelle, et que le futur, d’autre part, s’arrange de bonne grâce pour justifier et relancer les époques révolues. Ce n’est là d’une certaine façon que le fantasme de l’immortalité où tout doit conspirer pour nous rendre inoubliables dans l’Histoire et retarder à jamais nos obsèques nationales. Dans la tripartition des miroirs du temps, le présent est le seul qui ne soit pas déformant, d’où cette fuite sempiternelle de notre condition véritable et notre disposition à «[errer] dans les temps qui ne sont pas nôtres» (2), là où nos reflets possèdent les poids et les mesures qu’ils n’ont pas lorsque nous nous évaluons à l’aune des visions les plus fidèles de la nature humaine. Si nous y réfléchissions un tant soit peu, nous verrions, comme Pascal, que le présent est exclusif étant donné que nous ne pouvons appartenir qu’à lui et qu’il n’y a que lui qui nous appartienne fondamentalement. Le problème, cependant, c’est que le présent ou bien nous mortifie et nous pousse à l’espérance, ou bien nous plaît et nous met dans la crainte insoutenable de le voir bientôt moins généreux. L’espoir illimité ou les regrets anticipés font barrage à toute tentative de carpe diem et cela nous montre que tous les hommes, sans exception, se marginalisent du jour présent pour fonder l’espérance des jours meilleurs, et, ce faisant, ils prennent le passé et le présent comme des moyens ordinaires en vue de préparer des lendemains qui chantent. Cette instrumentalisation du temps prouve que «nous ne vivons jamais, mais que nous espérons de vivre» (3), parce que, si nous vivions, nous serions galvanisés de ce qui nous est offert (la force de la vie) plutôt que tracassés par ce qui pourrait nous être hypothétiquement ôté (les illusions de la vie bonne).
Cette incapacité à tenir le présent pour autre chose qu’un moyen enferme l’homme dans la prison des tiraillements continuels. Il est écartelé entre la douleur imaginaire d’avoir déjà trop vécu et la peur logique de n’avoir plus que des miettes à vivre, comme si l’homme se disait chaque fois que son avenir est derrière lui, alors que le présent, s’il était vécu à sa juste mesure, laisserait deviner à celui qui s’y abandonne le sentiment de l’infini. Plutôt que de considérer le temps à l’instar d’une brume indépendante, telle une haleine du cosmos qui aurait la consistance d’un brouillard pittoresque dans un cimetière écossais, les hommes en ont fait une affaire personnelle, ils l’ont mathématisé, divinisé, réinventé à satiété. Comme Bergson l’a bien saisi par la suite, les hommes ont créé un temps subjectif qui les éloigne du temps objectif de la durée pure (4). En voulant mesurer ou quantifier le temps, en nous préoccupant par exemple du temps qu’il nous resterait à vivre et sur lequel il faudrait sérieusement investir, nous agissons envers le temps comme nous le faisons envers l’espace, nous amalgamons des grandeurs intensives avec des grandeurs extensives, et cette confusion majeure retranche au temps ses qualités essentielles. Certes il est pratique d’avoir une mesure du temps pour arriver à temps et bénéficier d’une organisation précise de la société, pour se situer dans un univers exhaustivement lisible et délimité, mais la spatialisation du temps induit un processus de dénaturation de l’homme puisque le découpage de ce qui est par essence indivisible nous fait perdre en parallèle le flux également insécable de notre conscience. En d’autres termes, la division du temps en séquences rationnelles, aussi utile soit-elle, engendre des hommes divisés dont la conscience fragmentée n’a de signification qu’à l’intérieur d’un champ instrumental de la vie, un lieu où toute la conscience est engagée dans le but de l’action efficace (le moins de temps dépensé doit aboutir au maximum de résultats pertinents dans les espaces ultra-normés), un lieu, donc, étranger à toute sorte de champ contemplatif où nous pourrions regarder le monde indépendamment de nos intérêts les plus immédiats. En divisant le temps, nous augmentons fatalement la délimitation du monde, et cela entraîne des rapports au monde et des rapports d’intersubjectivité tout à fait calibrés, un monde, en l’occurrence, où l’instant non quantifiable du présent, muni de toute sa beauté potentielle et de son infini réel, s’est égaré dans la vaine espérance d’une vie excentrée dans les vaniteuses stratégies d’accroissement de soi. Hors du présent la plupart du temps, les hommes n’y sont que moyennant un registre précis d’actions qui doit les déporter dans un meilleur futur ou leur dissimuler leur fragilité omniprésente, et ces actions, quoique présentement accomplies, s’appuient en outre sur un passé qui n’est aussi que l’outil d’une manutention abusive de l’avenir. En définitive, l’homme ne sait pas vivre et peut-être qu’il ne peut pas affronter son apocalyptique présent, ce présent qui lui révèle sa monstrueuse faiblesse, son cœur étant de surcroît «creux et plein d’ordure» (5). Ainsi l’examen du temps et de l’espace confondus, acheminant chez Bergson une nouvelle image de l’homme mesure de toutes choses, se traduit chez Pascal par l’impuissance des hommes à combler leur terrible vacuité autrement que par les impuretés cumulatives du divertissement, c’est-à-dire par une spatio-temporalité finitisante qui néglige l’infini du présent et l’ampleur de la grâce divine. Là où le vide et la corruption devraient appeler Dieu et la plénitude d’une vie menée en Christ, ils n’appellent que d’autant plus de vide et de corruption par le biais du divertissement.
Il est vaniteux de vouloir échapper à sa faiblesse originelle par la mise en scène d’une existence divertissante, mais l’homme étant ce qu’il est, sa nature le dispose à désirer un bonheur toujours plus vif que celui qu’il détient possiblement hic et nunc. Puisque notre condition n’a de cesse de nous rappeler que nous ne sommes presque rien sitôt que nous voulons y penser instamment, «nos désirs nous figurent un état heureux, parce qu’ils joignent à l’état où nous sommes les plaisirs de l’état où nous ne sommes pas» (6), mais le revers de la médaille, bien sûr, c’est que l’état futur une fois atteint, si toutefois nous l’atteignons, ne sera que le tremplin d’un autre fantôme désirable de l’avenir. Le chagrin nous étreindrait constamment si nous n’étions incessamment déportés vers les pays de Cocagne de nos désirs, et pourtant, au milieu de ces projections chimériques, nous avons les craintes typiquement humaines «qui nous troublent, parce qu’elles joignent à l’état où nous sommes les passions de l’état où nous ne sommes pas.» (7) L’on doit supposer alors que ces craintes se fraient un passage parmi la fabrication assidue de nos désirs et la juxtaposition effrénée de nos distractions. Les angoisses ne se manifestent éventuellement qu’à la faveur de nos temps morts ou de nos temps faibles, lorsque nous ne pouvons éviter le repos après tant de réjouissances, lorsque vient l’heure de rejoindre notre lit et d’être pris quelquefois de la modestie de nous savoir exténué, allongé là comme le gisant que nous serons un de ces jours, emmitouflé de draps qui sont à leur façon les postulats de notre inévitable mise en bière. Aussitôt diverti du divertissement, lorsqu’il est naturellement contraint de se reposer, l’homme ne peut plus contourner l’aventure de sa juste condition, et ne fût-ce qu’une seconde, le temps de sombrer dans le sommeil réparateur, il aura sans doute songé à ce qu’il est – un point éphémère dans l’infinité de l’univers (8). Quant à ceux qui ne s’endorment pas tout de suite, ils sont souvent assiégés par les craintes mentionnées par Pascal, et tous les tyrans fortunés de cette planète, présumons-le, ne sont que des enfants apeurés dès lors qu’ils tournent dans leur lit au rythme saccadé de leurs pensées craintives. Eux aussi passeront sous la faux et de la Mort et eux aussi perçoivent ce qui leur manque actuellement pour être soi-disant plus heureux. Tout homme, au fond de lui-même, préfère vivre en différé, dans l’inconscience désirante et divertissante, plutôt que dans la perpétuité du présent où le bonheur des contemplations, la joie des rêveries pleinement vécues, risque toujours de cohabiter avec la détresse des prises de conscience. L’homme contemplatif a-t-il d’ailleurs jamais pu exister longtemps sur cette Terre affairée ? Depuis que l’argent a donné le change à l’orgueil des capitaines Fracasse de ce monde, nous n’avons quasiment que des hommes dangereusement actifs, des insensés qui gagnent leur vie et qui pour la majorité ne voient pas qu’ils la perdent (dans le travail et dans le divertissement, les deux allant parfois de pair (9)).
La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.
Lien permanent | Tags : philosophie, pascal, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer



























































