« Orléans de Yann Moix, capitale du bonimenteur | Page d'accueil | Seiobo est descendue sur terre de László Krasznahorkai, par Gregory Mion »
15/09/2019
Le dernier loup de László Krasznahorkai, par Gregory Mion

 László Krasznahorkai dans la Zone.
László Krasznahorkai dans la Zone.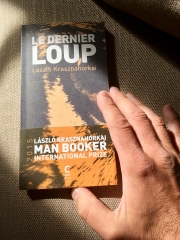 Acheter Le dernier loup sur Amazon.
Acheter Le dernier loup sur Amazon.«Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre !»
Paul Valéry, Le cimetière marin.
À la fois confession extatique et voyage abyssal dans une Espagne brûlée par le soleil, Le dernier loup (1) de László Krasznahorkai est un petit roman composé d’un seul tenant, traversé du début jusqu’à la fin par une phrase unique où l’auteur épouse les chemins emmêlés d’un ancien professeur de philosophie, peut-être une vieille gloire du concept, peut-être aussi un imposteur. Quoi qu’il fût dans ce passé philosophique, cet homme, désormais, a pris des habitudes oisives et désabusées sur la Hauptstrasse de Berlin, sorte d’artère où «[tout commence et tout finit]» (p. 9), aux façades encrassées de «graffitis kurdes» et aux seuils éclaboussés de «vomis gelés» (p. 9), signes incontestables d’un brassage de vies à la marge des rigueurs bourgeoises. C’est dans un bar de ce côté-là de Berlin que le professeur déclassé raconte à un bistrotier son improbable errance espagnole, au cœur des paysages désertiques de l’Estrémadure où les chênes disséminés dans cette aride pampa, visibles à perte de vue, ont pu rimer avec la mélancolie de son âme (cf. pp. 34-5 et 51-2). La situation de ce grand déballage inattendu, de surcroît émis par un personnage dont la parole semble moins clarifier son identité que la dissimuler à nouveaux frais, évoque l’un de ces innombrables récits composant Les détectives sauvages de Roberto Bolaño. On y retrouve la nécessité du nomadisme, la sensation d’une élongation du monde, comme si ce dernier était la proie d’une force diabolique, puis les plaisirs et les mystères d’une enquête de terrain. Toutefois Le dernier loup ne poursuit pas la trace d’une poète mexicaine dont la légende a connu des amplifications romanesques. Il est question, avec Krasznahorkai et sa créature professorale, d’une invitation inopinée pour l’Estrémadure, suggérant au prétendu savant de découvrir cette région afin qu’il écrive quelque chose à son propos (cf. p. 10), ou, plus exactement, afin qu’il «consigne les pensées que l’Estrémadure a fait naître en lui» (pp. 19-20). Il s’agirait presque d’une incitation à rédiger l’un de ces banals manuels de tourisme qui se contentent de broder sur les lieux remarquables et qui se gardent d’effectuer toute espèce de sortie de route. Il n’en sera rien heureusement.
Cette proposition est néanmoins étrange parce que le professeur, dorénavant ostracisé de ses anciennes fonctions, n’est plus qu’un apparent traîne-misère qui supporte le poids d’une réputation peu enviable, auteur de «livres illisibles gorgés de phrases lourdement déficientes mues par une logique déprimante et une terminologie suffocante» (p. 11). On ne sait s’il s’agit là d’un jugement proféré sous les auspices d’une taquine focalisation omnisciente, pas davantage que l’on ne sait s’il s’agit d’une réalité objective ou d’une montée de bile noire de la part du principal intéressé. Cette hésitation sur les qualités potentielles de cet homme, associée aux sollicitations en provenance de l’Espagne, laisse augurer que tout est possible et que l’essence du professeur pourrait être celle d’un esprit de génie comme celle d’un fallacieux raisonneur. Encore une fois, l’impression d’une clarification redoublée d’un obscurcissement se vérifie, empêchant la moindre certitude de se faufiler, rappelant ainsi les moments les plus virtuoses des Détectives sauvages et jouant le jeu, si l’on ose dire, d’un secret qui semble même dépasser Krasznahorkai, comme si le romancier hongrois était engagé dans l’une de ces spirales créatrices qui a tant dévoré Bolaño. C’est en outre là, précisément là, c’est-à-dire dans cette incapacité de cerner un personnage voire un livre tout entier, que se détermine la constitution d’un chef-d’œuvre de la littérature : contrairement aux mauvais textes qui avancent avec de gros sabots, produits avec des recettes d’écriture et des éphémérides commerciaux, les textes d’exception, eux, assument une bizarrerie déroutante qui résiste aux petites cases du commentaire journalistique. Par conséquent Le dernier loup nous confond par sa duplicité monumentale, par son genre de sourire de chat du Cheshire, par sa faculté de nous rejeter au large toutes les fois que nous avons cru atteindre le port, immunisé contre les dictatures de la signification qui débordent des colonnes analphabètes de la presse littéraire (ou soi-disant littéraire), laquelle, admettons-le une fois pour toutes, n’a plus pour mission que de répéter deux ou trois éléments de langage à destination d’un lectorat qui veut tout comprendre du premier coup et qui, de toute façon, ne pourrait aucunement lire Krasznahorkai. Cela est une bonne chose, en fin de compte, car nous pouvons par exemple éviter l’incompétence d’une Raphaëlle Leyris, inculte et illettrée baragouinant au Monde des livres, vivant paradoxe de la nullité linguistique du fait même de son emploi dans un journal dont le titre a l’air de sous-entendre une vague compétence rédactionnelle. Que n’écrirait-elle pas comme fadaises si elle était commissionnée pour étudier l’œuvre de László Krasznahorkai ! (2)
La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.































































 Imprimer
Imprimer