« La critique littéraire en France, par Damien Taelman | Page d'accueil | Le Questionnaire d'Ernst von Salomon »
03/03/2020
L’esclave d’Isaac Bashevis Singer, par Gregory Mion

«Vous finirez par contaminer le pays entier : par votre faute, le pays entier aura mérité sa ruine. Et quand nous en serons arrivés là, je vous le dirai de tout mon cœur : que l’on rase ce pays, que l’on extermine ce peuple !»
Henrik Ibsen, Un ennemi du peuple.
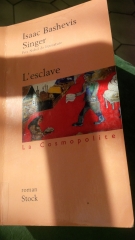 À notre triste époque de regain antisémite un peu partout dans le monde, il serait bon de rappeler l’existence de l’œuvre d’Isaac Bashevis Singer, prix Nobel de littérature en 1978, né en Pologne au début du XXe siècle puis expatrié aux États-Unis en 1935 comme tant d’autres juifs persécutés, traducteur en yiddish de Knut Hamsun et de Thomas Mann, écrivain, par ailleurs, qui sut admirablement composer avec la profondeur de la religion et ses aspects les plus merveilleux, mélangeant volontiers la rigueur de la Torah avec la farandole de quelques monstres et prodiges, confrontant le divin et le malin au moyen d’une remarquable ivresse créatrice qui nous fait de temps en temps songer aux pages inoubliables du Diadorim de João Guimarães Rosa. À bien des égards du reste, les romans de Bashevis Singer, disparu un jour de l’été 1991, peuvent apparaître comme les ancêtres esthétiques de Philip Roth en raison de plusieurs glissements vers la problématique sexuelle, mais là où Roth a quelquefois forcé le trait non sans atteindre de grands moments de tragi-comédie, son précurseur, lui, a toujours résidé à l’étage supérieur parmi les secrets de la Kabbale et l’entrelacement de ceux-ci avec des personnages tantôt caricaturalement obsédés. Autrement dit la conciliation de la sagesse millénaire et des tentations prosaïques de la chair féminine, chez Bashevis Singer, relève d’une approche littéraire beaucoup plus subtile, ce que l’on constate immédiatement à la lecture de L’esclave (1), un roman où la spiritualité juive affronte le sacrilège de l’amour charnel parce que ce dernier prend racine dans le corps d’une «femme de la race des Gentils» (p. 75). Il en résulte des tiraillements magnifiques, où l’exigence de la religion se heurte à l’exigence de l’amour terrestre, complétés, en toile de fond, par le contexte de la Pologne convulsive du XVIIe siècle, au sortir des pogroms commandés par le redoutable Bogdan Chmielnicki, chef des Cosaques d’Ukraine et portrait craché de la calamité qui pose la question du Mal toléré par Dieu, de la laideur compatible avec l’onction du Seigneur (cf. pp. 117-9 et 169-170). En résumé : «Il était difficile de croire à la pitié de Dieu, alors que des assassins enterraient des enfants tout vifs. Mais la Sagesse de Dieu n’en éclatait pas moins partout» (p. 19), c’est-à-dire jusque dans les moindres tournures de ce paysage montagneux qui entrebâille cette histoire, jusque dans «le simple chant d’oiseau» (p. 9) dont la trille figure une insubmersible toccata, une musique invincible et naturelle qui sursoit aux dérives de la civilisation.
À notre triste époque de regain antisémite un peu partout dans le monde, il serait bon de rappeler l’existence de l’œuvre d’Isaac Bashevis Singer, prix Nobel de littérature en 1978, né en Pologne au début du XXe siècle puis expatrié aux États-Unis en 1935 comme tant d’autres juifs persécutés, traducteur en yiddish de Knut Hamsun et de Thomas Mann, écrivain, par ailleurs, qui sut admirablement composer avec la profondeur de la religion et ses aspects les plus merveilleux, mélangeant volontiers la rigueur de la Torah avec la farandole de quelques monstres et prodiges, confrontant le divin et le malin au moyen d’une remarquable ivresse créatrice qui nous fait de temps en temps songer aux pages inoubliables du Diadorim de João Guimarães Rosa. À bien des égards du reste, les romans de Bashevis Singer, disparu un jour de l’été 1991, peuvent apparaître comme les ancêtres esthétiques de Philip Roth en raison de plusieurs glissements vers la problématique sexuelle, mais là où Roth a quelquefois forcé le trait non sans atteindre de grands moments de tragi-comédie, son précurseur, lui, a toujours résidé à l’étage supérieur parmi les secrets de la Kabbale et l’entrelacement de ceux-ci avec des personnages tantôt caricaturalement obsédés. Autrement dit la conciliation de la sagesse millénaire et des tentations prosaïques de la chair féminine, chez Bashevis Singer, relève d’une approche littéraire beaucoup plus subtile, ce que l’on constate immédiatement à la lecture de L’esclave (1), un roman où la spiritualité juive affronte le sacrilège de l’amour charnel parce que ce dernier prend racine dans le corps d’une «femme de la race des Gentils» (p. 75). Il en résulte des tiraillements magnifiques, où l’exigence de la religion se heurte à l’exigence de l’amour terrestre, complétés, en toile de fond, par le contexte de la Pologne convulsive du XVIIe siècle, au sortir des pogroms commandés par le redoutable Bogdan Chmielnicki, chef des Cosaques d’Ukraine et portrait craché de la calamité qui pose la question du Mal toléré par Dieu, de la laideur compatible avec l’onction du Seigneur (cf. pp. 117-9 et 169-170). En résumé : «Il était difficile de croire à la pitié de Dieu, alors que des assassins enterraient des enfants tout vifs. Mais la Sagesse de Dieu n’en éclatait pas moins partout» (p. 19), c’est-à-dire jusque dans les moindres tournures de ce paysage montagneux qui entrebâille cette histoire, jusque dans «le simple chant d’oiseau» (p. 9) dont la trille figure une insubmersible toccata, une musique invincible et naturelle qui sursoit aux dérives de la civilisation. L’amoureux divisé de ce livre se prénomme Jacob et il se conduit selon les enseignements ascétiques de la Torah (cf. p. 26). Il est l’esclave de Jan Bzik, quelque part dans la Pologne immémoriale des paysans, loin de sa vie d’autrefois où il était maître d’école. Survivant du massacre perpétré par les Cosaques, ancien érudit de Josefov et père de famille dont la femme et les enfants sont morts dans le carnage, Jacob a été vendu comme esclave. En homme tout à fait pieux, il accepte l’épreuve de la Providence (cf. p. 12), se nourrissant de bon nombre de prières qu’il connaît par cœur, tel Primo Levi se souvenant des vers de Dante au milieu de l’univers concentrationnaire. La femme qui le perturbe de plus en plus s’appelle Wanda. Elle est la fille de Jan Bzik, âgée de vingt-cinq ans et veuve, d’une allure gracieuse qui contraste avec les dégénérées de ces hauts pâturages (cf. pp. 16-9). Il n’y a guère que Wanda, en outre, qui éprouve à l’endroit de Jacob un sentiment d’attirance. En effet, pour le commun de cette région, la judaïté de cet homme est perçue à l’instar d’une anomalie susceptible de menacer l’ordre établi (cf. p. 41). Ainsi Wanda ne craint pas de braver les interdits, de dédaigner la coutume à dessein de se rapprocher de Jacob en qui elle devine un «profond penseur» (p. 22). Mais lui, discipliné par une mystique endurcie, résiste religieusement aux velléités sentimentales de Wanda (cf. pp. 22-3). Il y voit même l’empreinte de Satan, la signature du Tentateur qui voudrait l’escorter jusque dans les souterrains du péché (cf. p. 17). S’engage alors un combat avec le démon, une lutte de tous les instants contre les sommations de la chair (cf. pp. 46-9), la réfutation permanente et torturante d’une sympathie pour les ténèbres qui l’encourage à renier Dieu (cf. p. 66). Par un effort grandiose de réminiscence, Jacob maintient vivante la Torah, «cachée dans les replis et les sillons de son cerveau» (p. 50). La douleur de l’exil et l’expérience d’un désir enfiévré lui font comprendre ce passage où la Kabbale évoque «la Face cachée de Dieu et [le] retrait de Sa lumière» (p. 73), l’heure grise où la beauté du divin disparaît pour celui qui est enchaîné «aux vanités de la chair» (p. 74).
La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.































































 Imprimer
Imprimer