« Vermines de Sébastien Vaniček : l’horreur sociale de l’existence verrouillée, par Gregory Mion | Page d'accueil | Bloc-notes du mystique à l'état sauvage de Maxence Caron : le maxencéisme est-il un aspermatisme ? »
19/01/2024
Au-delà de l'effondrement, 70 : L'Apocalypse frénétique d'Ernest Pérochon, par Francis Moury

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Tous les effondrements
Tous les effondrements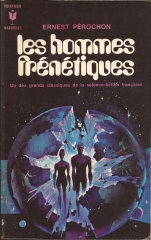 «L'humanité ne comprit pas, tout d'abord, qu'elle venait de recevoir le coup de grâce. [...] La civilisation avait sombré. A part quelques rares avions, quelques installations privées de cinétéléphonie, tout était à peu près disparu de ce qui avait fait la puissance et l'orgueil de la société moderne. [...] De vastes régions étaient jonchées de paralytiques gémissants qui mouraient de faim et de soif; en d'autres lieux, on ne trouvait plus guère que des aveugles. Des hallucinés, des fous, des monstres qui n'avaient même plus figure humaine erraient à l'aventure. Aucun des groupes sociaux n'avait subsisté. L'individu assurait sa subsistance au jour le jour et vivait en état de perpétuelle alerte.»
«L'humanité ne comprit pas, tout d'abord, qu'elle venait de recevoir le coup de grâce. [...] La civilisation avait sombré. A part quelques rares avions, quelques installations privées de cinétéléphonie, tout était à peu près disparu de ce qui avait fait la puissance et l'orgueil de la société moderne. [...] De vastes régions étaient jonchées de paralytiques gémissants qui mouraient de faim et de soif; en d'autres lieux, on ne trouvait plus guère que des aveugles. Des hallucinés, des fous, des monstres qui n'avaient même plus figure humaine erraient à l'aventure. Aucun des groupes sociaux n'avait subsisté. L'individu assurait sa subsistance au jour le jour et vivait en état de perpétuelle alerte.»Ernest Pérochon, Les Hommes frénétiques (Éditions Plon 1925, puis nouvelle Édition belge Gérard & Cie., Bibliothèque Marabout, section science-fiction, Verviers 1971), page 210. NB: la pagination indiquée est celle de la seconde édition Marabout.
On s'en souvient mal aujourd'hui mais la première moitié du vingtième siècle fut une période faste pour la littérature française de science-fiction. Certes, Jules Verne avait ouvert la voie durant la seconde moitié du dix-neuvième siècle (De la Terre à la Lune en 1865 et Vingt Mille Lieues sous les mers en 1869-1870) mais la popularité du genre devint considérable dès la génération suivante. L'apocalypse fut un de ses thèmes majeurs : qu'on se souvienne de Jacques Spitz (La Guerre des mouches en 1938) et d'Ernest Pérochon (Les Hommes frénétiques en 1925) ! Nous avons déjà consacré un article au livre de Spitz; intéressons-nous ici et maintenant à celui de Pérochon.
Son cas est d'autant plus curieux que rien ne le prédestinait à ce genre auquel ce fut, semble-t-il, son unique contribution parfois négligée, voire passée sous silence, dans les quelques maigres notices bio-bibliographiques qu'on lui a consacrées sur Internet. Ernest Pérochon (1885-1942) avait, en 1920, obtenu le prix Goncourt pour Nène, un roman paysan (ou de mœurs champêtres, comme on disait à l'époque) totalement oublié et il donna en 1927 un L'Instituteur non moins oublié. C'était sa profession initiale puisqu'il avait été normalien (pas Normale Sup, précisons : Normale... tout court) et qu'il devait, par la suite, signer quelques manuels scolaires élémentaires. Son roman Les Gardiennes (1924) qui raconte l'histoire, durant la Première Guerre mondiale, de quelques femmes françaises de l'Arrière, privées des hommes envoyés au front et devant donc assurer la sauvegarde des champs, des cultures et des usines par leurs propres moyens, a été récemment adapté (2017) au cinéma. Il en a écrit d'autres qu'il faudrait peut-être redécouvrir mais, assurément, le roman de science-fiction Les Hommes frénétiques occupe une place singulière, unique, particulière dans cet ensemble partiellement englouti.
L'histoire racontée par Les Hommes frénétiques est assez simple : elle imagine une guerre mondiale survenue (pour un motif absurde et futile) en 2145 et mettant un terme à une civilisation techniquement si avancée qu'elle utilise les méridiens et les parallèles comme lignes de séparation et de transport tout à la fois, alimentant de puissants réseaux de télécommunications et de transmissions d'énergie. Ce n'est pas tant la description de cette guerre mondiale (essentiellement aérienne, effectuée par l'emploi de curieux tourbillons modifiant l'éther et / ou l'atmosphère) et de ses nouvelles techniques de destruction (occupant pratiquement les deux premières parties du livre) qui retiendra ici mon attention, en dépit de son caractère régulièrement spectaculaire, que celle du remplacement de la race humaine par une quasi nouvelle race, survenant durant la troisième et dernière partie du livre (pages 207 à 245), intitulée Une genèse. Les critiques contemporains du livre furent, pour leur part, d'abord et essentiellement sensibles aux effets d'anticipation scientifique : on créditait même parfois Pérochon d'avoir surpassé, sur leur propre terrain, les inventions techniques les plus prophétiques et / ou les plus folles déjà portées sur le papier par Jules Verne, J.-H. Rosny aîné, sans oublier l'inévitable Herbert-George Wells. Aucun des maigres extraits critiques cités dans la Postface (même pas celui signé par l'académicien Henri de Régnier qui aimait beaucoup le livre et l'avait écrit dans Le Figaro) de Jean-Baptiste Baronian, ne mentionne pourtant l'originalité si remarquable de cette troisième partie.
Cette genèse d'une nouvelle race, dérivant de celle des hommes mais moins intellectuelle et davantage poétique, qui s'avère bientôt physiquement plus apte à la survie dans un monde revenu à l'état sauvage que la race déclinante puis malade puis vouée à la disparition des hommes anciens, est discrètement (mais assez dialectiquement — au sens hégélien et non pas au sens platonicien car il s'agit non pas d'une contrariété initialement érigée en contradiction logique puis ontologique mais d'une germination quasiment botanique) annoncée par la situation modeste de Samuel et Flore, leurs fondateurs que le début du livre nous montre, alors encore enfants, aux côtés du plus grand savant de l'époque, Harrisson : «C'était [Samuel] un enfant curieusement arriéré, sans aucun symptôme morbide, cependant; les experts psychologues voyaient en lui, non un malade, mais un spécimen de l'humanité aux âges néolithiques. En sa cervelle obscure, les mots les plus simples éveillaient seuls de fugitives images. D'une beauté parfaite, l'harmonie naturelle de ses gestes était une joie pour les yeux. [Flore et Samuel] étaient totalement dépourvus de ce courage agressif, de cette férocité que l'on attribuait — peut-être gratuitement — à l'homme préhistorique» (pages 9 et page 101).
Le savant Harrisson qui les héberge à proximité de son laboratoire privé, se compare, pour sa part, assez volontiers, sur le plan de la philosophie des sciences, à «quelque aventureux coureur des âges primitifs, quittant la horde pour pénétrer seul, toujours plus avant dans le mystère d'une forêt inconnue. La forêt était sans bornes, peuplée de formes inimaginables et d'une mobilité telle que les images glissantes d'un rêve saugrenu eussent paru, en regard, choses stables, nettes, admissibles. Royaume de folie, plein de l'immense tremblement des chimères. La folie ! Un savant des siècles précédents et même, à l'heure présente, un penseur trop habitué aux vieilles règles en eussent peut-être senti le vent sur leur face. Mais lui, Harrisson, regardait, sans trouble, chavirer les idoles, s'évanouir les systèmes qui, depuis des siècles, formaient les assises de l'esprit humain» (page 10).
Pour le lecteur cultivé de 1925, de tels fragments évoquent inévitablement à la fois le positivisme (le culte de l'histoire, y compris et surtout celui de l'histoire anthropologique autant que celui de l'histoire des sciences et des civilisations), son rameau darwiniste évolutionniste (1), Nietzsche et son Crépuscule des idoles. S'y greffe aussi, fugitivement mais réellement, quelque chose du Victor Hugo poète, celui de La Légende des siècles. L'idée du rapport philogénétique et ontogénétique de l'individu à une horde est déjà scientifiquement exploitée en Angleterre par James G. Frazer dans Totémisme et exogamie (1910-1937) et en Autriche par Sigmund Freud dans Totem et tabou (1913), ce dernier titre étant le véritable prélude aux études d'anthropologie psychanalytique de Geza Roheim. Elle découle en droite ligne d'une autre intuition nietzschéenne (2). Tel est le contexte, plus ou moins connu en France, auquel Pérochon ajoute son expérience personnelle d'ancien combattant de la Première Guerre mondiale et celle du pessimisme philosophique qui s'ensuivit. Paul Valéry (3) et bien d'autres savaient, bien avant 1918, que la civilisation européenne était mortelle et qu'elle avait fourni techniquement aux autres civilisations les moyens de la surpasser matériellement, voire de la détruire.
Dès lors, rien d'étonnant si Harrisson, le savant triomphant et énergique du début du livre, finit supplanté (par hasard ou par une obscure nécessité renversant les anciennes philosophies humaines de l'histoire) par des enfants innocents, graines d'une race future bien plus vigoureuse car bien moins philosophe mais peut-être plus essentiellement humaine que ne le furent ses anciens maîtres. Il y a quelque chose de réellement nietzschéen dans les derniers chapitres de Les Hommes frénétiques, non seulement à cause de la critique fondamentale, ici bien évidemment reprise, de la civilisation occidentale ébauchée puis systématisée par Nietzsche mais encore en raison de l'idée finale d'un recommencement presque pré-temporel, presque mythique et d'essence poétique, recommencement pérochien qui pourrait bien s'assimiler à l'éternel retour (4).
Un des grands moments du livre est probablement celui de la lecture, par Harrisson, d'une imaginaire et ridiculement scientiste «Histoire générale de la civilisation, du dix-huitième siècle chrétien au cinquième siècle de l'ère universelle». L'historien y soutient naïvement que ni les philosophes, ni les moraliste, ni les poètes, ni les guerriers, ni les légistes ne dirigent l'humanité : seuls les savants méconnus, auteurs modestes d'inventions ponctuelles purement techniques, provoquent de réels changements. Toute la suite du livre affirme bien entendu le contraire d'une manière assez ironique : la fin du monde est activée par la folie d'une poétesse fanatique laotienne (joliment nommée Lia-Té) et la technique n'est pas ici l'objet des imprécations philosophiques d'un Oswald Spengler, d'un Martin Heidegger ou d'un Nicolas Berdiaeff. Elle est un simple facteur neutre, constaté, observé mais n'impliquant aucun gain particulier sur le plan stratégique, encore moins tactique puisque toutes les parties du globe sont supposées être à niveau égal, n'impliquant pas non plus un quelconque déficit ontologique ou spirituel. Harrisson, le plus grand savant du monde honoré par cette époque, ne pourra d'ailleurs rien faire pour empêcher la catastrophe.
Ce sont Samuel et Flore qui (in troisième partie, §II L'Odyssée de Samuel et Flore, pages 217-234) enfantent, contre toute attente, cette nouvelle race «chanteuse, paresseuse et douce» qui supplante l'humanité ancienne, décimée par la maladie. Cette genèse est racontée d'une manière progressivement non seulement biblique mais franchement mythique à mesure que le récit progresse, à partir de la page 217. L'histoire, la science, la culture humaine ont disparu : une sorte de rapport immédiat des données factuelles à la conscience les remplace. Il ne s'agit certes pas d'objectivité ni de courant de conscience au sens défini par les œuvres littéraires supérieures de James Joyce (1882-1941) ou de William Faulkner (1897-1962) ; ce n'est pas non plus ce que Henri Bergson entendait lorsqu'il inventait le titre de sa thèse de doctorat : Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), dédiée à Jules Lachelier. Il s'agit simplement, pour Pérochon, de décrire la progression du crépuscule d'une race maudite vouée à la disparition et la naissance inédite d'une nouvelle ère primitive au sens où Lucien Lévy-Bruhl étudiait entre 1910 et 1935 la mentalité primitive et l'âme primitive réelles.
Il faut noter un point décevant : Pérochon s'arrête trop tôt et ne mentionne aucune création de mythe, de rite, de culture. Il laisse sa place à l'infini du possible, y compris, peut-être, à l'émergence d'une contre-culture telle que l'avait imaginée Wells dans La Machine à explorer le temps (1895) : une humanité demeurant au stade infantile, des livres inexorablement voués au retour à l'état de poussière faute de conservation correcte, faute d'entretien, faute d'éducation.
Cette crépusculaire troisième partie est décrite par de simples notations factuelles, ponctuelles, écrites dans un style volontairement plus enfantin que adulte, en raison de sa syntaxe dénuée de tout artifice, de tout parement stylistique ou allusif. L'ébauche d'une ultime alliance entre l'ancienne race humaine et cette nouvelle race échoue dramatiquement, encore une fois autant par hasard que par une obscure nécessité à laquelle les ultimes protagonistes sont insensibles, car devenus ignorants, inconscients des tenants et aboutissants de leur propre histoire. C'est le sens du titre du dernier chapitre, Le Chant du matin, (pages 235 à 245) qui est une sorte de poème en prose, s'achevant sur une simplicité biblique au sens poétique mais aussi stylistique, au sens où un Victor Hugo pouvait l'entendre dans certains de ses poèmes écrits pour La Légende des siècles : on peut songer, à l'occasion des descriptions de nature et d'impressions épidermiques qu'elle engendre dans une conscience rêveuse, à peine éveillée, à certaines strophes de la seconde partie de Booz endormie (1859), si on veut une comparaison d'histoire de la littérature qui n'est certes pas raison, mais qui fut peut-être bien présente à l'esprit de Pérochon qui avait grandi en lisant les Parnassiens autant qu'Hugo. Ce sont peut-être, d'ailleurs, précisément ces dernières pages qui plaisaient le plus à Henri de Régnier, bien davantage que le lourd assemblage futuriste de prospective stratégique et militaire auparavant déployée dans les deux précédentes parties.
Pérochon déclarait en 1925 à Frédéric Lefèvre qui l'interrogeait pour Les Nouvelles littéraires : «Nous accueillons avec une étonnante insouciance les nouveautés scientifiques les plus ahurissantes. Nous ne semblons pas remarquer que la science est une grande révolutionnaire. Je crains que le réveil ne soit terrible. Tant mieux si cette crainte est ridicule ! Mais enfin j'appréhende avec angoisse un évanouissement catastrophique de notre jeune civilisation. Le coeur des hommes est encore trop barbare, trop orageux pour qu'ils puissent utiliser sans danger les forces secrètes de la nature. Sincèrement, si j'ai composé cette affreuse et folle histoire, c'est dans l'espoir d'avoir un démenti» (cité in Postface de Jean-Baptiste Baronian, pages 248-249). Il mourra en 1942, trois ans avant que les bombes atomiques ne tombent sur Hiroshima et Nagasaki, provoquant des conséquences matérialisant d'une manière assez précise et fidèle certains des pires cauchemars qu'il avait imaginés dans Les Hommes frénétiques.
Notes
(1) Cf. Francis Moury, Le Pragmatisme de John Dewey (2017).
(2) Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, V, § 354 Du «Génie de l'espèce» (1882-1887, traduction 1950 par Alexandre Vialatte aux Éditions Gallimard, NRF + retirage Idées-Gallimard 1972), pages 305 à 309 : «À quoi bon la conscience si elle est superflue pour l'essentiel de l'existence ? [...] Je pense, comme on le voit, que la conscience n'appartient pas essentiellement à l'existence individuelle de l'homme, mais au contraire à la partie de sa nature qui est commune à tout le troupeau [...] etc.» Cet article 354 'est l'un des plus longs du livre V et sa démonstration, dense et serrée, exige qu'on s'y reporte intégralement pour être correctement appréciée. Il a certainement inspiré une partie de la théorie freudienne de la horde en 1913.
(3) Paul Valéry, Regards sur le monde actuel (Éditions Gallimard, NRF, 1945 + reprise Idées-Gallimard, 1967), page 8 : «Je ne sais pourquoi les entreprises du Japon contre la Chine et des États-Unis contre l'Espagne qui se suivirent d'assez près, me firent, dans leur temps (1895 et 1898), une impression particulière. [...] Je ressentis toutefois ces événements non comme des accidents ou des phénomènes limités, mais comme des symptômes ou des prémisses, comme des faits significatifs dont la signification passait de beaucoup l'importance intrinsèque et la portée apparente. L'un était le premier acte de puissance d'une nation asiatique réformée et équipée à l'européenne ; l'autre, le premier acte de puissance d'une nation déduite et comme développée de l'Europe, contre une nation européenne.»
(4) Clifford D. Simak, Demain les chiens (City), sera lui aussi inspiré, en 1952, par une telle critique d'essence nietzschéenne. Le brillant philologique de la construction de l'intrigue (des chiens, philologues du futur, étudient un antique manuscrit dont certaines leçons pourraient prouver l'existence d'une race humaine ayant dominé la Terre) pouvant éventuellement constituer un hommage ironique direct à Friedrich Nietzsche qui avait été, comme on sait, le premier critique dévastateur de la discipline qu'il enseignait si brillamment au début de sa carrière universitaire. Sur le mythe lui-même et son rapport à la philosophie de l'histoire, à l'histoire de la philosophie et aux religions, cf. Mircea Eliade, Le Mythe de l'éternel retour – Archétypes et répétition (Éditions Gallimard, Les Essais XXXIV 1949 + nouvelle édition revue et augmentée Idées-Gallimard, 1969).































































 Imprimer
Imprimer