« Sur le Journal de quatre ou cinq dindes confinées, par Gregory Mion et Atmane Oustani | Page d'accueil | Apocalypses biologiques, 1 : The Last Man on Earth de Sidney Salkow et Ubaldo Ragona, par Francis Moury »
07/04/2020
Le temps qui reste de Giorgio Agamben

Photographie (détail) de Juan Asensio.
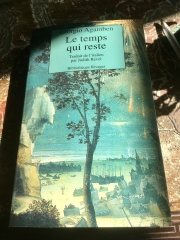 Du très riche commentaire que Giorgio Agamben donna de l'Epître aux Romains de Paul, lors de plusieurs séminaires tenus au Collège international de philosophie de Paris, à l'université de Vérone, à la Northwestern University et enfin à l'université de Berkeley, réunis en un seul volume en 2000 sous le titre Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, nous ne retiendrons qu'un seul aspect, apparemment anecdotique et pourtant riche de perspectives, non seulement dans l'audace du parallèle dont l'intuition est ensuite méthodiquement détaillée (et comme prouvée, bien qu'a posteriori) mais aussi dans les implications entrainées par la remarque fulgurante.
Du très riche commentaire que Giorgio Agamben donna de l'Epître aux Romains de Paul, lors de plusieurs séminaires tenus au Collège international de philosophie de Paris, à l'université de Vérone, à la Northwestern University et enfin à l'université de Berkeley, réunis en un seul volume en 2000 sous le titre Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, nous ne retiendrons qu'un seul aspect, apparemment anecdotique et pourtant riche de perspectives, non seulement dans l'audace du parallèle dont l'intuition est ensuite méthodiquement détaillée (et comme prouvée, bien qu'a posteriori) mais aussi dans les implications entrainées par la remarque fulgurante.C'est lors de sa quatrième journée consacrée à la définition de l'apostolos, l'apôtre qui, dans le temps messianique, remplace le prophète qui n'a plus lieu d'être (1), que Giorgio Agamben esquisse un pas vers un domaine qui, à vrai dire, n'est jamais étranger à sa pensée : le langage et, plus spécifiquement, le langage propre au poème. Il s'agit alors de définir les spécificités du temps messianique puisque, «encore une fois, chez Paul, le messianique n'est pas un troisième éon entre les deux temps», passé et futur, «mais plutôt une césure qui divise la division entre les temps et introduit entre eux un reste, une zone d'indifférence inassignable à l'intérieur de laquelle le passé est déplacé dans le présent et le présent étendu au passé (pp. 123-4). Ainsi, au-delà même de ces divisions de la cession qui peuvent vite nous sembler un pur jeu de l'esprit, le temps messianique «n'est pas la fin chronologique du monde mais le présent comme exigence d'achèvement» (p. 127), et, tout autant, il n'est pas un «autre temps par rapport au temps chronologique et à l'éternité, mais la transformation que le temps subit en se donnant en tant que reste», autrement dit comme perpétuel écart institué au centre même du temps entre passé, présent et avenir, raison pour laquelle, nous dit le penseur italien, il est alors possible de le rapprocher du temps si particulier qu'institue le poème, qualifié de «machine sotériologique» capable de transformer «le temps chronologique en temps messianique». C'est dire en effet que «le temps du poème» (peu importe, ici, qu'Agamben cite le cas précis, assez anecdotique, de la sextine) est alors «la métamorphose que le temps subit en tant que temps de la fin, en tant que temps que le poème met pour finir» (p. 134, l'auteur souligne), ce temps étant perpétuellement élargi par le jeu compliqué des croisements et redites des rimes permettant de retenir le poème, le tenir mais aussi l'apprendre, comme si, remarque géniale d'Agamben, toute mémoire devait être rapprochée du temps messianique, de la perspective du salut : «La mémoire apparaît ici comme une propédeutique et une anticipation du salut» (p. 128). C'est je crois ramasser en un bond des volumes entiers de gloses sur la question de la mémoire, de la remémoration considérées comme préfigurations d'un passé perdu, du coup reconquis.
Nous ne sommes pas loin de Pierre Boutang évoquant savamment le rythme propre à toute grande poésie, qui n'est que le calque, la métrique de l'être, comme si ce dernier avait besoin de se redire perpétuellement pour assurer son assise, sa fondation ontologique, sa tenue et sa retenue dans la mémoire. Si le sacré, la sphère des dieux qui assure la stabilité du monde doit se répéter, se remémorer dans la reprise (kierkegaardienne, suggère Agamben, cf. p. 125), la fuite de ces derniers ne pourra que casser la rythmique mémorielle de la poésie, un phénomène que l'auteur voit à l’œuvre dans la grande poésie fracturée de Hölderlin ayant sombré dans la folie de la parataxe et du verbe déchu, une fois le ciel vidé des ses assises, si je puis me permettre ce jeu avec la pesanteur : «Quand Hölderlin, au seuil d'un siècle nouveau, élabore sa doctrine de la prise de congé des dieux» et, en particulier, du dernier d'entre eux, «le Christ» ajoute Agamben, «alors, au moment même où il assume cette nouvelle athéologie, la forme métrique de sa poésie se brise jusqu'à perdre, en particulier dans les derniers hymnes, tout trait d'identité reconnaissable». La conclusion qu'en tire le penseur est là encore magnifique, ce qui n'est qu'affaire de jugement, mais surtout radicale, ce qui nous plonge dans le domaine de la praxis au sens fonctionnel et fictionnel d'une grammaire agissante, source de l'effluence du monde (quand dire c'est faire bien sûr) se jetant dans l'océan houleux de l'action, qu'importe qu'elle soit aveugle : «Le congé des dieux ne fait qu'un avec la disparition de la forme métrique fermée, l'athéologie se donne immédiatement comme une aprosodie» (p. 140).
Je ne sais si nous ne pourrions parler, à propos des aperçus de Giorgio Agamben, d'une forme de «violence herméneutique» (p. 203) que le commentateur considère justement comme l'une des marques les plus visibles de la théologie messianique de Paul, mais il n'en reste pas moins fascinant de constater que son analyse mot à mot de l’Épître aux Romains laisse plus d'une fois affleurer des strates de langage très anciennes, comme si l'embrassement (et l'embrasement) du temps messianique impliquait obligatoirement une récapitulation, une redite ou, je l'ai dit, une reprise du passé le plus lointain, non pas définitivement englouti mais sauvé comme reste, temps interstitiel (non au sens chronologique, nous l'avons dit), temps du reste du temps qu'est l'ouverture messianique, sorte de coin capable de faire sortir de leurs gonds les portes en apparence les plus massives. En fait, et cette remarque est aussi d'une très belle justesse et d'une grande profondeur, chaque «révélation, continue Agamben, est avant tout une révélation du langage lui-même, l'expérience d'un pur événement de parole qui excède toute signification» (p. 210). C'est ainsi ce qu'écrit Giorgio Agamben lorsqu'il évoque, à plusieurs reprises, la valeur performative de la parole de la foi selon l'apôtre Paul, affirmant que «faire des choses avec des mots n'est donc pas une occupation si innocente que cela, et le droit peut même être considéré comme le résidu dans le langage d'un stade magico-juridique de l'existence humaine, où les mots et les faits, l'expression linguistique et l'efficacité réelle coïncident» (p. 207), ou lorsque, revenant au temps messianique, il désigne ce dernier comme ce qui fait signe «en direction d'une expérience de la parole" qui se présente alors, «sans être liée de manière dénotative aux choses ni valoir elle-même comme une chose, sans rester indéfiniment suspendue dans son ouverture ni se fermer dans le dogme», laquelle se présente «comme une pure et commune puissance de dire, capable d'un usage libre et gratuit à la fois du temps et du monde" (p. 212).
Cette expérience de la parole si particulière, toute chargée d'une urgence messianique, Giorgio Agamben croit la déceler dans tel texte des dernières années de Walter Benjamin, un auteur qu'il n'a à vrai dire jamais cessé de commenter, directement ou en silence, implicitement, par exmple lorsqu'il analyse, là encore de façon stimulante, l'usage du terme bild chez l'auteur de Sur le concept d'histoire, un terme que nous pourrions traduire par celui d'image. Voici ce qu'il écrit alors : «Bild est donc pour Benjamin tout ce en quoi (objet, œuvre d'art, texte, souvenir ou document) un instant du passé et un instant du présent s'unissent en une constellation à l'intérieur de laquelle le présent doit savoir se reconnaître visé par le passé, et inversement le passé doit trouver dans le présent son sens et son accomplissement» (p. 221). Autrement dit poursuit Giorgio Agamben, avec ce que nous pourrions cette fois-ci qualifier de rudesse herméneutique qui caractérise sa volonté de rattacher Walter Benjamin, comme d'autres auteurs, à Paul, lui qui parle de l’Épître de l'un et des thèses de l'autre comme de «deux textes messianiques fondamentaux pour notre tradition, séparés par presque deux mille ans et composés l'un et l'autre dans une situation de crise radicale», autrement dit le principe benjaminien de lecture suppose que «tout texte [contient] un indice historique qui en marque non seulement son appartenance à une époque déterminée, mais [dit] également qu'il ne parviendra à sa pleine lisibilité qu'à un moment précis de l'histoire» (p. 226) comme si, au fond, toute lecture véritable, ainsi que toute remémoration sérieuse, ne pouvait qu'invoquer et convoquer le temps qu'il nous reste ou, plus précisément, ce temps qui est reste et qui, souverainement, appelle et engendre l'urgence messianique comme constellation unissant passé, présent et futur, qu'il nous appartient, toujours, de déchiffrer puis d'exposer. C'est appeler la lecture à une dimension rarissime que, pourtant, nous ne devrions jamais oublier ni même occulter : être un engendrement; plus qu'une lecture croisée, comparative comme on le dit dans les salles des professeurs, faire surgir, en plus d'un aperçu insoupçonné entre deux textes, une parcelle d'éternité qui est comme l'aleph selon Borges, rayonnant et impénétrable, irrécusable pourtant dans sa mystérieuse présence excédant toutes les catégories.
Note
Giorgio Agamben, Le temps qui reste (traduction de l'italien par Judith Revel, Éditions Payot & Rivages, coll. Bibliothèque Rivages, 2000) écrit encore (p. 103) : «L'apôtre parle à partir de la venue du messie» et c'est donc à ce moment-là que «la prophétie doit se taire : elle est désormais réellement achevée (et c'est là tout le sens de sa tension intime vers la clôture)».































































 Imprimer
Imprimer