« Apocalypses biologiques, 2 : The Omega Man de Boris Sagal, par Francis Moury | Page d'accueil | Apocalypses biologiques, 3 : The Crazies de George A. Romero, par Francis Moury »
06/05/2020
Au-delà de l'effondrement, 65 : De visu (The Pesthouse) de Jim Crace

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 L'effondrement de la Zone.
L'effondrement de la Zone.Pour lire ce roman qui ne peut bien évidemment que nous faire songer à La Route de Cormac McCarthy, il faudra commencer par faire fi d'une double monstruosité. Le titre français tout d'abord, qui n'a je crois aucun rapport direct ou même indirect avec l'original, The Pesthouse, autrement dit, littéralement, la maison de la peste, soit la léproserie ou le lazaret, un terme d'ailleurs plusieurs fois utilisé par la traductrice.
Tout au plus pourrions-nous penser qu'il a fallu que les deux personnages principaux de ce roman post-apocalyptique, décrivant assez chichement une Amérique redevenue féodale après un cataclysme qui n'est jamais directement mentionné (même si les premières pages peuvent nous laisser en deviner la nature), constatent donc par eux-mêmes, de visu, la folle vanité de leurs espérances de renouveau. Il faudra aussi parvenir à oublier, ce qui se révèlera encore plus compliqué je le crains, la couverture, d'une laideur réellement post-apocalyptique, preuve s'il en est de l'extrême paresse, dans ce domaine comme dans d'autres (je songe à la médiocrité à peu près générale de la relecture et correction orthographique), de l'édition française (1).
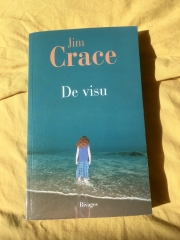 La thématique de la peste, appelée simplement le flux, n'a qu'une importance secondaire, à la différence de ce que nous pouvons constater dans telle nouvelle de Poe ou tel bref texte de Jack London, La Peste écarlate, dans ce roman doucement crépusculaire que l'on dirait avoir été écrit avec une espèce de tranquillité peu pressée de livrer de trop visibles effets. Là où certains auteurs pourraient consacrer plusieurs pages à évoquer la possible déchéance du langage, Jim Crace, lui, se contente d'écrire, et d'écrire bien, tout en mentionnant l'existence d'une possible Thébaïde, au-delà des océans, décrite, selon les optimistes pensant «qu'une fois le fleuve franchi, alors on découvrirait quelque chose de la vieille Amérique, ces régions dont parlaient leurs grands-pères et grands-mères, un pays d'abondance, protégé des prédateurs humains», un endroit décrit «par beaucoup de leurs grands-parents, avec des mots qu'ils tenaient de leurs propres grands-parents» (p. 52).
La thématique de la peste, appelée simplement le flux, n'a qu'une importance secondaire, à la différence de ce que nous pouvons constater dans telle nouvelle de Poe ou tel bref texte de Jack London, La Peste écarlate, dans ce roman doucement crépusculaire que l'on dirait avoir été écrit avec une espèce de tranquillité peu pressée de livrer de trop visibles effets. Là où certains auteurs pourraient consacrer plusieurs pages à évoquer la possible déchéance du langage, Jim Crace, lui, se contente d'écrire, et d'écrire bien, tout en mentionnant l'existence d'une possible Thébaïde, au-delà des océans, décrite, selon les optimistes pensant «qu'une fois le fleuve franchi, alors on découvrirait quelque chose de la vieille Amérique, ces régions dont parlaient leurs grands-pères et grands-mères, un pays d'abondance, protégé des prédateurs humains», un endroit décrit «par beaucoup de leurs grands-parents, avec des mots qu'ils tenaient de leurs propres grands-parents» (p. 52).C'est d'ailleurs cette volonté de ne point trop aller vite, de se presser, de faire le malin qui constitue l'originalité d'une histoire que l'on dirait avoir lue des centaines de fois : un homme et une femme se rencontrent, finissent par s'aimer, sont séparés puis se retrouvent après avoir connu bien des dangers. Je crois aussi que cette volonté de prendre son temps s'accorde bien avec les descriptions, souvent superbes, d'un paysage redevenu vierge, en dépit bien sûr des affreuses cicatrices laissées par l'ancienne civilisation : adapté à l'écran, ce texte mériterait sans doute de longs plans-séquences qui alterneraient avec des épisodes plus brefs, plus violents, ramassant les muscles du héros principal de notre livre autant que l'intérêt des lecteurs. Las, les amateurs de polars futuristes à la Mad Max en seront pour leurs frais, car, après un périple riche en dangers, nos deux héros n'aspireront finalement qu'à rester en Amérique, leur rêve n'étant pas le futur mais le passé : «Une terre, une cabane et une famille. Une mère qui attendait dans la véranda» (p. 251), les réalités finalement les plus simples et solides qui, à la différence de «tant de vieilles choses» abandonnées et en train de se délabrer (p. 264) de l'ancien monde, appelé même une fois Antiquité (cf. p. 263), ne lâcheraient pas prise. Ailleurs, alors qu'ils sont prêts de s'embarquer pour une destination inconnue, en tout cas quitter ce qui a été l'Amérique à une époque lointaine, nos deux héros ne rêvent plus que de revenir là où ils se sont rencontrés, retourner chez eux, même si leur terre est pauvre, et de prendre soin l'un de l'autre (cf. p. 278). Ils refont alors, mais en sens inverse, le chemin qu'ils ont parcouru puisqu'il leur paraît désormais «naturel et inévitable, comme pour un saumon, de remonter le courant», étant donné qu'ils ne se sentent plus «vaincus par l'Amérique, comme la plupart des émigrants qui partaient vers l'est, poussés par leurs échecs» (p. 288).
Les dernières pages du roman nous montre nos aventuriers traversant une contrée qu'ils avaient précédemment quittée mais, cette fois-ci, «c'était comme si le pays, autrefois hostile envers eux, regrettait sa méchanceté et leur offrait maintenant une compensation», autrement dit «moins de dangers, des nuits plus tièdes, une progression plus facile dans une saison qui s'ouvrait au lieu de se fermer» ou même qu'il «ornait le chemin de fleurs précoces» (p. 291), le retour vers l'ouest n'étant en somme que prolongé depuis l'époque désormais révolue où cette direction représentait aussi l'ultime frontière, comme si, nous dit Jim Crace de sa petite musique si convaincante de n'être que chuchotée, Margaret et Franklin «pouvaient imaginer s'adjuger une parcelle de terre abandonnée depuis longtemps et élire domicile dans quelque vieille maison, sur un territoire qui suppliait d'être utilisé» (p. 309) comme il a pu leur semblé que l'ancien langage, lui aussi, suppliait d'être redécouvert.
Que savons-nous de ce monde d'après l'effondrement qualifié, une seule fois, de «Grande Contagion» (p. 107) ? Pas grand-chose à vrai dire, sinon qu'il est dans un pathétique «état d'anarchie et de rancœur» (p. 96), que tout y est «déjà cabossé et tordu» (p. 87) et qu'y bruissent de nombreuses légendes et mêmes prophéties, l'une d'entre elles ayant annoncé que la mère devrait abandonner «sa fille aux cendres, que père et fils se sépareraient dans les flammes, qu'avant que les portes du paradis ne puissent s'ouvrir, il faudrait que s'abatte sur l'Amérique un silence noirci, brûlant et total, qui ne pourrait être éteint que par la mer et auquel ne survivraient que les gens des navires» (p. 93). Une seule fois, les anciens textes sont mentionnés : «Le couvercle portait une inscription, en lettres arrondies, exemple des textes oubliés qui avaient survécu sur tant de reliques de l'ancienne Amérique et qui, on ne sait pourquoi, semblaient toujours supplier qu'on les touche» (pp. 241-2), très belle manière de dire que le sacré demeure encore, à l'état de traces pouvant paraître stupéfiantes (cf. p. 263), dans ce monde redevenu vierge ou peu s'en faut, mais que nul ne songe à le convoquer ou même tenter de lui redonner vie, hormis, peut-être, nous le verrons, certains ordres religieux aux curieuses pratiques. Nous y trouvons je l'ai dit les immenses cadavres métalliques des «grandes villes du passé», «mégapoles» comme on les appelait autrefois, «quand les Américains étaient aussi nombreux et vigoureux que les puces» (p. 121). Nous savons à cet égard que l'Amérique du futur se vide, la terre ne vivant plus que pour elle-même (cf. p. 175) alors que les liens se défont déjà «dans toutes les familles du pays» (p. 179), ou encore que les populations regroupées dans de petits bourgs qui répugnent à utiliser les métaux, les objets étant plutôt fabriqués «avec du bois, du cuir, de l'écorce, des racines, de l'osier, du bambou, de la laine, des calebasses, de l'argile ou de la fourrure» puisqu'il existe tant et tant «de matériaux pratiques à utiliser sans recourir à la corvée longue et sale d'extraire et fondre» (pp. 126-7).
Je ne résiste d'ailleurs pas, à ce propos, de noter que Jim Crace imagine non seulement une répugnance, pour nos lointains descendants, à utiliser les objets métalliques qui n'ont pas totalement disparu, à la différence de ce qui se produit dans La Mort du fer de Serge Simon Held, mais un véritable interdit religieux, comme il le développera dans l'épisode où Margaret trouve refuge auprès de l'Arche tenue par les Baptistes tâtons, comme ils se nomment, et tâtons au point de fouiller méticuleusement toute personne demandant à pénétrer dans leur refuge, puisqu'il est clair que «le métal cause la cupidité et la guerre» (p. 190). Ces Baptistes tâtons obéissent aux Seigneurs impotents, ainsi nommés parce que, considérant que tout travail est l’œuvre du diable, ils refusent de se servir de leurs propres mains : «Le travail du diable», comme ne tarde par à le découvrir Margaret, «incluait non seulement la bagarre et le vol, lesquels nécessitent indiscutablement des mains malhonnêtes, mais aussi l'art, l'artisanat, la cuisine, le travail, et les pratiques anciennes de la technologie, qu'il valait mieux oublier, et dont le métal représentait la preuve angoissante. Les Seigneurs impotents dressaient leur esprit et leur corps contre l'histoire ferreuse du pays. Sans ailes, bras atrophiés, ils gagneraient leur place auprès de Dieu» (p. 198).
Note
(1) Jim Crace, De visu (traduit de l'anglais par Maryse Leynaud, Rivages, 2009).































































 Imprimer
Imprimer