« Les abeilles d'Aristée de Wladimir Weidlé | Page d'accueil | Les Grands Cimetières sous la lune de Georges Bernanos »
03/06/2020
L'Amérique en guerre (15) : L’adieu aux armes d’Ernest Hemingway, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Gillian Pullinger (Alamy).
 L'Amérique en guerre.
L'Amérique en guerre.«Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens
C'est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m'en vais déserter».
Boris Vian, Le déserteur.
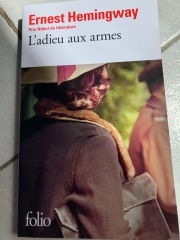 Loin d’être une histoire d’amour miraculeuse qui dompte le monstre de la guerre, L’adieu aux armes (1) se présente plutôt comme une ondoyante possibilité romantique de tourner le dos à la guerre sans vraiment s’en délivrer tout à fait. D’une certaine façon la guerre est une sorte d’absolu du Mal qui ne saurait être perturbé par le contrepoids sensible de l’amour. Ce dernier, dans le roman, n’existe en effet que relativement à la guerre et il ne paraît jamais en mesure d’exister par lui-même (sauf en de rares occasions où la mise à distance du casse-pipe entretient l’illusion du Bien, l’une des ruses du Mal étant de faire croire qu’il est absent alors même qu’il est davantage actif que s’il était visible (2)). Cela étant dit, cette douloureuse contrainte étant posée, le temps vécu hors des tranchées de la Première Guerre mondiale par Frédéric Henry et Catherine Barkley n’en reste pas moins un temps précieusement volé, une digression nécessaire, une prodigieuse extase au milieu de la force gravitationnelle de l’horreur. Contre l’inquiétude d’un conflit qui semblait interminable (cf. pp. 171 et 212) et figurer une «nouvelle guerre de Cent Ans» (p. 115), Ernest Hemingway a voulu opposer la quiétude momentanée d’une histoire d’amour aussi impromptue qu’excessive. En quelques mois seulement, à cheval entre 1917 et 1918, Frédéric et Catherine connaîtront tous les chapitres d’une vie, comme une version accélérée de ce qu’ils auraient pu vivre plus longtemps en amont ou en aval de cette abomination planétaire. Les deux amoureux comprennent intuitivement qu’ils n’ont pas les moyens de s’attarder au chevet de telle ou telle étape de leur histoire, même si, parfois, ils discutent brièvement de leur vie future. L’un ou l’autre des amants, alternativement, possède la certitude inconsciente que cette aventure ne durera pas et qu’il faut la traverser à l’instar d’un fabuleux sarcasme lancé au visage de la guerre. Ils ressemblent à cet égard à deux animaux qui papillonnent pendant que les hommes se livrent de sanglantes batailles, deux créatures, au fond, qui ont l’air de continuer leurs parades provocantes d’indifférence sous les yeux des soldats fatigués. Ce sont presque deux intrus qui se forgent un arrière-monde consolateur en sachant qu’ils ne sont que provisoirement allégés d’une terrifiante réalité qui les attend au tournant. La vision romanesque d’Hemingway est évidemment pessimiste et la fin de L’adieu aux armes a consterné plus d’un lecteur. Mais qu’eût-on pensé d’une littérature du happy end au cœur d’un immense jeu de massacre ? Par conséquent, on aura beau prendre soin de la vie comme on souffle avec méticulosité sur une bulle de savon, celle-ci éclatera toujours tôt ou tard (3).
Loin d’être une histoire d’amour miraculeuse qui dompte le monstre de la guerre, L’adieu aux armes (1) se présente plutôt comme une ondoyante possibilité romantique de tourner le dos à la guerre sans vraiment s’en délivrer tout à fait. D’une certaine façon la guerre est une sorte d’absolu du Mal qui ne saurait être perturbé par le contrepoids sensible de l’amour. Ce dernier, dans le roman, n’existe en effet que relativement à la guerre et il ne paraît jamais en mesure d’exister par lui-même (sauf en de rares occasions où la mise à distance du casse-pipe entretient l’illusion du Bien, l’une des ruses du Mal étant de faire croire qu’il est absent alors même qu’il est davantage actif que s’il était visible (2)). Cela étant dit, cette douloureuse contrainte étant posée, le temps vécu hors des tranchées de la Première Guerre mondiale par Frédéric Henry et Catherine Barkley n’en reste pas moins un temps précieusement volé, une digression nécessaire, une prodigieuse extase au milieu de la force gravitationnelle de l’horreur. Contre l’inquiétude d’un conflit qui semblait interminable (cf. pp. 171 et 212) et figurer une «nouvelle guerre de Cent Ans» (p. 115), Ernest Hemingway a voulu opposer la quiétude momentanée d’une histoire d’amour aussi impromptue qu’excessive. En quelques mois seulement, à cheval entre 1917 et 1918, Frédéric et Catherine connaîtront tous les chapitres d’une vie, comme une version accélérée de ce qu’ils auraient pu vivre plus longtemps en amont ou en aval de cette abomination planétaire. Les deux amoureux comprennent intuitivement qu’ils n’ont pas les moyens de s’attarder au chevet de telle ou telle étape de leur histoire, même si, parfois, ils discutent brièvement de leur vie future. L’un ou l’autre des amants, alternativement, possède la certitude inconsciente que cette aventure ne durera pas et qu’il faut la traverser à l’instar d’un fabuleux sarcasme lancé au visage de la guerre. Ils ressemblent à cet égard à deux animaux qui papillonnent pendant que les hommes se livrent de sanglantes batailles, deux créatures, au fond, qui ont l’air de continuer leurs parades provocantes d’indifférence sous les yeux des soldats fatigués. Ce sont presque deux intrus qui se forgent un arrière-monde consolateur en sachant qu’ils ne sont que provisoirement allégés d’une terrifiante réalité qui les attend au tournant. La vision romanesque d’Hemingway est évidemment pessimiste et la fin de L’adieu aux armes a consterné plus d’un lecteur. Mais qu’eût-on pensé d’une littérature du happy end au cœur d’un immense jeu de massacre ? Par conséquent, on aura beau prendre soin de la vie comme on souffle avec méticulosité sur une bulle de savon, celle-ci éclatera toujours tôt ou tard (3). On ne saura pas exactement ce qui a conduit Frédéric, un jeune Américain, à s’engager sur le front italien parmi les ambulanciers, sinon de vagues dissensions avec sa famille aux États-Unis et peut-être l’envie de voir du pays. Cela concorde avec le minimalisme psychologique d’Hemingway qui ne s’embarrasse d’aucun délayage introspectif, à l’exception d’une scène poignante où Frédéric se demande si Catherine va survivre à son accouchement (cf. p. 304). Et ce laconisme des états d’âme se répercute sur les descriptions contextuelles où le narrateur, Frédéric himself, relate les événements avec l’objectivité du témoin (4). Il n’a pas cette position de littérateur hors-sol qui consisterait à caviarder la guerre en lui soutirant des réflexions métaphysiques ou des fioritures insupportablement bourgeoises. Il ne tombe pas dans le piège de la tentation stylistique tel que le dénonce W. G. Sebald lorsqu’il étrille l’écrivain Peter de Mendelssohn pour ses ridicules restitutions des bombardements qui ont ravagé les villes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale (5). D’une guerre à l’autre, d’une catastrophe humaine à l’autre, le substrat de la violence ne change pas et exige d’être rapporté sans le moindre encombrement théorique. D’où la simplicité de la scène d’ouverture à travers laquelle se contredisent la nature et la culture, c’est-à-dire la noblesse de la montagne et l’ignoble agitation des combats (cf. pp. 7-8). Une fois les échauffourées passagèrement terminées entre les soldats italiens et leurs ennemis autrichiens, le remarquable vert de la forêt s’est dissipé, maintenant réduit à «des moignons, des troncs brisés [et] un sol défoncé» (p. 10), comme si l’on avait semé la terreur dans un sous-bois de Constant Dutilleux. Ce contraste entre la beauté naturelle et la laideur des hommes en guerre suffit à justifier la décision ultérieure que prendra Frédéric (cf. pp. 217-224) : l’abandon de la guerre n’est pas seulement une question de passion amoureuse qu’il faudrait vivre de toute urgence afin de conjurer l’abjection, mais il concerne également un rejet autonome, une répulsion qui n’a cessé de grandir envers les pratiques de l’inhumanité propres à la guerre et qui ont fini par atteindre un seuil intolérable.
De retour d’une mission, tandis que le dégoût du champ de bataille n’est encore que balbutiant, Frédéric apprend de l’aide-major Rinaldi, un chirurgien exubérant, que de «nouvelles femmes» (p. 15) viennent d’être envoyées à Gorizia tant pour divertir les combattants que pour les assister dans l’effort de guerre. Le festoso dottore se dit amoureux de l’infirmière Catherine Barkley, qu’il cèdera néanmoins volontiers à Frédéric en s’apercevant qu’elle le préfère à lui et que des relations sans lendemain conviennent mieux à son exubérance (cf. p. 43). La description de Catherine par Frédéric est par ailleurs aussi lapidaire que suggestive : «Miss Barkley était assez grande. Elle portait ce qui pour moi était un uniforme d’infirmière. Elle était blonde. Elle avait la peau ambrée et des yeux gris. Je la trouvais très belle.» (p. 21). Catherine avoue à Frédéric qu’elle a été fiancée pendant huit ans avec un homme qui est mort à la bataille de la Somme. Elle est désarçonnée par ce récent souvenir parce qu’elle pensait que la guerre «serait [mauvaise]» (p. 22) pour son bien-aimé, mais elle n’a pas su argumenter pour le convaincre de fuir cette folie, comme Andromaque s’est retrouvée impuissante à retenir Hector sur les remparts de Troie. Les mots de conclusion de Catherine sont ceux d’une femme aussi profondément blessée que la pudeur de ses aveux est éloquente : «Et puis voilà… il a été tué… et tout fut fini.» (p. 22). Sa réserve est compréhensible et on devine qu’il ne faudrait pas grand-chose pour qu’elle s’embarque dans un réquisitoire antimilitariste. À vrai dire, Catherine incarne la beauté humaine qui sert de réplique cinglante à la hideur et à l’absurdité de la guerre. Elle est quasiment allégorique par son aura de tendresse et sa féminité courageuse, et, en cela, elle évoque la Complainte de la paix d’Érasme qui révèle la grimace de la guerre sur le visage du monde, la façon dont l’infamie de la guerre fait naître un «fléau» parmi les États, forçant les lois à devenir «muettes au milieu des armes» (6). Il ne fait aucun doute que Frédéric adhère au pacifisme latent de Catherine. Cela se voit distinctement lorsqu’il mentionne «le ridicule de porter un revolver» (p. 32) ou lorsqu’il éprouve une haine du conflit (cf. p. 73). Cette polarité d’opinions précipite probablement le mouvement affectif qui va les unir, au-delà de l’évidente parenté des langues qui ne pouvait pas éclore avec Rinaldi (car elle est anglaise et Frédéric est américain). Très entreprenant, convaincu peut-être du répondant de Catherine, l’audacieux Frédéric l’enlace, puis l’embrasse, puis se fait gifler avant qu’elle ne l’embrasse à son tour (cf. pp. 29-30). Le plus important, néanmoins, c’est que cette séquence furtive contribue à repousser les assauts de la guerre. Les manifestations de ce badinage sont autant d’atouts pour oublier ce qui se passe à quelques encablures de Gorizia, dans l’enfer des montagnes et des expectatives angoissées.
L’amour s’affirme plus précisément dès l’instant où Frédéric prononce un «Je vous aime» (p. 33). Bien qu’il se défende d’aimer Catherine en vérité, fidèle à un certain esprit viril, la déclaration se confirmera sans équivoque (cf. pp. 91-2). La réciprocité qui se dessine avec Catherine vaut mieux qu’une relation de maison close (cf. p. 33). Frédéric a même hâte que la guerre s’achève afin de consolider son amour (cf. p. 40). Il a en effet la nette impression que la guerre déshonore l’humanité, qu’elle empêche la douceur de vivre (la dolce vita selon Fellini), même s’il se persuade d’une manière un peu bravache qu’elle n’est «pas plus dangereuse qu’une guerre de cinéma» (p. 40). Ces considérations succèdent à une remise en cause du roi «Vittorio Emanuele», jugé comme un «petit homme à long cou et à barbe de bouc», inapte à revêtir le costume d’un chef de guerre tel que pouvait l’être Napoléon (p. 39). Un mécanicien qui se nomme Passini affirme en outre que les dirigeants de l’Italie sont idiots et font la guerre sans se rendre compte des conséquences humaines (cf. pp. 52-3). Passini est désabusé par cette situation qui s’enlise, par ce «terrible» carnage senza fine, aussi rêve-t-il d’un cessez-le-feu qui serait perpétré par la soudaine désaffection de tous les soldats, quel que soit leur pays de ralliement. Et sitôt ces paroles utopiques balancées dans les oreilles tout aussi lasses de ses camarades, le destin s’empare de cette âme écœurée, un obus lui broyant les jambes et l’affublant d’un moignon tremblant qui rappelle les moignons sylvicoles tantôt consignés (cf. pp. 57-8). Peu après Frédéric se fait également surprendre par un obus (cf. pp. 59-64), par une explosion que le peintre Christopher R. W. Nevinson a pu immortaliser avec la crudité du vécu, mais il ne sera pas mortellement blessé. Il est touché aux pieds, aux jambes et plus légèrement à la tête. Dans l’ambulance qui le ramène en lieu sûr, les brancards tanguent en raison de la route démolie et il est éclaboussé par le sang d’un mourant qui subit une hémorragie. Cet épisode traumatisant assombrit ses pensées. Il estime que l’amour n’est pas une chose pour lui (cf. pp. 74-5). Heureusement du reste que Rinaldi vient égayer sa convalescence en lui attribuant la valeur d’un «Garibaldi américain» (p. 79). À la suite de quoi Frédéric quitte les quartiers de Gorizia pour être transféré à l’arrière, à l’hôpital américain de Milan où Catherine Barkley, joli hasard de la littérature ou manœuvre diégétique acceptable, est convoquée en renfort (cf. p. 80).
Le segment milanais réoriente doublement le sentiment amoureux : d’une part Frédéric acquiert l’assurance d’aimer et d’autre part la relation avec Catherine s’accélère instinctivement. Ils parlent des enfants qu’ils auront et du mariage qui sanctifiera leur union (cf. pp. 101-105). Cette chronologie pressée et stéréotypée a pour but d’exorciser les puissances de désunion de la guerre. Frédéric et Catherine désirent profiter de la moindre occasion parce que la mort est susceptible de frapper à tout moment. Dans cette chambre d’hôpital où le corps de Frédéric reprend consistance, «les nuits étaient merveilleuses et il [leur] suffisait de pouvoir [se] toucher pour être heureux» (p. 111). Le malheur de la guerre convertit la plus infime opportunité d’euphorie en quelque chose d’incommensurablement unique. Frédéric le raconte avec la simplicité des amants qui ont érigé un nid d’aigle parmi les décombres du monde : «Outre les moments de grande jouissance, nous avions mille petits moyens de nous aimer; et quand nous n’étions pas ensemble, nous tâchions de nous transmettre nos pensées l’un à l’autre. Parfois cela avait l’air de réussir, mais probablement parce que nous pensions tous les deux à la même chose en même temps.» (p. 111). Pourtant la guerre ne desserre pas son étreinte en dépit de ces embrasements du cœur. L’entrée en guerre de l’Amérique marque une amplification des hostilités (cf. p. 114). L’horreur se généralise tellement que toutes les nations belligérantes semblent partager une défaite commune (cf. pp. 129-130). Et bientôt le vacarme de la guerre se rapproche à nouveau pour Frédéric et sa dulcinée, tant et si bien que la grossesse avérée de Catherine sera vite mitigée (cf. pp. 133-4). L’heure de retourner au front interrompt brutalement le cycle amoureux d’une existence qui vivait jusqu’alors comme sur une scène romantique de la Scala (cf. pp. 141-151). Ils essaient de prolonger le temps de toutes les manières possibles, à l’instar des condamnés à mort qui voudraient s'éterniser dans la dernière seconde, juste avant que le couperet ne tombe et ne les fasse passer de vie à trépas. C’est pourquoi Frédéric et Catherine louent une chambre d’hôtel à deux pas de la gare, et même si le train pour Gorizia est prévu à minuit, ils souhaitent déjouer cette fatalité en s’offrant quelques heures d’accalmie.
Revenu nell’occhio del ciclone, Frédéric assiste à la pesante mélancolie de Rinaldi. D’habitude envahissant et riant, l’aide-major tout droit sorti d’une commedia dell’arte paraît brusquement expédié dans une mauvaise farce où le rire s’est absenté pour laisser monter un flot désolant de désespoir. Déprimé par les événements, Rinaldi dénonce une guerre qui «ne vaut rien» (p. 162). Frédéric, quant à lui, préférerait perdre la guerre car la gagner signifierait seulement que les Italiens sont descendus plus bas dans les maudits anneaux d’un enfer dantesque (cf. p. 173). L’automne qui plus est n’arrange rien à sa méditation brumeuse. La pluie, les blessés et la faillite des stratégies (cf. p. 181) aggravent encore l’impression d’un inadmissible gâchis humain. Frédéric ne croit plus aux rhétoriques martiales qui conjuguent aisément la violence avec l’idée d’une purification divine : «Je n’avais rien vu de sacré, et ce qu’on appelait glorieux n’avait pas de gloire, et les sacrifices ressemblaient aux abattoirs de Chicago avec cette différence que la viande ne servait qu’à être enterrée. Il y avait beaucoup de mots qu’on ne pouvait plus tolérer […]» (pp. 177-8). Ces critiques pleinement fondées se vérifient lors d’un déplacement des troupes en direction d’Udine (cf. pp. 186-200). L’épreuve de la boue et des averses gelées, associée à la perpétuelle menace des Autrichiens, détruit les individus et les rapproche symboliquement des traits bouleversants de L’homme poignardé de Félix Vallotton, silhouette nue et émaciée transpercée par l’acier impitoyable de l’Histoire belliqueuse.
En filigrane, d’une façon croissante, l’adieu aux armes qui intitule le roman se définit avec davantage de clarté. Le refus progressif de participer à cette boucherie fait aussi écho au refus de se porter garant d’une technique au service de la guerre. De ce point de vue, la désertion de Frédéric, motivée par l’immonde comportement de la police des armées (cf. pp. 217-8), se complète par la répudiation d’une époque où l’on met des outils de mort de plus en plus perfectionnés dans des mains de moins en moins soucieuses du prochain. Ainsi Frédéric est ici comparable à une émouvante doublure de «l’Ange de l’Histoire» imaginé par Walter Benjamin (7), cet ange aux yeux exorbités par un avenir sombre et redoutable, emporté par une tempête «que nous appelons le progrès» (8). Ce que distingue alors Frédéric à travers l’action de la police des armées, c’est le prélude d’une régression morale inédite, la mort infligée à une vitesse vertigineuse par des justiciers envoûtés, des pseudo-redresseurs de torts possédés par la réalité d’un nouvel armement qui procure des fantasmes de surhomme. Qui sont-ils exactement ? Ce sont des pelotons chargés de liquider les réfractaires ou les semi-désobéissants, ce sont des «juges [qui] avaient ce beau détachement, cette dévotion à la stricte justice des hommes qui dispensent la mort sans y être eux-mêmes exposés» (p. 217). Devant cet affligeant spectacle d’une humanité effondrée, Frédéric se démobilise au propre comme au figuré, à l’intérieur comme à l’extérieur, étranger aux acteurs de cette sinistre «comédie» (p. 224). Il fuit et prend un train en marche (cf. pp. 221-2), tel un trimardeur qui serait sorti d’un livre de Jack London, songeant à Catherine pour compenser un crépuscule par une aurore (cf. pp. 223-4).
À Milan derechef, on informe Frédéric que Catherine est partie pour Stresa (cf. pp. 230). En attendant de la rejoindre, il doit être prudent car il est dorénavant déterminé par sa périlleuse condition de déserteur. Vêtu des habits d’un civil, Frédéric se sent «déguisé» (p. 233), nourrissant une espèce de culpabilité vaporeuse. Il veut sincèrement oublier la guerre mais celle-ci, cruellement, le hante comme une Némésis. De sorte que la guerre doit être fuie avec d’autres expédients encore plus concluants. C’est la raison pour laquelle Catherine et lui, une fois qu’ils se retrouvent à Stresa (cf. p. 236), ébauchent un brouillon d’esquive. Il est impératif d’insister dans l’amour avec davantage de volonté que la guerre n’en met à insister dans l’ignominie. Ce dont ils ont besoin, c’est d’une patrie libérée, d’un endroit où personne n’a jamais entendu les mélopées de l’artillerie. Au bord du lac Majeur, ils goûtent un prologue de libération en se prélassant dans la douceur des draps (cf. pp. 239-240). Il s’agit d’un écrin d’amour qui résonne avec la chambre d’hôpital de Milan, lorsque Frédéric et Catherine s’apprivoisaient dans la précipitation des amants en danger, certes heureux de se découvrir avec volupté mais lucides quant à l’incertitude des lendemains. Encore une fois, donc, la chambre de Stresa s’avère aussi intermittente que la chambre de Milan. La menace concrète d’une arrestation jette dans les veines de Frédéric et Catherine l’adrénaline de la fugue. En pleine nuit, sur une barque prêtée par un barman solidaire, ils prennent le large et remontent le lac Majeur vers la Suisse, poussés par un vent favorable (cf. pp. 253-266). Le sentiment de la liberté et de l’aventure les galvanise à tel point que même la pluie devient «gaie» (p. 267), comme si le mois de novembre se transfigurait en un printemps mythique. Et au fur et à mesure qu’ils rament sur cette eau lacustre, dans ce cœur des ténèbres qui n’a pas les attributs préoccupants des eaux fluviales de Joseph Conrad, ils approfondissent leur joie, ils défient l’éphémère et ils accostent en Suisse avec l’excitation d’un équipage qui viendrait de fouler du pied un autre Nouveau Monde. De Locarno à Montreux (cf. p. 270), on serait presque tenté de dire que la guerre est vaincue.
Pourtant, malgré les agréments d’une vie contemplative, malgré la confession d’une «vie délicieuse» (p. 290), la guerre subsiste et elle s’invite obliquement dans les journaux où Frédéric consulte «le récit des désastres» (p. 278). Une existence tranquillement monochrome est inenvisageable lorsque la guerre tout autour de la Suisse continue sa dévastation. On pressent d’ailleurs que la contamination mentale due à la guerre accède à un niveau supérieur de nuisance même quand elle est soi-disant reléguée par-delà les frontières politiques. Malgré qu’ils en aient, Frédéric et Catherine ont ramené avec eux un germe malfaisant, un relent des combats qui faisaient rage près de Gorizia. Aussi l’approche de la naissance de leur enfant est recouverte d’une ombre inquiétante. Les pages finales du roman (cf. pp. 292-316), à l’hôpital de Lausanne, décrivent une parturition inversée en ce sens que Catherine, censée donner la vie, paraît lutter plutôt contre le mode de donation inexorable de la mort. En une journée, Frédéric essuie la perte de l’enfant qui n’a pas survécu dans le ventre de sa mère, puis la perte de Catherine qui succombe à une hémorragie. L’absence de gémissements psychologiques ou de pathétique du deuil a souvent pu interloquer les lecteurs, mais il y a une dignité particulière dans l’attitude résignée de Frédéric (cf. p. 316). C’est un genre de renoncement qui conflue avec sa désertion. Son adieu aux armes embrasse de ce fait une manière de déposer noblement les armes de la vie définie en tant que vouloir-vivre dévorateur. Ce n’est pas tant que Frédéric veuille promouvoir une sorte de suicide qui l’affranchirait d’un monde injuste et foudroyant. À l’inverse, nous interprétons sa conduite comme un radical anéantissement de l’égoïsme, ce qui, dans une optique schopenhauerienne (9), signifie que Frédéric se débarrasse du principe d’individuation afin de se fondre dans tous les autres vivants (qui ne sont pas non plus épargnés par les souffrances de la guerre). La pudeur de sa réaction, voire son défaut de réaction, le hisse à un degré de sainteté absolument admirable. Notre hypothèse s’appuie du reste sur les discussions que Frédéric a pu avoir avec l’aumônier à tel ou tel moment de sa carrière tourmentée dans les ambulances. Alors que beaucoup s’amusaient à tourner la foi de l’aumônier en ridicule, Frédéric, lui, prenait du plaisir à échanger avec cet homme d’Église. S’agissait-il donc de prolégomènes à la sainteté ? En tous les cas, l’économie émotionnelle de la dernière phrase – «Et je rentrai à l’hôtel, sous la pluie.» – pose les jalons d’une intériorité colossale qui inspire le plus grand respect. On ne peut ainsi éviter de rappeler la retenue de Catherine lorsqu’elle évoquait son fiancé mort dans la Somme.
Notes
(1) Ernest Hemingway, L’adieu aux armes (1929). Nous utilisons l’édition Gallimard en collection Folio (2017) dans la traduction de Maurice-Edgar Coindreau.
(2) Theodor Adorno a parfaitement saisi la sournoise omniprésence du Malin en suggérant qu’un arbre en fleur n’est que duperie si on «le regarde en oubliant l’ombre du Mal» (cf. Minima moralia, réflexions sur la vie mutilée).
(3) Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation (livre IV, paragraphe 57).
(4) On sait en outre que L’adieu aux armes est inspiré par l’expérience d’Ernest Hemingway dans l’univers militaire des ambulances italiennes au cours de la Grande Guerre.
(5) W. G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle.
(6) Érasme, Complainte de la paix.
(7) Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire.
(8) Walter Benjamin, ibid.
(9) La lecture de tout le livre IV du Monde comme volonté et comme représentation est vivement conseillée pour remettre en perspective l’attitude de Frédéric.






























































 Imprimer
Imprimer