« Essais sur la rhétorique, le langage, le style de Thomas De Quincey | Page d'accueil | L'Amérique en guerre (15) : L’adieu aux armes d’Ernest Hemingway, par Gregory Mion »
28/05/2020
Les abeilles d'Aristée de Wladimir Weidlé

Photographie (détail) de Juan Asensio.
Nous ne gloserons pas sur le fait que Les abeilles d'Aristée, un très bel ouvrage dont l'ambition est donnée par le sous-titre, Essai sur le destin actuel des lettres et des arts, n'ait jamais été réédité par Gallimard, qui le publia en 1954, alors même que ce texte, repéré par Gabriel Marcel, parut pour la toute première fois en 1936 dans la collection dont le philosophe s'occupait alors chez Desclée de Brouwer; Gallimard laissa ce livre, comme tant d'autres, sombrer dans l'oubli, avant qu'il ne soit de nouveau édité par Ad Solem en 2002, ce dont nous ne pouvons que remercier cet éditeur qui, ces dernières années toutefois, semble accuser le coup, revenir à l'étiage morne des productions de niche, et n'éditer en conséquence que des textes convenus, de la poésie lacrymalo-sacristaine bien souvent, rien de plus que des volumes pour devanture de Procure et agenouillements à tropisme lyrique.
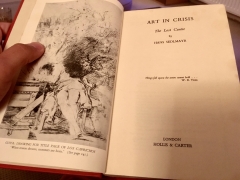 Nous pouvons rapprocher l'essai de Wladimir Weidlé de celui de Hans Sedlmayr, totalement inconnu en France, sans doute parce qu'il n'a toujours pas été traduit en français, mais disponible en anglais sous le titre Art in Crisis et le sous-titre significatif The Lost Centre qui renvoie à William Butler Yeats bien sûr mais aussi à Zissimos Lorentzatos et son Centre perdu, un texte fulgurant devenu lui aussi pratiquement introuvable, puisque notre pays, nous le savons, s'il aura toujours les moyens de s'offrir les tulipes géantes de l'imposteur milliardaire Jeff Koons et les planter hideusement en plein Paris sous les applaudissements des édiles, n'aura aucun éditeur pour publier les plus radicales critiques de l'art contemporain, cela, car c'est bien d'un cela qu'il s'agit, que Jean-Philippe Domecq appelle justement l'art du contemporain. En remontant moins loin et comme Bernard Marchadier le mentionne dans sa préface, ce sont des titres comme Babel de Roger Caillois, les Fleurs de Tarbes de Jean Paulhan ou, à l'évidence, George Steiner, celui de Réelles présences plutôt que celui de Langage et silence qui peuvent présenter un certain nombre de ressemblances avec l'ouvrage du Russe qu'André Malraux fit en son temps Chevalier des arts et lettres. N'oublions pas, enfin, de signaler l'existence d'autres abeilles qui furent en leur temps de véritables ouvrières du savoir, celles de Pierre Boutang, qui alla les chercher à Delphes.
Nous pouvons rapprocher l'essai de Wladimir Weidlé de celui de Hans Sedlmayr, totalement inconnu en France, sans doute parce qu'il n'a toujours pas été traduit en français, mais disponible en anglais sous le titre Art in Crisis et le sous-titre significatif The Lost Centre qui renvoie à William Butler Yeats bien sûr mais aussi à Zissimos Lorentzatos et son Centre perdu, un texte fulgurant devenu lui aussi pratiquement introuvable, puisque notre pays, nous le savons, s'il aura toujours les moyens de s'offrir les tulipes géantes de l'imposteur milliardaire Jeff Koons et les planter hideusement en plein Paris sous les applaudissements des édiles, n'aura aucun éditeur pour publier les plus radicales critiques de l'art contemporain, cela, car c'est bien d'un cela qu'il s'agit, que Jean-Philippe Domecq appelle justement l'art du contemporain. En remontant moins loin et comme Bernard Marchadier le mentionne dans sa préface, ce sont des titres comme Babel de Roger Caillois, les Fleurs de Tarbes de Jean Paulhan ou, à l'évidence, George Steiner, celui de Réelles présences plutôt que celui de Langage et silence qui peuvent présenter un certain nombre de ressemblances avec l'ouvrage du Russe qu'André Malraux fit en son temps Chevalier des arts et lettres. N'oublions pas, enfin, de signaler l'existence d'autres abeilles qui furent en leur temps de véritables ouvrières du savoir, celles de Pierre Boutang, qui alla les chercher à Delphes.Le titre lui-même de l'ouvrage de Weidlé, qui renvoie à telle fable rapportée dans les Géorgiques, indique suffisamment dans quelle perspective se place l'auteur qui, aussi pessimiste qu'on le voudra sur les productions de l'art de son époque, n'en fera pas moins le pari qu'une renaissance est possible, ou plutôt : une résurrection, comme un essaim d'abeilles naîtra des carcasses pourries d'un des taureaux sacrifiés par Aristée afin de tenter de se faire pardonner la mort d'Eurydice.
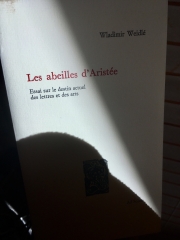 Dans la première partie de l'ouvrage, intitulée Le crépuscule des mondes imaginaires, Wladimir Weidlé évoque longuement un appauvrissement de la langue, lequel est pour le moins paradoxal puisqu'il tient à une excroissance érudite de ses jeux combinatoires pouvant aller jusqu'à l'hermétisme, la tour d'ivoire dans laquelle finira par se réfugier celui qui s'estime ne pas devoir s'abaisser à utiliser les mots de la tribu qui, comme nous le savons, sont désormais totalement démonétisés. C'est ainsi que Joyce et Mallarmé sont tous deux convoqués à la barre, l'auteur leur reprochant l'invention d'une langue privée de ses forces réelles, aussi somptueuse qu'on le voudra mais devenue totalement artificielle, comme la danse lascive de Salomé n'est plus que le souvenir d'une réelle puissance corporelle. De Joyce, Weidlé écrira ainsi : «Sa langue, pour lui, comme pour tant d’autres de nos contemporains, n’est plus le corps inévitable et naturel de sa pensée. Elle est son instrument, la somme de ses ressources; elle lui appartient, il en fait ce qu’il veut, il la possède; mais ce que l’on a n’est jamais ce que l’on est, en art comme ailleurs, et, ne serait-ce qu’à notre insu, nous avons toujours demandé à l’artiste non pas seulement d’avoir, mais d’être» (p. 111), l'accusation étant encore plus catégorique pour Mallarmé qui, à force de n'être plus, s'est transformé en fantôme tout proche de l'aphasie terminale : «La seule présence parmi nous, au cours des années formatrices du siècle, de ce génie aussi vaste, bien que moins élevé et moins profond que les génies d’autrefois, construisant avec une application infinie son énorme et vain gratte-ciel babylonien, est révélatrice, plus qu’aucune autre, de nos erreurs et du destin que nous avons fait à toute spontanéité créatrice. […] Cette Somme démesurée des plus alléchantes contorsions verbales, cet Art poétique en dix mille leçons n’est pas une incarnation vivante de l’art; il est l’autopsie de son cadavre» (pp. 124-5). Il n'y a d'art qu'incarné, répète Wladimir Weidlé (1) et ces coruscantes cathédrales verbales, si elles se dressent fièrement, ne plongent pas très profond leurs fondations et les pas qui parfois y résonnent n'éveillent qu'un écho glacial, propre à toute solitude inamovible : «Quant à la pure langue littéraire, consciente de sa différence, jalouse de son prestige, elle se sépare de plus en plus de l’usage commun, s’enferme en soi, et le dessèchement intérieur ne la menace pas moins que la marée haute du langage populaire urbanisé, mécanisé, ayant perdu sa couleur originelle» (p. 100). J'ai naturellement employé la métaphore de la cathédrale, que Wladimir Weidlé utilise tout aussi naturellement lorsqu'il écrit : «On purifie l’art et la poésie comme on fait pour l’alcool, en opérant par analyse et abstraction, en substituant aux «nourritures terrestres» un assortiment de pilules nutritives. Le laboratoire travaille à plein rendement. Le temple désaffecté est en ruine», poursuit Weidlé puisque, à sa place «il n’y aura rien et l’herbe poussera sur les pierres, si l’artiste, trop longtemps séparé de la vraie foi, n’y construit pas avec l’aide de celle-ci une cathédrale indestructible, si l’art condamné à errer dans des pays sans chemin ne se souvient pas de sa patrie abandonnée, n’y cherche et n’y trouve pas, une fois de plus, sa justification suprême» (pp. 126-7). Nous savons désormais ce qu'entend Wladimir Weidlé par incarnation, et qu'il emploie ce terme dans son sens le plus fort, christique, et nous comprenons que l'honneur de l'artiste, dès lors, est à ses yeux bien autre chose qu'une carrière subventionnée : un véritable sacrifice, et qu'importe même que Dieu ait déserté cœurs et consciences et que le magistère du poète ou du peintre s'exerce dans des temples presque totalement désertés, s'il s'agit de faire advenir, avec chaque nouvelle création, le mystère de la réelle présence !
Dans la première partie de l'ouvrage, intitulée Le crépuscule des mondes imaginaires, Wladimir Weidlé évoque longuement un appauvrissement de la langue, lequel est pour le moins paradoxal puisqu'il tient à une excroissance érudite de ses jeux combinatoires pouvant aller jusqu'à l'hermétisme, la tour d'ivoire dans laquelle finira par se réfugier celui qui s'estime ne pas devoir s'abaisser à utiliser les mots de la tribu qui, comme nous le savons, sont désormais totalement démonétisés. C'est ainsi que Joyce et Mallarmé sont tous deux convoqués à la barre, l'auteur leur reprochant l'invention d'une langue privée de ses forces réelles, aussi somptueuse qu'on le voudra mais devenue totalement artificielle, comme la danse lascive de Salomé n'est plus que le souvenir d'une réelle puissance corporelle. De Joyce, Weidlé écrira ainsi : «Sa langue, pour lui, comme pour tant d’autres de nos contemporains, n’est plus le corps inévitable et naturel de sa pensée. Elle est son instrument, la somme de ses ressources; elle lui appartient, il en fait ce qu’il veut, il la possède; mais ce que l’on a n’est jamais ce que l’on est, en art comme ailleurs, et, ne serait-ce qu’à notre insu, nous avons toujours demandé à l’artiste non pas seulement d’avoir, mais d’être» (p. 111), l'accusation étant encore plus catégorique pour Mallarmé qui, à force de n'être plus, s'est transformé en fantôme tout proche de l'aphasie terminale : «La seule présence parmi nous, au cours des années formatrices du siècle, de ce génie aussi vaste, bien que moins élevé et moins profond que les génies d’autrefois, construisant avec une application infinie son énorme et vain gratte-ciel babylonien, est révélatrice, plus qu’aucune autre, de nos erreurs et du destin que nous avons fait à toute spontanéité créatrice. […] Cette Somme démesurée des plus alléchantes contorsions verbales, cet Art poétique en dix mille leçons n’est pas une incarnation vivante de l’art; il est l’autopsie de son cadavre» (pp. 124-5). Il n'y a d'art qu'incarné, répète Wladimir Weidlé (1) et ces coruscantes cathédrales verbales, si elles se dressent fièrement, ne plongent pas très profond leurs fondations et les pas qui parfois y résonnent n'éveillent qu'un écho glacial, propre à toute solitude inamovible : «Quant à la pure langue littéraire, consciente de sa différence, jalouse de son prestige, elle se sépare de plus en plus de l’usage commun, s’enferme en soi, et le dessèchement intérieur ne la menace pas moins que la marée haute du langage populaire urbanisé, mécanisé, ayant perdu sa couleur originelle» (p. 100). J'ai naturellement employé la métaphore de la cathédrale, que Wladimir Weidlé utilise tout aussi naturellement lorsqu'il écrit : «On purifie l’art et la poésie comme on fait pour l’alcool, en opérant par analyse et abstraction, en substituant aux «nourritures terrestres» un assortiment de pilules nutritives. Le laboratoire travaille à plein rendement. Le temple désaffecté est en ruine», poursuit Weidlé puisque, à sa place «il n’y aura rien et l’herbe poussera sur les pierres, si l’artiste, trop longtemps séparé de la vraie foi, n’y construit pas avec l’aide de celle-ci une cathédrale indestructible, si l’art condamné à errer dans des pays sans chemin ne se souvient pas de sa patrie abandonnée, n’y cherche et n’y trouve pas, une fois de plus, sa justification suprême» (pp. 126-7). Nous savons désormais ce qu'entend Wladimir Weidlé par incarnation, et qu'il emploie ce terme dans son sens le plus fort, christique, et nous comprenons que l'honneur de l'artiste, dès lors, est à ses yeux bien autre chose qu'une carrière subventionnée : un véritable sacrifice, et qu'importe même que Dieu ait déserté cœurs et consciences et que le magistère du poète ou du peintre s'exerce dans des temples presque totalement désertés, s'il s'agit de faire advenir, avec chaque nouvelle création, le mystère de la réelle présence ! Nous retrouvons ici David Jones affirmant que l'art est signe et sacrement. Voici ce qu'il écrit dans sa préface aux Anathemata : «Plutôt qu’un voyant ou un prophète, l’artiste est une sorte de vicaire, ses fonctions sont d’un légat, c’est une espèce de Servus Servorum chargé de transmettre ce qui lui a été transmis, qui ne peut rien ajouter ni retrancher aux dépôts confiés. Ce n’est pas ce que nous entendons par «originalité». Il n’y a qu’un seul récit à raconter même si la narration se prête à une ingéniosité et à un développement infinis et peut se présenter sous un million de variantes» (Art, signe et sacrement, traduction, présentation et annotation de Bernard Marchadier, Ad Solem, 2002, p. 169). Wladimir Weidlé, lui, écrit : «L’artiste, même incroyant, même entièrement oublieux de tous les enseignements de la foi, célèbre dans son art un mystère, un sacrement, dont l’ultime raison d’être est religieuse. Si le miracle cesse de se produire, si l’art dont il est le pain quotidien périt d’inanition, ce n’est pas parce que le sacrificateur a péché, c’est parce qu’il refuse d’accomplir le sacrement» (p. 412). Et, si l'art est sacrement, l'artiste est celui qui le délivre aux masses réduites à du bétail que l'on contente, modérément, avant de finir par l'abattre, pour que la place qui lui était chichement accordée puisse être occupée par un nouveau spécimen tout aussi peu conscient de son destin si peu enviable : «Être poète aujourd’hui, c’est faire une profession de foi, dans un monde incroyant, mais c’est aussi conquérir, et mériter, une couronne de martyr, laquelle, quoi qu’on fasse, restera une couronne usurpée. Dieu s’est caché : le monde n’est plus. Dans les ténèbres, le poète seul, créateur sans majuscule, est responsable pour chaque parole, pour chaque battement de cœur» (p. 159). Les petits ricaneurs lèveront les yeux au ciel (vide), pointeront d'un doigt tremblant le passéisme réactionnaire d'une telle conception de l'art, ne sachant même pas que l'auteur aura par avance moqué leur consternation («Ce dont on a le plus soif, au fond, ce n’est pas l’art du passé, ce sont les conditions dans lesquelles cet art a pu fleurir ; ce n’est pas telle image, c’est le libre exercice de l’Imagination qui les engendre toutes», p. 313), et retourneront arroser de leur pisse les tulipes géantes de l'imposteur milliardaire Jeff Koons, en se disant, quand même, que l'art, naguère, avait une allure bien différente, et que dire de sa portée ! : «L’homme dépossédé de l’art est tout aussi inhumain que l’art privé de l’homme. Car la mesure de l’homme, de sa grandeur comme de sa misère, c’est l’art» (p. 48).
Dans la deuxième partie intitulée Minuit de l’art, évoque plusieurs peintres dont Cézanne et Picasso : si, du premier, Weidlé loue la tragique grandeur (2), du second, il pointe le goût de la parodie rentable, bientôt de l'imposture en série (3) : «Grand inventeur, plus grand liquidateur, Picasso, mieux que tout autre peintre, représente la rupture de la tradition avec laquelle avaient renoué ses prédécesseurs, et mieux que tout autre artiste, dans n’importe quel domaine de l’art, nous fait toucher du doigt le déracinement, le désarroi de la création humaine, prisonnière de sa propre liberté, condamnée à tourner en rond indéfiniment dans la chambre à miroirs de l’esthétique" (pp. 207-8).
Plus ça change et plus c’est la même chose, ce sera même, un jour non pas prochain mais, pour nous, bien présent, «l’épitaphe de notre temps. Tout y est agité et stagnant à la fois, varié à l’infini et tristement uniforme. Les intentions, les inventions, les engouements successifs ne s’enchaînent pas dans une suite intelligible, et le même déséquilibre intime fait échouer les efforts les plus divers. L’artiste et son public sont tous deux omniscients et omnivores" (p. 227), mais cette science et cette faim ne font que tourner à vide et, plus que cela, annoncent les immenses charniers puisque, selon Wladimir Weidlé, à «l’art qui ne voit rien au-delà et au-dessus de l’homme c’est l’homme, inévitablement, qui fera un jour défaut" (p. 234). En effet, et c'est là une des plus grandes leçons que des penseurs et écrivains tragiques comme Unamuno, Picard, Bloy, Péguy ou Bernanos, nous ont inlassablement répétée, la réduction drastique du domaine divin ou plutôt : de notre soif de Dieu, de notre volonté de préserver les toutes dernières sources du sacré dans notre monde plat et ravagé, si tant est qu'il en reste encore, s'accompagne d'une non moins drastique réduction du domaine de l'humain, réduit, comme ses peintures, à un assemblage plus ou moins fonctionnel d'organes dont l'obsolescence est programmée : «Ce qui distingue le monde où il [l’artiste] vit actuellement, ce n’est pas seulement la diminution de la foi en Dieu, c’est aussi le dépérissement de la foi en l’homme, car ce que l’on divinise aujourd’hui, c’est l’homme déshumanisé» (p. 403), et cette divinisation-là est nous le savons assez consommatrice en sacrifices et immolations, comme Wladimir Weidlé ne manque pas de nous le rappeler en évoquant le Moloch de métal que nous servons, tous, plus ou moins consciemment, en le voilant de draperies plus ou moins translucides : «Pour en sortir, pour changer de monde, les uns s’en tiennent à la machine et nous proposent de l’adorer sans plus, ou de nous adorer nous-mêmes en tant que machinistes, ou encore de n’adorer rien du tout mais de nous préparer à la jouissance des bienfaits miraculeux que la machine nous dispensera dans l’avenir; tandis que les autres, plus astucieux sans doute, s’occupent en premier lieu de la mascotte, la transforment à l’aide d’une idéologie d’appât en une idole redoutable, obtiennent en son nom le pouvoir, et se nourrissent ensuite de la fumée des sacrifices humains, institués en son honneur et se perpétuant à leur profit, sans que la machine soit elle-même érigée en idole» (p. 311).
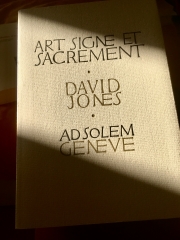 Cette leçon douloureuse sera répétée sans relâche dans la troisième partie, intitulée, et le titre ne souffre aucune ambiguïté, L'Office des ténèbres puisqu'il s'agit, à l'heure la plus noire de la nuit, d'oser invoquer la lumière de l'aube, et d'oser le faire malgré toutes les plus cruelles évidences nous indiquant une fin de partie (4) : «La fin de l’art n’est pas l’art, elle est la transparence suprême de l’œuvre» (p. 382) et c'est justement dans ce dépassement à peu près inexplicable par le déterminisme (5), c'est dans cette transparence que l'homme pourra se retrouver, retrouver son visage qu'il avait égaré dans le kaléidoscope destructeur de l'art cubiste et, en se retrouvant, de nouveau inventer ou réinventer le geste d'un art qui est d'abord remerciement, louange, et qui s'élève plutôt que de s'abaisser.
Cette leçon douloureuse sera répétée sans relâche dans la troisième partie, intitulée, et le titre ne souffre aucune ambiguïté, L'Office des ténèbres puisqu'il s'agit, à l'heure la plus noire de la nuit, d'oser invoquer la lumière de l'aube, et d'oser le faire malgré toutes les plus cruelles évidences nous indiquant une fin de partie (4) : «La fin de l’art n’est pas l’art, elle est la transparence suprême de l’œuvre» (p. 382) et c'est justement dans ce dépassement à peu près inexplicable par le déterminisme (5), c'est dans cette transparence que l'homme pourra se retrouver, retrouver son visage qu'il avait égaré dans le kaléidoscope destructeur de l'art cubiste et, en se retrouvant, de nouveau inventer ou réinventer le geste d'un art qui est d'abord remerciement, louange, et qui s'élève plutôt que de s'abaisser.C'est à cette seule condition que, redevenu sacral, s'élevant plutôt que s'étalant, l'art renaîtra et qu'en renaissant, il redonnera à l'homme une nouvelle vigueur, l'un et l'autre pouvant dès lors s'unir dans la célébration qui est, au fond, l'unique mission de tout art occupé d'autre chose que de son propre nombril : «Quand la foi coagulée redeviendra liquide, quand elle sera, comme dans son premier âge, amour et liberté, c’est alors que l’art se rallumera une fois de plus à l’embrasement nouveau du feu spirituel et qu’il retrouvera la place qui lui appartient de droit dans l’existence des hommes" (p. 407). Si ce ne devait pas être le cas, si l'art voulait décidément se passer de son moyeu et centre spirituel et même, osons le vilain mot, religieux, sacramentel (6), alors il disparaîtrait sous notre regard devenu insensible au mirage de l'art contemporain, se transformerait en ce qu'il est devenu, une «stérile ferblanterie de nos propres produits esthétiques" (p. 392), de la verroterie de la pire vulgarité, emballée dans des monceaux de discours creux et méprisants, de la camelote capable d'être reproduite à l'infini tout en étant parfaitement capable, ainsi que n'importe quelle marchandise, d'enrichir considérablement celui qui l'a produite de même que ceux, intermédiaires innombrables, réels maquereaux, qui l'écoulent. Wladimir Weidlé, lui, invoque un autre destin, certes plus grandiose : «On ne guérit pas de la mort. L’art n’est pas un malade qui attend le médecin, mais un mourant qui espère en la résurrection. Il se lèvera de son grabat dans la clarté calcinante du jour nouveau; sinon, il nous faudra l’ensevelir, et sa glorieuse histoire résonnera à nos oreilles comme une longue oraison funèbre» (p. 412).
Ce sont les toutes dernières lignes de ce livre superbe que sont Les abeilles d'Aristée, que nous pourrions rapprocher d'autres, cette fois signées par David Jones que nous avons déjà mentionné et qui, elles aussi, témoignent d'une double certitude : c'est la fin de partie et nous aurons résisté. Les voici, elles aussi superbes : «Prenons une allégorie. Si, depuis notre position bombardée par l’ennemi, nous envoyons en morse le mot de code «Hélène», nous n’aurons peut-être pas de réponse parce que toutes les liaisons auront été coupées. Le barrage aura fait son œuvre. Ou peut-être recevrons-nous pour réponse que l’officier chargé du décodage et son carnet de mots ont sauté depuis longtemps. Nous n’osons pas transmettre en clair parce que c’est interdit et que l’ennemi en ferait en tout cas grand profit. Nous n’avons donc rien d’autre à faire qu’à attendre la suite. Quelqu’un un jour prendra la relève, même si ce n’est qu’une unité de fossoyeurs ou un groupe de secours […]. Mais quels qu’ils soient, ils trouveront suffisamment de marques de notre présence pour leur indiquer ce qui était encore valable pour nous en tant que signes avant que notre front ne finisse par être enfoncé» (7).
Notes
(1) «Il n’y a d’art que s’il y a incarnation, et quoi donc serait incarné si ce n’est l’image de l’homme et celle du monde, tel qu’il se révèle à l’homme ?», Wladimir Weidlé, Les abeilles d'Aristée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts (Ad Solem, 2002), p. 49.
(2) «Il exigea de son art cette même plénitude d’incarnation qui manquait à son temps et qui manque plus encore au nôtre» (p. 206).
(3) «Aucune époque antérieure au siècle dernier n’a même conçu l’idée d’une floraison aussi énorme d’impostures, de mensonges, d’absurdités et de faux-semblants» (p. 224).
(4) «On a beau aller tout au fond, descendre encore et encore, s’engager dans des couloirs sans fin, avec le seul espoir de trouver au bout un peu de nuit, rien que de la nuit. On tient les yeux fermés. Mais lorsqu’on les rouvre, l’ampoule électrique est toujours allumée, et sa lumière n’a rien perdu de son insupportable éclat artificiel" (p. 380).
(5) Dans un appendice à notre ouvrage est donné un long texte de l'auteur, intitulé Biologie de l’art, où il écrit ainsi que : «Comme un organisme vivant ne se contente pas de ce qui le rendrait, selon les plus exactes estimations, parfaitement viable et revêt des caractères qui, au sobre regard de la science, ne sont que des parures superflues, de même l’œuvre d’art n’aura jamais fini d’étonner le critique par l’obstination qu’elle manifeste à vouloir dépasser le nécessaire, à lui offrir plus encore que ce qui l’aurait déjà comblé» (pp. 424-5).
(6) «L’expérience artistique, intégralement vécue, se révèle enracinée dans l’expérience religieuse, et l’imagination qui crée les arts ne saurait continuer à œuvrer indéfiniment dans l’absence de cette justification, de ce support métaphysique, que rien sauf la religion n’est capable de lui fournir» (p. 407).
(7) David Jones, Art, signe et sacrement (traduction, présentation et annotation de Bernard Marchadier, Ad Solem, 2002), p. 186.





























































 Imprimer
Imprimer