« Journal de Paule Régnier | Page d'accueil | L’Amérique en guerre (29) : Le sergent Salinger de Jerome Charyn, par Gregory Mion »
21/08/2022
Heureux est l’homme de François Esperet, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Sanjay Kanojia (AFP).
Je me permets de signaler, car c'est unique sur la Toile, que Gregory Mion a évoqué, pour la Zone, tous les ouvrages publiés de François Esperet.
 Gagneuses de François Esperet, ou la poétique de la délivrance.
Gagneuses de François Esperet, ou la poétique de la délivrance. Sangs d’emprunt de François Esperet : sucs poétiques et artères scabreuses.
Sangs d’emprunt de François Esperet : sucs poétiques et artères scabreuses. Visions de Jacob de François Esperet : une poésie de la naissance.
Visions de Jacob de François Esperet : une poésie de la naissance. Larrons de François Esperet : une croix pour les malfrats.
Larrons de François Esperet : une croix pour les malfrats. Ne restons pas ce que nous sommes de François Esperet.
Ne restons pas ce que nous sommes de François Esperet.«L’Empire d’occident croula sous le choc.»
J.-K. Huysmans, À rebours.
«Aussi, le genre humain ne s’y est jamais trompé, et l’infaillible instinct de tous les peuples, en n’importe quel lieu de la terre, a toujours frappé d’une identique réprobation les titulaires de la guenille ou du ventre creux.»
Léon Bloy, Le Désespéré.
 Insufflé par le premier Psaume auquel son titre se dévoue éperdument, le nouveau livre poétique de François Esperet, Heureux est l’homme (1), peut se lire comme l’hagiographie d’un «va-nu-pieds céleste» (p. 51) dans le Paris babylonien d’aujourd’hui. La voix du poète – incantatoire – s’assimile de manière assez autobiographique à la voix du prêtre – obstinée du Royaume. C’est la relative nouveauté de ce texte de François Esperet qui renforce un lien construit au fil de ses œuvres antérieures entre une apologétique de la précarité et une mystique intensifiée year-over-year, en disciple cumulatif de Jack Kerouac et de James Agee, mais aussi en humble gardien de Grégoire de Nazianze et de Basile de Césarée (2) : on y retrouve ainsi tout le bois flotté des échoués de l’existence, blanchâtres vestiges osseux peut-être enlisés sur une plage des quais de Seine devenue outrageusement pérenne, sordides carcasses de sauriens déshérités, tombés de fatale pauvreté, miroirs brisés des larrons désespérés de vivre (3), légataires des prostituées contractuelles des trottoirs du vice mais femmes titulaires en vertu (4), les uns et les autres saisis par l’œil purifiant du poète. On les retrouve donc à l’avant-poste de la tourmente, ces précurseurs et ces successeurs de la grâce, on les suit dans Paname écrasée d’inégalités, mais, cette fois, le regard inspiré d’un chemin des crêtes parnassiennes s’agrandit d’un regard lesté de plus hautes bénédictions, résultat des sacrements amassés par François Esperet ces dernières années au sein de la vocation orthodoxe, ex-artisan du diaconat récemment ordonné prêtre par le métropolite Antoine de Chersonèse du subsistant – et consolateur – patriarcat de Moscou.
Insufflé par le premier Psaume auquel son titre se dévoue éperdument, le nouveau livre poétique de François Esperet, Heureux est l’homme (1), peut se lire comme l’hagiographie d’un «va-nu-pieds céleste» (p. 51) dans le Paris babylonien d’aujourd’hui. La voix du poète – incantatoire – s’assimile de manière assez autobiographique à la voix du prêtre – obstinée du Royaume. C’est la relative nouveauté de ce texte de François Esperet qui renforce un lien construit au fil de ses œuvres antérieures entre une apologétique de la précarité et une mystique intensifiée year-over-year, en disciple cumulatif de Jack Kerouac et de James Agee, mais aussi en humble gardien de Grégoire de Nazianze et de Basile de Césarée (2) : on y retrouve ainsi tout le bois flotté des échoués de l’existence, blanchâtres vestiges osseux peut-être enlisés sur une plage des quais de Seine devenue outrageusement pérenne, sordides carcasses de sauriens déshérités, tombés de fatale pauvreté, miroirs brisés des larrons désespérés de vivre (3), légataires des prostituées contractuelles des trottoirs du vice mais femmes titulaires en vertu (4), les uns et les autres saisis par l’œil purifiant du poète. On les retrouve donc à l’avant-poste de la tourmente, ces précurseurs et ces successeurs de la grâce, on les suit dans Paname écrasée d’inégalités, mais, cette fois, le regard inspiré d’un chemin des crêtes parnassiennes s’agrandit d’un regard lesté de plus hautes bénédictions, résultat des sacrements amassés par François Esperet ces dernières années au sein de la vocation orthodoxe, ex-artisan du diaconat récemment ordonné prêtre par le métropolite Antoine de Chersonèse du subsistant – et consolateur – patriarcat de Moscou. Il ne fait alors aucun doute que l’association d’un fort sens poétique (révélé avec les compositions initiatiques des Sangs d’emprunt (5)) et d’un sens religieux toujours accentué donne à ce livre une dimension énorme, une incroyable capacité de captation de la réalité, une faculté de conscience non plus vécue séparément du monde dans le registre de la représentation mais directement incorporée aux choses, transcendance humaine – trop humaine – enfin confondue au poème de l’immanence divine, enfin réconciliée avec elle-même et ce qui l’enveloppe since the dawn of time. Aussi les mots préliminaires de cette légende dorée du saint «Pachtoune» aperçu d’abord au quartier de la «Cité» (p. 9) vibrent comme un repentir de la conscience détrônée du malheur du schisme représentationnel, comme un aveu remarquable de l’homme d’Église écrivain, terrassé par la misère de ce duplicata d’un commandant Massoud dégradé, recevant cette vision de la détresse matérielle non pas tant comme le facile symbole d’une gloire spirituelle qu’il faudrait célébrer, mais plutôt, dans l’immédiat, «comme un reproche au prêtre» (p. 9) qui a longtemps navigué sur des hauteurs casuistiques ahurissantes qui l’empêchaient parfois – fût-ce rarement – de s’abaisser à la source du monde. En cela, dès le début de ce mémento écrit en l’honneur du foudroyant misérable déplacé de ses déserts régaliens par quelque occulte étiologie occidentale, il y a une impuissance du prêtre qui s’abstient de convoquer trop vite la toute-puissance de Dieu pour résoudre le problème de la pauvreté. À vrai dire, ce que le poète édifié ressent, c’est moins la nécessité de s’en remettre à Dieu que le flagrant délit de la présence de Dieu au sein même de ce clochard somnolant à Cité, la possibilité que Dieu se soit fait homme à travers le corps de cet infortuné, exigeant ainsi que l’on descende aux confins de la Terre avant de s’estimer admissible au trajet ascendant d’une échelle de Jacob.
Dès lors s’engage un chassé-croisé à la fois réel et imaginaire entre le religieux et son alter ego en altissima paupertas. Le rythme de cette probable sarabande – qui pourrait se dérouler en fonction des accords inquiétants de Georg Friedrich Haendel – est toutefois décidé par le gisant meurt-de-faim de Cité tant le charisme de sa privation frappe l’abondance de cœur de l’aède ecclésiastique. Celui-ci devine la souveraineté de celui-là, sa fulgurante législation de lumière, sa bravoure de modeste bateau en papier qu’on aurait lancé dans un hideux caniveau tributaire de l’impitoyable Seine dévoreuse de Paul Celan, bateau enfantin qui tiendrait son cap contre toute attente, tel ce brave petit bateau évoqué par Malcolm Lowry dans son recueil de nouvelles Écoute notre voix ô Seigneur…, vulnérable embarcation mais vénérable véhicule des énergies sacrées, chancelante patrie de tous les eccentric outsiders de Lowry, de tous ceux qui sont sous la coupe d’une «âme humaine en cabotage» (6) au milieu des goulets d’étranglement d’une société trompeusement conviviale. Et à voir l’extrême indigence de ce dramatique et littéral mendiant qui dort sur l’île la plus onéreuse de la planète, réconforté par les miasmes thermiques d’une bouche de chaleur, à voir cette robinsonnade de l’irréversible dérive, la question que posait Lowry se répète (la question qui concernait les passagers figurés du petit bateau dodelinant de sa voile abandonnée au hasard), le point d’interrogation de ces maudits marins revient à la charge : «Comment l’âme peut-elle endurer cette sorte de démolition et pourtant survivre ?» (7) Par quel miracle de la volonté ce paria de Cité persévère dans la vie sinon par la volonté du pourvoyeur de toutes les choses ? Par quelle ironie du supra-prolétariat ce gueux quasiment végétatif continue-t-il ses rarissimes déambulations et ses changements de position sur son museau urbain qui le réchauffe de sa douteuse haleine ? Au service de ce comateux de la voierie, on se demande un peu en désespoir de cause s’il existe un score de Glasgow pour mesurer la fuite de sa conscience dans les fonts baptismaux de l’inexpugnable dénuement. Mais quoi qu’il en soit de cette conscience qui paraît inaccessible et perdue, il faut se l’imaginer heureuse comme l’homme du Psaume originel, à rebours de la conscience malheureuse qui vit encore divorcée de la Création. C’est la destination que doit se fixer le poète s’il veut être digne de ce qu’il est : s’avancer jusqu’aux territoires inexplorés du bohémien archétypal pour tuer la conscience malheureuse et la précipiter dans les abysses du flux de la conscience suprême – cet endroit où le très-bas rejoint le très-haut.
En d’autres termes, si le poète a l’intention de se mettre au niveau de celui qui semble avoir uni en lui tout ce qui est désuni pour les mentalités communes, il va lui falloir se revêtir du dénuement, se parer de la nudité d’une vie que rien ne rattache à la litigieuse épaisseur des combinaisons sociales. Or c’est là que François Esperet se distingue de livre en livre : non seulement il parvient à manifester l’autorité de la vie partout où l’opinion identifie des hommes et des femmes subordonnés aux carcans sinon de la mort imminente, du moins de la mort sociale, mais il parvient aussi à révéler toute l’apothéose des humiliés qu’il choisit de décrire moins sous l’angle d’une horrible crucifixion du Juste que sous les aspects du Christ pantocrator inondé de lumière. Telle est par conséquent la poésie de François Esperet : non pas une mise en croix des pauvres gens qui se regarderait comme la réécriture moderne, auto-satisfaite et mind-easing d’une Histoire biblique vouée à la répétition, mais plutôt un refus de stigmatiser les stigmates, un rejet du romantisme de la souffrance, ceci à dessein de convertir nos courtes vues sociologiques en longues vues mystagogiques, nous découvrant ainsi une part du mystère, une part de la vérité définitive, une part de l’évidence la moins évidente et pourtant la plus certaine, à savoir que les malheureux sont le point de passage ultime de l’illumination bienheureuse. À cet égard, aucun poète, aucun homme de lettres et même aucun homme en général ne devrait limiter sa parole au maniable répertoire de la mortification quand il s’exprime au sujet des suprématistes de la calamité. Le cas échéant, ce serait commettre une cinquième grande erreur après les quatre grandes erreurs cataloguées par Nietzsche, ce serait ne pas voir que notre monde se complaît à glorifier les offenseurs et à offenser les glorieux, que ce monde abîmé de sentences illicites assigne aux seconds les péchés capitaux des premiers, et que, ce faisant, nous altérons nos façons de parler en qualifiant de photophores ceux qui sont sournoisement satanophores, négligeant de mieux parler de ceux auxquels on ne réserve habituellement que des éléments de langage, des champs lexicaux prévisibles ou des raccourcis théoriques. À tous ces écueils potentiels, François Esperet oppose un langage qui ne fait ni l’économie d’une matière infâme, ni l’économie d’une antimatière sublime, incessamment au chevet des montrés-du-doigt tout en les reliant au principe de l’intensité de Dieu, ne serait-ce que parce que les plus démunis d’entre les hommes sont toujours les plus vivement intégrés aux plénitudes surnaturelles. Aussi n’est-il pas contradictoire que le trimardeur de Cité soit constamment baigné des mots du premier Psaume et que son hagiographie ne bascule pas dans les lexiques d’une complaisante martyrologie.
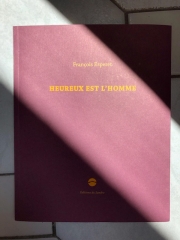 Il est donc indubitable que «l’ange immobile» (p. 34) endormi sur les satanés trottoirs de l’Occident impur aura sa «part au Royaume» (p. 11). Il y est même déjà presque arrivé tant les moindres fibres de sa personne font de lui un irrédent des régions divines. Ce «fol esclave en cavale» (p. 15) interrompue par le dur sommeil de la débâcle majorée, ce phénoménal «ascète rivé à son enfer» (p. 12), cet animal sauvage de l’Orient libérateur, nul n’a le droit de remettre en question sa recevabilité dans les provinces pacifiées du Règne de Dieu. Peu importe les déterminations qui le réduisent à la condition d’un bouc-émissaire, peu importe les apparences, il demeure celui devant lequel tremblent toutes les brebis galeuses et devant lequel jubilent tous les saints emboucanés, chef de file des «barbares à [nos] portes au cœur de [nos] cités les âmes perdues les pures» (p. 11), sultan régulier parmi la dangereuse irrégularité de l’imposture parisienne, divulgateur, en son apocalyptique virginité, de la tragédie séculaire qui s’acharne à croire que le Mal réside à la périphérie de Paris ou sur le rebord des voies piétonnes alors qu’il prolifère intra-muros, au centre même des monarchies institutionnelles dont la France tire une déconcertante et fâcheuse vanité. La localisation réprobatrice de la soi-disant mauvaise graine conjuguée à l’accommodante rédemption de tout le débraillé psychique de l’Occident retarde ainsi le Grand Soir d’une réforme des esprits – ce n’est pas demain la veille que les quartiers chics apprendront la chance qu’ils auraient de subir une invasion des anges qui aussitôt susciterait l’évacuation des démons. Ce n’est pas non plus de sitôt que l’œil de la bourgeoisie persécutrice verra les affinités célestes de celui qui «se dissimulait sous un suaire de l’Assistance publique des hôpitaux» (p. 13). Il ne reste ici que l’optique infiniment dimensionnelle de la poésie et de l’orthodoxie poussée à son maximum de perméabilité pour s’emparer de cet alité de l’asphalte et le relever de son épuisement. Et par le truchement de ce sensible redressement du paralytique de Cité où se rejoue le miracle de Capharnaüm (8), par un effet accru de pénétrabilité de toutes les strates de la réalité paralysée, François Esperet se livre à l’improbable (pour qui ne le connaît pas) mais nécessaire (pour qui le connaît) sanctification des «bagnards» de la maladie tels qu’ils gisent inanimés dans «un Lazaret [de] Hyères» (p. 14), destinataires de l’almanach des maladies orphelines à tendance curarisante, cérébro-lésés des accidents vasculaires à séquelles irrémissibles, femmes, enfants et hommes dévastés de malchance, désabusés du «ciel inique» (p. 14), imprégnés cependant d’une équité plus vaste qui donne à pressentir un matin de justice. De Paris à Hyères, du secteur de Cité aux topographies de l’Almanarre où se dresse ironique l’hôpital San Salvadour, pôle de la douleur sommitale côtoyant les plages de l’euphorie maximale, de ce Nord indifférent à ce Sud où le «clergé soignant le bas-clergé des pauvres» (p. 14) ne peut que torcher des corps impatients de «l’incinérateur attenant» (p. 14), l’apostolat du poète bâtit une arche de la souffrance rédimée, un palladium de prières serinées pour les défaits de la nation, non sans oublier de dire anaphoriquement «merde à Vauban» sous la férule militante de Léo Ferré (p. 14), condamnant ceux qui embastillent et réhabilitant les embastillés – respectivement les manufacturiers de l’inégalité et les ayants droits du mépris de tout droit.
Il est donc indubitable que «l’ange immobile» (p. 34) endormi sur les satanés trottoirs de l’Occident impur aura sa «part au Royaume» (p. 11). Il y est même déjà presque arrivé tant les moindres fibres de sa personne font de lui un irrédent des régions divines. Ce «fol esclave en cavale» (p. 15) interrompue par le dur sommeil de la débâcle majorée, ce phénoménal «ascète rivé à son enfer» (p. 12), cet animal sauvage de l’Orient libérateur, nul n’a le droit de remettre en question sa recevabilité dans les provinces pacifiées du Règne de Dieu. Peu importe les déterminations qui le réduisent à la condition d’un bouc-émissaire, peu importe les apparences, il demeure celui devant lequel tremblent toutes les brebis galeuses et devant lequel jubilent tous les saints emboucanés, chef de file des «barbares à [nos] portes au cœur de [nos] cités les âmes perdues les pures» (p. 11), sultan régulier parmi la dangereuse irrégularité de l’imposture parisienne, divulgateur, en son apocalyptique virginité, de la tragédie séculaire qui s’acharne à croire que le Mal réside à la périphérie de Paris ou sur le rebord des voies piétonnes alors qu’il prolifère intra-muros, au centre même des monarchies institutionnelles dont la France tire une déconcertante et fâcheuse vanité. La localisation réprobatrice de la soi-disant mauvaise graine conjuguée à l’accommodante rédemption de tout le débraillé psychique de l’Occident retarde ainsi le Grand Soir d’une réforme des esprits – ce n’est pas demain la veille que les quartiers chics apprendront la chance qu’ils auraient de subir une invasion des anges qui aussitôt susciterait l’évacuation des démons. Ce n’est pas non plus de sitôt que l’œil de la bourgeoisie persécutrice verra les affinités célestes de celui qui «se dissimulait sous un suaire de l’Assistance publique des hôpitaux» (p. 13). Il ne reste ici que l’optique infiniment dimensionnelle de la poésie et de l’orthodoxie poussée à son maximum de perméabilité pour s’emparer de cet alité de l’asphalte et le relever de son épuisement. Et par le truchement de ce sensible redressement du paralytique de Cité où se rejoue le miracle de Capharnaüm (8), par un effet accru de pénétrabilité de toutes les strates de la réalité paralysée, François Esperet se livre à l’improbable (pour qui ne le connaît pas) mais nécessaire (pour qui le connaît) sanctification des «bagnards» de la maladie tels qu’ils gisent inanimés dans «un Lazaret [de] Hyères» (p. 14), destinataires de l’almanach des maladies orphelines à tendance curarisante, cérébro-lésés des accidents vasculaires à séquelles irrémissibles, femmes, enfants et hommes dévastés de malchance, désabusés du «ciel inique» (p. 14), imprégnés cependant d’une équité plus vaste qui donne à pressentir un matin de justice. De Paris à Hyères, du secteur de Cité aux topographies de l’Almanarre où se dresse ironique l’hôpital San Salvadour, pôle de la douleur sommitale côtoyant les plages de l’euphorie maximale, de ce Nord indifférent à ce Sud où le «clergé soignant le bas-clergé des pauvres» (p. 14) ne peut que torcher des corps impatients de «l’incinérateur attenant» (p. 14), l’apostolat du poète bâtit une arche de la souffrance rédimée, un palladium de prières serinées pour les défaits de la nation, non sans oublier de dire anaphoriquement «merde à Vauban» sous la férule militante de Léo Ferré (p. 14), condamnant ceux qui embastillent et réhabilitant les embastillés – respectivement les manufacturiers de l’inégalité et les ayants droits du mépris de tout droit. Cette réciprocité des douleurs est aussi l’occasion de blâmer l’État-Providence (cf. p. 14) : aucun décret sur la misère et aucune allocation de solidarité ne sont compatibles avec une compréhension approfondie des causes qui provoquent la déchéance. Au contraire, selon un mouvement de cession des possibles qui dissimule en vérité une cynique annexion à l’impossible, plus l’État fait preuve d’activisme, plus les initiatives se multiplient envers les faibles, moins le périmètre d’un enfer sur terre diminue. Il en va finalement des bonnes volontés de l’État comme d’une balourde philosophie du care : c’est précisément parce qu’on insiste beaucoup sur l’attention portée à autrui que celui-ci n’existe que très partiellement au sein d’un dispositif impersonnel de protection (ou à l’intérieur des spéculations d’intellectuels bien nourris). Dans son inimitable scansion – délestée du balisage de la virgule et du point – qui se déroule à l’instar d’un fleuve de sévère probité par opposition à la friponnerie des agents officiels de la République, tel un Nil torrentueux qui viendrait sauver les cœurs stériles, François Esperet accuse une sorte d’interventionnisme hygiéniste, dénigrant les manières à la fois littérales et symboliques de «[perfuser l’ascèse]» (p. 14) des pénitents de la rue, de leur infliger une espèce d’impérialisme du «glucose» afin qu’à «l’aube ils se découvrent attachés à la poche de leurs droits nos devoirs insinués dans leurs veines» (p. 14). Ce genre d’éthique de la sollicitude – ou de socialisme exhibitionniste – n’a l’air que d’une immunité que l’État s’achète au prix avantageux de son incompréhension réitérée des créatures explicites de Dieu. À Paris ou à Hyères, on meurt d’un surcroît de rigueur étatique et d’un déficit de reconnaissance des ministres de la béatitude. À Paris, regrettablement, des frères en béatitude vont rejoindre Paul Celan dans les eaux de la délivrance et à Hyères, fâcheusement, le spectre de Saint-John Perse se cabre de stupéfaction à la vue des solitaires de San Salvadour. Partout le rabaissement des pauvres fait rage et exhorte à ce que la mission primordiale des vivants consiste à redresser les abaissés, à se souvenir que la descente du Christ a induit le même type de fléchissement de soi-même en vue d’aider ceux qui ont été astreints à l’étiage de la société.
Mais pour colossale que soit la négation du vagabond lambinant sur le cadastre qui fut jadis la fierté des mémorialistes et qui aujourd’hui n’est plus que la fatuité des monstres du tourisme, lui, malgré tout, malgré son altitude outragée, s’affirme comme un irradié de l’énergie blanche qui sanctionne les passants escroqués par la magie noire (cf. p. 17). Tandis que les uns dorment en marchant, le cénobite de Cité, incontestablement, marche d’une démarche prophétique en dormant. Il n’est pas victime de ces «marchands de sommeil» contre lesquels Alain mettait ses élèves en garde et qui désiraient perpétrer les fondations d’un grégarisme consumériste (9). En dépit du «feu souterrain de Paris qui l’enfièvre» (p. 17), en dépit aussi du «miasme exhalé par la ville saoulée d’elle-même son haleine de pocharde» (p. 35), abominable rançon des siestes récurrentes sur une bouche d’aération au fond de laquelle des voyageurs accaparés mésestiment l’insolvable de la surface, notre homme, envoyé du Seigneur, promet une verticalité dont les autres ne veulent plus ou ne sont plus capables. Cela suppose un rééquilibrage des valeurs parce que la pathologie présumée du miséreux relativise la normalité des possédants, et même, devrait-on ajouter, la pathologie n’apparaît qu’en proportion de tout ce qui dérange les avocats de l’ordre temporel. Ces derniers tentent de faire de la pauvreté une maladie et de la richesse une santé, mais ce qui est valable temporellement est inadmissible spirituellement. C’est pourquoi les triomphateurs de l’univers temporel ne souhaitent pas le mélange des ordres. Ils ne visent que l’exclusivité des géographies matérialistes, ils organisent la civilisation à l’avenant de leurs fantasmes de prospérité, toutefois la certitude des bas-fonds ne saurait être niée car là où siègent les réprouvés du monde physique s’initient les élections du monde métaphysique, et là où titube un innommé de la nomenclature profane commence la nomination l’humanité sacrée. Il s’ensuit que toute manifestation de la pauvreté crasseuse en ce monde si soucieux de propreté constitue un pli de l’ordre temporel vers l’ordre spirituel, une pliure bénie au milieu des maudits alignements de la médiocrité – une brillante épiphanie parmi les ténèbres virulentes qui s’obstinent à protéger «ceux qui ricanent» (pp. 45 et 58). Ainsi n’est-il nullement préjudiciable que le pouilleux talonné par François Esperet soit hypothétiquement «autiste» ou «peut-être attardé va savoir un des enfants des rues marocaines rue Myrha» (p. 18), car, tout au contraire, plus on l’affublera de pathologies, plus sa députation spirituelle sera fervente et réussira à éduquer le temporel démesuré à la mesure de l’ordre juste. D’où le fait évidemment que cette cloche percée se dévoile comme «la plus étrangement [gracieuse des misères] éclatant sous la crasse» (p. 22), comme un Silène socratique dont la laideur pelliculaire nous masquerait une substantielle et renversante beauté. Il est en ce sens indispensable que l’œil de verre de la cécité mondaine fasse l’effort de s’ajuster à la clairvoyance du poète et qu’il aperçoive, derrière «le matos de fripes et paperolles empilées dans des sacs aux poignées renforcées qu’enveloppent et protègent de la pluie des cirés de rebut savamment rapiécés» (p. 23), derrière les «sacs bourrés de dépliants» (p. 24) où ruissellent les palimpsestes de toutes les déchetteries de Paris, avec, possiblement, la déjection apparente d’un magazine branché où pérore une pute littéraire, il est donc indispensable, derrière tout cela, que les aveugles recouvrent la vue et qu’ils soient désarçonnés par l’apocalypse des hiérarchies véridiques.
Tout bien considéré, la présence intrusive de cette bête brune échappée d’un éventuel Afghanistan, semblable «au vieux zouave des images d’Épinal fumant sa pipe d’écume» (p. 24), tout bien pesé, ce buffle à la peau haillonneuse nous encourage dans la «tentation de passer à l’ennemi» (10), d’abjurer les dogmes sophistiqués de la ville pour coïncider avec un «univers brûlant et impassible qui défie l’histoire et ses agitations» (11). Sa dissimilitude est tellement frappante en plein centre de la métropole conformiste que toute notion d’identité se dérobe et laisse apparaître la pure motivation «de ne ressembler à rien» (12). Il n’y a que de cette façon que l’on atteindra la sobriété durable : en alimentant le désir de différer à l’endroit même où la différence fait l’objet d’un crime ou d’un déni. Et il n’y a pas de meilleure méthode pour s’absorber dans cette ascétique démarcation de l’uniformité que celle qui préconise une immersion au cœur des prétendues difformités (cf. pp. 25-43). C’est le moment où François Esperet dilate sa pupille et adjoint au quotidien de son assaillant du Royaume les portraits de quelques autres désaxés réunis dans un même axe de tribulation. Tous autant qu’ils sont, en rade à Paris la scélérate, ils battent le rappel des marginaux, par exemple, que Cormac McCarthy a décrits dans l’incroyable Suttree. Du Knoxville (Tennessee) de McCarthy au Paris (France) d’Esperet, nulle ombre d’un écart de nature, mais tout au plus d’infimes écarts en termes de degré d’exclusion. En quoi nous repérons dans ce Paris de la féroce banqueroute les fols-en-Christ de Knoxville et peut-être même ce fornicateur de pastèques qui adorait décharger dans les chairs aguicheuses des melons d’eau du Volunteer State (13), commis-voyageur on his own way des espérances justiniennes du Logos spermatikos, définitif contradicteur des culs-de-plomb de sacristie. Ce séducteur charismatique des pastèques du Tennessee ruiné, sans contredit, ne peut incarner que le frère aîné du trafiquant d’animaux qui fomente des copulations consanguines ou zoologiquement inconcevables et que l’on voit enterrer une charogne à Montsouris (cf. p. 26). Assurément témoin de plusieurs sodomies de ragondins et juge (et partie ?) des coïts de diverses races enflammées de rut endogamique, ce pseudo-vétérinaire non seulement rivalise avec le tombeur des pastèques, mais, de surcroît, il ressuscite certains psychismes déréglés des comtés faulknériens (14). Que dire encore de ce baratineur qui s’invente une biographie au cours de laquelle son paternel aurait croisé Kerouac à Big Sur (cf. p. 30) ? Et lui, en digne rejeton du pater familias de la libre Californie d’antan, il raconte avoir parcouru les fuseaux trinitaires de l’Amérique en opérant quasiment selon les mandats d’un chanteur de charme, non sans avoir dû par la suite négocier sa vie ou sa mort avec des camés vindicatifs de la Provence tzigane (cf. pp. 31-2). Il fut de la sorte un gitan d’emprunt, un sophomore de l’implacable gitanerie camarguaise, et toutes les fois qu’on se le représente ou plutôt qu’on essaie de calculer son ontologie à partir de son canonique élan vital, on l’entend «se [lever] en gambergeant des mensonges à bonir pour se tirer de là se faire prêter du fric sur parole et trahir au son d’une guitare» (p. 34). Puis à côté du Mengele des chenils et du Manitas de Plata de kermesse, on aborde un nègre cardiaque, un arpenteur essoufflé du pandémonium citadin, apnéique du sommeil diagnostiqué au débotté par un marabout cardiologue autoproclamé, lui aussi, le «Renoi» menacé de myocardite, réchauffé par l’exhalaison des catacombes ferroviaires où vivote le Pachtoune (cf. pp. 34-5). Ce Black aux ventricules fatigués est en outre archi-visible sur les lignes homogènes et lactescentes de la trop blanche humanité de Cité, raillé par les immaculés putatifs, moqué et détesté, inculpé de Grand Remplacement alors que la vraie pègre se cache, branleuse à «l’arrière», composée des «planqués [des] bandits qui sont cause des guerres les immortels c’est bien derrière qu’ils sont qu’il faudrait les crever ou c’est eux qui nous crèvent innocents de nos mains» (p. 37).
Un peu plus tard et un peu plus loin dans ce pèlerinage de l’imagination poétique effectuant sa tournée des gibiers de potence, on avise de nouveau ce souffre-douleur créolisé. Un billet de cent le relance (cf. p. 38), la charité fortuite l’éloigne de la mésaventure et le rétablit sur le boulevard de l’aventure, comme cent dollars suffisent à solder les dettes du monde anesthésié dans Un cœur pour les dieux du Mexique de Conrad Aiken et à créditer un trio d’idéalistes pour leur faire vivre provisoirement l’odyssée du monde hypersensible. Le don dépourvu de contre-don renvoie donc ce descendant des esclaves d’Afrique sur le chemin relativement carrossable et éphémère d’une vie d’affranchi. On le rejoint subséquemment régénéré dans le Marais dévirilisé, taureau couillu «au milieu du bal des invertis livides» (p. 39), mâle omniprésence parmi «les fiottes efféminées», parmi les tantes «zélées à sucer les précieux déguisés» (p. 39), lopettes vacataires d’hôtel de ville aspirant aux CDI du tapinage municipal de l’emploi fictif. Il surgit ainsi musclé dans le multivers atrophié du népotisme génital et idéologique, essence de la nature qui vient fustiger les accidents de la culture, secret de la mémoire primitive assurant les fonctions d’un brutal et curatif ressouvenir pour une époque amnésique. Sa débordante fraternité, du reste, afflue jusqu’aux rives d’un Tamoul éthylique, «exterminé par l’alcool ennemi le fléau de sa race» (p. 40). Il repose «là délabré et traître à sa caste» (p. 40), supplicié par les épiciers du petit commerce arabisé ouvert le jour et la nuit, incapable d’être caissier ou même manutentionnaire dans ce bordel sarracénique (cf. p. 41). Il est la tête de Turc des ambitieux des ruelles ou des passages Choiseul céliniens, il est le crucifié terminal des crucifiés habituels de l’Occident mystificateur, débiteur de son ivresse qu’il paie «aux coups et aux blessures» (p. 43). Et c’est exactement à la convergence de ces hommes effondrés mais adorés de Dieu que séjourne ensommeillé le Saint des saints du temple humain, le sanctifié majeur plébiscité par François Esperet, le fascinant Pachtoune isolé des philistins et abondamment incorporé au divin, le fragment cosmique éboulé de la voûte céleste et qui restitue à la civilisation disgraciée un indice intempestif de sa plus belle version. Immuablement mobile dans l’invisible et injustement immobilisé dans le visible (cf. p. 43), il n’est «esseulé» (p. 43) que pour ceux qui ne savent pas sentir sa communion avec le Tout de la réalité, sa résolution à ne pas suivre «le chemin des pécheurs» (p. 43). En cela son intensité est si prodigieuse qu’elle stupéfie par son intarissable mystère les ressources tarissables du poète (cf. p. 43) et peut-être aussi l’équipement spirituel du prêtre sidéré.
Il faudrait alors oser entériner l’étonnant messianisme de ce personnage et aller jusqu’à formuler à travers lui les preuves consolantes du Second avènement du Christ. Autour de lui s’évanouissent les charlatans du Bien, les bénévolats frauduleux, «tous couards militants misère en bandoulière d’esprit et non de chair» (p. 45). Ce sont eux et rien qu’eux les Grands Remplaçants, les «créatifs impuissants», les «insatiables émeutiers éclairés» (p. 45), à l’affût des subventions cabalistiques des ministères de l’opulence, parasites en surnombre qui défont ce que le Sauveur a fait, terribles arrivistes froufroutant «comme un vieil acouphène» (p. 45). Leur frénésie est une cinétique de la perdition pendant que l’inertie du clodo est un enracinement dans la terre sainte. Du haut de sa bassesse apocryphe, l’opprimé de Cité «[endure] l’outrage comme un saint» (p. 47), agent d’une transsubstantiation unique où le corps anémié du délit de misère se mue en un corps astral de la justice éternelle. C’est d’ailleurs supposément ce que nous pouvons lire sur les tatouages de ce messie oriental avec «la kabbale en farsi [qui lui grimpe dessus] depuis le coup de pied comme du lierre» (p. 51). La gravure épidermique de cette surhumaine végétation est d’une telle densité expressive qu’elle subjugue a priori un contingent de gitanes en maraude (cf. p. 57). Elle subjugue ensuite – et encore et encore – le poète pratiquement nommé starets (cf. p. 60), tatoué lui aussi, ému par ce «lierre d’éternité» (p. 60) approché de très près tandis qu’il délace les souliers du dormeur de ce val parisien (cf. pp. 62-3), «belles mules éculées [dotées du] sourire des vierges le jour de leur martyre» (p. 60). Au pied de cet atlante du Seigneur, prosterné, révérencieux et bouleversé, François Esperet recueille la sobre confession d’un homme entièrement coulé dans le Verbe. Il écoute l’imploration d’un homme pour ainsi dire pro-Verbial, d’un individu si profondément désamarré des discours crapuleux qu’il appartient avant toute chose au flux pré-individuel du souffle omni-créateur. Cet homme-là, inéluctablement, transmet l’intuition d’une perpétuelle aura divine et chacune de ses lentes motions constitue déjà une bourrasque du Royaume «[murmurant] sa loi jour et nuit» (p. 63).
Notes
(1) Éditions du Sandre (2022).
(2) Pour les deux derniers noms, cf. François Esperet, Ne restons pas ce que nous sommes. Ce recueil d’homélies réserve également des plongées dans les inspirations de Grégoire de Nysse, de Macaire le Grand et d’Origène.
(3) Cf. François Esperet, Larrons.
(4) Cf. François Esperet, Gagneuses.
(5) Selon une chronologie non pas éditoriale mais vivante, ce sont les premiers poèmes écrits par François Esperet (publiés par les Éditions de La Grange Batelière en 2015).
(6) Malcolm Lowry, Écoute notre voix ô Seigneur… (La Traversée du Panama).
(7) Ibid.
(8) Cf. Évangile de Marc.
(9) Cf. Alain, Discours de distribution des prix du lycée Condorcet.
(10) Albert Camus, L’été (Le minotaure).
(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) Cf. Cormac McCarthy, Suttree.
(14) On assiste à une mémorable scène de copulation animalière inattendue – et forcée par des hommes excommuniés de toute bien-pensance – dans Sartoris.






























































 Imprimer
Imprimer