« Bloc-notes du mystique à l'état sauvage de Maxence Caron : le maxencéisme est-il un aspermatisme ? | Page d'accueil | Les Français de la décadence d'André Lavacourt dans le dos noir du temps »
08/02/2024
L’arc-en-ciel de la gravité de Thomas Pynchon, par Gregory Mion

«Ceux qui préfèrent les contes de fées font la sourde oreille quand on leur parle de la tendance native de l’homme à la méchanceté, à l’agression, à la destruction, et donc aussi à la cruauté.»
Jacques Lacan, Le Séminaire (livre VII).
«Le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues et l’économie de son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l’homme de devenir une malédiction pour lui.»
Hans Jonas, Le Principe responsabilité.
«Béni soit-Il dans la Paranoïa !»
Allen Ginsberg, Kaddish.
I/ Science, para-science ou méta-science : tous les moyens sont bons pour confondre l’ennemi nazi et reprendre le contrôle du ciel enténébré de Londres
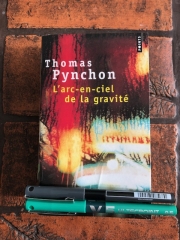 Le ton est donné dès les premières lignes de L’arc-en-ciel de la gravité (1) avec le sentiment de regarder la ville de Londres comme si elle était dominée par une longue offensive issue d’un traité de poliorcétique par les airs et usant de la stratégie du bombardement – le Blitz – pour arriver à ses fins crapuleusement prescrites (2). La Seconde Guerre mondiale ne sait pas qu’elle est entrée dans ses ultimes phases et les Alliés d’Angleterre, contre la fanatique insistance des troupes hitlériennes, s’acharnent à procéder aux évacuations de rigueur à la suite des tirs d’artillerie sur la capitale britannique, les autorités compétentes s’organisant pour relocaliser une «avalanche d’âmes en peine» (p. 13). L’étendue croissante d’un paysage de ruines suggère une douloureuse polysémie à l’égard de la notion de gravité : il y a non seulement le pouvoir de l’attraction universelle qui traduit l’impossibilité de suspendre la chute des projectiles envoyés sur le périmètre de Londres, mais il y a également la grièveté des conséquences, l’expansion de l’onde de choc autour de chaque point d’impact, le plongeon des corps d’acier entraînant le plongeon des corps sociaux, et toutes ces regrettables accointances des terminologies de la gravité impliquent un monde où le ciel n’est plus l’objet d’une profondeur cosmique car il est devenu l’objet d’une insupportable menace balistique (cf. p. 19). Et ce n’est pas une littérature de l’économie des moyens qui décrit ce contexte de prolapsus général dans la mesure où Thomas Pynchon relance inlassablement le mécanisme du romanesque, multipliant les registres de langue et de forme, afin de s’emparer d’une part d’un moment précis de l’Histoire, et, d’autre part, afin de réfléchir à toutes les nuances possibles contenues dans le concept de la guerre. L’ensemble s’agrège sous les traits d’un livre unique, d’une longueur fluviale et d’une allure méandreuse, où l’on retrouve les nobélisables et exorbitantes monomanies de Thomas Pynchon : l’intrication des faits historiques bruts et leur stupéfiante interprétation métaphysique, l’usage de patronymes aussi étranges que drôles et assez souvent aptonymiques (mention spéciale pour Terence Overbaby malgré son rôle mineur), la profusion des approches scientifiques aussi sérieuses que bénéfiques pour justifier l’ampleur d’une fiction qui ne recule pas devant l’intimidante envergure de la réalité.
Le ton est donné dès les premières lignes de L’arc-en-ciel de la gravité (1) avec le sentiment de regarder la ville de Londres comme si elle était dominée par une longue offensive issue d’un traité de poliorcétique par les airs et usant de la stratégie du bombardement – le Blitz – pour arriver à ses fins crapuleusement prescrites (2). La Seconde Guerre mondiale ne sait pas qu’elle est entrée dans ses ultimes phases et les Alliés d’Angleterre, contre la fanatique insistance des troupes hitlériennes, s’acharnent à procéder aux évacuations de rigueur à la suite des tirs d’artillerie sur la capitale britannique, les autorités compétentes s’organisant pour relocaliser une «avalanche d’âmes en peine» (p. 13). L’étendue croissante d’un paysage de ruines suggère une douloureuse polysémie à l’égard de la notion de gravité : il y a non seulement le pouvoir de l’attraction universelle qui traduit l’impossibilité de suspendre la chute des projectiles envoyés sur le périmètre de Londres, mais il y a également la grièveté des conséquences, l’expansion de l’onde de choc autour de chaque point d’impact, le plongeon des corps d’acier entraînant le plongeon des corps sociaux, et toutes ces regrettables accointances des terminologies de la gravité impliquent un monde où le ciel n’est plus l’objet d’une profondeur cosmique car il est devenu l’objet d’une insupportable menace balistique (cf. p. 19). Et ce n’est pas une littérature de l’économie des moyens qui décrit ce contexte de prolapsus général dans la mesure où Thomas Pynchon relance inlassablement le mécanisme du romanesque, multipliant les registres de langue et de forme, afin de s’emparer d’une part d’un moment précis de l’Histoire, et, d’autre part, afin de réfléchir à toutes les nuances possibles contenues dans le concept de la guerre. L’ensemble s’agrège sous les traits d’un livre unique, d’une longueur fluviale et d’une allure méandreuse, où l’on retrouve les nobélisables et exorbitantes monomanies de Thomas Pynchon : l’intrication des faits historiques bruts et leur stupéfiante interprétation métaphysique, l’usage de patronymes aussi étranges que drôles et assez souvent aptonymiques (mention spéciale pour Terence Overbaby malgré son rôle mineur), la profusion des approches scientifiques aussi sérieuses que bénéfiques pour justifier l’ampleur d’une fiction qui ne recule pas devant l’intimidante envergure de la réalité. La section inaugurale du roman (cf. pp. 11-261) expose d’une façon récurrente les atouts majeurs de la Résistance et plus particulièrement les secrets d’une armée de métiers occultes censée vaincre le démon du nazisme. Cette phalange londonienne antifasciste se compose de «voyants, [de] magiciens fous, [de] spécialistes de la transmission de pensée et [de] voyageurs astraux» et autres «mages» exceptionnels (p. 64) dont la fusion des pouvoirs doit constituer un palladium contre les volontés destructrices du régime nazi. L’axe de ce blindage ésotérique s’apparente à une sorte de spiritisme épistémologique, d’agissante et savante immatérialité, en opposition farouche avec les lourdeurs de l’univers matériel de la guerre. C’est à un véritable basculement de plusieurs modèles scientifiques et de la figure même de l’homme de science auquel nous assistons, comme une espèce de crise qui se serait emparée du tempérament ordinairement terre-à-terre de l’homme positif, celui-là même que critique Husserl en lui reprochant son fétichisme des données factuelles au détriment d’un accès aux données plus subtiles (3), homme positif désormais enclin à lever un peu la tête, à se préoccuper de ce qui est en haut pour démêler ce qui est en bas, à imiter Thalès en évitant de tomber dans un puits, pressé d’en finir avec les différents holocaustes qui ont rendu précaire l’avenir de la planète.
Parmi le répertoire des membres éminents de cette confrérie de l’hermétisme, on note la présence de Geoffrey «Pirate» Prentice, un capitaine possédant le don de transmigration psychique, la faculté de «se mettre dans la peau des autres» (p. 24) en vue de les démasquer ou en vue de leur ressembler. Au zénith de ses performances trans-migratoires outrepassant la seule dimension de ses semblables et donc apte à pénétrer des régions énigmatiques de la nature, le capitaine Prentice se signale d’un «œil révulsé» qui peut lire «d’antiques caractères au fond de ses orbites» (p. 27), autrement dit le transmigrant Prentice jouit de la capacité de voir le parchemin du monde humain et non-humain se dérouler sous ses yeux. En comprend-il pour autant le langage et fait-il preuve de suffisamment d’adresse pour déjouer les aspects linéaires de l’ancestrale et totale narration du réel lorsque ceux-ci dissimulent d’éventuelles traces angulaires de palimpseste ? Est-ce que le flibustier Geoffrey Prentice est finalement à la hauteur du texte et du sous-texte du mystère de l’engendrement des formes vivantes ? Ses frustrations répétitives sont là pour modérer ses prétentions et la magnitude de ses renommées de visionnaire accompli. À côté de ce nécromancien, beaucoup plus pragmatique mais tout de même inscrit dans une orbite similaire d’usage paranormal et avant-gardiste de la rationalité, se dresse le statisticien Roger Mexico dont l’objectif consiste à tester une formule canonique de Siméon Poisson (1781-1840) afin d’anticiper au plus près les coordonnées des frappes aériennes. Il s’agit dans le détail de sur-quadriller le quadrillage déjà effectif de la cité de Londres en attribuant à chaque zone résidentielle un nombre égal de carrés tout en coloriant un carré chaque fois que la létalité d’un air strike a suscité une hécatombe dans telle ou telle residential area. L’art de la statistique est donc supposé fournir une pertinente futurologie des prochaines attaques parce qu’il paraît inconcevable qu’une zone déjà largement éprouvée continue de subir ce qu’une zone jusqu’ici moins éprouvée n’a pas encore subi. En ce sens tout à fait divinatoire où se mêlent indifféremment un protocole méthodique et un pari assez hasardeux, Roger Mexico part du principe qu’il existe un équilibre invisible des bombardements et par conséquent aucune raison valable de s’engager dans la croyance d’une loi des séries qui créditerait un mini-triangle des Bermudes ici ou là dans le Londres ébranlé de la Seconde Guerre mondiale. Sa conviction est d’ailleurs tellement étayée qu’elle apporte du grain à moudre à certains illuminés, amateurs intérimaires de la conspiration et des cinquièmes colonnes, mais aussi à d’autres experts de la paranoïa, recrutés à temps plein pour sublimer l’aliment des récits alternatifs, et toute cette faction d’infatigables annotateurs de bas de page du réel s’entend à dessein de concevoir que les bombes du Troisième Reich – selon toute vraisemblance et au mépris relatif des algorithmes de Poisson – s’abattent davantage à l’Est et au Sud de Londres, spécifiquement sur les quartiers les plus affligés de pauvreté, comme s’il était prévu de rajouter de la calamité à la calamité, comme si les plus fortunés, en outre, détenaient une indiscernable auréole de protection malgré le quotient exterminateur des missiles, des roquettes et des redoutables et inaudibles fusées V-2, celles-ci ne se révélant à l’oreille qu’à la suite de leur infernale explosion (en l’occurrence : si l’on perçoit le bruit de l’explosion, on a la certitude d’être encore de ce monde). Du reste, à l’instar de Geoffrey Prentice et nonobstant quelques réussites isolées, le sacralisateur des nombres nommé Mexico se voit contraint de reconnaître sa flagrante impuissance, au même titre qu’il se désole d’être le témoin d’une «civilisation nécrophile» (p. 260) qui ne sait pas protéger l’amour, qui se délecte d’avoir la cuisse légère avec les forces de la destruction, et cela, d’une manière inexorable, entraîne la profanation de ses sentiments pour son amante Jessica Swanlake dont il redoute par surcroît les déplacements faute d’avoir conquis les arcanes des recherches de Siméon Poisson.
À la fois plus oraculaire que Prentice et plus décisif que Mexico dans son usage des bibliographies scientifiques, le lieutenant américain Tyrone Slothrop incarne un singulier cabinet de curiosités autant qu’un ahurissant surpassement du cryptique socle de compétences de cette maquisarde coalition de talents. À quelque degré que ce soit, de la plus signifiante à la plus insignifiante des appellations, l’onomastique a toujours son importance avec Thomas Pynchon et il est bien évident que si Prentice ne peut aller au bout de ses prérogatives, c’est qu’il n’est – comme son nom l’indique en anglais – qu’un apprenti, un débutant, un manœuvre sur un chantier qui dépend du cerveau des ingénieurs. En ce qui concerne Roger Mexico, son nom de famille aux airs de nation ou de métropole sud-américaine le désigne d’emblée en tant que pièce rapportée au beau milieu d’une Europe distinctement codifiée, en tant que citoyen anglo-saxon à la psyché contrariée par son identité nominale. Quant à Slothrop, il est le ductile métal de la paresse (sloth) et il évolue sur l’onduleuse corde (rope) d’une nonchalance qui le rend d’autant plus déplaisant ou dérangeant qu’il pourrait apporter son substantiel écot à l’effort de guerre plutôt que de se tourner les pouces (encore qu’il faille tempérer cette somnolence à l’aune de ses choix d’action et de ses choix de repos, ceux-ci étant de justes esquives de la guerre quand ceux-là sont d’urgentes déductions sur le malaise de la civilisation). Profitant d’un rarissime voire inégalable don de fakirisme génital, les érections du lieutenant Slothrop seraient prémonitoires vis-à-vis des points de chute des fusées V-2 ou d’une catégorie approchante de torpille planante, de la même façon qu’elles seraient remotivées consécutivement à un impact et en proportion du désastre occasionné (cf. pp. 179-180). En d’autres termes, les surrections de cette verge répondent au schéma d’une continuelle persécution de l’artillerie ennemie car, en effet, si l’artillerie nazie baissait d’intensité ou venait à être mise hors d’état de nuire, la verge elle-même deviendrait hypothétiquement dysfonctionnelle, molle et tristement impassible, l’idiosyncrasique atonie de Slothrop ne lui permettant probablement pas d’être vigoureux en dehors d’une excitabilité surnaturelle (ce qui sera concrètement démenti mais ce qui n’empêche pas d’assigner aux érections de Londres un statut de singularité). Mais sans accorder trop d’égards à ces considérations spéculatives et délibérément extravagantes, il n’en demeure pas moins que l’autorité de Slothrop s’avère intacte et que son enrôlement parmi les très hauts potentiels de la Résistance britannique n’est pas dû au hasard : sa parole compte autant que ce qu’il ne dit pas, son silence vaut un évangile et sa mobilité dans la capitale anglaise est observée à la loupe parce que la moindre de ses stations – surtout s’il est question d’une étape libidinale – est susceptible de figurer le signe avant-coureur d’un bombardement. C’est là que le domaine du génésique entre en conflit avec le domaine du statistique et les commentaires sur Slothrop, souvent à son insu et quelquefois confondus à des ragots, abondent comme s’il était un sujet d’étude aussi fondamental que les prodigieuses formules de Siméon Poisson ou les dernières découvertes de tel ou tel surdoué ou de tel ou tel autiste de haut niveau de vaticination. Ce pénis d’Amérique ouvre quoi qu’on en pense une voie lubrifiée de compréhension au sujet du trajet conjectural des fusées V-2, puis, de fil en aiguille, les directeurs d’études et les hiérarchies apparentées parviennent à déterminer (ou à feindre de le faire) que les saillies de Slothrop précèdent de quelques jours une meurtrière déflagration (cf. p. 151), à moins que, dans certains cas ou dans tous les cas, les saillies soient une affaire d’attraction des fusées davantage qu’elles ne seraient une affaire de prémonition – c’est-à-dire que si le lieutenant n’allait pas se délasser avec des filles, s’il n’allait pas éprouver sa proverbiale oisiveté dans la pratique du sexe, alors il n’y aurait peut-être pas de carnage le lendemain, le surlendemain ou la semaine suivante.
Ce qui est en revanche vérifiable comme preuve tangible des activités du lieutenant Slothrop se limite à une carte de Londres punaisée sur le mur de son logement de caserne. La carte est constellée d’étoiles aux couleurs de l’arc-en-ciel et chacun de ces astres immobiles est associé à une fille conquise à cet endroit exactement notifié. La pigmentation de chaque étoile correspond par ailleurs à la couleur du sentiment manifesté lors de la rencontre (cf. p. 39) et ce n’est que dans un second temps purement exégétique et parfois délirant que les rendez-vous de Slothrop sont reliés au mécanisme érectile et à l’immatriculation des sites catastrophiques des bombardements. Pour Slothrop, pour cet Américain solitaire engagé dans la bataille contre le totalitarisme, les petites amies ne sont que des prescriptions d’instants divertissants «parmi les catastrophes tombées du ciel comme des ordres mystérieux surgis de la nuit et qui n’ont aucun sens pour lui» (p. 40). La furtivité d’une aventure charnelle relève ni plus ni moins d’un dérivatif pour atténuer l’effarant spectacle de «ces ruines où chaque jour il travaille» et qui «sont autant de sermons sur la vanité des choses de ce monde» (p. 43). Cette tendance critique envers la guerre en particulier et envers la nature humaine en général provient d’un héritage de la mentalité familiale qui dame le pion à une hérédité pénienne procurant une «sensibilité à ce qui apparaît dans le ciel» (p. 45). Il est en effet plus intéressant d’argumenter en défaveur de la guerre et des hommes qui en font l’apologie plutôt que de vouloir exploiter une spécificité phallique en devenant un phénomène de foire ou l’assistant dévoué d’une corporation de savants fous. C’est ainsi que le lieutenant Slothrop relativise intérieurement sa participation aux combats – fussent-ils consubstantiels à l’idée d’une guerre juste – et qu’il se souvient de l’aphorisme que ses ancêtres ont transmis à toutes les générations suivantes de son clan : «La merde, l’argent [et] les Mots [sont] les trois grandes vérités américaines qui font marcher la machine» (p. 47). Manière de dire que ce reclus des États-Unis n’est pas dupe à propos de sa patrie et qu’il assume volontiers cette opinion à charge faisant de l’Amérique une semeuse de troubles davantage qu’une semeuse de pacifisme. Et si l’Amérique récolte la guerre, c’est qu’elle a patiemment et méthodiquement semé le grain noir des antagonismes sanglants, et, de surcroît, elle l’a fait avec des alibis financiers et des exercices de sophistique propres à une navrante et sournoise diplomatie. Dans la continuité de cette inculpation de la politique américaine, s’il fallait déplacer la signification des tumescences pubiennes de Slothrop, on pourrait avancer que la guerre n’est qu’une histoire des patriarches dévergondés qui désirent seulement mesurer la longueur de leurs membres durcis et qui ne lèguent à l’humanité que des effigies de pitoyables priapes et des milliers de monuments aux morts. D’où éventuellement cette ironie du chromatisme de l’arc-en-ciel sur la carte londonienne de Slothrop étant donné que ce photométéore a une valeur symbolique de transition, d’unification, de passerelle déployée par de célestes ambassadeurs afin de réunir deux rives concurrentes.
De là s’expliquent les discrets ferments de l’antimilitarisme de Slothrop et son croissant psychisme d’objecteur de conscience ou de réviseur du mouvement officiel de l’Histoire. Que le nazisme soit battu ou soit vainqueur, dans le fond, cela ne sera qu’un priapisme vaincu ou un priapisme triomphant, et, en cas de défaite, l’ithyphallique obscénité des lauréats de la guerre ne fera que poursuivre la macabre fertilisation du monde avec les prétendus moyens de la paix. C’est là une prospective des mystifications de la Pax Americana et à n’entendre que les espérances proférées à l’égard de l’après-guerre, à ne saisir que d’une oreille inattentive les promesses d’un rationalisme gestionnaire des peuples pour «éviter que fût encore possible la fascination exercée par un seul» (p. 124), par Hitler, par Mussolini ou par tout autre minable égocentrique à tropisme dictatorial, on s’aperçoit évidemment que l’on ne ferait que tituber de Charybde en Scylla : la planète se débarrasserait des tyrans organiques pour adopter les habitudes d’un tyran inorganique personnifiées par l’idolâtrie de la technique et la montée du péril managérial initié par le taylorisme. On serait loin – et nous en sommes effectivement loin – d’une réalisation cosmopolitique digne de ce nom. Les leçons tirées des massacres de 1939-1945 ont été honteusement minimes, comme celles tirées des saccages de 1914-1918 au demeurant, et, à parler dans les terminologies de la philosophie hégélienne, les sociétés qui ont suivi ces faillites énormes sont encore plus éloignées de l’Absolu divin qu’elles ne l’étaient avant ou pendant les guerres, tout comme elles sont encore plus distantes d’une substance éthique animée d’un ressort de re-sacralisation. À vrai dire, si l’on devait caractériser les intuitions réfractaires de Slothrop, celles-ci soutiendraient possiblement que le monde de la guerre était encore un monde vivant dérangé par quelques poches de mort, alors que, paradoxalement, le monde qui suivra la guerre, en se soumettant à l’ordonnance des technocraties et des bureaucraties exacerbées, sera un monde mort où ne subsisteront plus que de très rares poches de vitalité.
Il ne faut donc pas s’offusquer de lire que «la guerre véritable» marque son territoire de connivence avec «le culte des marchés» (p. 159). La guerre est une mine d’or pour ceux qui profitent de sa criminalité de masse et il y a toujours eu un beau remariage du Capital et de la guerre aussitôt corroboré le déclenchement d’un conflit. Il s’agit quasiment d’un fait anthropologique : dès que des hommes perdent la vie sur un champ de bataille, d’autres hommes gagnent la leur dans le registre de la spéculation et de la transaction. Le pire, sans doute, c’est que l’horreur phénoménale du sang versé a pour fonction de cacher l’horreur nouménale du profit – l’horreur visible sert à camoufler une horreur invisible bien plus scandaleuse que toutes les satanophanies des charniers. C’est pourquoi la guerre ne se réduit pas au simple monolithe allemand du «ein Volk ein Führer» (p. 194), elle ne se découvre pas sous l’accessible silhouette d’une concrétion du maître et de ses esclaves placés en ordre de bataille, d’une condensation du Mal en attente de la réfutation condensée du Bien, la guerre n’est rien de tout cela parce qu’elle est révélatrice d’une minéralité complexe où se heurtent plusieurs types de matières (la pesanteur des armes et la légèreté des calculs), plusieurs strates de la réalité (la surface de la violence et les abîmes d’une aspiration inconnaissable), jusqu’à produire une volonté bâtarde incessamment affirmative et négative, un entrelacs de pulsions contradictoires, symptomatique, peut-être, d’une énergie aussi primitive que schizophrénique et virtuellement nécessaire à l’avancement de la condition humaine (cf. p. 194). N’est-ce pas là du reste ce que suggérait Jean Jaurès lorsqu’il se demandait si la guerre n’était pas «d’essence divine» et si elle n’était pas l’inattendu véhicule de l’une de ces «forces mystérieuses qui mènent l’humanité vers sa perfection» ? (4) Mais quoi qu’il en soit de cette hybridation de la guerre ou de son ancrage théologique archaïsant, quoi qu’il en soit de cette «diversité apparente des entreprises» (p. 244) où il serait tentant de rechercher un archétype de la barbarie, un point de suture de «la matière et [de] l’esprit» (p. 244) afin d’élucider les instincts caporalistes et d’en finir un fois pour toutes avec ces immolations internationales, la guerre, cette guerre-là, en tant que telle et hors de toute fantaisie conceptuelle, ne peut pas être autre chose qu’un fléau énergivore qui a besoin de charbon et d’électricité, à tel point que le niveau de consommation énergétique a une incidence sur la vitesse des pendules – le temps ralentit sur le cadran des horloges parce que la temporalité de la guerre atteint des sommets (cf. pp. 198-9), parce que le monde est condamné à subir l’Heure hégémonique de la guerre, parce que la mort démesurée en situation de belligérance est le terrifiant résultat d’une guerre qui ne manque jamais de sonner ses vêpres et ses matines. Devant une aussi malheureuse régression de l’humanité, on comprend que la consolation de Dieu ne puisse pas suffire, et, tant qu’à se contenter du spiritisme d’un côté ou de l’autre des belligérants, on tolère que la conscience malheureuse ait pu s’en remettre à une séance de tables tournantes pour convoquer le spectre de Walter Rathenau et l’interroger sur les débâcles du moment (cf. pp. 245-7). Et à la question qui veut savoir si Dieu est «vraiment juif», le fantôme assassiné ne répond pas.
II/ En quoi Tyrone Slothrop peut être comparé à un salutaire conduit de dérivation : redéfinition des enjeux et renversement de quelques valeurs tutélaires
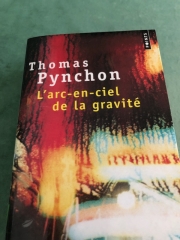 En «permission» dans le Sud de la France (p. 304), peut-être sur la petite péninsule de Saint-Jean-Cap-Ferrat selon les indices littéraires disponibles, le lieutenant Slothrop ne boude pas son plaisir d’avoir pris de la distance avec Londres et de respirer l’air méditerranéen malgré l’escorte de Teddy Bloat et de Tantivy Mucker-Maffick, binôme appartenant à la même communauté de forces spéciales employant les services du polymathe américain. S’agissant de Bloat, sa compagnie sent le soufre de l’enflure, de la boursouflure, le mot anglais bloat renvoyant au lexique du ballonnement mais aussi de l’exagération, somme toute une série de propriétés parfaitement assorties à l’idée que l’on pourrait se faire d’un fonctionnaire de la fonction privée de l’occultisme de guerre. Le cas de Mucker-Maffick est non moins transparent puisqu’il fait retentir les sonorités de ce que la langue anglaise appelle un muckraker, c’est-à-dire un fouineur, un indiscret, un fouille-merde dont le nez ne craint pas de renifler quelques égouts de l’Histoire afin d’entretenir les fantasmes d’un état-major aux fourbes et déconcertantes intentions. Pas du tout naïf sur cet accompagnement et même plutôt prédisposé à jeter un œil soupçonneux sur ses acolytes, le méfiant Slothrop se moque de passer pour un ingrat ou un misanthrope envers ses collègues. Il est à ce titre comparable au philosophe nietzschéen qui se donne «le devoir de se méfier» et «de darder sur le monde, du fond de tous les gouffres du soupçon, le regard le plus malintentionné» (5), fût-ce dans le but de douter davantage de son camp que du camp à combattre. De sorte que le permissionnaire yankee se tient sur ses gardes sans être crédule d’un système qui paraît consolider ses machinations pour l’espionner. Les visées d’une telle systématicité inquisitrice reviendraient à soutirer de ses faits et gestes un exhaustif dossier concernant ses dons érectiles putatifs et les manières de les exploiter à son insu, abstraction faite, en outre, du supposé double dealing de cet auxiliaire d’Amérique auquel on impute des prébendes extra-génitales lors de ses distrayantes escapades. Et pour tromper les soi-disant barbouzes, lesquels, en réalité, le sont à divers degrés d’implication au gré de labyrinthiques organigrammes de surveillance (cf. p. 313), Tyrone Slothrop se glisse adroitement dans le décor balnéaire, ne négligeant rien de son mandat de collecteur d’informations sur les fusées V-2 et autres acérés cylindres à tête foudroyante afin de coller à la définition instituée de son rôle. Ces jeux réciproques de scepticisme – où chacun est présumé coupable de ne pas être tout à fait ce qu’il est – renforcent une grandissante atmosphère de paranoïa et ne cessent également d’ajouter des corridors, des fausses pistes et des passages secrets au sein du convulsif récit de la Seconde Guerre mondiale. En témoigne la massive architecture du Casino Hermann Goering sur le littoral de la Côte d’Azur à l’intérieur et aux environs duquel vont se tramer de supplétives annotations de ce récit à la fois rigoureux et délirant (tantôt fidèle aux chronologies établies, tantôt tordu par l’exubérance de la fiction), un établissement de jeux de hasard dont la dramaturgie cotise pour l’accentuation de tous les troubles jeux inhérents aux interactions sociales et touchant à la profusion des protagonistes mis en scène par l’un des écrivains les plus indéchiffrables de notre ère. Dirigé par un certain César Flebotomo, factotum d’une furonculeuse époque jouant les prolongations, le Casino Goering maintient à flot les relents d’un increvable nazisme malgré la Libération qui a d’ores et déjà délivré la France d’une partie des tumeurs hitlériennes (cf. p. 270).
En «permission» dans le Sud de la France (p. 304), peut-être sur la petite péninsule de Saint-Jean-Cap-Ferrat selon les indices littéraires disponibles, le lieutenant Slothrop ne boude pas son plaisir d’avoir pris de la distance avec Londres et de respirer l’air méditerranéen malgré l’escorte de Teddy Bloat et de Tantivy Mucker-Maffick, binôme appartenant à la même communauté de forces spéciales employant les services du polymathe américain. S’agissant de Bloat, sa compagnie sent le soufre de l’enflure, de la boursouflure, le mot anglais bloat renvoyant au lexique du ballonnement mais aussi de l’exagération, somme toute une série de propriétés parfaitement assorties à l’idée que l’on pourrait se faire d’un fonctionnaire de la fonction privée de l’occultisme de guerre. Le cas de Mucker-Maffick est non moins transparent puisqu’il fait retentir les sonorités de ce que la langue anglaise appelle un muckraker, c’est-à-dire un fouineur, un indiscret, un fouille-merde dont le nez ne craint pas de renifler quelques égouts de l’Histoire afin d’entretenir les fantasmes d’un état-major aux fourbes et déconcertantes intentions. Pas du tout naïf sur cet accompagnement et même plutôt prédisposé à jeter un œil soupçonneux sur ses acolytes, le méfiant Slothrop se moque de passer pour un ingrat ou un misanthrope envers ses collègues. Il est à ce titre comparable au philosophe nietzschéen qui se donne «le devoir de se méfier» et «de darder sur le monde, du fond de tous les gouffres du soupçon, le regard le plus malintentionné» (5), fût-ce dans le but de douter davantage de son camp que du camp à combattre. De sorte que le permissionnaire yankee se tient sur ses gardes sans être crédule d’un système qui paraît consolider ses machinations pour l’espionner. Les visées d’une telle systématicité inquisitrice reviendraient à soutirer de ses faits et gestes un exhaustif dossier concernant ses dons érectiles putatifs et les manières de les exploiter à son insu, abstraction faite, en outre, du supposé double dealing de cet auxiliaire d’Amérique auquel on impute des prébendes extra-génitales lors de ses distrayantes escapades. Et pour tromper les soi-disant barbouzes, lesquels, en réalité, le sont à divers degrés d’implication au gré de labyrinthiques organigrammes de surveillance (cf. p. 313), Tyrone Slothrop se glisse adroitement dans le décor balnéaire, ne négligeant rien de son mandat de collecteur d’informations sur les fusées V-2 et autres acérés cylindres à tête foudroyante afin de coller à la définition instituée de son rôle. Ces jeux réciproques de scepticisme – où chacun est présumé coupable de ne pas être tout à fait ce qu’il est – renforcent une grandissante atmosphère de paranoïa et ne cessent également d’ajouter des corridors, des fausses pistes et des passages secrets au sein du convulsif récit de la Seconde Guerre mondiale. En témoigne la massive architecture du Casino Hermann Goering sur le littoral de la Côte d’Azur à l’intérieur et aux environs duquel vont se tramer de supplétives annotations de ce récit à la fois rigoureux et délirant (tantôt fidèle aux chronologies établies, tantôt tordu par l’exubérance de la fiction), un établissement de jeux de hasard dont la dramaturgie cotise pour l’accentuation de tous les troubles jeux inhérents aux interactions sociales et touchant à la profusion des protagonistes mis en scène par l’un des écrivains les plus indéchiffrables de notre ère. Dirigé par un certain César Flebotomo, factotum d’une furonculeuse époque jouant les prolongations, le Casino Goering maintient à flot les relents d’un increvable nazisme malgré la Libération qui a d’ores et déjà délivré la France d’une partie des tumeurs hitlériennes (cf. p. 270). Non loin de cette gambling zone où alternent les cathartiques clartés azuréennes et les ombres de la «lumière grise» (6) d’une paix ambiguë, dans le petit bain des brisants où les baigneurs aiment à se reposer entre deux nages, une surprenante agression menace la vie d’une femme séduisante (cf. pp. 272-6). Mû par un élan de secouriste, endossant le stéréotype de l’Américain proactif, le vigilant Slothrop se met à l’eau et tel un émérite loup de mer dompte une pieuvre hugolienne dotée d’une suspecte violence. La femme sauvée du sensationnel céphalopode s’appelle Katje Borgesius et Slothrop a pressenti son cabotinage de minette en danger autant qu’il a subodoré les insolites subterfuges du poulpe. Il a encore une fois visé juste dans la mesure où l’irascible pieuvre dérive d’un projet digne du docteur Moreau de H. G. Wells ou de tout autre sinistre trafiquant de l’ordre naturel fictif ou existant, un projet d’ailleurs piloté par Ned Pointsman ou littéralement par Ned l’Aiguilleur en version française, l’ambitieux et mégalomane médecin pavlovien se prenant pour un aiguilleur du ciel de l’atavisme depuis qu’il a modifié avec succès la génétique du tentaculaire animal. Baptisée du soviétique prénom de Grigori, la pieuvre géante et comédienne est la rumeur phonétique d’un conglomérat d’influences, d’un indéfinissable réseau d’intelligences, avec, en ligne de mire, la psychose d’un complot russe et d’un scientisme originaire de l’Est paré du plus mauvais effet de façade. Dressée pour la conspiration, la pieuvre Grigori était chargée de leurrer Slothrop aux fins de le rapprocher de la taupe Borgesius, et cette dernière, en professionnelle des missions d’infiltration, était chargée de contrefaire la détresse en s’ajustant à l’offensive mais innocente chorégraphie du poulpe duplice. Le scénario et les acteurs de cet assaut minutieusement simulé ont été respectivement écrit et entraînés à la maison-mère d’un mirobolant Bureau du Renseignement Parallèle, une espèce d’aberrante combinatoire de MI-5 et de MI-6, une loufoque élongation de toutes les sections de la Military Intelligence britannique, synchronisée au nom de code suivant et passablement évocateur de sortilèges : The White Visitation. Entre les murs de cette forteresse de l’expérimentation extrême et de l’élucubration intempérante élevées au rang d’indiscutables piliers d’un règlement intérieur de la dérégulation totale, éhontée, criminelle, l’orgueilleux Pointsman, directeur tyrannique des aiguillages du déraillement planétaire, connaît la «solitude d’un Führer» (p. 392). Il monopolise les champs de la théorie et de la pratique, usant et abusant de ses grades et qualités, redoublant d’efforts parasites pour se livrer aux pires tentatives sur les animaux et sur les humains, confrontant les uns et les autres à la folie de sa suffocante sottise de morticole s’imaginant qu’il est un Esprit universel détenant un droit de cuissage sur le Tout de la Création (cf. pp. 327-340). Les inspirations élémentaires du sagace Ivan Pavlov sont ce faisant détournées en licencieuses démarches urologiques et scatologiques dont on a de la peine à saisir les tenants et les aboutissants, sinon qu’ils sont l’œuvre d’un dément, d’un torrentiel pédant qui voudrait proclamer que la science a le privilège de toutes les strates de la vérité, qu’elle est un levier plus puissant que la guerre, qu’elle est même le nutriment essentiel de la guerre et qu’elle continuera une guerre latente à la suite de la guerre patente parce qu’il est du devoir de cette élite invisible de «tenir l’humanité à un niveau d’angoisse convenable» (p. 353) afin de préparer les consciences à toutes les exactions de la politique – à tous les seuils de médiocrité.
Cette terrifiante absurdité cumulative et problématique se redistribue ensuite au cœur même du Casino Goering où Slothrop entreprend de culbuter la trop consentante Borgesius et de remettre le couvert en dépit de ses réticences à fréquenter la vraisemblable complice d’une vraisemblable organisation cabalistique et nuisible à l’harmonie de la vie (cf. pp. 286-8). Cet épisode voluptueux introduit un enchaînement de péripéties burlesques pendant lesquelles Slothrop fortifie sa certitude d’être un dindon de la farce. Mais outre le fait que Katje Borgesius ait tous les attributs de l’ennemie travestie en partenaire accommodante, il n’en découle aucune conclusion hâtive parce que Slothrop est davantage convaincu que cette indicatrice de contenance batave n’est pas une ennemie centrale. L’épicentre de l’hostilité se trouverait plutôt «quelque part dans Londres» (p. 301) à l’intersection d’une fatale quantité de maléfices, ou, pire encore, «dans les laboratoires américains» (7). En d’autres termes, sur l’immense toile tissée par une araignée de race inconnue et s’étendant sur toute l’Europe et sur une large superficie du reste du monde, la présence de Katje avoisine celle d’un prédateur subalterne, celle d’un second couteau à huit pattes velues commissionné depuis le quartier général de l’aranéide en chef. Toujours est-il que Slothrop, dans le sillage de Katje, se promène un peu partout parmi les entrailles du Casino Goering, en retirant de ces viscérales déambulations la désagréable impression de commettre une «violation du Monde interdit» (p. 295), d’approcher d’une source secondaire du Mal qui serait un tremplin vers la source primordiale des ténèbres. Il circule en effet de chambre en chambre, de secteur en secteur, évoluant dans ce bâtiment ludique et hôtelier en fonction des possibilités offertes par de «longues pièces», en l’occurrence des salons où stagnent «des paralysies anciennes [distillant] le mal» (p. 295), spectrale macération de narcissiques revenants qui ont dépensé des fortunes pour risquer un numéro à la roulette ou pour simplement – effroyablement – se divertir chaque fois que les événements historiques ont autorisé une caste à venir flamber l’argent d’une guerre ou d’une malédiction afférente dès l’instant où – bien entendu – les remparts du Casino Goering ont été solennellement ou pompeusement inaugurés. Il est ainsi légitime que Tyrone Slothrop se demande à quel jeu tous ces gens – Katje Borgesius et ses très probables supérieurs de Hollande ou d’Angleterre ou des Nostalgiques Territoires de la Prusse – sont en train de jouer au-delà de l’ostensible mobilier de la délassante contingence où les tapis verts se disputent la vedette avec les bandits manchots (cf. p. 295). Quels sont les gambits pratiqués dans les coulisses et qu’est-ce qu’ils induisent sur l’échiquier des associations ou des coopérations internationales ? Quels paris sont décidés sans vergogne au détriment de la vie humaine ? Ce sont autant de questions judicieuses qui noircissent le bloc-notes interne de Slothrop et qui rendent son doute hyperbolique à propos de ses deux collègues de travail. Il est évident qu’une guerre d’une nature autrement plus mesquine s’esquisse par-delà les ravages de la guerre principale qui préoccupe les journaux. Il y a une guerre dans la guerre, un dépôt de nuisance insoupçonné sous le courant superficiel de la nocivité, une variante de l’Occupation gisant sous les confuses promesses de la Libération, comme un genre de Léviathan qui n’aurait plus réellement de force dissuasive manifeste, mais, tout au contraire, une force instruite par sa fausse absence, une force tranquille nourrie par les crypto-fomentateurs de l’Histoire. Du sommet à la base d’une maçonnique pyramide de la sécrétion du Secret, on aurait alors, par ordre d’apparition ou de capacité de dissolution, les grandes instances d’une Grande Inquisition dépassant toutes les limites imaginables et leurs serviteurs dévoués dispersés de par le monde en factions dogmatiquement dirigées, pour chacune d’entre elles, par un «sous-fifre zélé» (p. 307) dont le curriculum vitae pourrait par exemple être celui d’une Katje Borgesius.

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, thomas pynchon, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































