Rechercher : alain soral
Dominique de Roux, immédiatement !

Dans ces lignes qui mélangent attente de l’eschaton et révélation de la réalité, le romancier se montre le direct continuateur de Bloy à l’évidence mais aussi de Bernanos : seul peut encore nous sauver un cataclysme qui par son ampleur balaiera la boursouflure du monde contemporain, position éminemment apocalyptique qui ne s’accorde que bien rarement (pour ne pas dire : jamais) avec la politique de nains telle que la conçoivent la majorité des dirigeants occidentaux. Si ce devait être le cas, il faudrait imaginer comme l’a fait Walter Benjamin dans ses dernières méditations sur l’Histoire un bouleversement non seulement politique mais à l’évidence eschatologique qui, à dire vrai et dans un passé fort récent, a bien failli tout emporter avec la rage suicidaire d’Hitler. Mais cela encore n’est rien, les millions de victimes de la Seconde Guerre mondiale sont comme un fétu lorsque l’on songe au véritable djihad que lancera sur la terre Celui qui, dans l’esprit enfiévré de Bloy, n’était pourtant que l’annonciateur du Christ de la fin des temps. Frank Herbert a compris cela dans son cycle arrakien, qui mentionne plusieurs razzias d’échelle cosmique, dont celle qu’il appelle le djihad butlérien: l’humanité est contrainte de se régénérer par la guerre, position qui fera jauni d’un coup l’atoll placide des bien-pensants, position presque toujours illustrée par la littérature et le cinéma d’outre-Atlantique, très rarement par nos propres œuvres, plus préoccupées par le fait insigne de décortiquer l’appareil sexuel de nos contemporains. Pourquoi ? La réponse la plus évidente mais aussi celle qu’il sera sans doute impossible d’expliquer à nos concitoyens déchristianisés, que dis-je, dédouanés de toute forme d’inquiétude spirituelle, consisterait à affirmer, banalement, que l’Amérique du Nord, pour le pire et le meilleur (et le meilleur qui naîtra par le pire, sentence hölderlinienne presque parfaite), est une nation apocalyptique, à l’image d’ailleurs de sa littérature dont à mon sens le génie visionnaire (au sens premier du terme) a une fois pour toutes été quintessencié par William Faulkner, d’ailleurs admiré par Dominique de Roux.
À propos de : Rémi Soulié, Les châteaux de glace de Dominique de Roux, Lausanne (L'Âge d'Homme, coll. Les Provinciales), 1999. Les pages entre parenthèses renvoient à l’édition indiquée.
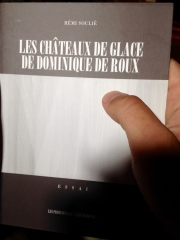 Acheter Les châteaux de glace de Dominique de Roux sur Amazon.
Acheter Les châteaux de glace de Dominique de Roux sur Amazon.Comme Boutang naguère et comme jadis Bloy dans son tonitruant Journal que Pierre Glaudes vient de rééditer (ces lignes furent écrites en 1999), Rémi Soulié a de ces emportements nourriciers dans son livre, le quatrième déjà de la collection dirigée par Olivier Véron. Après tout, cette violence est salutaire, car, comme l'auteur qu'il choisit de présenter l'a écrit, «il n'y a pas de littérature sans la fascination de la chose unique, sans le vertige d'une seule attention». Ce petit ouvrage aussi tranchant que l'arrête de glace (peinte par Gérard Breuil) qui orne sa couverture, est un livre pressé d'en finir comme il a commencé, la liberté des derniers lieux sauvages fréquentés par quelques barbares présidant aux résurrections tutélaires convoquées dans son incipit : «Je ne crois plus qu'au maquis, dit-il, aux cénacles et aux catacombes pour échapper à la bulle gloutonne de ce qu'il faut exactement appeler la chambre stérile du monde où s'affairent» ces «fanatiques de la nullité» dont parlait De Roux dans une lettre à Abellio (p. 16).
Sans doute Soulié a-t-il trouvé l'endroit propice aux méditations sauvages et au style qui éperonne, comme la sorcière, selon Michelet, qui ne pouvait naître que dans les landes recouvertes de ronces, d'où elle allait lancer sur le monde des sots à découvert ses philtres de destruction les plus puissants. De Roux écrit dans son Ouverture de la chasse que la «liberté, aujourd'hui est dévastation». J'ajouterai qu'elle ne peut être que cela, ruine. Ruine et errance, quête errante d'absolu, comme le combat mené par l'écrivain, selon Soulié, pour «la Dame Beauté», qui prendra «toutes les formes extrêmes, politiques, religieuses, physiques». «La laideur, ajoute l'auteur, ce n'est rien d'autre que la tiédeur» (p. 74), car la beauté, comme chacun le sait parfaitement ou devrait s'appliquer bien le savoir, étant toujours extrême comme la métaphysique, est de droite selon De Roux. Notez que je parle de la droite idéale, c'est-à-dire métaphysique, non pas de celle qui afflige notre patience, droite bien-pensante, veule, aguicheuse et stupide.
De Roux est extrême, sans doute, comme Rimbaud exposant son dérèglement systématique de tous les sens. Mais cet extrémisme est d'abord critique lancée contre la déchéance métaphysique dans laquelle l'Occident a sombré sous les yeux de quelques veilleurs. Ainsi l'auteur du Livre nègre eût pu faire sien, comme Rimbaud, pareil engagement de forcené du verbe, avant d'encalminer son étrave bleue dans la chaleur vacante, non pas, cette fois, celle du Harare (devenu avec Alain Borer le Saint-Tropez des touristes bigleux), mais celle de la tremblante image d'un Portugal mystique, à jamais refusé, jadis rêvé par le Père Viera dans ses superbes visions. L'un et l'autre de ces impeccables écrivains, Rimbaud et De Roux, ont oublié une de leurs jambes, restée prisonnière dans la gangrène de la tourbe européenne, cette infecte saumure paralysant les nerfs du poète, comme un dernier croc-en-jambe qu'aurait fait la médiocrité au voyant erratique, un coup bas assené dans le ventre de ce père sans descendance, qui a pourtant enfanté chacun des écrivains majeurs de notre siècle. Quant à celle de De Roux (écrivant justement dans ce livre païen qui fut l'un des premiers titres d'Une Saison en enfer !) : «L'Europe ne valait guère mieux soumise à la matière et au conformisme de la quantité; le génie rapetissé à l'intelligence pratique gouverné par le qu'en-dira-t-on. Payez le prix et les médias vous mettront dans la poche l'opinion publique qui, elle, croira toujours que cette vérité fabriquée, maîtresse de l'instant, est d'origine divine», ce membre remarquable qui fit de cet homme un flaireur, un découvreur (plus : un véritable nommeur, selon la définition qu'en donnait Nietzsche), un marcheur hors-pair s'aventurant à la rencontre de génies de l'écriture encore méconnus ou conspués à son époque, c'est bel et bien la bassesse rampante de la finance-spectacle qui a paralysé son formidable élan.
De sorte que, nous devions nous y attendre, ce ne sont pas les éructations du Dies Irae qui ont secoué le monde vain des hommes creux et qui ont emporté dans leur ire la protestation ivre de Dominique de Roux, mais l'espèce de consternante mollesse dans laquelle se prélassent les satrapes des fins d'empire, ces louvoiements de croupes où l'on devine la présence des âmes perverses : «Le monde a été conçu dans le feu, écrit ainsi superbement l'auteur de L'Harmonica-Zug, vient du feu et y retournera. Mais dans les sentiers du feu, une certaine décadence d'émeraude, symbole de la trahison vipérine du doute, de l'éternelle contestation du néant, détourne le feu de ses prolonges d'acier, vers les cloaques délicieux qui sont à la Jérusalem céleste de nos enfances rimbaldiennes, ce que sont aujourd'hui à Istamboul, les harems à poufiasses couvertes de pierreries creuses pour touristes aveugles»
«Mais dans les sentiers du feu»... Ce sont bien eux, et non pas les torves marécages de la «trahison vipérine du doute», les louches mastroquets où Sollers tient conférence devant son miroir à l'eau moussâtre et verdeuse, ce sont bien eux, ces derniers lieux de pudeur et de franchise réservés aux hommes de parole, ce sont bien ces chutes d'eau vive que la prose agitée de Rémi Soulié est rageuse de trouver pour en rejoindre l'éternel fracas et s'y consumer.
18/05/2004 | Lien permanent
Syntaxe ou l'autre dans la langue de Renaud Camus

17/11/2004 | Lien permanent
Les nœuds de paille, par Dominique Autié

Fidèle à sa façon d'écrire (dois-je préciser qu'elle est éminemment réfléchie ?), Dominique Autié m'a fait parvenir une lettre ayant trait à la fonction de nos blogs.
 Cher Juan, voilà qu’à plusieurs reprises, ces derniers temps, vous avez évoqué dans la Zone et dans vos messages quelle fatigue, source potentielle de lassitude spirituelle, suscite une présence rigoureuse sur la Toile. Faute d’être en mesure de vous contredire sur ce point, vous proposer, ainsi qu’à nos lecteurs et aux solitaires des îlots proches, un instant de recul pour mieux discerner les fonctions de cet effort est ce que je peux faire de plus urgent.
Cher Juan, voilà qu’à plusieurs reprises, ces derniers temps, vous avez évoqué dans la Zone et dans vos messages quelle fatigue, source potentielle de lassitude spirituelle, suscite une présence rigoureuse sur la Toile. Faute d’être en mesure de vous contredire sur ce point, vous proposer, ainsi qu’à nos lecteurs et aux solitaires des îlots proches, un instant de recul pour mieux discerner les fonctions de cet effort est ce que je peux faire de plus urgent.J’esquisse ici, sans les hiérarchiser, trois directions, trois pistes. Il en est d’autres, je veux le croire. Celles-ci me paraissent les plus remarquables dans leur évidence. Hors d’un espace médiatique verrouillé de toutes parts, elles semblent constituer notre premier cahier des charges. Je m’efforcerai de les introduire ou de les illustrer d’un exemple précis.
• – Célébrer. J’apprends vendredi dernier, en consultant le carnet du Monde, que Josette Rey-Debove est morte subitement le mardi précédent, 22 février. Linguiste et lexicographe, elle est (entre autres travaux et publications) coauteur avec son mari, Alain Rey, du Grand et du Petit Robert, un chantier qu’ils ouvrent ensemble en 1953 à Alger. La notice nécrologique du Monde est sans reproche, glaciale. Or, il convient, faisant métier de l’écriture et passion de la langue, de célébrer cette femme. J’y vois une sorte de devoir moral.
Nous savons aujourd’hui ce qu’il en est des célébrations : un conservateur général du Patrimoine, rattaché à la direction des Archives de France, a le titre de Délégué général aux célébrations nationales et publie, à l’usage des collectivités locales de tout poil, un annuaire assez richement illustré où sont effectivement recensées les personnalités et les événements de l’Histoire susceptibles d’être commémorés l’année suivante : mémoire d’État, variante à peine plus subtile que le JT de 20 heures du formatage du parc humain.
L’hommage, le mémoire et la déploration, les lettres d’amour et jusqu’aux objurgations de la juste colère – tous modes bannis par l’asepsie consensuelle, qui exigent de se tenir droit pour les écrire ou les proférer – peuvent être de pures célébrations. Il semblerait que ce soit l’un des premiers usages que l’Homme ait assigné à la langue dès que celle-ci vint irriguer sa présence au monde. Irriguons la Toile de nos célébrations !
• – Vous avez insisté à juste titre sur le fait que la Zone a été le seul média qui mit en écho, dans leur dimension métaphysique, le tsunami du 26 décembre 2004 et, en janvier, la descente de la sonde européenne Huygens dans l’atmosphère de Titan. Le désastre d’Asie a suscité une dispute entre Francis Moury et Serge Rivron, assortie d’autres contributions de visiteurs ou familiers de la Zone, qui n’aurait trouvé nul autre espace pour éclore ni, surtout, se propager à six reprises.
Ni thèses d’État, ni prospectus promotionnels aux ordres de quelque régie, nos chroniques partagent cette particularité de ne jamais s’en tenir à l’espace confiné de leur sujet apparent, mais d’ouvrir sur les toits – pensées de plein vent, rapprochements non convenus d’œuvres hors-champ, convocations nominales abruptes, liens éloquents. La Zone est aussi, en ce sens, un tonique Château des courants d’air (j’emprunte un instant le titre du beau recueil que Jacques Réda a consacré aux grandes gares parisiennes).
Je retiens toutefois une autre référence, plus féconde en la circonstance, me semble-t-il. Réfléchissant ces jours-ci sur la fin de vie du Saint-Père, m’est revenu un texte insolite de Roger Caillois dans lequel il relate les propos de Marcel Mauss, dont il fut l’élève, sur l’étymologie du mot «religion» et le sens de «pontife» : pontifex est, non le passeur, mais le constructeur de ponts – architecte, ingénieur, mais aussi tâcheron, précise Caillois, grand pontonnier (je donnerai bientôt à lire ce texte troublant, dans une chronique à venir).
Dans le plus strict respect de l’étymologie, payer de sa personne pour jeter ainsi les ponts qui relient la Zone aux territoires périlleux de l’inhumain, c’est pontifier.
 • – Voir. Je m’adosse ici sur un passage décisif, à mes yeux, du premier volume du Théâtre des opérations – Journal métaphysique et polémique 1999, de Maurice G. Dantec ; j’ai tenté de n’en retenir que l’essentiel, pour sa compréhension, renonçant surtout à le paraphraser : «[…] l’écrivain doit impérativement soumettre l’Homme à la question, il doit torturer la mémoire de l’humanité et déjà pour commencer celle du XXe siècle afin de lui faire accoucher ses projets secrets concernant le futur, c’est-à-dire notre présent, il doit faire de même avec la réalité présente afin de lui faire avouer ses plans occultes pour l’avenir, et il ne doit pas avoir peur d’interroger directement cet avenir, qui seul, bien sûr, contient l’explication du passé.» Et Dantec de conclure : «Le travail de l’écrivain du XXIe siècle sera donc celui d’un archiviste prospectif et transfictionnel. Opérant sur les lignes de césure et de soudure entre les différents cryptages de la réalité, les différentes actualisations du monde humain et naturel, il devra mettre en évidence quelques figures singulières susceptibles d’en produire une généalogie pertinente, sans avoir peur de mêler réalité et fiction, y compris la plus débridée, et de la façon la plus dangereuse qui soit, puisque c’est précisément cela dont il s’agit : assembler un explosif métaphysique qui prenne corps littéralement dans le “matériel” humain» (pp. 197-198).
• – Voir. Je m’adosse ici sur un passage décisif, à mes yeux, du premier volume du Théâtre des opérations – Journal métaphysique et polémique 1999, de Maurice G. Dantec ; j’ai tenté de n’en retenir que l’essentiel, pour sa compréhension, renonçant surtout à le paraphraser : «[…] l’écrivain doit impérativement soumettre l’Homme à la question, il doit torturer la mémoire de l’humanité et déjà pour commencer celle du XXe siècle afin de lui faire accoucher ses projets secrets concernant le futur, c’est-à-dire notre présent, il doit faire de même avec la réalité présente afin de lui faire avouer ses plans occultes pour l’avenir, et il ne doit pas avoir peur d’interroger directement cet avenir, qui seul, bien sûr, contient l’explication du passé.» Et Dantec de conclure : «Le travail de l’écrivain du XXIe siècle sera donc celui d’un archiviste prospectif et transfictionnel. Opérant sur les lignes de césure et de soudure entre les différents cryptages de la réalité, les différentes actualisations du monde humain et naturel, il devra mettre en évidence quelques figures singulières susceptibles d’en produire une généalogie pertinente, sans avoir peur de mêler réalité et fiction, y compris la plus débridée, et de la façon la plus dangereuse qui soit, puisque c’est précisément cela dont il s’agit : assembler un explosif métaphysique qui prenne corps littéralement dans le “matériel” humain» (pp. 197-198).Voir n’est donc pas à prendre ici à la légère : regards à longue portée de sonde intersidérale, aux confins de la voyance. L’exemple que je retiens est minuscule, immodeste et saisissant : je consacre il y a quelques jours une brève chronique aux Lettres des deux amants (quasi assurément Héloïse et Abélard) dont une traduction française assortie du texte latin vient de paraître chez Gallimard. Je la conclus par cette notation : Cette langue d'amour est à ce point intemporelle que je me prends à rêver qu'elle nous parvient d'un espace-temps qui aurait volé en éclats – j'entends : que, par la magie d'une brèche, elle soit d'amants à venir, en aval, en avant de nous sur la flèche de notre temps bien trop humain. Je reçois, quelques jours plus tard, un courrier électronique de Sylvain Piron, l’éditeur de ces lettres (dans l’acception rigoureuse de cette fonction, à savoir celui qui a en a établi le texte, traduit, annoté et préfacé l’ensemble) : «Je n'ai voulu donner qu'un commentaire d'historien, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de situer ce document. L'affaire est en soi presque un roman. Mais c'est là le domaine de la prose. Pour bien distinguer les genres, je me suis abstenu de tout commentaire sur les lettres comme document poétique, préférant les laisser parler d'elles-mêmes. De ce point de vue, ce que vous dites de leur caractère intemporel est très juste. C'est précisément ce que j'ai visé dans l'opération de traduction : rendre ces lettres présentes, mais surtout, plus encore, les rendre disponibles. En ce sens, je pensais déjà à ces amants à venir, à l'avenir de la langue et de l'écriture, en rêvant à une très improbable renaissance du XIIe siècle. Je suis ainsi particulièrement troublé que vous ayez pu ressentir cette intention cachée.»
La différence de portée (ou, plus justement, de proportions) entre l’injonction magnifique et impérieuse de Dantec et la connivence singulière qui s’est imposée, grâce au blog, entre ma lecture et la démarche secrète de Sylvain Piron n’est qu’apparente : avec les Lettres des deux amants, c’est le vent violent du désir qui secoue la Toile – et je ne sache pas que Dantec récuse, où que ce soit dans son œuvre, cette énergie-là pour conduire ses travaux d’Hercule et inspirer les nôtres.
Célébrants et pontifes, voyants… S’honorer de telles charges ne vaudra sans doute pas, aux quelques-uns que nous sommes, un afflux massif de faux amis (nous les traquons assez dans la langue). Persistons et signons, voulez-vous, quel qu’en soit le prix. Car il en va peut-être (pas moins) d’un exercice nouveau de religio – et je pèse les mots : religere, «nouer des nœuds de paille», affirmait Mauss à Caillois, ces nœuds qui servaient à fixer entre elles les poutres des ponts.
NDJA : La seconde photographie dans le corps de la note m'a été envoyée par Dominique Autié alors qu'il était malade et alité.
30/05/2014 | Lien permanent
Avec Benny Lévy de Rémi Soulié

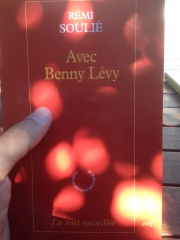 Acheter Avec Benny Lévy sur Amazon.
Acheter Avec Benny Lévy sur Amazon.À propos de Avec Benny Lévy de Rémi Soulié paru aux éditions du Cerf dans la collection La nuit surveillée / Philosophie politique et morale dirigée par Chantal Delsol, 2009.
Une fois de plus, comme il l'avait fait avec Charles Péguy, c'est un écrit de combat que Rémi Soulié nous donne, avec cette belle méditation consacrée à Benny Lévy, que nous avons «tout intérêt à entendre», «hébreu, seul, depuis l'autre rive du Jourdain» (p. 20).
Les toutes premières pages du livre de Soulié évoquant le lien indéfectible qui unit Athènes et Rome avec une fébrilité parfois toute proche d'une écriture devenue fièvre (et dont les sautes de température sont donc imprévisibles), mentionnant les efforts que fit, selon Lévy, le «réactionnaire Platon» (1), en véritable katechon, pour «retenir l'avènement mortifère de la législation positive ou, si l'on préfère, de la légalité» (p. 24), mériteraient, tant elles me semblent constituer un bréviaire de ce que nous pourrions appeler une écriture à cran d'arrêt (2), d'être citées in extenso.
Je me contenterai de recopier ce court passage (p. 38) : «Le fils des Lumières émancipé – devenu majeur et kantien – a gagné son autonomie (alors qu’il faut toujours rester enfant et «téter la parole de l’origine» auprès de sa grand-mère ou de sa nourrice); affranchi de l’ordre théologico-politique (dont je rappelle qu’il est somme toute, pour Benny Lévy, synonyme de démocratie laïque – cet affranchissement n’est donc qu’un leurre) ou des mitsvot (commandements), il bricole, mi-Prométhée, mi-Frankenstein, une petite religion civile à sa mesure de dernier homme (il pressent qu’il en a tout de même besoin, à la fois pour que la «dissociété» (Marcel de Corte) ne s’écroule pas tout à fait et pour que les barbares soient encore un peu contenus avant que ne lâchent complètement les digues politiques et psychiatriques. Présentement, la nôtre s’appelle droits de l’homme et Shoah – Benny Lévy parle aussi de la «vulgate libérale»).»
Ce style peut hérisser, ces phrases qui se tortillent, s'interrompent, se brisent même puis reprennent, comme quelque animal fabuleux, le cours de leur patiente reptation, faire peur. Certes encore, pareille écriture est parfois quelque peu artificielle, Soulié cherchant, finalement, à tout dire en une seule phrase monstrueuse et ne parvenant, souvent, qu'à en dire beaucoup trop. Elle ne peut toutefois durablement rebuter celui qui considère qu'un livre est comme un labyrinthe de fête foraine, aux glaces transparentes : parfois, nous pouvons nous cogner à l'une de ses parois alors que nous pensions la voie ouverte mais, toujours, nous voyons, derrière le mur de verre, une réalité tentatrice, toute proche, diffractée, déformée : d'autres noms, une multitude de noms, d'autres livres et la certitude que Soulié, par ses phrases syncopées, frôle le bel hermétisme de celui qui a ruminé les écrits de ses maîtres, lui qui semble nous dire que si vous ne savez rien des textes de Boutang ou de Péguy, autant ne pas le lire et passer son chemin, la fausse clarté qui n'est que simplisme sera ailleurs, dans les pages d'un Badiou sans doute. J'avoue aimer cette morgue qui, après tout, n'est rien de plus que le respect le plus conséquent de la figure, si irréelle, du lecteur, renvoyé à son échec, à ses lacunes criantes : la voie des maîtres et des meilleurs essayistes qui en sont bien souvent les meilleurs commentateurs est de nous rappeler qu'il nous manque toujours ce livre-ci, puis cet autre et encore celui-là, et de le faire dans un style qui n'est point celui de celles et ceux qu'ils ont lus.
Charles Maurras et son génial héritier, sans doute le dernier très grand polémiste que la France a connu, Pierre Boutang, Charles Péguy aux livres duquel il faut décidément toujours revenir mais aussi, bien sûr, Jean-Paul Sartre, cordialement détesté en tant qu'incarnation de l'impuissance et du rien (possédé, écrivait de lui, dans un extraordinaire brûlot, Boutang...), ectoplasme invoqué aux tables tournantes du refus ontologique de la paternité, Alain Badiou, convié par Soulié à lire correctement les textes de saint Paul avant de tenter de les commenter en les faisant mentir, puis encore Lévinas, Schmitt, Taubes et (hélas) Freud, voici quelques-uns des noms avec lesquels Rémi Soulié fait entrer en résonance celui de Lévy qui n'est pas seulement pieusement commenté mais critiqué, surtout lorsqu'il se veut, comme tant de nos contemporains, à sa propre source, père de son propre engendrement, figure d'une paternité aussi irréelle qu'ontologiquement dévoyée : «Nous n'étions pas nés [...]. Les Lumières nous proposaient une cérémonie de la naissance. Un commencement absolu». Triste illusion d'une puissance générative qui n'est que dégoût de soi-même, comme nous l'explique Soulié après Bernanos.
Pour qui n'est pas habitué à l'écriture, elle-même elliptique, de Benny Lévy, les fulgurances stochastiques de Rémi Soulié, apprises à l'école de Dominique de Roux qu'il a évoqué dans un beau livre publié par Olivier Véron aux Provinciales, sa manie des parenthèses, des citations (toujours superbes) d'auteurs, peuvent, je l'ai dit, dérouter (3) et décourager, étant donné le fait qu'il suppose connues de ses lecteurs les fondations de sa réflexion, dépassées les bornes qu'il a pris le soin de disposer le long de son chemin, ardu et sec comme un sentier du Rouergue : en quelques mots, les hommes de notre époque ne peuvent qu'être profondément nihilistes, voire désespérés puisque notre âge s'est voulu sorti de sa propre matrice, sans rien devoir à son passé théologico-politique éminent issu d'une triple confluence juive, grecque puis christiano-romaine. Derrière ce refus de la tradition, de l'héritage, de la piété, cette vertu éminemment illustrée par l'exemple de l'Énéide de Virgile auquel Theodor Haecker, que cite Soulié, a consacré une étude magistrale, Virgile, Père de l'Occident (publiée par Ad Solem), se lit, péché sartrien par excellence selon l'auteur, l'incapacité à aimer une terre, un corps, une cité selon Péguy (régulière et séculière) comme lieu invisible où Jeanne d’Arc donne la main à François Villon, voire Gilles de Rais, une langue, leur fragile incarnation qui est nation, et nation élue, israélienne ou française, puisque la nation française n'est pas moins élue, qu'elle est élue différemment, que la juive.
À ce titre, et contre certaines pathétiques inepties traînant sur la Toile, cette niche immense où glapissent bien des bavards au cerveau contrefait et à la langue déformée, rappelons, comme le fait d'ailleurs Soulié dans son livre, ces lignes de Stéphane Mosès : «Le christianisme [...] a un besoin vital de s'appuyer sur l'existence physique du peuple juif. Le mystère de l'Incarnation s'appuie sur la réalité historique du juif Jésus et de sa participation au destin de son peuple. [...] Cette assise quasi physique du christianisme, ce n'est pas seulement la Bible qui la lui fournit; car la Bible elle-même ne serait encore qu'un livre, si le peuple juif ne témoignait pas, par son existence même, du fait que la Bible est une réalité vivante [...]. C'est pourquoi l'existence réelle du peuple juif est, pour le christianisme, la seule preuve absolument indubitable de la vérité de sa foi» (4).
Lien indéfectible que Rémi Soulié condensera en une seule phrase : «La chrétienté médiévale, cette immense cathédrale que décrit Léon Bloy dans La Femme pauvre, rassemblement du ciel et de la Terre, anticipation liturgique plus que politique du Royaume portant à son paroxysme la vocation collective du christianisme pour les nations fut, mutatis mutandis, une réplique/répétition catholique du Sinaï» (p. 97).
Notes
(1) Benny Lévy, Le Meurtre du Pasteur. Critique de la vision politique du monde (Grasset-Verdier, 2002), p. 18.
(2) J'emprunte cette belle image (doublement présente : dans Physiologie de la critique et Réflexions sur la critique) à Albert Thibaudet, ce remarquable lecteur qui nous a laissé, justement, bien des images toutes plus significatives les unes que les autres : «Pas de critique sans une critique de la critique. Et la forte critique, la valeur maîtresse, c’est une critique à cran d’arrêt.»
(3) Autre défaut de ce petit livre tendu de sa première ligne jusqu'à sa dernière qui est d'ailleurs une citation de Pierre Boutang : ses jeux de mots trop typiquement lacaniens (ainsi de ces frères Énée, p. 127).
(4) Stéphane Mosès, L'Ange de l'Histoire (Gallimard, coll. folio Essais, 2006), p. 287.
08/01/2010 | Lien permanent
La collectionneuse d’Éric Rohmer, par Francis Moury

31/01/2010 | Lien permanent
Dialogues sur l'achèvement des temps modernes de Jaime Semprun

 Acheter Dialogues sur l'achèvement des temps modernes sur Amazon.
Acheter Dialogues sur l'achèvement des temps modernes sur Amazon.Si les temps modernes sont achevés, il ne reste plus qu'à plier bagage, tirer sa révérence et quitter la scène sur laquelle l'homme européen voire occidental aura plus ou moins convenablement paradé. C'est ce que semble vouloir nous dire l'auteur de la si délicieusement ironique Défense et illustration de la novlangue française dans ce dialogue publié en 1993, s'inspirant de Brecht et mettant en scène deux personnages, Ziffel et Kalle, par le biais d'une postulation double : tout d'abord, il se pourrait bien que l'homme puisse «se perdre lui-même sans acquérir la conscience de cette perte» (1) et, ensuite (ou avant, c'est tout un à notre époque si confuse), il ne faut jamais oublier que, "pendant le désastre, la vente continue» (p. 59).
S'il n'y avait dans le texte de Jaime Semprun, comme nous le suggère cette dernière assertion, qu'une espèce d'annonce ou bien de redite de tant des truculentes critiques et des bons mots de Philippe Muray, nous nous dépêcherions de le faire connaître aux meilleurs représentants de l'espèce homo reactus, qui présente la notable particularité d'évoluer à reculons, qu'il s'agisse de Jacques de Guillebon ou de son jumeau monozygote Romaric Sangars ou encore d'Alain Finkielkraut et de Richard Millet, celui que, tous, nous savons être le dernier écrivain de race charolaise. Il y a heureusement plus, chez Semprun, qu'une assurance d'imbécile ou plutôt, moins, puisque ces Dialogues valent surtout par l'hésitation que nous y lisons, le doute même, peut-être et pourquoi pas l'exposition d'une position purement intenable ailleurs que dans un livre.
Hésitation sur la bonne catégorisation de pensée politique, donc de praxis : réaction ou conservation ? Ainsi, si l'auteur affirme que les réactionnaires ont proféré beaucoup «d'excellentes vérités sur la société moderne», car ils «étaient plus libres» de voir venir l'avenir «sans préjugés, et donc de le considérer lucidement une fois qu'il a été là» (p. 32), il faut toutefois noter qu'ils «réagissent bien peu, faute de savoir ce qu'ils pourraient bien sauver» (p. 34), alors qu'un problème existe apparemment du côté de la conservation «de ce qui auparavant était normal et sans phrases», puisque, fût-elle «remarquable», cette conservation rend «factice» (p. 42) tout ce qu'elle touche. Certes encore, le simple fait qu'Orwell puisse apparemment être classé dans les rangs des conservateurs semble ne pas poser de problème à l'auteur, qui écrit : «Orwell, voilà justement quelqu'un qui est un bon exemple de ce dont je parlais, du fait qu'au moment où les hommes se sont trouvés précipités dans un monde indéfendable, avoir quelque chose à défendre du passé condamné permettait de voir dans toute son horreur la nouveauté, l'effondrement historique en cours» (p. 46), mais il n'en reste pas moins qu'il serait faux de supposer un intérêt quelconque au fait de conserver pour conserver puisque, une fois encore, nous tomberions dans la facticité, le remède privilégié par notre époque consistant «à faire accéder n'importe qui à une reconstitution truquée de ce dont a disparu la version authentique» (p. 59). Ailleurs, la subversion elle-même est reconnue comme l'un des plus hauts degrés du mensonge, lorsqu'elle est l'apanage de «chanteurs subversifs en quête de subventions étatiques» ou bien d'artistes prétendument maudits qui revendiquent une «couverture sociale» (p. 96). Muray, une fois encore, n'est pas loin et, avec lui, l'habituel cortège inculte des lecteurs de L'Incorrect ou de Valeurs actuelles, une proximité avec les veaux et les ânes à réaction qui eût je pense tétanisé Jaime Semprun !
La position conservatrice que nous avons évoquée est encore illustrée par la très belle parabole du «sage hassid» exposée par Ziffel à la page 66 du livre, exemple même d'une déchéance inéluctable de la parole de foi au travers des âges sans foi ni même loi, faute d'un auditoire suffisant ou même simplement intéressé par le fait de l'écouter et, donc, de la recevoir.
La position réactionnaire, à son tour, présente des désavantages, surtout lorsqu'elle semble être incarnée, aux yeux de Jaime Semprun, par Karl Kraus, un homme dont on a dit qu'il ne s'intéressait «à rien qui [eût pu] affaiblir sa colère», ce qui est juste, du moins en partie, mais (ce qui est absolument faux pour le coup) occasion pour l'auteur de proférer une ineptie totale, ce qui ma foi est fort rare sous sa plume, à l'égard du furieux polémiste autrichien (cf. p. 62). Ailleurs et par l'entremise de Ziffel, Semprun note que l'on peut «fort bien s'opposer à la désolation sans pour autant se sentir obligé de revendiquer un sol et une patrie, ou vouloir restaurer une tradition quelconque» (p. 77). Avouons qu'une telle réserve nous paraît de pure forme, car je ne vois guère comment il nous serait possible, d'un strict point de vue pratique, de repartir d'un zéro absolu, sans désirer invoquer ce qui a existé avant, avant la catastrophe, et qui pourra servir de socle, aussi friable qu'on le voudra ou bien craindra. Même le si poignant roman intitulé La Route de Cormac McCarthy, l'un des textes qui à notre connaissance pousse le plus loin la possibilité d'une fondation ô combien fragile abandonnant le passé à l'engloutissement, refuse de sombrer dans le puits sans fond d'une abolition totale de l'humanité et, surtout, de ce qu'elle a été.
Ni la conservation ni la réaction ne semblent finalement trouver grâce devant Jaime Semprun qui évoque une troisième option, plus radicale, puisqu'elle consiste à faire table rase de toutes choses et, d'abord, de notre société entièrement corrompue qui, d'ailleurs, n'a pas besoin que l'on précipite sa chute puisqu'elle s'écroule sous nos yeux : laissons-la «s'effondrer, et faisons l'inventaire des outils qui seront nécessaires pour reconstruire le monde» (p. 72). Nous constatons que la position de Jaime Semprun n'est point totalement nihiliste ou, si elle l'est, elle ne l'est qu'imparfaitement, un temps du moins, pour faire la part du feu en somme puisque, une fois survenu l'effondrement, il faudra bien se mettre à reconstruire, quelles que soient les modalités de cette reconstruction (il en existe des centaines, comme j'ai pu l'évoquer dans cette série consacrée à des textes post-apocalyptiques), en gardant toutefois à l'esprit la réserve que nous avons mentionnée plus haut et qui, selon nous, ne risque certainement pas de faciliter une hypothétique reconstruction.
Par ailleurs, rien ne semble vraiment fixé, du moins dans cet ouvrage, car Jaime Semprun ne manque pas de vanter les vertus d'une attitude conservatrice, l'auteur se demandant par exemple s'il ne convient pas «qu'aux époques les plus troublées se creuse ainsi malgré eux la solitude de quelques êtres, dont le rôle est d'éviter que périsse ce qui ne doit subsister passablement que dans un coin de serre, pour trouver beaucoup plus tard sa place au centre du nouvel ordre» (p. 139). Quelques pages avant cet extrait, Jaime Semprun nous semble même aller jusqu'à adopter une posture réactionnaire, quel comble pour lui !, lorsqu'il évoque ce que nous pourrions appeler, sur les brisées d'un Joseph de Maistre, l'universelle analogie : «La certitude que le monde est un, et multiples, entre ses plans, les correspondances, a par le passé animé des emprises diverses dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles font plutôt bonne figure face à celles qui, niant cela, ont effectivement mis le monde en pièces, comme pour justifier leur aveuglement» (p. 125).
Ni conservateur ni réactionnaire, même s'il est difficile de trouver une voie qui se contenterait subtilement de longer la crête d'une espèce de nihilisme que nous pourrions qualifier, après d'autres, de passif, Jaime Semprun semble naviguer à vue dans ces Dialogues, oscillant commodément, par le biais de ses deux protagonistes, entre une position attentiste ou au contraire désireuse que l'abîme, en quelque sorte, ne se repeuple pas, mais, à l'occasion, ne dédaignant pas le fait de prôner les vertus de l'action, à tout le moins une certaine simplicité qui n'aurait pas besoin de se griser de grands mots ni de grandes théories, comme, ici, par la bouche de Kalle : «Vous l'avez dit l'autre jour, ceux dont les idées sonnent juste sont ceux qui ne s'affranchissent pas en pensée des limites qu'ils rencontrent dans la réalité» (p. 140). Ce sont peut-être ces limites bien réelles qui ont obligé Jaime Semprun à tenter un dangereux numéro d'équilibriste.
Note
(1) Jaime Semprun, Dialogues sur l'achèvement des temps modernes (Éditions de l'Encyclopédie des nuisances, 1993), p. 134.
16/07/2019 | Lien permanent
Revue de presse de La Littérature à contre-nuit aux éditions Sulliver

Revue de presse
Paméla Ramos, Juan Asensio, Antonin Artaud et autres héros au culte impossible [texte supprimé].
Cécile Balavoine, Le mal pris au mot pour le site Nonfiction.fr.
Jean-Luc Evard, Spectres et trous noirs, article publié sur Stalker.
Stéphane Partiot, Masques du Mal, Face de Dieu pour la revue électronique Polaire [site supprimé].
Dominique Autié, La littérature et le Mal. Ma réponse. Je signale que Dominique et moi-même avions mené un entretien sur la réédition de mon livre, ici.
Axelle Felgine sur le site Le-Mort-qui-Trompe [qui n'existe plus].
Laurent Mabire sur son blog, Iaboc [qui n'existe plus]. Ce texte a ensuite paru (sous le titre Leçon de ténèbres) dans le n°34, été 2006, de la revue Liberté politique dirigée par Philippe de Saint-Germain.
Marc Alpozzo, Juan Asensio : le sens du mal, critique ayant d'abord paru sur le site E-Torpedo avant d'être reprise sur son blog [et supprimée depuis].
Pierre-Antoine Rey dit Cormary, La littérature sera pentecôtiste ou ne sera pas, pseudo-article paru dans Le journal de la culture n°14 avant d'être repris sur le blog de ce pitoyable lecteur. Ma réponse [laquelle contient la critique de Rey, supprimée sur son propre blog].
Joseph Vebret, Le journal de la culture n°14, mai/juin 2005 (extrait) : «Un mot, un seul, me fit réagir à la lecture difficile mais éclairante de l’imposant livre de Juan Asensio, La Littérature à contre-nuit (Éditions A Contrario), qui tente, et y parvient, d’identifier et de dénouer les liens complexes qui unissent le démoniaque à la littérature, insistant sur le «cancer que représente le Mal rongeant le langage», celui-ci étant suffisamment rusé comme Baudelaire en avait révélé de si belle façon le paradoxe et pervers pour parvenir à nous faire croire qu’il n’existe pas. Une simple note en bas de page [...]».
Olivier Noël, dans une critique parue sur son blog (datée du 6 décembre 2005) consacrée à Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec, écrit : «Dans La Littérature à contre-nuit, le recueil de textes critiques de Juan Asensio, figure un passage intitulé «de la littérature considérée comme un trou noir» où il est opportunément rappelé que cette singularité fut aussi désignée par Nerval comme l’œil de Dieu. «[N]ous mettons en rapport la négativité d’un espace aboli, celle d’un astre inversé ou retourné, et l’apparition, au sein d’une écriture romanesque, d’un vide qui la creusera jusqu’à son amuïssement final.» D’amuïssement, il ne saurait être question dans Cosmos Incorporated puisque la parole – contre-verbe – y est déjà vaincue. On saisit quel abîme sépare irrémédiablement le roman de Maurice G. Dantec et le chef-d’œuvre de Georges Bernanos, Monsieur Ouine, dont Juan Asensio, qui lui consacre les plus belles pages de son livre, écrit à juste titre qu’il est une révélation, ce que Cosmos Incorporated, à trop vouloir tutoyer les dieux, ne parvient jamais à être».
Lucien Suel, note de lecture publiée dans la Zone, intitulée Dans la gorge de l'ombre.
Pol Vandromme pour Valeurs actuelles, n°3580, du 8 au 14 juillet 2005, article repris dans Le Bulletin célinien n°269, novembre 2005 : «Un auteur, Juan Asensio, a la coquetterie de s'adapter à la mode (il utilise les techniques les plus modernes) pour mieux narguer le conformisme. Son blog dérange au point d'inquiéter et d'éveiller de vilains soupçons : le prêt-à-penser et le prêt-à-écrire l'ont mis sous surveillance. Ce n'est pas encore un maudit; c'est déjà un rebelle en voie de marginalisation. La littérature, la vraie, se reconnaît aux œuvres exemplaires qui réprouvent la règle commune et confusionniste selon laquelle «n'importe quelle bluette consensuelle et marchande a la profondeur de L'Enfer de Dante ou la dimension tragique de l'œuvre de Dostoïevski». Juan Asensio, indisposé par le bavardage frivole, la clarté factice, la prose sans dessous, se réclame d'un courage de hardiesse sur un ton tranchant et parfois oraculaire. Avec lui, en compagnie de Dominique de Roux, de Gadenne, de Péguy, de Bernanos (les pages qu'il lui consacre autour de Monsieur Ouine constituent le point culminant du livre), l'analyse inflexible de la grande critique et le style éclatant de la grande polémique sont de retour parmi nous».
Michel Crépu pour La Revue des deux mondes, numéro du mois de septembre 2005 : «Il se trouve encore des lecteurs pour se confronter avec les œuvres, des lecteurs pour savoir que la littérature n'est pas seulement une affaire de classes et de prix littéraires. Juan Asensio est de ceux-là. Les lecteurs de la Revue des Deux mondes se souviennent de l'étonnante étude qu'il avait consacrée au roman Villa Vortex de Maurice Dantec : il y faisait montre d'un sens de la vision qu'on retrouve ici, dans un volume d'études réunies autour de quelques écrivains majeurs [...]. Ce qu'il y a de commun entre ces auteurs si différents les uns des autres ? Peut-être ceci, qui est capital : faire sentir que la littérature a partie liée avec un drame métaphysique propre à l'Occident nihiliste où nous sommes désormais; donner à lire ce clandestin où la théologie joue moins comme une référence que comme une dimension irréductible, la part de transcendance sauvage. Une certaine culture littéraire française s'effarouche de tels propos, leur préférant un paysage plus neutre, paisible et rationnel. C'est oublier que nous avons Léon Bloy dans la bibliothèque, et Bernanos et aussi Bataille... Tous gens de ténèbres [...]. Juan Asensio s'inscrit tout à fait dans cette filiation peu faite pour les âmes sensibles, impatient d'y faire entendre la grande voix de la littérature, désespérant d'une époque médiocre, éteinte. [...] Lire Conrad à travers Maistre, mettre en relation Les Soirées de Saint-Pétersbourg avec Au cœur des ténèbres, ce n'est pas seulement manier une analogie de surface, c'est chercher au contraire comment ces œuvres révèlent la question essentielle qui hante ce livre : qu'en est-il du langage, qu'en est-il de la parole dans un monde où tout concourt à sa disparition, où l'imposture elle-même est promue comme vérité, où l'on félicite les imposteurs ? De s'engager sur un tel chemin vaudra sans nul doute à l'auteur bien des désagréments et beaucoup d'indifférence. Lui-même semble mettre un point d'honneur à aggraver son cas en multipliant l'invective, quand une légère pointe suffirait à embarrasser l'adversaire. Peu importe, il s'agit là [...] d'une équipée vitale. S'en détourner, c'est se mentir à soi-même, renoncer à l'essentiel. En ce sens, Juan Asensio est le digne élève de ces maîtres».
Le Vif L'Express, week-end du 22 avril 2005, compte rendu signé par M.E.B.
Alain Santacreu pour Contrelittérature, n°16, été 2005, dans un article intitulé La traversée du trou noir dont voici quelques lignes : «Il est important de surprendre l’angle sous lequel Juan Asensio voudrait que l’on considérât son livre et pour cela on commencera par lire son «avant-propos». Que faut-il entendre par ce titre : La Littérature à contre-nuit ? Il y a là toute la méthode de son herméneutique : lire comme on grave, selon la technique baroque dite «à contre-nuit». Le lecteur éclairé, le critique authentique, sera donc graveur à la «manière noire», autre nom de ce procédé qui consiste à noircir entièrement une plaque de cuivre avant de la graver : «J’avance péniblement dans l’extraordinaire complexité des œuvres que j’évoque, grattant patiemment, à mon tour, le noir de la plaque de cuivre pour en faire apparaître quelques traits», dira l’auteur, évoquant cette métaphore de la littérature à contre-nuit (p. 24).
Cette pratique de la lecture métaphorise un procédé contraire à celui de la gravure traditionnelle. Dans cette dernière, la pointe opère à la façon du crayon noir sur le papier blanc tandis que, dans la «manière noire», le grattoir produit l’effet d’un crayon blanc sur du papier noir. En filant la métaphore, on pourrait donc considérer l’ouvrage de Juan Asensio comme une plaque de cuivre que le critique-graveur aurait d’abord fendillée jusqu’à obtenir le noir le plus noir, pour approcher ensuite – en relissant au grattoir les lamelles métalliques – le blanc absolu. Les trois chapitres du livre correspondraient ainsi aux stations opératoires d’une herméneutique existentielle.»
Une lettre de Sarah Vajda.
31/07/2007 | Lien permanent
Intégralité de l'entretien avec Marc Alpozzo : les larmes du Stalker

25/08/2008 | Lien permanent
La crise de la littérature française et la nullitologie horizontale, 2 : la déshumanisation de l'art romanesque

 (1) José Ortega y Gasset, La déshumanisation de l'art suivie de Idées sur le roman et de L'art au présent et au passé (traduit de l'espagnol par Paul Aubert et Ève Giustiniani, préface, remarquable soulignons-le, de Paul Aubert, Éditions Sulliver, 2008). Les pages entre parenthèses renvoient toutes à cette édition.(2) La crise du roman, des lendemains du Naturalisme aux années vingt [1966], José Corti, 1993, p. 128.(3) «Il me semble que la nouvelle sensibilité est dominée par un dégoût de ce qui est humain dans l’art très proche de celui qu’ont toujours ressenti les hommes supérieurs devant les figures de cire. En revanche, cette macabre farce de cire a toujours enthousiasmé la plèbe» (p. 89).(4) «Mallarmé fut le premier homme du siècle passé qui voulut être un poète. […] Cette poésie n’a pas besoin d’être «sentie» parce que, comme il n’y a rien d’humain en elle, il n’y a rien de pathétique en elle» (p. 91) et encore : «Que peut faire parmi ces physionomies le pauvre visage de l’homme qui officie comme poète ? une seule chose : disparaître, se volatiliser et être changé en pure voix anonyme qui soutient les mots dans l’air, véritables protagonistes de l’entreprise lyrique» (Ibid.).(5) «Dans le domaine artistique, toute répétition est nulle. Chaque style qui apparaît dans l’histoire peut engendrer un certain nombre de formes différentes à l’intérieur d’un type générique. Mais un jour vient où la magnifique carrière s’épuise. Cela est arrivé, par exemple, avec le roman ou le théâtre romantico-naturaliste» (p. 75). Aussi : «Dans l’art, comme dans la morale, le devoir ne dépend pas de notre libre arbitre; il faut accepter l’impératif de travail que l’époque nous impose. Cette docilité à l’ordre du temps est l’unique probabilité de succès qu’a l’individu. Même ainsi, il est possible qu’il ne parvienne à rien; mais son échec est beaucoup plus sûr s’il s’obstine à composer un opéra wagnérien de plus, ou un roman naturaliste» (Ibid.).(6) «Une bonne partie de ce que j’ai appelé «déshumanisation» et dégoût des formes de vie provient de cette antipathie pour l’interprétation traditionnelle des réalités» (p. 103).(7) «Si maintenant nous regardons de biais la question de savoir de quel type de vie cette attaque du passé artistique est le symptôme, une vision étrange au dramatisme gigantesque nous saisit. Car, en fin de compte, agresser l’art du passé, de façon aussi générale, cela revient à se retourner contre l’Art lui-même, puisque concrètement, qu’est-ce que l’art, sinon celui qui s’est fait jusqu’ici ?» (p. 103, l'auteur souligne).(8) «[…] l’artiste d’aujourd’hui nous invite à contempler un art qui est une plaisanterie, qui est, essentiellement, une parodie de lui-même. Au lieu de se moquer de quelqu’un ou de quelque chose en particulier – sans victime, il n’est point de comédie –, l’art nouveau ridiculise l’art» (p. 105). Et encore : «Jamais l’art ne démontre mieux son don magique qu’en se moquant de lui-même. Car, en faisant le geste de s’anéantir lui-même, il reste toujours de l’art, et par une merveilleuse dialectique, cette négation est aussi le gage de sa conservation et de son triomphe» (p. 106).(9) «Pour l’homme de la toute nouvelle génération, l’art est quelque chose qui n’a aucune transcendance. Une fois écrite, cette phrase m’effraie, car je me rends compte qu’elle irradie d’innombrables sens différents. Ce n’est pas que l’homme d’aujourd’hui trouve que l’art est une chose sans importance, ou moins importante que pour l’homme d’hier, mais c’est que l’artiste lui-même voit son art comme une tâche sans transcendance» (p. 107).(10) Mais aussi au fait que l'art n'occupe plus, dans la société qui est celle d'Ortega y Gasset (et que dire de la nôtre !) la place qu'il y occupait dans le passé : «Tous les caractères de l’art nouveau peuvent se résumer à ce manque de transcendance, qui, à son tour, n’est dû qu’au fait que l’art ait changé de position dans la hiérarchie des préoccupations ou des intérêts humains» (p. 109).(11) «Si on analyse le nouveau style, on y trouve certaines tendances connexes. Il tend : 1) à la déshumanisation de l’art; 2) à éviter les formes vivantes; 3) à faire en sorte que l’œuvre d’art ne soit rien d’autre qu’une œuvre d’art; 4) à considérer l’art comme un jeu, et rien de plus; 5) à une ironie essentielle; 6) à éluder toute fausseté, et, par conséquent, à une scrupuleuse réalisation. Enfin, 7) l’art, selon les jeunes artistes, n’a aucune espèce de transcendance» (p. 75).(12) Voir le remarquable ouvrage de Frédéric Gugelot intitulé La conversion des intellectuels au catholicisme en France (1885-1935) (Éditions CNRS, 2010).(13) Sur la métaphore comme puissance d'extraction hors du réel (et donc force de déshumanisation) et «floraison d'îles sans pesanteur», José Ortega utilise cette très belle... métaphore : «La métaphore est probablement la puissance la plus fertile que l’homme possède. Son efficience va jusqu’à toucher les confins de la thaumaturgie et elle semble être un travail de création que Dieu oublia au sein de l’une de ses créatures au moment de la former, tout comme le chirurgien distrait oublie un instrument dans le ventre de l’opéré» (p. 92).(14) Artistes sans art ? (Presses Pocket, Agora, 1999), p. 218.
(1) José Ortega y Gasset, La déshumanisation de l'art suivie de Idées sur le roman et de L'art au présent et au passé (traduit de l'espagnol par Paul Aubert et Ève Giustiniani, préface, remarquable soulignons-le, de Paul Aubert, Éditions Sulliver, 2008). Les pages entre parenthèses renvoient toutes à cette édition.(2) La crise du roman, des lendemains du Naturalisme aux années vingt [1966], José Corti, 1993, p. 128.(3) «Il me semble que la nouvelle sensibilité est dominée par un dégoût de ce qui est humain dans l’art très proche de celui qu’ont toujours ressenti les hommes supérieurs devant les figures de cire. En revanche, cette macabre farce de cire a toujours enthousiasmé la plèbe» (p. 89).(4) «Mallarmé fut le premier homme du siècle passé qui voulut être un poète. […] Cette poésie n’a pas besoin d’être «sentie» parce que, comme il n’y a rien d’humain en elle, il n’y a rien de pathétique en elle» (p. 91) et encore : «Que peut faire parmi ces physionomies le pauvre visage de l’homme qui officie comme poète ? une seule chose : disparaître, se volatiliser et être changé en pure voix anonyme qui soutient les mots dans l’air, véritables protagonistes de l’entreprise lyrique» (Ibid.).(5) «Dans le domaine artistique, toute répétition est nulle. Chaque style qui apparaît dans l’histoire peut engendrer un certain nombre de formes différentes à l’intérieur d’un type générique. Mais un jour vient où la magnifique carrière s’épuise. Cela est arrivé, par exemple, avec le roman ou le théâtre romantico-naturaliste» (p. 75). Aussi : «Dans l’art, comme dans la morale, le devoir ne dépend pas de notre libre arbitre; il faut accepter l’impératif de travail que l’époque nous impose. Cette docilité à l’ordre du temps est l’unique probabilité de succès qu’a l’individu. Même ainsi, il est possible qu’il ne parvienne à rien; mais son échec est beaucoup plus sûr s’il s’obstine à composer un opéra wagnérien de plus, ou un roman naturaliste» (Ibid.).(6) «Une bonne partie de ce que j’ai appelé «déshumanisation» et dégoût des formes de vie provient de cette antipathie pour l’interprétation traditionnelle des réalités» (p. 103).(7) «Si maintenant nous regardons de biais la question de savoir de quel type de vie cette attaque du passé artistique est le symptôme, une vision étrange au dramatisme gigantesque nous saisit. Car, en fin de compte, agresser l’art du passé, de façon aussi générale, cela revient à se retourner contre l’Art lui-même, puisque concrètement, qu’est-ce que l’art, sinon celui qui s’est fait jusqu’ici ?» (p. 103, l'auteur souligne).(8) «[…] l’artiste d’aujourd’hui nous invite à contempler un art qui est une plaisanterie, qui est, essentiellement, une parodie de lui-même. Au lieu de se moquer de quelqu’un ou de quelque chose en particulier – sans victime, il n’est point de comédie –, l’art nouveau ridiculise l’art» (p. 105). Et encore : «Jamais l’art ne démontre mieux son don magique qu’en se moquant de lui-même. Car, en faisant le geste de s’anéantir lui-même, il reste toujours de l’art, et par une merveilleuse dialectique, cette négation est aussi le gage de sa conservation et de son triomphe» (p. 106).(9) «Pour l’homme de la toute nouvelle génération, l’art est quelque chose qui n’a aucune transcendance. Une fois écrite, cette phrase m’effraie, car je me rends compte qu’elle irradie d’innombrables sens différents. Ce n’est pas que l’homme d’aujourd’hui trouve que l’art est une chose sans importance, ou moins importante que pour l’homme d’hier, mais c’est que l’artiste lui-même voit son art comme une tâche sans transcendance» (p. 107).(10) Mais aussi au fait que l'art n'occupe plus, dans la société qui est celle d'Ortega y Gasset (et que dire de la nôtre !) la place qu'il y occupait dans le passé : «Tous les caractères de l’art nouveau peuvent se résumer à ce manque de transcendance, qui, à son tour, n’est dû qu’au fait que l’art ait changé de position dans la hiérarchie des préoccupations ou des intérêts humains» (p. 109).(11) «Si on analyse le nouveau style, on y trouve certaines tendances connexes. Il tend : 1) à la déshumanisation de l’art; 2) à éviter les formes vivantes; 3) à faire en sorte que l’œuvre d’art ne soit rien d’autre qu’une œuvre d’art; 4) à considérer l’art comme un jeu, et rien de plus; 5) à une ironie essentielle; 6) à éluder toute fausseté, et, par conséquent, à une scrupuleuse réalisation. Enfin, 7) l’art, selon les jeunes artistes, n’a aucune espèce de transcendance» (p. 75).(12) Voir le remarquable ouvrage de Frédéric Gugelot intitulé La conversion des intellectuels au catholicisme en France (1885-1935) (Éditions CNRS, 2010).(13) Sur la métaphore comme puissance d'extraction hors du réel (et donc force de déshumanisation) et «floraison d'îles sans pesanteur», José Ortega utilise cette très belle... métaphore : «La métaphore est probablement la puissance la plus fertile que l’homme possède. Son efficience va jusqu’à toucher les confins de la thaumaturgie et elle semble être un travail de création que Dieu oublia au sein de l’une de ses créatures au moment de la former, tout comme le chirurgien distrait oublie un instrument dans le ventre de l’opéré» (p. 92).(14) Artistes sans art ? (Presses Pocket, Agora, 1999), p. 218.
08/02/2011 | Lien permanent | Commentaires (72)
Statique ou dynamique des intellectuels ?, par Francis Moury

 À propos de Alain Minc, Une histoire politique des intellectuels, avec bibliographie et chronologie de 1715 à 2007 (Éditions Bernard Grasset & Fasquelle, 2010).
À propos de Alain Minc, Une histoire politique des intellectuels, avec bibliographie et chronologie de 1715 à 2007 (Éditions Bernard Grasset & Fasquelle, 2010).15/01/2011 | Lien permanent

























































