« Au-delà de l'effondrement, 21 : Je serai alors au soleil et à l'ombre de Christian Kracht | Page d'accueil | Les cinq métaphysiques d’Aristote, par Francis Moury »
25/05/2010
L'art de naviguer d'Antonio de Guevara

Crédits photographiques : Gerald Herbert (AP Photo).
À Dominique Autié, parti en très haute mer.
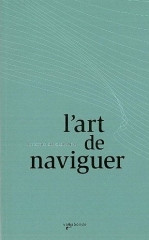 À propos de L'art de naviguer d'Antonio de Guevara (éditions Vagabonde, 2010).
À propos de L'art de naviguer d'Antonio de Guevara (éditions Vagabonde, 2010).LRSP (livre reçu en service de presse).
«Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer».
Sancho Pança.
Le format de ce texte pour la première fois traduit en français imite celui de la collection de poche de la très prétentieuse maison d'édition qu'est Allia, publiant des textes rarement inédits (comme celui-ci, de Jules Lequier, d'abord publié par L'Éclat) : du recyclage, voire, tout simplement, du parasitage, plutôt qu'un véritable travail d'éditeur, qui est, avant tout, un travail de découverte ou, à tout le moins, de redécouverte.
J'espère que le format de leurs livres respectifs est le seul point commun entre la surfaite Allia (allez les voir, lors d'un Salon du Livre, essayez de leur parler, et vous constaterez que je suis fort amène pour caractériser leur comportement si typiquement germanopratin) et la toute jeune maison de Benoît Laudier. Avec L’art de naviguer d'Antonio de Guevara, les éditions Vagabonde, qui publieront des textes de l'excellent László Krasznahorkai, nous proposent quoi qu'il en soit un magnifique petit livre, parfaitement préfacé par Pierre Senges, traduit et postfacé de façon remarquable par Catherine Vasseur qui écrit : «Discours trompeur, miroir aux alouettes. Soit. Ce qu’il est convenu de nommer la vraie vie, la vie impure, imparfaite, résiste obstinément aux suggestions de la propagande qui nous submerge. Mais depuis quel repli du monde pourrions-nous en parler ? Le monde n’a plus de repli. Sa conquête est achevée. L’œil scrutateur des satellites a remplacé celui de Dieu – auquel tout homme, à ses risques et périls, eut longtemps le loisir de ne pas croire. S’impose à nous l’idée que tous, nous naviguons sur la même galère» (p. 106).
Cette galère, seuls les esprits peu imaginatifs pensent qu'elle est faite de planches calfatées. Cette galère est le vaisseau, fait de mots et de phrases, qui nous porte depuis la nuit des temps ou plutôt, depuis que l'homme sait parler, en fait, écrit Humboldt dans un paradoxe lumineux, depuis que l'homme est homme : «L'homme n'est homme que par le langage; mais pour inventer le langage, il devait déjà être homme» (1). Que cette galère soit confrontée à un milieu supérieurement hostile n'a que peu d'importance, si l'on admet, avec Jean-Louis Chrétien, que le monde ne peut être complètement étranger à la parole : «Le monde lui-même est lourd de parole, il appelle la parole et notre parole en réponse, et il n'appelle qu'en répondant lui-même déjà à la Parole qui l'a créé. Comment serait-il étranger au verbe, lui qui ne subsiste, selon la foi, que par le Verbe ?» (2). Un danger plus insidieux et subtil nous menace, pointé par Catherine Vasseur : l'arraisonnement du monde, la négation de son mystère, sa transformation en immense parc de loisirs, en planétaire surface de jeu. Il se pourrait bien que ce soit la mise à plat de la nature, dépouillée de ses dernières parcelles de merveilleux, qui porte un coup fatal au langage. En somme, Guevarra pouvait écrire son ouvrage, quelle que soit la mauvaise foi que nous pouvons y lire, parce que, à ses yeux, le monde était encore tout bruissant de légendes et de contes noirs, même s'il n'y voyait qu'histoires de vieilles femmes, tout juste bons pour les esprits crédules.
Antonio de Guevarra, que l'on ne peut guère suspecter d'avoir le pied marin, parce qu'il est un affabulateur né, donc un écrivain, maîtrise pourtant l'élément hostile, contre lequel il n'a jamais de mots assez durs, plus sûrement qu'un capitaine d'un de ces navires au passé lointain et prestigieux.
S'impose donc à nous l'idée, pour paraphraser Catherine Vasseur, que tous nous naviguons sur le langage, qui n'a sans doute pas fini de nous faire découvrir de nouvelles terres, même si elles se réduisent comme peau de chagrin ou plutôt, même s'il nous faudra aller les conquérir sur une nouvelle planète et, pour ce faire, apprendre à naviguer sur les flots d'une mer sans limites.
Remarquable postface ai-je écrit, en ceci qu'elle tire du texte commenté infiniment plus qu'il semble nous en imposer lors de sa première lecture, fort plaisante du reste : la tentation de la surinterprétation est bien présente mais enfin, mieux vaut un commentaire intelligent, plus intelligent même que le texte commenté, plutôt qu'une monocorde paraphrase, à laquelle se réduisent tant de préfaces et de postfaces inutiles, unique occasion de faire plaisir à quelque auteur en vue, dont le nom est susceptible d'attirer les badauds. Catherine Vasseur lit donc ce texte trompeur, ironique et torve en en faisant le foyer de convergence de nombreux faisceaux qui brûlent cette fausse évidence : l'homme n'a strictement rien à faire sur la mer (3), si ce n'est, nous dit le pauvre Sancho, apprendre à prier et, complète Guevara qui ne se trompe point, questionner le langage pour le forcer à avouer qu'il n'a lui-même, qu'il ne peut lui-même avoir le moindre rapport avec la mer : «Au terme de sa lecture, l’ironie du titre se révèle pleinement : l’Art de naviguer est en réalité un Art de la nausée (le verbe «marear» véhicule l’une et l’autre notions). L’incompatibilité entre l’homme et les flots est d’emblée inscrite dans le langage» (p. 116). Oui, comme je le faisais remarquer au sujet d'un très beau roman, où la parole est confrontée à ce qui la dépasse, immense force inanimée, qu'un seul mot pourrait pourtant maîtriser si nous pouvions nous rappeler de l'Éden.
Cette incompatibilité, ou plus précisément, cette séparation entre le vrai langage civilisé, qui n'a rien de commun avec l'élément trompeur et celui, barbare, des marins (4), dont la dégradation a sans doute quelque point commun avec la mer, va donc être le sujet du court texte de Guevara dont je conseillerai la lecture à celles et ceux qui goûtent les proses surécrites, euphuistiques (5) d'un Thomas De Quincey et de son continuateur le plus génial, Jorge Luis Borges.
«Une ligne est donc tracée, ajoute Catherine Vasseur, qui fait découler l’abolition de la parole de celle de l’intégrité physique. D’où la portée exclusivement pratique des prescriptions prodiguées par Guevara à la fin de son «sermon». L’âme ne se relèvera pas à force de prières, d’ascèse, de retrait dans un quant-à-soi au demeurant inconcevable. Elle ne prendra aucune hauteur. Survivre sur la galère consistera à prendre soin de l’ultime refuge susceptible d’abriter les reliquats d’un dialogue, d’un rapport au monde et à l’autre – cet autre fût-il soi-même : son propre corps» (p. 120).
Sur une galère, il ne sert à rien de parler, et peut-être même de prier, puisque le langage, une fois pour toutes, est banni de cet univers sordide, sale, meurtrier, littéralement : sans paroles autres que celles que les marins sont forcés d'échanger pour gouverner leur navire, autant dire quelques mots au sens abstrus, un jargon que seuls les hommes du métier parviennent à comprendre. Le jargon, en ceci qu'il refuse le postulat de l'universalité propre à toute langue, le retournant au contraire en son plus petit dénominateur commun, le langage pour initiés, ne peut être œuvre de Dieu selon Guevara. Reste donc le diable. De la mer, seul celui qui ne la connaît point, qui même, selon toute probabilité, se refuse obstinément à la connaître mais a en revanche lu tous les livres qui l'évoquaient, y compris ceux qu'il a lui-même inventés, peut donc parler, surtout si son texte, violemment opposé à tout art de naviguer qui nous ferait tourner la tête en vantant les mérites d'un séjour sur un bateau, inscrit ses pliures, ses images, ses charges depuis le lieu qui oblitère la puissance sans cesse changeante et incompréhensible comme une femme (sans doute une métaphore guevaresque qui m'est spontanément venue sous la plume) qu'est l'océan : la terre ferme.
Celle-ci, pourtant, ne saurait être tenue en grande estime par celui (souvent un homme à la science livresque inépuisable) qui voit derrière les apparences la vérité et, derrière une feinte constance, l'inconstance, plus baroque que satanique.
En somme, Fray Antonio de Guevara, à la différence d'un Pierre de Lancre qui ne refusa pas, lui, de plonger jusqu'à risquer de s'y noyer dans la mer de la sorcellerie ayant submergé le pays du Labourd léché par une mer faisant assaut d'illusions, ne trempe pas un seul de ses précieux orteils dans la flache qu'il préfère toiser de son mépris souverain, ridiculiser par la grâce de sa fausse science et du jeu de références parfaitement fantaisistes. Modernité, sans doute même si ce mot signifie désormais à peu près n'importe quoi, de Guevara, puisque l'ironie et le jeu avec les mots sont des réalités que nos contemporains, lecteurs de peu de science, se plaisent à ne souvent trouver que dans les ridicules cornues du Nouveau Roman, où dans les livres mécaniquement calibrés pour être lus de tous, dont de personne.
Modernité n'est cependant point grandeur, car, en refusant de plonger dans l'immense océan des livres évoquant les dangers et les beautés de la navigation, Guevera est bien moins écrivain de race, fieffé menteur que ne l'est l'inquisiteur au style superbe, si visiblement fasciné, dans son étonnant Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, par son diabolique sujet. À sa façon, ce livre maudit, qui a provoqué directement ou indirectement la mort de pauvres hères accusées de sorcellerie et de fornications inouïes en réunion sabbatique, est aussi un art de se diriger et de survivre en pleine mer démontée, puisque la métaphore de la navigation n'est point absente de ses pages controuvées, puisque les images de l'eau sont éminemment présentes, qu'il s'agisse des vapeurs se condensant durant les nuits d'orgie ou des vagues léchant le rivage de ce décidément si étrange pays basque, des surfaces des étangs, enfin, où se mirent les belles que le Diable prendra pour ses fiancées froides : «[...] il m'est ressouvenu que tant de choses et visions étranges, que le Diable fait mouvoir au sabbat, où l'on voit de ces fontaines d'eau noire croupie et puante, de ces lacs faits en forme d'abîme, dans lesquels le Diable fait semblant de vouloir précipiter ceux qui venant à lui font la moindre difficulté de renier et renoncer leur Créateur. On y voit cent mille ressorts, cent mille mouvements divers, les uns en l'air, comme feux artificiels, élancés à perte de vue» (6).
Antonio de Guevara, lui, par sa réjouissante mauvaise foi et sa détestation si visible des périples maritimes et de ceux qui font mine de s'en extasier, parce qu'il ne se mouille pas pourrait-on dire, s'encalmine dans ses ruses et fait donc œuvre d'écrivain mineur : l'un des poncifs les plus délavés par l'incessant ressac de l'habitude et de l'imitation, aux yeux de ces Modernes que nous évoquions plus haut, n'est-il pas celui qui consiste à déduire la valeur d'un artiste de sa capacité de parvenir à décrire l'extrême auquel il est confronté ? Le grand Camoens ne s'y trompe pas, qui écrit : «Dire tout au long les périls de la mer, mal compris des humains : orages soudains et terribles, traits de foudre embrassant le ciel, noires averses, nuits ténébreuses, grondements de tonnerre ébranlant le monde, ce serait pour moi une épreuve aussi grande que vaine, lorsque même ma voix serait de fer» (7).
Vanité feinte bien évidemment, puisque Camoens chante comme nul autre la beauté traîtresse de la mer variable où toute crainte abonde ainsi que l'écrit Clément Marot. Antonio de Guevara au contraire, voit dans la saleté, les dangers innombrables mais aussi le langage barbare qu'utilisent les marins entre eux la pire des extrémités, la pitoyable folie (8) d'hommes qui préfèrent, à la terre solide, la mer : «Ainsi soit ce qui fut, et inventeur celui qui inventa – mais quand je pense à celui qui, le premier, se risqua à affronter les périls de la mer alors qu’il était en lieu sûr sur la terre, je me dis que cet homme-là était bien haïssable; car il n’est point de navigation si sûre que l’écart entre la vie et la mort y excède l’épaisseur d’une planche» (p. 46).
Guverra n'est point le juge Pierre de Lancre, supérieurement paradoxal en ceci qu'il condamne à la question puis à une mort atroce des femmes que son texte ne peut s'empêcher de mettre en scène comme s'il s'agissait de sirènes infernales au milieu desquelles il prendrait un bain peu orthodoxe.
Guevara loue la sagesse ancienne (9), qui est droite raison et modestie (10), et d'abord celle que le courtisan dispense autour de lui : «Je ne prononce de telles paroles ni ne pousse l’insolence à vous donner un tel conseil de manière inconsidérée, car tout le dommage causé dans les cours princières vient de ce que les nations se suivent, que les gens se suivent, que les opinions se suivent – mais que la raison ne suit jamais» (p. 21).
Curieux et passionnant sermon, en fin de compte, que celui de cet affabulateur qui résiste pourtant de toutes ses forces à la tentation de se laisser dériver. Il loue la raison mais ment effrontément, triche, invente au besoin, sans jamais se soucier d'une quelconque concaténation des propositions.
Finalement, la modernité (autre mot-baudruche) du texte de Guevarra tient peut-être à son baroquisme, à cette courbure de l'écriture qui prendra, bien des années après la parution de L'art de naviguer, le nom de soupçon.
Notes
(1) Wilhelm von Humboldt, Sur le caractère national des langues et autres écrits sur le langage (trad. par Denis Thouard, Seuil, coll. Points Essais, 2000), p. 85.
(2) Jean-Louis Chrétien, L'arche de la parole (PUF, coll. Épiméthée, 1998), p. 175.
(3) Alors qu'il a tout à faire, selon Guevarra, dans les cieux : «[…] Dieu n’a pas créé l’homme pour qu’il meure dans les océans, mais pour qu’il peuple les cieux» (p. 48).
(4) «Nous avons énuméré les libertés et les privilèges de la galère. Nous rendrons compte maintenant du langage dont on y use ; la façon d’y parler n’a en effet rien à envier à la façon d’y vivre : toutes deux sont extrêmes» (p. 83).
(5) Voir la note 19 p. 126 : «Le style de Guevarra est souvent perçu comme la matrice du conceptisme et du cultisme, qui caractériseront, jusqu’à leur épuisement dans le maniérisme, la littérature espagnole baroque. Un autre de ses avatars serait l’euphuïsme – du nom de l’ouvrage de l’Anglais John Lyly, Eupheus. The Anantomy of Wit (1578) – démarche esthétique consistant à porter à son comble le raffinement langagier via des concetti confinant à l’énigme.»
(6) Pierre de Lancre, Tableau de l'Inconstance des mauvais anges et démons [1613] (Aubier, coll. Palimpseste, 1982, Introduction critique et notes par Nicole Jacques-Chaquin), pp. 295-6.
(7) Camoens, Les Luisiades (traduction de R. Bismut, Lisbonne, 1954), V, 16, p. 129.
(8) «La mer ne trompe personne ni n’engage quiconque à se fier à elle : à tous elle révèle la monstruosité de ses poissons, la profondeur de ses abîmes, l’arrogance de ses flots, la contrariété de ses vents, la dureté de ses récifs, la cruauté de ses tempêtes; aussi, ceux qui vont s’y perdre ne sauraient être tenus pour ignorants, mais pour complètement fous» (pp. 89-90).
(9) «Ce que nous appelons dicton en langue vulgaire est appelé proverbe en latin ; ce qu’en latin nous appelons proverbe est appelé sentence en grec; et ce qui s’appelle sentence en grec se nomme expérience en chaldéen. Ainsi, les dictons désignent d’une part des sentences de philosophes et, d’autre part, des avertissements par des hommes d’expérience» (p. 23).
(10) «La mer est, sans comparaison, encore plus grande par l’arrogance dont elle fait montre que par les dommages qu’elle cause ; car ses flots sauvages finissent toujours par se briser sur ses propres rivages» (p. 87).




























































 Imprimer
Imprimer