« La dernière histoire de Mouchette ? | Page d'accueil | Entretien avec Rémi Soulié sur Pierre Boutang »
26/02/2017
Apostille à La montagne morte de la vie de Michel Bernanos : chemin vers l’inorganique, par Gregory Mion
 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.«Don’t blame this sleeping satellite».
Tasmin Archer.
«Ah ! ne plus être malade, ne plus souffrir, mourir le moins possible ! Son rêve aboutissait à cette pensée qu’on pourrait hâter le bonheur universel, la cité future de perfection et de félicité, en intervenant, en assurant de la santé à tous».
Émile Zola, Le Docteur Pascal.
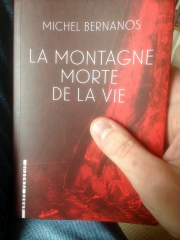 Acheter La Montagne morte de la vie sur Amazon.
Acheter La Montagne morte de la vie sur Amazon.Pour beaucoup trop de lecteurs, Michel Bernanos est un inconnu et malheureusement la tendance ne risque pas de s’inverser de sitôt, à supposer en outre qu’elle puisse encore le faire. En effet, la France qui n’en finit plus d’écouter aux portes d’un journalisme littéraire inculte, analphabète et dégénéré se préoccupe en ce moment moins de Michel Bernanos que des petites crottes vendues sur le gros marché des coprophages, où nous retrouvons bien sûr quelques nullités qui barytonent du cul (1) et qui le font de concert avec les crétins qui les défendent en publiant des articles apparentés à une putassière réclame, comble génétique de la niaiserie consanguine. Nullités soi-disant littéraires qui se multiplient, donc, et qui révèlent en creux la nullité de tout un pays qui s’en va vers un scrutin national de la pire espèce, l’indigence des lettres étant forcément cause de la misère politique, l’une entraînant nécessairement la mort de l’autre. Nullité d’un pays qui saborde méthodiquement sa littérature depuis deux ou trois décennies et qui préfère maintenant s’en remettre aux conseils narcotiques d’un François Busnel plutôt que de faire confiance aux rares forcenés qui ont toujours à cœur de sauver la grandeur de nos meilleurs romanciers vivants ou disparus. Nullité définitive de la France qui cet hiver se pourlèche les babines avec les étrons scrupuleusement emballés de Cécile Coulon et de Yann Moix tout en ignorant bêtement la réédition de La montagne morte de la vie de Michel Bernanos (2). Las ! Quel spectacle affligeant que celui d’un pays qui se suicide en s’étouffant volontairement avec les torrents de merde qu’il s’envoie dans le gosier ! La France n’est plus qu’un troupeau de bovins démocratiques, vaincue par son esprit grégaire et par son Putanat, pauvre France qui pense comme on défèque, qui écrit comme on vomit et qui patauge crânement dans son cloaque en s’imaginant tenir la dragée haute au monde.
À côté de ces pratiques scandaleuses gisent des textes étranges et fabuleux comme cette Montagne morte de la vie, qui, en un peu plus de cent pages, pose un écrivain d’envergure. Le sujet du livre pourrait tenir en une question : comment survivre dans une nature devenue hostile et inconnue ? Nul n’en revient, évidemment, et les deux personnages principaux de ce récit extraordinaire en font la douloureuse expérience, quoique fondatrice au bout du compte. Il s’agit d’abord du jeune narrateur, tout juste âgé de dix-huit ans, jeté un peu malgré lui dans la destinée navale d’un galion pour une durée contractuelle d’un an (cf. p. 43). Ce bleu-bite employé comme mousse subira un bizutage de circonstance, frôlant une mort qu’il aurait peut-être préférée au regard des péripéties futures, puis il sera d’une certaine façon adopté par Toine, un vieux cuistot rompu aux coutumes parfois brutales des longs voyages en mer (cf. pp. 48-9). Cette rencontre scelle une fois pour toutes le lien entre les deux personnages. Ce sont les seuls individus qui passeront du monde maritime familier (cf. pp. 43-93) à l’univers inquiétant du minéral (cf. pp. 97-162), ces deux segments correspondant aux deux parties distinctes du court roman de Michel Bernanos. Ce trajet du liquide au solide, néanmoins, ne constitue pas les qualités uniques de la matière telle qu’elle se décline souvent dans le langage commun, à quoi nous devrions aussi adjoindre l’état gazeux. Bien plus qu’une matière dont nous connaissons ordinairement les principes et les énergies, Bernanos, par ses descriptions fulgurantes et son choix étudié des épithètes, nous fait pénétrer sur un sol richement plastique, impulsé par une infinité de configurations et d’humeurs, capable de passer du fluide au visqueux, du massif au spongieux, du linéaire au granulaire, etc. L’enjeu est par conséquent littéraire et scientifique, littéraire d’abord parce qu’il faut être en mesure de restituer l’expression d’un paysage inédit sans tomber dans les facilités du cratylisme, scientifique ensuite parce que l’on se demande à bon droit comment des corps humains peuvent résister à ce passage soudain d’un univers à un autre, passage singularisé par la chute dans un gigantesque tourbillon aquatique (cf. pp. 82-4), transition vers une humanité occulte qui semble surgie de nulle part, digne du cratère narratif qui se creuse subitement dans le texte et qui nous aspire avec la même force que Toine et son récent protégé.
Dans ce nouveau monde qui eût probablement dérouté Christophe Colomb et tout autre «révélateur du globe» (3), nos deux aventuriers malgré eux se confrontent à la minéralisation progressive de leur environnement, ainsi qu’à leur propre et inexorable solidification. Ils ont en quelque sorte cheminé vers l’inorganique, et peut-être que la disparition des attributs corporels s’annonce dès le début, comme le symptôme ostentatoire d’une condition plus grave ou plus authentique, lorsque précisément l’équipage du bateau bascule dans le cannibalisme (cf. pp 56-8). Ces hommes qui s’entre-dévorent, au fond, ne sont que le prélude à l’anéantissement ultérieur des corps. Ils annoncent un retournement rythmique fondamental que nous définissons comme la perte décisive de l’anthroporythmie et le commencement irrémédiable d’une lithorythmie (4). L’homme privé de ses organes se rapproche de la statue imaginée par Condillac dans son Traité des sensations, mais celle-ci est encore trop humanisée pour réellement proposer l’expérience d’un être changé en pierre (5). Or en osant une interprétation, Michel Bernanos, aux toutes dernières lignes de son livre (cf. p. 162), ne postule aucune caractéristique humaine à l’existence d’une personne devenue roche, sinon la capacité de verser une larme, de pleurer sur son sort ou de pleurer de joie. Cet astucieux détail nous incite à considérer d’un œil nouveau la rosée que l’on observe sur les pierres à des moments cruciaux de la journée : ainsi regardées, ces pierres sont-elles de très anciennes présences humaines qui exsudent une émotion antédiluvienne ? La rosée devient par conséquent le possible langage des pierres, lesquelles nous expriment par ce biais un pathos résolument approfondi. Quant aux compléments éventuels de ce langage, il faudrait examiner les lignes de faille, les émiettements, les effritements, les empiètements de chaque pierre, en un mot les données de l’érosion comme autant d’inflexions et de tonalités probables, comme autant d’options pour ponctuer une fréquence perceptive qui n’est pas de notre ressort habituel. Conformément à ces intuitions, les pierres créent des formes intelligentes, elles font jaillir la matière bien plus que ne le font les dieux ou quelque incarnation d’un premier moteur, et il n’est pas interdit de suggérer une pensée forte dans un éboulement, d’entendre dans la dégringolade des roches une espèce de cri de protestation !
Tout ceci est à notre avis sous-entendu au dernier chapitre de La montagne morte de la vie (cf. pp. 153-162) et nous devons nous y arrêter plus en détail pour justifier notre apostille. Ce chapitre confirme définitivement la suprématie du minéral après que nos voyageurs interstellaires ont précédemment traversé un territoire végétal où «tout [était] vert à en mourir» (p. 128). Par son altitude et sa majesté, la montagne, de toute façon, domine l’ensemble de cet univers jusqu’alors inexpérimenté, et la forêt va même jusqu’à littéralement s’incliner devant la noblesse des cimes (cf. p. 156). Quant à cet univers en tant que tel, est-ce un double-fond secret de la Terre, une sorte de lapin surgi du chapeau cosmique d’un magicien et dont nous ne pourrions atteindre l’intérieur que par le biais d’un plongeon inopiné dans un tourbillon d’eau ? Est-ce un palier spécifique des profondeurs de la Terre qui, avec sa «lumière écarlate» (p. 97), figurerait un Enfer crédible ? Est-ce encore un segment hétérotopique situé dans un monde parallèle qui n’aurait aucun lien avec les abysses physiques de notre planète ? Il est vrai que la chute spectaculaire des personnages dans le vortex océanique nous encourage à conjecturer un lieu inhérent à la Terre, un lieu qui aurait la consistance d’un estomac et dans lequel nos deux aventuriers seraient tombés à la suite d’une glissade angoissante dans un œsophage hybride, un genre de conduit absorbant fait d’une matière métastable et indéfinissable, cependant, compte tenu de ces aspects irréductiblement originaux, il n’est pas incongru de parier sur un milieu extra-mondain rétif à toute métrique spatio-temporelle classique. À cet égard, Toine et le jeune mousse font une expérience croissante de la relativité, car, au fur et à mesure qu’ils se rapprochent de la montagne, leur temps se dilate et leur espace se contracte. Ils s’homogénéisent dans une durée proto-éternelle qui est celle de la roche, et, simultanément, ils se confondent à l’espace excessivement contracté de cette même roche, devenant eux-mêmes des pierres, des modes de la substance-montagne parmi une infinité d’autres modes incorporés à ses flancs (cf. p. 161-2). Dans le vocabulaire de l’opinion, nous affirmerions volontiers qu’ils sont morts, qu’ils ont été vulgairement réduits à de l’inorganique, toutefois la montagne n’est morte que pour ceux qui ne savent pas en percevoir le rythme intime, car elle est bel et bien montagne morte de la vie pour Michel Bernanos, c’est-à-dire une autre manière d’exister, une autre solution pour comprendre le devenir.
La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.






























































 Imprimer
Imprimer