« Journal d'un homme occupé de Robert Brasillach | Page d'accueil | L’État chez les Grecs de Friedrich Nietzsche ou le certificat de décès de la modernité, par Gregory Mion »
14/06/2017
Au-delà de l'effondrement, 61 : D'un feu sans flammes de Greg Hrbek
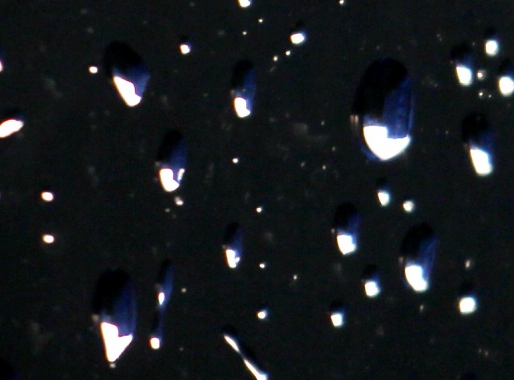
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Tous les effondrements.
Tous les effondrements.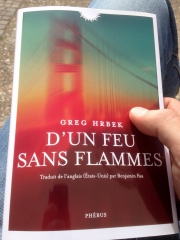 Acheter D'un feu sans flammes sur Amazon.
Acheter D'un feu sans flammes sur Amazon.L'une des plus sottes, donc journalistiques façons de lire D'un feu sans flammes de Greg Hrbek (1) serait de se focaliser sur sa seule prétendue actualité post-attentats du 11 Septembre. Celle-ci est de nature double : une trame de roman post-apocalyptique qui ne sombre point dans les écueils du genre mais brille davantage par son extrême sobriété, doublée d'une réflexion sur le fanatisme musulman s'insérant dans une société contemporaine, nord-américaine en l'occurrence.
De l'événement qui, ce 11 août, a frappé le Golden Gate Bridge, nous ne savons rien ou plutôt tout, puisqu'il existe une profusion d'explications plus ou moins farfelues, à peu près tout : il s'agit ainsi, peut-être, d'un «avion de ligne», d'«un avion avec les mots «Air Arabia» inscrits sur le fuselage qui s'était écrasé puis avait explosé» (p. 38), ou bien d'une «météorite, ou Dieu sait quoi d'autre» (p. 65), à moins qu'il n'y ait jamais eu d'avion ni de bombe, cette «cité pécheresse [ayant été] détruite par une formidable explosion née du Néant par la seule volonté du Tout-Puissant» (p. 152), ou même d'un «vaisseau spatial», d'un «disque en argent, d'un diamètre et d'une circonférence incroyables, qui paraît tourner sur lui-même autour d'un axe central tandis qu'il plane au-dessus des deux tours du pont» (p. 154). Bref, «il y a huit ans», «il s'est passé ce qui s'est passé au-dessus du Golden Gate Bridge» (p. 182), peu importe que l'un des personnages ait lu sur Internet «qu'une météorite était tombée sur le pont, dévorait des quartiers entiers» (p. 278), peu importe quoi, avion détourné, météorite, bombe sale, doigt du Tout-Puissant Allah ou vaisseau spatial allez savoir, car en fait ce qui s'est passé ne regarde jamais que le pouvoir de l'écriture romanesque qui, bien loin de ne s'intéresser qu'à la destinée de l'un des témoins de l'événement, Skyler Wakefield (dont le nom est en soi tout un programme, qui renvoie à l'un des contes les plus étranges d'Hawthorne), bien loin encore de suivre celle, émouvante, d'un gamin qui, mais nous n'en sommes pas certains là aussi, finira embrigadé par un imam et se fera exploser au milieu d'une foule de badauds américains, a pour unique but d'exposer une série de grilles ou de trames figurant la multiplicité des vertiges et des destins. La littérature nord-américain est friande de ce genre de construction plus ou moins complexe, comme le montre l'exemple des subtiles Contrenarrations de John Keene, récemment évoqué dans la Zone.
Nous approchons de la vérité du texte de Greg Hrbek avec ces lignes : «C'est pareil avec la mémoire. Avec des pilules, on peut traiter un deuil ou un traumatisme. Soulager la peine provoquée par une perte. On peut même tout oublier du jour où cela s'est passé, et avec lui tous les détails de la tragédie. Mais on ne peut pas effacer une vie entière. Celle-ci reste pour toujours quelque part en nous, et elle aura été vécue, quoi qu'il arrive, pour toujours. Et si quelque chose venu du ciel s'était abattu sur San Francisco, quelque chose qui n'était ni un avion détourné ni un météore, mais quelque chose d'infiniment plus puissant, capable d'effacer des intrications de réalités tout entières...» (p. 221). Ce quelque chose d'inconnu, c'est la narration, qui empêche, d'une certaine manière, qu'une vie entière ne disparaisse à tout jamais du monde et de la mémoire des hommes.
 Greg Hrbek, intelligemment, ne s'avance pas plus loin sur cette piste de la réalité double, multiple, dickienne en somme, se contentant d'affirmer que nul ne pourra jamais comprendre la véritable nature de cet événement survenu un 11 août (cf. p. 291), simulacre qui ne trompera que les mauvais lecteurs, qui n'auront pas compris que ce roman intelligent n'a qu'une seule obsession, héritée (qui sait ?) du Kierkegaard de la Reprise ou Répétition.
Greg Hrbek, intelligemment, ne s'avance pas plus loin sur cette piste de la réalité double, multiple, dickienne en somme, se contentant d'affirmer que nul ne pourra jamais comprendre la véritable nature de cet événement survenu un 11 août (cf. p. 291), simulacre qui ne trompera que les mauvais lecteurs, qui n'auront pas compris que ce roman intelligent n'a qu'une seule obsession, héritée (qui sait ?) du Kierkegaard de la Reprise ou Répétition.Il s'agit de reconquérir celle que l'on a perdue, ici la jeune Skyler, que son frère ne cesse de voir lorsqu'il rêve, puis que son père finira par voir au détour d'une photo dont il n'avait, des années durant, pas soupçonné la véritable nature. Le vocabulaire, mais aussi les hypothèses que Greg Hrbek nous donne sont de nature mathématiques (cf. pp. 137, 208, 232, 249), mais je crois qu'elles sont encore bien trop didactiques, tout comme ses explications insistant sur la multiplicité des trames, des chemins incarnat différents destins : «C'est donc cela, l'inspiration. Ils existent vraiment, ces déesses et ces esprits saints qui parlent à travers nous, ces vents divins qui nous procurent des visions... Des visions d'une forme fantomatique. Ce pourrait être un quasar, comme ce pourrait tout aussi bien être une fille» (p. 165), se dit ainsi le père de Skyler, qui semble avoir tout oublié de sa propre fille depuis l'événement du 11 août, et dont il commence à soupçonner l'existence enfuie, dissoute, morte, énigmatiquement résurgente ou bien simplement parallèle, en examinant le reflet d'une jeune femme sur les verres teintés de la paire de lunette que portait sa femme, lorsque la photo a été prise.
Certes, «parmi les innombrables structures de réalité constituant les plans parallèles de ꝏ, il existe un ordonnancement de hasard et de libre arbitre selon lequel cette guerre sans fin n'a jamais commencé. Peux-tu sentir cette réalité ? Un monde où ceux que tu as perdus sont toujours à tes côtés, où ceux que tu risques de perdre seront toujours en sécurité» (p. 192); certes encore, c'est le libre arbitre de Karim qui, dans «un certain nombre d'autres chemins», l'a «conduit à écarter l'option consistant à trancher la gorge du chien» (p. 232), ou à deviner, «aux limites extrêmes de sa conscience, un moyen de changer son chemin» (p. 274), mais ces hypothèses qui ne sont que des facilités scénaristiques ne peuvent cacher l'interrogation essentielle du roman magnifiquement mélancolique de Greg Hrbek : «Une bombe sale [...] est-elle sur le point d'exploser ? La peau de Dorian Wakefield commence-t-elle déjà à brûler et à se boursoufler ? Sommes-nous condamnés à perdre pour toujours ceux que nous aimons ? Ou bien ceux qui ont disparu depuis longtemps peuvent-ils finalement, par miracle, nous être rendus ?» (p. 233).
Retrouver, par-delà la mort et l'oubli, comme un motif secret dans le tapis (2), l'autre, la femme aimée et perdue, dont l'histoire abolie constitue la trame aux infinies miroitements sous l'apparente couche de glace de l'impossibilité, de la rupture, de la mort, sujet au fond de La chute du Zeppelin à la nuit tombée, et ainsi arpenter de nouveau cette «route qui symbolise l'espace entre deux possibles» (p. 298), et sur laquelle il s'agit de faire de son mieux, en parvenant «à rester fidèle aux meilleurs anges de notre nature» (p. 306), tout en écoutant «l'écho d'une action encore à réaliser, ou même à imaginer» (p. 119), point complètement forclose en tout cas dans la tombe du jamais plus.
Finalement, c'est peut-être par pudeur que Greg Hrbek a sciemment occulté le sujet véritable, bouleversant, de son roman très maîtrisé, lui qui se contente, en guise de dernières lignes, d'affirmer que chaque «perte mérite d'être racontée», poursuivant en écrivant que ce qu'il a voulu «retranscrire ici n'est que la fraction d'un tout, ni plus ni moins représentative de l'histoire dans son ensemble qu'une seule cellule peut l'être du corps humain vivant. De même, chaque personne qui y apparaît n'est, en quelque sorte, qu'une fraction d'un immense ensemble d'autres elles-mêmes. Et pourtant, même dans ce cadre limité, il nous est possible de déterminer une équation fonctionnelle définissant le rapport entre les interconnexions entre deux coordonnées très lointaines, et elle peut même incorporer des liens de causalité transverses entre des chemins distincts (pp. 322-3).
Notes
(1) Greg Hrbek, D'un feu sans flammes (Phébus, traduction de Benjamin Fau, 2017), dont le titre original, Not on fire, but burning a été judicieusement traduit. Signalons tout de même à l'éditeur un certain nombre de coquilles plus ou moins discrètes, qui se trouvent aux pages 30 (l'expression latine «a fortiori» devant être mise en italiques), 47 (défavorisées et non «défavorisés»), 126 (qu'on croirait amplifiée et non «amplifié»), 223 (qui marchent et non «qui marche»), 247 (un «est» en trop dans «ni où elle se trouve réellement»), 261 (et non plus à mille cinq cents kilomètres au lieu «et non plus de mille cinq cents kilomètres»), 266 (grammaticalement, la phrase «une canette de bière sur la table qu'il n'arrive pas à boire» est fausse, que élidé renvoyant à table), 273 (un «de» manque à la première ligne), 275 (censée et non «censé»), 290 (Restez ici et non «Rester ici»), 295 (Il y a quatre jours de cela et non «Il a quatre jours de cela») et enfin 308 (celles au lieu de «ceux quils avaient construites», puisqu'il s'agit de «demeures de fortune). La grande misère des éditeurs contemporains, je le répète désormais de note en note, c'est qu'ils se contrefichent quasiment tous, petits, moyens ou grands, de faire relire et corriger leurs livres par des lecteurs dont c'est le métier.
(2) Que, dans le roman de Hrbek, nous pourrions assimiler à la mention continue de la couvée du Grand Est, qui n'est autre que l'éclosion, tous les 17 étés «depuis que les glaces se sont retirées des terres et qu'une forêt de plusieurs centaines de millions d'hectares de feuillus leur offre un foyer où elle peut chanter à son aise» (p. 191), de millions d'insectes Magicicada septendecim imprimant à l'histoire une temporalité inéluctable qui n'est pas celle de l'humanité.




























































 Imprimer
Imprimer