« Au-delà de l'effondrement, 61 : D'un feu sans flammes de Greg Hrbek | Page d'accueil | Le Paradis français d'Éric Rohmer, sous la direction d'Hugues Moreau »
01/07/2017
L’État chez les Grecs de Friedrich Nietzsche ou le certificat de décès de la modernité, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Joël Ricci (Air Journal).
 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.Je dédie cette note à Pierre Mari. Pour célébrer sa récente et fabuleuse Épître aux Avachis.
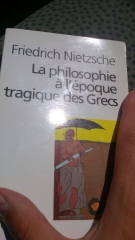 Acheter La philosophie à l'époque tragique des Grecs sur Amazon.
Acheter La philosophie à l'époque tragique des Grecs sur Amazon.La cécité hypocrite des modernes jugée par le regard vrai des anciens Grecs
Lors des journées festives qui jalonnent la dernière semaine de l’année 1872, Nietzsche travaille avec une sincère gaieté aux plus ou moins connues Cinq préfaces à cinq livres qui n’ont pas été écrits (1), et, parmi ces textes, on peut lire L’État chez les Grecs, qui constitue à première vue un remarquable élan de provocation vis-à-vis de l’Allemagne du XIXe siècle. L’intention du philosophe est de montrer que l’Allemagne se contente d’un très faible modèle de civilisation et qu’elle s’épuise considérablement, emportée par les petites ambitions de l’époque moderne où les hommes vulgaires, partout en Europe, prospèrent au détriment des hommes d’esprit. Ce n’est donc pas seulement l’Allemagne qui intéresse Nietzsche, car la nation teutonique n’est en définitive que le terrain où toutes les maladies de son temps se manifestent à lui avec une implacable netteté, mais l’ensemble de la culture européenne, menacée par la torpeur et par la régression, ainsi que par de préoccupantes alliances entre les hommes de savoir et les pires philistins. Considérées en outre depuis notre propre actualité, ces crispations culturelles de jadis, chargées de lamentables connivences humaines et d’une insoutenable tendance à décroître en force vitale, ne nous apparaissent tout au plus qu’à l’instar des choses habituelles. Cependant, au moment où Nietzsche se souciait de ces flétrissures désormais irréversibles, le combat valait d’être mené parce que l’on pouvait croire à bon droit que des hommes supérieurs étaient susceptibles de se réveiller depuis le confort des nécropoles sociales, qu’il pouvait s’en trouver certains pour se dresser au milieu des tombeaux du népotisme et fouler tout cela d’un pied conquérant, prêts à relancer la machine allemande et avec elle tout le Vieux Continent assoupi. Par conséquent la base du projet de Nietzsche est là : il lui fallait écrire un texte suffisamment assourdissant pour que même les oreilles les moins réceptives fussent ébranlées, mises en situation de comprendre la gravité des événements à l’œuvre, en l’occurrence la réalité d’une déchéance humaine inédite, suscitée par un socle de valeurs nuisibles et mensongères.
En dépit du fait que Nietzsche, vers le terminus de sa vie lucide, finira par se convaincre de la défaite inéluctable de toute forme de grandeur spirituelle, il est quand même utile de s’appesantir sur ses critiques formulées à l’aube des années 1870. Elles sont précieuses à plus d’un titre, ne serait-ce déjà que parce qu’elles sous-entendent un enjeu vital pour la civilisation européenne, et aussi parce qu’elles réfutent toute la timidité politique d’une classe dirigeante capitularde, composée pour l’essentiel de chefs illégitimes. Elles sont du reste d’autant plus précieuses qu’elles nous rendent aujourd’hui un service inestimable pour évaluer la choquante médiocrité de nos élites. Quel serait en effet le propos de Nietzsche s’il était actuellement le témoin des catastrophiques aventures de l’Europe ? Comment réagirait-il en voyant l’Allemagne faire la leçon à la Grèce, avec toute l’arrogance dévolue aux incapables, alors même que le philosophe prenait appui sur l’ancien peuple grec pour discréditer la politique culturelle allemande d’autrefois ? Il aurait sans doute un rire narquois, peut-être aussi un haussement d’épaules, puis il passerait son chemin afin d’éviter une montée fatale d’écœurement. De son vivant déjà, redisons-le différemment, Nietzsche avait pressenti l’impossibilité pour l’Europe de se prescrire une vision musclée, tout conscient qu’il était du ramollissement des occidentaux et de leur rancune à l’égard des véritables suprématies (2). Au regard de ce verdict intraitable, ce n’est pas un hasard s’il attire notre attention sur le ressentiment du communisme et du socialisme en ce qui concerne une expérience particulière de l’art et un aspect contrariant de l’Antiquité.
L’art, tout d’abord, induit aux yeux de Nietzsche un goût de l’ivresse, une disposition résolue à s’engager dans le pugilat créatif, en quoi il n’est pas compatible avec l’attitude effarouchée des culs-de-plomb qui défendent le statu quo et qui refusent l’adversité. Le génie artistique se fourvoierait en se proclamant le seul de son espèce, car il a besoin d’un second génie pour amplifier sa création, pour résister à la tentation de la nonchalance (3). En ce sens, la meilleure protection de l’art ne provient pas de subventions partiales ou de crises égocentriques comme on en connaît tant de nos jours, mais plutôt d’une réelle passion pour le duel, d’un assentiment pour le bon côté de l’éristique, c’est-à-dire d’un consentement pour tout ce qui encourage les hommes au travail acharné, lucides quant au fait que d’autres hommes enthousiastes s’évertuent aussi à créer, à innover, ne lâchant aucun lest dans leurs actions pionnières. On le comprendra encore mieux en spécifiant que l’Antiquité grecque, depuis Les Travaux et les Jours d’Hésiode qui en ont fixé littérairement le principe, concevait deux déesses Éris. L’une inspirait la guerre dans ce qu’elle a de plus meurtrier et méprisable, mais l’autre, au contraire, stimulait une saine rivalité à tous les niveaux du travail humain, tant et si bien que chaque homme pouvait devenir le jaloux d’un autre, désirant atteindre l’apogée d’un concurrent à la seule force de son poignet (4). La mentalité antique est donc tout à fait honorable car elle développe clairement l’idée qu’une certaine quantité de travail et de courage doit être rassemblée si l’on veut aboutir au résultat que nous envions. Que l’on soit artisan, poète, riche ou mendiant, il y a toujours cette lucidité qui nous rappelle que si un artisan jalouse un autre artisan, de même qu’un mendiant peut également en jalouser un autre, comme le poète soupire au succès d’un autre poète et le riche aux avantages d’un autre riche, alors, pour renverser le courant, il ne faut compter que sur notre capacité à impulser à l’intérieur de nous-mêmes la force d’entrer dans la joute, dans le combat pour la vie individuelle, et non espérer un passe-droit ou la faveur d’une destinée pour réaliser platement nos objectifs. Ceci étant posé, signalons tout de même que cette proto-conjecture de l’émulation ne peut avoir un intérêt que si tous les hommes qui se donnent du mal et qui parviennent à leurs fins le font légitimement. Les Grecs ne dissimulaient pas leurs efforts et ils avaient les coudées franches, pas plus qu’ils ne dissimulaient leurs esclaves inaptes à toute création, autant de qualités qui nous paraissent maintenant perdues à l’heure où le travail s’obtient moins par le mérite que par la ruse la plus scandaleuse, comme il en va du reste des honneurs politiques, des privilèges bourgeois et des mauvais artistes que l’on protège, tout cela étant marqué par le sceau d’une tricherie flagrante. La Grèce d’Homère était une exhibition permanente de toute la société, de ses bas-fonds de violence jusqu’à ses plus impressionnants raffinements culturels, tandis que notre Europe contemporaine essaie de cacher par tous les moyens ses diverses corruptions. Les Grecs ne sous-estimaient pas la malpropreté relative de la nature humaine et ils ont su bâtir une culture qui n’a pas fléchi au moment d’échantillonner les atouts de chacun, séparant les esclaves des maîtres, contrairement aux cultures modernes qui ont tant poussé le vice de l’égalité qu’elles ont fini par glorifier les esclaves et par ensevelir les maîtres.
Cette ancienne organisation des relations humaines contredit évidemment les matrices théoriques du communisme et du socialisme, si impatientes de faire l’apologie de l’égalité de jure alors même que la logique intrinsèque de ces idéologies suppose la production d’une inégalité de facto, tant elles sont génératrices d’impuretés, de filouteries et de manigances (5). La virilité des premiers Grecs contraste énormément avec les faibles du monde moderne et les politiciens dépravés de la démocratie populaire, agglutinés en troupeaux moribonds et poussant des cris d’effroi retentissants dès qu’une parole suggère une aristocratie de l’existence, ou plus exactement la possibilité qu’un homme n’en vaille pas un autre. À cet égard, le problème de la modernité, c’est d’une part qu’elle est pusillanime et de mauvaise foi, parce qu’elle enfante elle-même une quantité inouïe d’injustices tout en s’offensant des injustices d’autrui, et d’autre part qu’elle s’abstient de reconnaître la cruauté qui se dégage ouvertement du fond de l’humanité, aussi elle ne cesse de se consoler à grand-peine en usant d’hallucinations collectives.
Chacun d’entre nous, pour peu qu’il s’applique à observer notre société, qui n’est en outre que l’aggravation embarrassante de la société de Nietzsche, n’y verra malheureusement qu’un ramassis d’esclaves. L’esclave doit être ici entendu comme celui qui se fossilise dans la faiblesse et l’anéantissement de toute activité créatrice puissante. De plus, l’esclave est rancunier; il déteste les seigneurs et pour éviter de se mesurer à eux, il a ouvert les portes des institutions à ses semblables, congédiant les maîtres par un effet pervers de domestication massive. Autrement dit, les bonnes élites ne sont nulle part et les esclaves sont partout, et pour se prévaloir de cette évidence, la société des esclaves affirme donc des concepts hallucinogènes tels que la «dignité du travail» et la «dignité de l’homme». Pour les esclaves qui travaillent au service d’autres esclaves, le travail est forcément un concept consolateur, et c’est encore plus avantageux si le travail asservi nous hisse d’un seul coup à la dignité de l’existence. Il s’agit d’une certaine manière de mettre la poussière sous le tapis par le biais d’une intériorisation conceptualisée de la faiblesse, afin d’oublier la laideur de l’esclavage up to date et le peu d’intérêt d’une vie impuissante.
Ce qui se révèle distinctement au creux de ce camouflage abstrait de la vérité nue, c’est le déni de barbarie et de grossièreté qui préside à toute culture, le refus de voir la racine véhémente qui gît sous l’arbre civilisé, les hommes étant nécessairement inscrits dans la trivialité des désirs et dans un «bellum omnium contra omnes» tant que n’a pas jailli un État pour les contenir. Concrètement, pour la modernité avachie, cela veut dire que chaque esclave n’est docile qu’en vertu d’un processus de gouvernance qui veille à répondre sempiternellement aux desiderata de la foule, et dût-on manquer une minute à l’appel des esclaves, nous risquerions des soulèvements dévastateurs car les appétits de la nature ne toléreraient pas le prolongement d’une disette de civilisation – l’estomac déclarerait des guerres incontrôlables si le mythe de l’État-providence devait succomber. Par métaphore, il en irait de même sur le plus élégant des bateaux : les voyageurs de la haute société, prétendument éduqués à la philosophie et aux délicatesses de l’art, se transformeraient en infâmes prédateurs si leur bateau devait se perdre dans l’océan et naviguer à vue pendant de longues semaines. La pénurie croissante de nourriture les ferait entrer dans des transes cannibales et nous les verrions en un rien de temps basculer des violences symboliques aux violences crues, après qu’ils auraient assisté à l’effondrement de tous leurs mirages conceptuels, chassés les uns après les autres par la voracité du ventre (6). Peut-on ainsi se satisfaire d’une société moderne où les esclaves sont omniprésents, s’ignorent en tant qu’esclaves et se précipitent à la bauge de l’argent pour soulager leur avidité ? Ce n’est là qu’une façon d’user d’une quelconque stratégie mystifiante pour apprivoiser les guerres intestines qui irriguent l’humanité depuis le début. On ne fait que recouvrir les tensions humaines d’un enduit culturel, tel un pansement que l’on applique sur une blessure qui continuera d’être douloureuse, et ce faisant nous valorisons un mode existence qui en lui-même est dépourvu de la moindre valeur. Plus fondamentalement encore, la modernité valorise l’existence humaine en faisant semblant de ne pas s’apercevoir que l’existence conçue dans une politique généralisée du travail est sans valeur aucune.
Pour Nietzsche, conformément à ce qui précède, l’Europe du XIXe siècle se ment à elle-même : elle croit avoir réglé la question de l’esclavage en insistant sur la dignité du travail et des hommes disciplinés, mais elle ne fait que ramasser traîtreusement le javelot des méthodes esclavagistes là où d’anciennes civilisations moins cosmétiques l’ont laissé tomber avec davantage de transparence (7). Cela signifie que des civilisations sont un peu moins sournoises que d’autres vis-à-vis de la substance cruelle qui préexiste à toute épiphanie de la culture, ou, si l’on préfère l’exprimer encore plus synthétiquement, cela signifie que la modernité s’est dotée d’une culture violente et de surcroît inefficace parce qu’on s’entête à vouloir en minimiser le fondement barbare et l’extension malsaine. Notre esclavage pourrait être utile s’il avait la franchise de ce qui se pratiquait chez les Grecs, s’il avait la véracité dont Théognis de Mégare chantait les louanges, mais faute de grandeur et de dignité authentiques, nous n’avons que des esclaves qui accélèrent la déchéance occidentale, des caniches humains judéo-chrétiens, et nous n’en avons même pas honte.
Il nous faut donc postuler une fierté des nouveaux esclaves, receleurs de niaiseries et de béatitudes populacières, tout heureux de s’entre-valoriser et de se justifier en permanence dans leurs brumes fantasmagoriques. Beaucoup d’entre eux ont cependant la prétention d’être des artistes, sans doute parce qu’ils subissent la double attirance de l’avidité d’exister et du besoin d’art, que Nietzsche qualifie opportunément d’»amalgame antinaturel», et sans doute aussi parce qu’ils ont effectivement réussi à mélanger les terminologies de ces deux destinations antinomiques, l’art n’étant pour les esclaves qu’une option supplémentaire pour faire fortune tout en fardant leur avidité d’une vertu imaginaire. Les esclaves ont par conséquent dénaturé la création artistique dans la mesure où ils l’ont vulgairement rabaissée à une intrigue de marché. Ils ont accouché de la figure monstrueuse de l’artiste professionnalisé, sensible aux tendances communes, otage complice d’un réseau d’intérêts, esclave du temps rétréci où l’argent vient au galop, à l’opposé total de ce qu’il devrait être, en l’occurrence un individu qui ne gaspille pas son temps à vouloir survivre pour survivre, mais qui s’offre tout entier au temps éternel d’un art vigoureux et désintéressé, soutenu en outre par un État qui n’est pas moins vigoureux dans sa façon de légitimer à ciel ouvert un certain esclavage – une majorité doit travailler en vue de permettre à une minorité de faire éclore le génie, tel que cela s’opérait chez les Grecs de l’Antiquité. Pour que de tels artistes aient droit de cité, il faudrait bien sûr que la morale grégaire des esclaves fasse reflux, qu’elle remonte à la source étincelante de la vieille Grèce, or nous n’en prenons guère le chemin étant donné que les valeurs des esclaves sont dorénavant sanctifiées à l’école, où les enfants sont sommés d’ingurgiter cette potion morbide afin de se préparer à conforter la servitude immense de leurs aînés.
Au reste, Nietzsche s’offusquait déjà de la nocivité de l’enseignement dans l’Allemagne qui était la sienne, et il pointait un facteur déterminant qui devrait nous alarmer : le désistement de toute espèce d’exigence à l’égard de la langue maternelle (8). Or quand une langue quelle qu’elle soit est mutilée dès le départ, passée au crible de la paresse pédagogique et meurtrie ensuite par les turpitudes journalistiques que Nietzsche détestait tant (9), la culture s’affaiblit et l’esclavage s’intensifie. Cela entraîne une simplification abusive du réel par un langage qui ne vise que l’efficace et qui n’a même plus la force de se vexer de ses propres difformités. L’indulgence envers un tel langage n’est rien de moins qu’un crime contre le vivant et le génie qu’il recèle, mais elle a une fonction médullaire pour les esclaves qui dorment paisiblement sur leurs deux oreilles et qui ont allongé les maîtres sur des lits de Procuste. Nous sommes de la sorte ravagés par une société du simulacre où l’artiste n’en est plus un, où tous les arts sont plombés par la lourdeur des esclaves et une infinité de collusions avec les journalistes, et les défauts de la langue allemande repérés par Nietzsche dans les années 1870 sont de nos jours accrus dans la langue française, autorisant les médiocres à se légitimer par des hallucinations réciproques et des cooptations charogneuses (10). Dans une telle société, plus personne n’a la dignité d’un individu, et tout le monde se confond à la masse indigne des travailleurs de l’esclavage qui perpétuent la plus agenouillée des humanités. Un sentiment de honte devrait nous submerger, un haut-le-cœur aurait dû depuis longtemps nous étouffer, mais nous préférons avoir honte des Grecs anciens plutôt que de nous-mêmes. Posons ainsi une question décisive : faut-il préférer l’esclavage de la vénérable Athènes ou la nouvelle logique des gourgandines ? Puis reformulons aussitôt cette interrogation pour gagner en clarté et perdre en polémique : est-il préférable qu’une majorité travaille pour une minorité réellement légitime, ou est-il préférable qu’un troupeau d’illégitimes prospère en empêchant le moindre génie d’apparaître ? Les deux propositions qui se détachent ont chacune des défaillances morales, mais, au jeu insidieux du moindre mal, le choix des Grecs est éminemment plus respectable que le choix des modernes.
Il suit de là que notre siècle est culturellement indéfendable parce qu’il a procédé à tous les choix qui consistent à stériliser la culture aristocratique, la culture vraie que les Grecs endossaient, celle, en l’occurrence, qui ne peut être entretenue que par des personnalités résolument charismatiques et supérieures. Mais au profit de qui et de quoi ces choix ont-ils été validés ? Il n’est pas difficile de répondre que nous avons érigé au rang de figures tutélaires de la culture contemporaine les hommes et les femmes les plus funestement ignobles, incompétents et corruptibles, sûrement parce que les esclaves qui leur concèdent une légitimité ne valent pas mieux, sûrement aussi parce qu’il est réconfortant, pour un troupeau d’esclaves, de pouvoir se dire que des sommets ainsi conquis sont accessibles au tout-venant. La rareté du génie suscite l’angoisse, elle nous renvoie à nos déficits naturels, tandis que l’abondance de la banalité rassure et materne les cervelles diminuées. Par ailleurs, tel que nous le faisions remarquer en préambule, on pouvait déjà, du temps de Nietzsche, s’inquiéter de plusieurs conspirations ourdies par des groupes d’hommes apparemment inaccordables, c’est-à-dire entre des hommes vraiment cultivés et des hommes honteusement incultes, or cette liaison bâtarde n’a eu de cesse de se renforcer à l’ère post-nietzschéenne, pour devenir à notre époque la norme de la culture. Après quoi le franc-parler nous oblige à rajouter, non sans mélancolie, que les hommes cultivés d’aujourd’hui ne partagent aucune qualité avec les hommes cultivés d’hier, car les premiers, privés de toute consistance, se sont tellement familiarisés avec l’avilissement qu’ils n’ont plus qu’un éventail de titres honorifiques pour essayer de tenir la comparaison avec les seconds. Quel spectacle affligeant que le nôtre, qui nous donne par exemple à voir des professeurs d’Université assez savants faire l’éloge officiel de quelques petites gourgandines des lettres, probablement à dessein d’optimiser les ventes d’une œuvre qui sue sang et eau pour se tailler une place parmi les philistins, ou, autre exemple du même acabit, le spectacle non moins consternant d’un écrivain qui aurait pu être sérieux et qui s’est laissé accaparer par les sirènes de la vulgarité, par faiblesse d’être sérieux sur le temps long, et donc par crédulité stupide envers le temps court ! Par contraste, il est fort envisageable que les Grecs savaient, ou du moins avaient l’intuition, en bons philosophes de la nature qu’ils étaient, que ce qui remporte une victoire sur le temps court finit par s’écrouler dans le temps long. À ce jour, nous n’avons vraisemblablement aucune aspiration à propager cette fulgurance compte tenu des tombereaux de misérables sottises que nous admirons, et même révérons, en tant que culture française.
Comme voie potentielle de guérison, lorsque le mal n’était pas encore incurable, Nietzsche préconisait un pèlerinage mental dans la Grèce ancestrale, resplendissante de philosophie, et il se montrait admiratif que des auteurs tels que Goethe et Schiller pussent avoir marché jusqu’aux cimes de cette civilisation fondatrice (11). C’était pour ainsi dire une époque presque accidentelle de la culture allemande, qui s’est hâtée par la suite de reconstituer un contexte obscène de servitude, la main dans la main avec une Europe de la même trempe défaitiste et poltronne. Partant de là, doté de la clairvoyance qu’on lui connaît, Nietzsche n’a pas été stupéfait de constater que le peuple réclamait l’augmentation du nombre d’établissements scolaires, remuant le fumier argumentatif et socialiste de la culture de masse, ignorant que les choses culturelles véridiques doivent être réservées à une élite licite et qu’elles ne peuvent que dépérir une fois qu’elles sont jetées à la tête gloutonne de la populace (12). Les résultats de ces revendications démocratiques ne se sont pas fait attendre : une partie du bon peuple s’est égarée dans la culture tout en la prostituant, en lui administrant des airs d’utilité, et nous avons contemplé d’un œil effrayé la naissance des vaches démocrates à demi cultivées, ces mêmes vaches qui communiquent en ce moment leurs basses-œuvres un peu partout, avec l’assentiment des esclaves qui les courtisent et dont elles sont également les esclaves. À l’instar de Nietzsche, nous préférons mille fois les membres du bon peuple qui sait demeurer à sa place et qui n’a pas eu la tête retournée par les Lumières, qui vit d’ailleurs le plus souvent à l’écart de nos villes et de nos capitales, puis nous méprisons férocement les petites traînées citadines qui charrient des bibliographies insignifiantes, les roulures qui vivent de la respiration artificielle des réseaux et qui tirent vanité d’une obscure situation culturelle, sans parler des tapineurs futiles de tous les horizons culturels imaginables, hommes fienteux, mâles rétamés, sous-hommes émérites, veaux anémiés de la démocratie qui pactisent avec les vaches susmentionnées. Ce sont précisément ces grappes humaines antipathiques qui abusent des ressources du langage pour défendre la «dignité du travail» et la «dignité de l’homme», les «droits de l’homme» aussi. Elles en sont arrivées là pour masquer l’ignominie de la modernité et pour se masquer ce qu’elles sont : un dédaignable troupeau qui dépouille la vie de ses forces, un troupeau de grossiers travailleurs de l’art falsifié dont l’existence est profondément inesthétique, lâche et bien-pensante, en définitive un troupeau d’imposteurs qui se cramponnent à la moindre subvention pour éviter le travail plus robuste du petit peuple, ce peuple dont ils croient être affranchis et dont ils redoutent la prise de conscience comme une peste noire (13).
La morsure fatale : le fauve grec met à mort la brebis moderne
On peut déduire de tout ce qui précède qu’une société composée de travailleurs hallucinés n’a aucune chance de s’offrir une vaillante perspective de création. Les esclaves épuisés par le travail n’ont pas vocation à s’engouffrer significativement dans les arts. Au reste, répétons-le, ils sont d’autant plus épuisés qu’ils obtiennent le travail par la ruse, victimes d’un état diffus de corruption qu’ils ont eux-mêmes alimenté. Le drame, toutefois, c’est que les esclaves consomment les tranquillisants de la faiblesse et s’imaginent volontiers appartenir à la région des aigles, oubliant qu’ils ne sont que des agneaux et qu’il ne peut en être autrement. Le travail moderne des esclaves n’est qu’une activité de la survie collective, une propriété de la vie grégaire, et les délires conceptuels qui essaient d’embellir cette existence atrophiée font croire au troupeau qu’il est libre et qu’il a des droits de regard dans les questions culturelles. Les conséquences de cette société opiomane sont sinistres : il y a désormais un grégarisme des arts qui nous submerge de productions ratatinées. Les œuvres qui sont encensées suintent des valeurs rachitiques de notre siècle, d’où le fait que même les œuvres présentées comme sulfureuses ou avant-gardistes ne le sont qu’à l’échelle d’un troupeau qui ne sait pas juger de l’art et qui renifle des précurseurs là où nous ne voyons que des médiocres légats des chartes en vigueur.
Il est aisé de s’en convaincre par une rapide évaluation des artistes actuels et de la vie qu’ils mènent : une vie de propriétaires terriens, une vie de flatterie, une vie de cupidité où l’action de se répandre l’emporte sur l’action de s’individualiser avec magnanimité. Ainsi l’artiste du troupeau souffre de la maladie de l’extension (14), il s’empâte en avoir, il grossit en espace pour simultanément diminuer en être et en temporalité. L’extensiopathie est la condition nécessaire et suffisante pour plaire aux esclaves et s’affirmer soi-même comme un esclave au carré, mais nous sommes fatigués de nous étendre sur un monde aux proportions limitées, en embrassant de surcroît une conception finie de l’existence. L’esclave est en effet celui qui finitise l’être, il n’entretient aucun rapport avec l’infini et il est naturellement incapable de s’associer à la postérité immortelle des génies. En cela, même quand il entreprend de s’aventurer dans une démarche artistique, l’esclave convertit toute la réalité en lignes de démarcation – il fabrique de l’étant qui vient se surajouter aux étants qui concourent à dessiner le territoire des asservis. Subordonnés à l’étant, les sociétaires du troupeau s’échangent les valeurs de la restriction tout en partageant la vulgarité de s’étendre au maximum, et, bien souvent, ces horribles cafards se battent pour vivre longtemps et pour être visibles dans plusieurs étants, unique façon pour eux d’approcher une sensation d’infinité. Cela explique le fait que les œuvres de l’étant ont besoin d’être associées à toute la constellation de la servitude, qu’elles doivent être relayées sans relâche, affichées, voire placardées, dans un engagement mutuel des esclaves soi-disant créateurs, des esclaves du journalisme et des esclaves usagers d’un art frelaté. Les succès de ces artistes se vivent in media res, au sein de l’étant, et sachant que leur mort contribuera à les balayer de la mémoire du monde, sachant qu’ils seront dûment remplacés par d’autres esclaves, ils craignent avec terreur ce jour où il faudra mourir. Cette peur de la mort est d’ailleurs ce qui les dégrade en artistes émasculés, impropres à la grandeur, indignes des étoiles. Il va de soi que l’on perdrait notre temps à vouloir chercher un authentique individu parmi cette désolante colonie d’attroupés.
À vrai dire, c’est toute la sphère de la culture moderne qui travaille pour l’étant, et Nietzsche ne s’y est pas trompé lorsqu’il a déclaré que nous n’avions aucun établissement d’enseignement dévoué à la culture, mais plutôt des «établissements de la misère de vivre» (15). Dès les premiers jours de la scolarité, les esclaves sont séduits par la moraline et détournés des vraies hauteurs, puis les meilleurs périssent, écrasés par le «ciel bas et lourd [qui] pèse comme un couvercle» (16). Autrefois protégés par un État grec qui faisait office de vigie aristocrate, les génies sont à présent délaissés, abandonnés à leur sort, mis en quarantaine par des esclaves qui se prennent pour des maîtres. Nietzsche n’hésitait pas à mettre en cause les Universités, qui, selon lui, se contentaient de véhiculer une illusion d’autonomie, produisant à la chaîne des experts de l’affairement et de la poltronnerie (17). C’est dire à quel point l’enseignement supérieur participait de toutes ses maigres forces à l’impuissance de vivre, formant des générations calamiteuses de bagnards, prêtes à bétonner le bunker de la servitude. C’est dire encore le déplorable continuum qui s’est accompli entre les Universités allemandes accusées par Nietzsche et les nôtres. Nos établissements du supérieur ressemblent à des colombariums où sont nichées les cendres de nos jeunes pousses, coupées à la racine et brûlées vives par de sordides technocrates. Il nous manque les grands cicérones de naguère pour diriger la sève de nos arbres vers de monumentales poussées, en somme vers la culture des maîtres. Et c’est parce que nous n’avons pas de guides puissants sur les estrades de nos facultés que nous ne pouvons pas exiger de nos étudiants qu’ils soient autre chose que des esclaves endormis. La vraie culture ne peut venir que de l’obéissance stricte à un maître légitime, de la soumission attentive au savoir, du dressage entendu comme redressement de tout ce qui est penché en nous, et, enfin, d’un noble sens du service à l’endroit du génie (18). De toute évidence, si cette culture était en usage, nous profiterions de valeurs tout à fait différentes et nous n’aurions pas à subir les miasmes des esclaves. Nous assisterions à un renversement inédit de la médiocrité, et bien des «importants» seraient destitués de leurs perchoirs d’imposture, quand ils ne seraient pas tout bonnement exterminés avec leurs têtes accrochées à des piques.
Par conséquent, au-delà de la création, c’est aussi la pensée qui s’est dérobée à la modernité. Tandis que les Grecs avaient légitimé la philosophie, comparant le philosophe, dans le lexique nietzschéen, à «une étoile de première grandeur dans le système solaire de la civilisation» (19), nous n’avons fait tout au plus que la légaliser, et, peu à peu, nous l’avons asphyxiée dans le carcan du régime universitaire. Nos professeurs d’Université enseignent moins par devoir que par conformité avec un devoir, et si quelques-uns d’entre eux possèdent encore une flamme vacillante de logos, ils sont probablement séquestrés par des chefs de département intrigants. De toute façon, ces prétendus lieux de savoir sont en général désertés par les penseurs. Ils ont dû s’enfuir dans des pampas très reculées pour s’adonner à la mission fondamentale de la philosophie, justifiant d’une proximité essentielle entre la vie philosophique et la vie mystique. Quant aux penseurs qui seraient malgré tout restés au pays des esclaves, ils sont contraints au «Larvatus prodeo» de Descartes, embastillés sous des masques de normalité afin de ne pas désarçonner les valeurs officielles. Mais par quelque bout que l’on prenne le problème du penseur, qu’il ait choisi de fuir l’actualité ou de lui résister, il paraît condamné à vivre son génie dans une forme achevée d’érémitisme. Il y a une impérative condition monastique du penseur, qui ne peut être qu’un inconnu de la culture moderne, un oublié définitif de son temps, parce que cette culture crapuleuse n’est plus qu’un instrument de publicité pour les esclaves. Dans cet ordre-là du monde, s’il voulait être reconnu, le penseur devrait s’encombrer de théories qui pourraient immédiatement avoir des conséquences pratiques pour les esclaves. Ce serait toutefois succomber à la tentation du troupeau et considérablement appauvrir la pensée. Quiconque se livre à la pensée aristocratique des cimes ne peut faire escale dans la modernité. Une telle pensée ne peut toucher quasiment personne parce qu’elle est inaccessible pour les esclaves. Ainsi l’absence de reconnaissance devient peut-être le symptôme déterminant de la pensée : le logos des altitudes n’entretient aucune sorte d’affinité avec la vallée des esclaves. La modernité a développé des modes d’existence qui sont des repoussoirs pour le philosophe, de même que ces modalités de vie font obstacle à toute possibilité d’émergence de la philosophie. En se fatiguant du matin au soir dans le travail, la population moderne a universalisé l’esclavage sur ses terres. Le travail salarié a paralysé les hommes, rendant impensable la fondation d’une civilisation de génies créateurs. Au-dessus des esclaves, les Grecs avaient des combats de géants; nous n’avons de notre côté que des combats de nains et nous ne rougissons même pas de ces ridicules nanomachies.
De plus, les Grecs avaient accepté la notion de travail avec la plus vive honte. Ils y détectaient cependant un avilissement nécessaire, et en associant majoritairement le travail aux esclaves, ils atténuaient la charge de cette besogne pour les natures fortes davantage adaptées aux arts et à la pensée. On allait même jusqu’à redouter la représentation du travail dans les arts et dans la pensée, ce que Nietzsche illustre par une métaphore impitoyablement attique : on peut certes s’émouvoir de la beauté d’un enfant, mais il est permis d’avoir de la répugnance pour l’acte qui a conçu l’enfant. En d’autres termes, les œuvres d’art sont belles, mais les créateurs d’exception doivent s’efforcer de faire oublier toutes les étapes laborieuses qui ont lentement conduit au résultat final. Les Grecs n’auraient pas renié que les génies artistiques étaient des travailleurs acharnés, mais ils eussent préféré que ce travail demeurât insoupçonnable (20). Ceci nous aide en outre à poser une thèse primordiale de L’État chez les Grecs : si le génie artistique l’est moins par l’inspiration que par son travail de forçat, si la création aboutie dépend moins d’un talent inné que d’un apprentissage patient, alors il est indispensable que des hommes privés de la moindre apparence de talent soient les esclaves d’une minorité prometteuse. Et même si nous pouvons supputer des degrés de force dans le génie artistique, il n’en reste pas moins que ces hommes ne seraient pas en mesure de pratiquer leur art paisiblement s’ils devaient se préoccuper de travailler à des futilités indignes de leur personnalité. Aussi, pour que la culture puisse assouvir son besoin d’art et progresser vers de nouveaux sommets, elle se doit d’installer les procédures d’un esclavage massif. C’est en ce sens précis que Nietzsche écrit que «l’esclavage appartient à l’essence d’une civilisation», en l’occurrence une civilisation qui soit capable de soutenir le regard du véritable esclavage et qui ne divague pas en conceptions fallacieuses pour éviter de se confronter au réel !
L’État va donc jouer chez les Grecs un rôle de puissance contraignante afin de durcir la condition des esclaves. L’exacerbation de la misère des esclaves «doit être encore accrue pour permettre à un nombre restreint d’olympiens de produire le monde de l’art», et, bien sûr, l’État incarne «la main de fer» qui soumet durement les faibles au bénéfice des forts. Aussi scandaleuses que soient ces opinions de Nietzsche, elles demandent à ce que nous réfléchissions au type d’esclavage qui sévit dans notre modernité avant de nous émouvoir et d’inculper le philosophe pour brutalité argumentative. À ce sujet, quatre remarques importantes peuvent être formulées à partir des raisonnements de Nietzsche dans la suite de son texte :
1/ Sans la présence d’un État, la médiocrité des hommes aurait certainement triomphé. Le corset de l’État réprime ainsi les propensions rancunières d’une masse triviale et concrétise les possibilités d’une exigence artistique. Avec une gaine étatique aussi intransigeante, on se dispense des jappements compassionnels des chiens judéo-chrétiens qui entendent soutenir l’égalité de tous les hommes dans la souffrance. Rien n’est plus nuisible à la force que les élans extravagants d’une compassion chrétienne, et rien n’est plus hypocrite dans la mesure où les premiers chrétiens n’ont pas été troublés par l’esclavage.
2/ Chaque homme est saisi par l’appétit de vivre, et ce désir de persévérer dans l’existence révèle une contradiction rédhibitoire : la civilisation se quintessencie en s’attaquant aux principes de l’esclavage, elle se purifie de ses imperfections, mais elle présume aussi l’esclavage dans la manière qu’elle a de s’organiser parce que chaque homme est aux aguets d’une situation qui pourra le fortifier dans la vie. Ramenée à l’éternité du devenir, la civilisation humaine s’inscrit dans une lutte perpétuelle des forces et des qualités. On identifie derrière ce propos le Polemos d’Héraclite, c’est-à-dire la guerre inhérente à la nature où les contraires s’affrontent et imprègnent l’univers en force de vie (jour se bat contre nuit, lourd se bat contre léger, grand se bat contre petit, etc.). Nietzsche clarifie cette guerre cosmique avec l’image de deux lutteurs qui s’affrontent indéfiniment sans que jamais l’un ou l’autre ne prenne le dessus, si bien que tout est chaque fois un peu dans tout, et que rien n’est définitivement isolé de l’architecture spasmodique de la nature (21). Les Grecs adhéraient de bon cœur à cette joute universelle; ils entraient la tête haute dans un monde envisagé comme «le jeu de Zeus» (22). Dans cette perspective, la justice se pense moins dans les tribunaux du droit positif que dans l’immanence éloquente d’une justice prononcée depuis les grands mouvements telluriques, depuis le combat fondamental qui se joue à l’intérieur du multiple cosmique.
3/ Par conséquent la cruauté que nous distinguons dans l’esclavage ne serait qu’une autre de nos hallucinations intellectuelles. Pour Nietzsche, l’esclavage n’est que le reflet humain des luttes naturelles qui subsistent de toute éternité. On se plaît souvent à vanter l’harmonie de la nature, mais si nous y regardions de plus près, si nous nous abaissions par exemple au niveau des petites herbes pour contempler le monde fascinant des insectes, on apercevrait un nombre faramineux de meurtres et de massacres ! Le règne de la force naturelle constitue ainsi l’étalon de mesure le plus fiable pour juger de l’esclavage. On s’entend finalement sur le fait que la disjonction des forts et des faibles est auto-normée, ceci n’ayant nullement besoin d’une justice hétéro-normée par des chefs usurpateurs. Tout le reste n’est que bigoterie et spéculations de philosophes douillets.
4/ Nos instincts sont corrélés aux convulsions du multiple belliqueux de la nature, aussi n’avons-nous pas de scrupule à confesser que le vainqueur domine le vaincu comme il le souhaite, que la force établit le droit liminaire et que tout droit, au fond de lui-même, contient l’empreinte d’une violence insurmontable. Reconnaître cela, c’est reconnaître par la suite que l’État est fondé sur cette base de violence et qu’il n’est que l’objectivation sociale de cet assortiment de sauvageries primitives – aux instincts animaux succède l’instinct de la politique. Ce passage d’un chaos de forces à un aménagement plus ou moins viable des intensités naturelles est ce qui permet au génie de s’épanouir. La logique de l’État n’en est donc que plus nécessaire, tout comme ses fondations ignominieuses continuent d’agir en filigrane, irradiant l’ensemble de nos délibérations et de nos actions. En fin de compte, bien que l’État soit revêtu d’un habit mondain, bien que chaque Cité grecque soit exemplairement régulée, chacune d’entre elles s’abreuve à la fontaine intarissable du Polemos et se tient prête à faire la guerre aux autres Cités (23).
Nietzsche nous montre ainsi que «la guerre est aussi nécessaire à l’État que l’esclave à la société.» Pour les Grecs de l’Antiquité, la guerre et l’esclavage s’entre-nourrissent, les deux s’acheminant vers un génie militaire des hommes supérieurs qui orchestrent les castes militaires viriles où sont embrigadés avec dévouement les hommes inférieurs. Les guerres, en outre, limitent les penchants égoïstes et accentuent le sentiment du patriotisme. Les esclaves de toutes sortes n’ont alors pas l’occasion de se soucier d’eux-mêmes et d’aspirer à des projets d’émancipation. Ils sont même doublement valorisés : non seulement ils assurent la sécurité de leur patrie, mais ils cristallisent aussi la totalité de l’État par leur empressement à le servir partout. En tant que fraction la plus faible de la société grecque, les esclaves n’en sont pas moins athlétiques, bien plus forts que les esclaves de la modernité qui s’engraissent en illusions et en nourritures solides compensatrices. Les Grecs tendaient physiquement à la Forme tranchante, ils approchaient corporellement et spirituellement des arêtes, tandis que les hommes de la modernité s’activent en Difformité, frères honteux des enflures organiques et des pensées furonculeuses. Les Grecs ont affiné le monde et les mauvais héritiers n’ont fait que l’épaissir, l’alourdir – l’encombrer.
En raison de cela, étant donné que l’époque moderne dispose également d’un État pour chacune de ses nations, il faut se rendre à l’évidence : malgré qu’il en ait, l’État moderne est un instrument d’asservissement, il est parvenu à schématiser ses forces, mais il ne s’est pas donné le même cahier des charges que les Grecs. Pour les modernes, le génie artistique est plus que secondaire. Ce qui importe en effet pour les néo-esclaves, c’est l’enrichissement personnel, c’est la Bourse, et si l’État grec était une femme sublime comme Hélène, l’État moderne n’est plus qu’une dame âgée aux allures impudentes de fille de joie. Les esclaves de «l’optimisme libéral» renient le Polemos car ce sont des chiens domestiques froussards, des eunuques à truffe qui font le trottoir de l’État à longueur de journée et de nuit. Rongés par le népotisme, ils ont horreur de la joute – le népotisme étant le processus par lequel l’idée même de la joute est bannie, par faiblesse d’avoir tendu une partie intime de soi-même pour avoir le bonheur d’un accès libre à la réussite financière. C’est pourquoi l’homme moderne est un avorton, une mauviette, un militant nerveux de la paix : il a une peur panique de la guerre ! Toutefois n’allons pas faire une erreur d’interprétation sur cet avorton : ce qu’il craint dans la guerre, ce n’est pas la mort sanglante d’autrui (car celle-ci le réjouirait en comprimant la concurrence), mais la perte du statu quo narcotique, la destruction des valeurs apocryphes qui lui ont offert les opportunités d’être un avorton déguisé en homme fort, c’est-à-dire un «tueur» socialiste en costume, une mouche excrémentielle qui sait recharger le fusil du népotisme et qui tremble devant la moindre opposition sérieuse. Autrement dit, l’avorton ne critique pas la guerre parce qu’il est moral, mais il la critique parce que c’est un pleutre qui s’est habitué aux faux combats de notre société mensongère, et il a de surcroît la conviction qu’il se ferait tailler en pièces par une guerre venue des profondeurs de l’homme. Et pour accabler davantage cet avorton cosmopolite par calcul, citons Kant avec soin, lui qui n’était pas l’homme le moins moral du monde : «On peut donc continuer à débattre tant qu’on le voudra, en comparant l’homme d’État et le chef de guerre, pour savoir lequel des deux mérite plus particulièrement le respect : le jugement esthétique tranche en faveur du second. Même la guerre, lorsqu’elle est menée avec ordre et un respect sacré des droits civils, a en elle-même quelque chose de sublime, et en même temps elle rend d’autant plus sublime la manière de penser du peuple qui la conduit de cette manière que ce peuple s’est exposé à d’autant plus de périls et qu’il a pu s’y affirmer courageusement; en revanche, une longue paix assure habituellement la domination du simple esprit mercantile, ainsi qu’en même temps de l’égoïsme rempli de bassesse, de la lâcheté et la mollesse – ce par quoi elle abaisse en général la manière de penser du peuple» (24).
Cette transfiguration négative de l’État moderne en haut-parleur de la démocratie capitaliste mondialisée est la cause absolue de notre déchéance. En modulant l’instinct étatique en instinct financier, l’esclavage a métastasé et le corps politique s’est engourdi en une sorte de goitre cauchemardesque. Ce changement de centre de gravité a entraîné le dépérissement de toutes les formes du génie – la parole oraculaire a régressé en parole managériale, les créations ont muté en productions, l’infini (Apeiron) s’est totalisé en zone finie (Peras), la main qui prolongeait le cosmos s’est rétractée en main manufacturière, l’individu s’est agrégé au troupeau, la figure du prophète a dégénéré en figure du politique rapace, l’éducation, enfin, s’est réformée en conditionnement.
La sidérante incompréhension de la modernité réside en ceci qu’elle croit aux forces du troupeau et aux encadrements, ou qu’elle feint d’y croire en sédentarisant un troupeau qui courtise des esclaves apparemment mieux lotis dans l’étant. Or nous n’avons dans la modernité que des degrés de l’esclavage, tous partageant le même dénominateur commun de la faiblesse. Aucun homme moderne n’est digne car aucun d’entre eux n’a la dignité d’incarner un instrument pour favoriser l’éclosion du génie. C’est toute la différence avec l’esclave grec qui se valorisait en consacrant ses forces brutes à la force des individus supérieurs. La discordance avec notre présent est dramatique tant la masse de notre servitude s’extasie en médiocrité et se passionne pour des expressions de la pure illégitimité sans jamais véritablement les contredire. Mais peut-être que la contradiction des représentants actuels du pouvoir n’est même plus concevable dans la mesure où les esclaves d’en bas ne font secrètement qu’envier les esclaves d’en haut. Puisque tout le monde est relativement illégitime à l’ère des esclaves planétarisés, il serait incongru de remettre en question ceux qui nous ressemblent tellement. D’ailleurs, abstraction faite de la maladresse du propos, n’était-ce pas le sens des paroles de Lars Von Trier lorsque celui-ci avait jeté à un parterre d’esclaves la possibilité que nous fussions tous des nazis ? (25).
À choisir, donc, entre la modernité et les Grecs, Nietzsche choisit les Grecs sans aucune espèce d’ambiguïté. Il termine son texte par une évocation de la Cité idéale de Platon, regrettant certes que les artistes ne soient pas directement placés à la tête de l’État, mais se félicitant tout de même de l’aristocratie symbolisée par le tempérament du philosophe-roi. En dépit de la mauvaise estime de Socrate pour le génie artistique, on doit se satisfaire du choix d’un génie de la sagesse pour diriger les hommes, la logocratie platonicienne valant toutes les kakocraties de la modernité. En tant que ce modèle politique s’efforçait de mettre les esclaves au service des maîtres, Nietzsche l’évaluait in fine comme «le hiéroglyphe extraordinaire d’une doctrine ésotérique sur la relation entre l’État et le génie, doctrine profonde et qui restera toujours à déchiffrer.»
Notes
(1) Ces préfaces peuvent être lues dans La philosophie à l’époque tragique des Grecs (Gallimard, 2005).
(2) N’allons pas du reste imaginer que Nietzsche aurait soutenu quelques décennies plus tard les perspectives envahissantes du fascisme hitlérien. Ce serait un contresens majeur, et c’est d’autant plus facile de s’en convaincre que c’est bel et bien le gâtisme des Européens, tant de fois critiqué par Nietzsche, qui a engendré quelque chose d’aussi aberrant que le nazisme. Aucune culture digne de ce nom n’aurait toléré ne serait-ce qu’un ersatz de la moustache d’Hitler dans l’espace public et privé.
(3) Cf. Nietzsche, La joute chez Homère (ce texte faisant partie des Cinq préfaces).
(4) Nietzsche cite longuement cette réflexion d’Hésiode dans La joute chez Homère.
(5) Les tenants de ces idées politiques sont effectivement empressés de défendre la veuve et l’orphelin, mais s’ils pouvaient eux-mêmes se situer au-dessus des deuils et des orphelinats, cela les arrangerait, quitte à se vautrer dans les pratiques les plus immorales en essayant de les passer sous silence.
(6) Pour ce cas de figure, il faudrait parler avec Platon d’une radicalité de l’epithumia (cf. République, livre IV). Dans ce type de contexte exacerbé, il faut accepter de penser que l’homme n’aurait plus ni intelligence (noûs) ni impétuosité (thumos) pour le délivrer du désir animal de survivre à tout prix. À peu de choses près, les personnages mondains que Faulkner met en scène dans son roman Moustiques auraient pu se découvrir sous cet aspect épouvantable si la croisière qu’ils effectuent avait mal tourné. Par ailleurs, si l’on veut profiter d’une scène littérale d’anthropophagie en pleine mer, nous recommandons chaudement la lecture de La montagne morte de la vie de Michel Bernanos, avec cette nuance que les voyageurs de Bernanos n’appartiennent pas à la société aisée.
(7) Nous empruntons l’image du javelot à Nietzsche (cf. La philosophie à l’époque tragique des Grecs, paragraphe 1).
(8) Cf. Nietzche, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement.
(9) «Si vous ne parvenez pas à éprouver un dégoût physique pour certains mots et tours auxquels nous ont habitués les journalistes, renoncez à aspirer à la culture […]» (cf. Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, deuxième conférence).
(10) Qu’il nous soit permis ici de pointer du doigt l’affreux novlangue managérial. Qu’il nous soit permis encore de renvoyer à un livre crucial de Baptiste Rappin : Au régal du Management : le banquet des simulacres (Éditions Ovadia, 2017).
(11) Cf. Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, troisième conférence.
(12) Ibid.
(13) Bien plus qu’une théorie grotesque du Grand Remplacement, qui, si elle était vraie, serait une chance pour renouveler les effectifs de notre pays éreinté, nous proposons un Grand Replacement, c’est-à-dire la montée des forces vives aux fonctions de responsabilité et la descente des imposteurs aux fonctions accessoires. Platon n’aurait pas démenti cet impératif de mobilité : «Et nous ajoutions qu’il ne fallait élever que les enfants des bons, et qu’on devait se débarrasser des mauvais en les faisant passer secrètement dans l’autre groupe. Toutefois, les autorités devront sans cesse surveiller les enfants, à mesure qu’ils grandissent, pour faire remonter ceux qui s’en montreront dignes, et pour déplacer ceux qui, dans leur groupe, s’en montreront indignes en leur faisant prendre la place de ceux qui auraient été promus.» (Platon, Timée, 18d-19-b, Socrate rappelant ici certains principes évoqués dans République, livre III).
(14) L’extensiopathie.
(15) Cf. Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, quatrième conférence.
(16) Baudelaire, Les fleurs du Mal.
(17) Cf. Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, cinquième conférence.
(18) Ibid.
(19) Nietzsche, La philosophie à l’époque tragique des grecs (paragraphe 1).
(20) On retrouve par ailleurs cette idée dans Humain, trop humain, livre 1, paragraphe 163.
(21) Cf. La philosophie à l’époque tragique des Grecs, paragraphe 5.
(22) Ibid., paragraphe 6.
(23) «Calme et fier, l’État s’avance à la barre conduisant par la main cette femme majestueusement épanouie : la cité grecque. C’est pour cette Hélène qu’il a mené ces guerres. Quel juge à la barbe grise pourrait alors le condamner ?»
(24) Cf. Kant, Critique de la faculté de juger, paragraphe 28.
(25) Von Trier avait fait cette déclaration lors d’une conférence de presse où la discussion portait sur son film Melancholia, sélectionné pour le Festival de Cannes 2011.




























































 Imprimer
Imprimer