« Trois buccins de l’Apocalypse : Baudouin de Bodinat, Matthieu Grimpret et Leonardo Castellani | Page d'accueil | Don DeLillo dans la Zone »
26/07/2018
Martin Eden de Jack London : des causes d’une grandeur et des raisons d’une déchéance, par Gregory Mion

 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.«Écrivains pour lesquels la critique à leur premier livre hésite non sur la réussite plus ou moins grande, le dosage des qualités et des défauts, mais sur ceci de plus sérieux qu’on appelle en sport la catégorie : écrivain ou plumitif, percheron ou pur sang. Au second ou au troisième galop d’essai, on est fixé : on fait une marque à la queue ou à la crinière, pour simplifier.»
Julien Gracq, Lettrines.
Le sentiment amoureux en tant que moteur de l’écriture (et inversement)
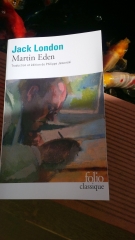 Acheter Martin Eden sur Amazon.
Acheter Martin Eden sur Amazon.Parmi les constantes affectives qui tiennent l’humanité debout et lui prodiguent l’envie de se dépasser, on a évidemment tout le répertoire amoureux, mais plus précisément, lorsqu’on se rapproche de l’apogée de ce florilège sentimental, on ne peut manquer d’être ému par l’histoire millénaire de ces hommes qui devinrent écrivains moins par désir de gloire que par désir d’être aimés d’une femme, ou par volonté, encore, de continuer à être aimés, comme si l’écriture était la garantie constitutive et nécessaire de la réciprocité des amants, ainsi que la nourriture suprême de l’intelligence féminine qui, en retour, récompenserait ces hommes romanesques de l’avoir rassasiée de spiritualité ou d’aventures. Du reste, s’il existe des femmes qui se sont obstinées à écrire pour conquérir l’assentiment renouvelé d’un homme, elles ont certainement moins souffert de cette fébrile dépendance tant il est vrai que la matrice des relations humaines, depuis qu’on l’investit de toutes parts, a montré que ce sont presque toujours les hommes qui finissent par soupirer sous des balcons orgueilleux, à l’affût d’une oreille conciliante et disposée à entendre quelques simagrées nocturnes. Bien des hommes de lettres, et souvent parmi les plus endurcis, ont souffert des seules critiques d’une femme plutôt que des persécutions de la multitude – comme ils ont parfois bu à la coupe du compliment féminin à grosses gorgées en dédaignant les éloges d’une foule d’admirateurs.
On connaît par exemple tout le trouble de Nietzsche lorsqu’il fit la connaissance de Lou von Salomé (1) en 1882 par l’intermédiaire de Malwida von Meysenbug, lui, pourtant, le philosophe qui se prévalait des formes basses de l’amour, sombrant prématurément et maladroitement dans la demande en mariage, ce contrat institutionnel qu’il voyait comme le sommet de la servitude et le moyen d’obtenir un passeport sexuel pour une éventuelle longue durée. C’est Lou qui déclina la proposition conjugale, en modèle de femme libre qui ne s’était pas non plus engagée avec Paul Rée, l’ami de Nietzsche, préférant aux somnolences prévisibles du mariage une «trinité» intellectuelle avec ces deux hommes d’exception. Le printemps et l’été 1882 seront extravagants d’échanges de haute voltige et d’excursions enivrantes pour Lou et Friedrich, ce dernier détaillant à la jeune femme les chemins ascendants de sa philosophie. L’état de grâce sera bref, cependant, car la sœur de Nietzsche, Elisabeth, enraye la belle mécanique de cette alliance platonique, et Lou, en femme individuelle, déplace ses distinctions électives vers la personnalité plus débonnaire de Paul Rée. Les conséquences sont terribles pour Nietzsche dès l’hiver 1882-1883 : le solitaire invétéré se lamente abondamment de cette perte, puis, de loin en loin, il se remet à l’ouvrage, décochant de temps à autre des flèches misogynes qu’on a pu attribuer à la rancœur sinon de ne pas avoir été aimé comme il se devait, du moins de ne pas avoir été compris par une femme qu’il estimait véritablement à l’époque de leurs pérégrinations communes. Que n’eût probablement pas écrit le grand Nietzsche s’il avait pu suivre une voie de persistance avec Lou ! Même dans le cas de ce penseur de la virilité martiale et de l’égoïsme créatif, il est permis de croire que le déficit du féminin, confirmé avec le retrait de Lou, aura contribué à une sorte d’incomplétude dans le prolongement de ses idées. Mais à considérer la situation d’un point de vue davantage objectif, il nous faut admettre que Lou n’était qu’une demi-cérébrale, intellectuellement médiocre et accidentellement tombée dans la galaxie du génie comme un astre vulgaire.
Nous insistons par ailleurs sur la brève et fulgurante trajectoire sentimentale de Nietzsche parce qu’elle éclaire non seulement plusieurs révolutions du cœur chez Martin Eden, le héros désormais mythique de Jack London, mais aussi plusieurs de ses convictions théoriques dans la mesure où ce baroudeur des mers se réclamera progressivement de la pensée nietzschéenne. À l’inverse toutefois des accomplissements respectifs de Nietzsche et de Lou von Salomé au moment de leur rencontre, Martin Eden, le jour où il voit Ruth Morse pour la première fois, n’est guère qu’un matelot inculte originaire d’Oakland tandis que Ruth est à la veille d’achever une licence de lettres dans une prestigieuse université californienne. En sorte que c’est un peu Ruth qui ressemble à Nietzsche et Martin à Lou : l’étudiante nubile est un Tout quasiment constitué alors que l’intrépide marin est un presque-Rien. À la fin cependant, Ruth se révèlera aussi frivole que Lou, et Martin atteindra en partie les cimes nietzschéennes qu’il avait tant convoitées, ultimement vaincu par la fatigue qui diminue les premiers de cordée, ceux qui ouvrent les voies sur les parois hostiles et vacillent admirablement devant l’infini (2). Héros intérimaire des altitudes de la création, humain malgré lui et tellement déçu ne de pas avoir été soutenu par Ruth lors de ses escalades, Martin Eden redescendra de ses perchoirs et choisira d’être englouti par une autre forme de l’infini : la mer et ses abysses, miroir profond des hauteurs jadis espérées, reflet essentiel sur lequel nous reviendrons en épilogue de notre examen.
S’il n’y avait pas eu Ruth, néanmoins, l’ambitieux Martin Eden n’aurait pas été jusqu’au bout de ses volontés. Il s’est acharné dans l’écriture pour gagner l’estime d’une femme qui représentait à ses yeux le summum du raffinement et du savoir. Il a été impressionné au début par l’étalage d’un prétendu bon goût, par les références littéraires et les signes de la réussite sociale. À côté de cette femme qui vivait parmi les livres et les langages policés, Martin Eden s’est d’abord accusé de maladresse. Sur la terre ferme, il était titubant comme un bateau éprouvé par l’océan déchaîné plusieurs années durant, et, dans un intérieur distingué où tout avait la certitude des choses stationnaires, il chancelait, il tanguait, aussi sauvage que l’on pouvait apparaître dans l’œil soupçonneux des bien-pensants, souffrant de la comparaison avec un pic de civilisation. À la suite de quoi, la maladresse auto-diagnostiquée s’est aggravée en intimidation. Il ne pouvait tenir le choc au milieu des membres de la famille Morse, tous éduqués, intégrés dans les places fortes du monde, héritiers des meilleurs sangs et des plus significatifs triomphes de la culture américaine. Les Morse avaient pour eux les configurations de l’Ordre universel comme s’ils étaient les agents supérieurs d’un projet divin – ils ressemblaient à des arguments d’autorité en chair et en os. Par dissonance avec ce gabarit de parfaites proportions, Martin Eden était un messager du Désordre, une présence chaotique intempestive, une pièce rapportée fortuitement invitée au domicile des Morse après que Martin eut sauvé Arthur, le frère de Ruth, d’une bagarre qui allait tourner mal. Ce détail assujettit d’emblée Martin à la trivialité de la violence. Selon les sous-entendus mesquins de la bourgeoisie, il n’a pas sauvé Arthur par le biais d’une délibération morale qui aurait traduit sa pureté d’intention, il n’a fait que suivre un tempérament de brutalité, s’engouffrant dans la rixe par unique souci de divertissement gratuit. C’est pourquoi la compagnie de Martin n’est que tolérée lorsqu’il est cordialement présenté aux Morse après l’altercation d’Arthur avec quelques vauriens – elle ne sera ensuite que supportée, puis tout à fait rejetée.
Il n’empêche que cette incursion dans la maison des Morse a suffi pour établir une vive impression sur l’âme primitive de Martin Eden. La vue de Ruth l’éblouit comme s’il avait essayé de rivaliser avec le regard du soleil. Dès qu’on aura refermé la porte derrière lui, Martin n’aura qu’une idée en tête, tel un adolescent échaudé sorti d’un roman de Dostoïevski : conquérir l’amour de Ruth en empruntant les sentiers scabreux de l’écriture. Il est ainsi fermement décidé à prouver que l’on peut se transfigurer grâce à la création littéraire. L’écriture sera son passe-muraille pour faire tomber la forteresse des Morse et arracher Ruth aux préjugés de sa classe dominante. Envers et contre tout, lorsqu’il sera un écrivain reconnu, elle n’aura d’autre choix que de l’aimer car il est impossible de rejeter la cavalcade d’un chevalier des lettres, fût-il d’une indigente lignée. Cet homme du lointain, irrigué de toutes les mers de la planète alors qu’il n’a que vingt ans, se fera un devoir de déniaiser cette femme des sécurités rapprochées. Si elle a été pour lui une étincelle d’érotisme pour la beauté du style et des idées, il sera pour elle un accélérateur des particules organiques, un Oliver Mellors qui réveille une lady Chatterley de son sommeil dogmatique. En un mot, il pourfendra le dualisme des classes sociales en instaurant le monisme d’un amour implacable guidé par la passion littéraire.
Un embryon d’écrivain : Martin Eden s’embarque sur un nouvel océan
Bien qu’il ne soit qu’un enfant des quartiers pauvres et un typique moussaillon d’Oakland, Martin Eden n’est pas totalement dépourvu de lettres. Disons que son langage et ses lectures se résument à un «petit bagage livresque» où se détache craintivement le nom du poète Henry Longfellow. Or il nous faut imaginer ce «bagage» comme une vieille et lourde malle dont les multiples épopées sur des mers houleuses ont fait chavirer les timides contenus. Par conséquent, on peut supposer que les savoirs de l’enfance, s’ils étaient plus ou moins harmonisés dans la tête de Martin à l’orée de sa vie, ont peu à peu subi l’affolement des voyages et des contraintes. Les tempêtes en mer et les roulis défavorables de la société ont engendré des herbes folles dans ces fragiles atomes de culture. Assez typiquement pour une énergumène de son mauvais rang, Martin Eden a perdu la culture initiale que les bourgeois parviennent à exploiter, son champ de connaissances ayant été envahi progressivement par un fatal chiendent. Il n’a pu entretenir les diamants liminaires du savoir humain et faute d’avoir pu s’affirmer en culture, il s’est familiarisé avec les manifestations radicales de la nature – climats extrêmes, éléments enragés, personnalités grossières, etc. C’est donc de très loin que Martin Eden s’élance dès lors qu’il se destine à séduire la ravissante Ruth Morse. Il part à l’assaut d’une terre inconnue qui n’est dessinée sur aucune des cartes maritimes qu’il a pu étudier. Il veut la gloire pour être brillant dans les yeux de sa promise, mais, par-dessus tout, il ambitionne la compréhension de la beauté. Pour cela, de jour comme de nuit, il pratiquera les grands auteurs, tournant et dévorant frénétiquement les pages de ces compositeurs du verbe, guettant les «principes» et les archétypes du Beau, sollicitant les moindres symptômes de «l’anatomie de la beauté».
Il entre littéralement dans le temple d’une nouvelle langue – celle de la littérature, et par extension celle de Ruth, qui s’exprime avec la délicatesse et la poésie des livres. Ceci implique une scrupuleuse correction de sa grammaire défaillante et saturée de boursouflures argotiques. Martin a l’humilité de se faire reprendre par Ruth à chacune de ses phrases ou tournures impropres. La succession des séances d’orthopédie linguistique motive en outre un bien étrange frémissement au fond de cet homme barbarisé par ses odyssées navales : l’envie d’écrire afin de combler la distance qui le sépare de Ruth, l’envie d’arriver au port d’attache de tout ce que le monde a inventé de plus beau. Cette envie d’écriture est fortifiée pendant un nouveau séjour en mer, puisque Martin effectue des missions régulières de matelotage à dessein de renflouer ses modestes économies. La mer est à peu près tout ce qu’il connaît et il se persuade que l’on ne peut écrire qu’à partir de ce que l’on connaît (3). En cela, il nous rappelle Joseph Conrad qui fit son apprentissage de la vie sur les bateaux, se rassasiant de la vastitude océanique avant de restituer sur le papier la matière aventureuse de cette expérience. Généralement parlant du reste, le profil du romancier qui a suivi la cadence d’une vie tambour battant, ceci en préambule de toute écriture, est un paradigme anglo-saxon. On présume à juste droit que l’école de la vie est une formation plus efficace que les aboutissements scolaires. Il y a cette idée que la confrontation précoce avec la nature induit un durcissement du caractère qui se prépare ainsi à délivrer un matériau inédit, ou à tout le moins surprenant, par contraste avec une littérature de l’urbanité qui produit de belles phrases mais qui s’épuise en platitudes bavardes, quand cette littérature n’est pas tout bonnement prisonnière d’une horrible dissertation de psychanalyse, à la recherche d’un Moi qui n’a rien vécu et qui se façonne un château de Dracula pour se faire peur.
L’on s’aperçoit donc que Martin Eden a déjà une conception esquissée de l’écriture. Son jugement de goût, à l’inverse des échos académiques et du psittacisme de Ruth qui seront de plus en plus notables, s’enracine dans le terreau de l’originalité. La simplicité de Martin en dit plus long que les notices alambiquées d’un dictionnaire officiel des universités. Se dispensant des explications biographiques et des commentaires de texte, Martin considère que les hommes de lettres, les vrais, sont les géants du monde. Ils sont monumentaux par leurs œuvres et ils offrent à l’humanité de quoi se grandir à tous les égards. Ce sont encore des magiciens de l’intériorité révélée puisqu’ils réussissent à partager le «trésor des visions intérieures», en l’occurrence tout le débit exalté de nos pensées et de nos ressentis véridiques, autant de joyaux bruts qui sont remontés à la surface du fleuve profond de notre conscience et subtilement délégués à l’écluse du langage. Alors que nous avons habituellement de la difficulté à distendre l’élastique des mots pour raconter les palpitations de notre intimité, les écrivains de talent, eux, n’ont pas l’air de buter contre le mystère de la psyché. Ils se racontent aussi bien qu’ils racontent autrui, sans effort apparent de composition ni détour laborieux par le concept, et c’est même en exagérant dans la fiction qu’ils finissent par mieux nous apprendre ce qu’ils sont. Au demeurant, qu’on ne s’attende point à un retour du refoulé psychanalytique : les flux de conscience ou les monologues intérieurs de la grande littérature ne sont pas des exercices à thèmes – ils débordent les cachots libidineux du freudisme et les jeux de mots casuistes. La psychanalyse n’a jamais été que le mouroir de la littérature dès qu’elle a essayé de se jucher sur les épaules d’un écrivain de mérite, et tel un forficule qui aurait échoué à se frayer un passage par l’oreille dudit écrivain, l’analyste n’a pas longtemps hésité à descendre vers des orifices moins nobles en vue de nous servir son apocalyptique pitance. À rebours de ces brasseurs de déjections qui fonctionnent un peu comme des stations d’épuration, ôtant à la geste de vivre et de créer tout l’arôme de son secret, Martin Eden accepte le maintien de l’énigme créatrice : les titans de la narration ont un immense et impénétrable pouvoir d’expression, ils repoussent les limites de l’ineffable avec une déconcertante facilité, déjouant n’importe quelle fureur exégétique, et lorsque Martin évalue ses ânonnements à la lumière de ces montagnes d’éloquence naturelle, il s’identifie à un chien couché au soleil, gémissant, aboyant faiblement, se hasardant à traduire dans l’onomatopée la moelle de ses songes. En d’autres termes, pour Martin Eden, l’écrivain de génie est un aède qui chante avec aisance nos vérités confidentielles, et le médiocre n’est qu’un aboyeur qui postillonne quelques opinions du moment ou quelques rêves insipides de sa créance. Les uns ont des accointances soigneuses avec la singularité (l’exaltation qui se chante et qui se danse), les autres n’ont qu’une amitié empruntée pour la pluralité banalisée (l’affadissement qui s’aboie et qui voudrait durer tout en se particularisant lamentablement).
La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, jack london, gregory mion, martin éden |  |
|  Imprimer
Imprimer



























































