« L’Amérique en guerre (16) : Ces morts heureux et héroïques de Luke Mogelson, par Gregory Mion | Page d'accueil | Kétamine de Zoé Sagan »
26/06/2020
Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis, par Gregory Mion

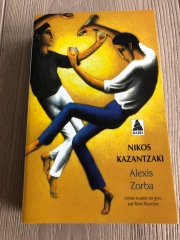 «En attendant, il se laissait aller, se reposait, se reconstituait après sa longue traversée de l’océan du savoir.»
«En attendant, il se laissait aller, se reposait, se reconstituait après sa longue traversée de l’océan du savoir.»Jack London, Martin Eden.
«Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m’entourent, hommes et femmes, sont également libres.»
Mikhaïl Bakounine, Dieu et l’État.
Avec l’inoubliable Alexis Zorba (1), écrit au début des années 1940 alors que la Grèce endure une famine dévastatrice et un fascisme multiforme, Nikos Kazantzakis médite sur une époque de sa vie passée tout en effectuant une apologie de la vie à contre-emploi d’un présent accablant. Il raconte la manière dont un écrivain de trente-cinq ans se libère des livres et fait l’expérience d’une révolte fondatrice de la chair. Dans une perspective nietzschéenne qui traverse le roman de la première à la dernière page, on peut apercevoir, au gré de cette révolte organique, les éléments d’une conversion qui s’amorce dans l’apollinien et se termine dans le dionysiaque, c’est-à-dire le cas d’une existence dont la perfection formelle (Apollon) se trouve subitement confondue et encouragée à nier sa forme individuelle pour fusionner avec le délire océanique de la totalité mouvante du monde (Dionysos). D’abord prisonnier d’une conception limitée et muséale de la beauté, l’écrivain, peu à peu, s’affranchit des dogmes constitués de la création en découvrant le mobilisme universel qui anime le vivant. À la faveur de son amitié avec un dénommé Stavridakis (2), il va rejeter sa condition de «rat de bibliothèque», otage de «l’encre» et du «papier» (p. 24), afin de commencer à revêtir son âme avec le muscle et le nerf des choses mêmes (cf. p. 25). Cet élan initiatique, toutefois, se complètera d’une façon inattendue dans la mesure où Stavridakis est appelé sous d’autres latitudes par le devoir patriotique. L’écrivain, bien décidé à ne pas laisser le flambeau de la vie retomber dans les gouffres glacés de la réclusion savante, prend la décision de partir en Crète pour exploiter une mine de lignite. La mine, symboliquement, oblige le jeune homme à se lancer dans une bouleversante catabase, dans une descente vers le noyau du monde, à l’opposé des anabases de l’esprit qui se satisfait uniquement de son agilité, en rupture absolue avec les vérités du corps. Et c’est en attendant son bateau salvateur au Pirée que l’écrivain fait la rencontre d’Alexis Zorba, soixante-cinq ans distribués par le truchement d’une «haute stature d’escogriffe» (p. 85), doté «[d’un] cœur vivant, [d’une] voix chaleureuse, [d’une] grande âme brute [qui n’a] pas coupé le cordon ombilical avec sa mère, la Terre» (p. 32).
L’amitié qui ne cessera de croître avec Zorba est une parfaite continuité de l’amitié vécue avec Stavridakis. Au sens le plus grec et le plus aristotélicien du terme, ces deux amitiés sont ancrées dans la tradition de la philia. Cela signifie que l’amitié se définit comme une vertu assidûment travaillée, comme une relation bienveillante pleinement réciproque et comme un lien totalement désintéressé puisque l’ami est aimé pour lui-même et non pour ce qu’il est susceptible de nous rapporter. Cette amitié subtile, voire cette affinité élective, n’apparaît que deux ou trois fois au cours d’une vie, d’où, évidemment, le soin particulier qu’elle implique. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote ajoute d’ailleurs qu’il est nécessaire de partager beaucoup de temps et beaucoup d’habitudes avec l’ami de sorte à se rendre digne de l’amitié et digne de confiance. En outre, ce qui a probablement convaincu l’écrivain de partir en Crète en compagnie de Zorba, c’est la simplicité avec laquelle celui-ci a fait irruption. À rebours de cette «heure du soir qu’aima P.-J. Toulet» (3), présage de ténèbres et d’inquiétude, c’est au seuil de l’aube que Zorba s’est invité à la table de l’homme de lettres (qui est aussi le narrateur), presque plus naturel et plus vivifiant que le soleil en approche. La dimension aurorale du personnage de Zorba est indéniable et elle inscrit un héliotropisme fondamental dans l’intériorité de l’écrivain. Aussitôt silhouetté parmi la nuit finissante et le jour encore timide, Zorba congédie toutes les tentations crépusculaires, et s’il a spontanément accosté cet écrivain sur le point d’entamer un changement d’existence, c’est en quelque sorte parce qu’il a deviné sa volonté de métamorphose, parce qu’il a entendu le coup d’État qui se préparait au sein de cette conscience jusqu’alors trop dépendante des livres de fiction, des encyclopédies et des doctrines idéalistes. C’est parce que Zorba «connaît si bien l’âme humaine» (p. 88) qu’il a ressenti une attirance extraordinaire pour ce solitaire en route vers la Crète et vers son humanité réconciliée avec elle-même.
La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.





























































 Imprimer
Imprimer