« Apocalypses biologiques, 6 et 7 : La Chose d'un autre monde de J. W. Campbell Jr. et The Thing de John Carpenter, par Francis Moury | Page d'accueil | Apocalypses biologiques, 8 : Resident Evil de P. W. S. Anderson, par Francis Moury »
11/08/2020
L'Amérique en guerre (17) : Home de Toni Morrison, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Ina Fassbender (Getty Images).
 L'Amérique en guerre.
L'Amérique en guerre.Décédée le 5 août 2019, en pleine pompe estivale, Toni Morrison n'a eu en France que les hommages auxquels on pouvait s'attendre de la part d'une critique littéraire devenue inexistante, illettrée, putassière et en cela favorable à toutes les impostures d'un pays qui en compte malheureusement beaucoup. Le 4 septembre 2019, dans une émission dite de rentrée littéraire, l'insupportablement idiot François Busnel, l'un de nos plus glorieux promoteurs de veaux et de vaches laitières de la littérature avec Augustin Trapenard, promet de rendre les honneurs à Toni Morrison. Pour ce faire, il invite quatre idiotes, quatre juments sauteuses de haies commerciales, quatre navrantes petites blanches qui n'ont jamais rien compris à Toni Morrison et qui n'y comprendront jamais rien pour d'évidentes raisons. Le temps venu de rendre hommage, toutes les quatre débitent d'affligeantes et embarrassantes banalités pendant un temps très court, ayant l'air avoir consulté la veille une notice Wikipédia sur tel ou tel livre de Toni Morrison. Une question s'impose déjà. Est-ce que les actualités d'Amélie Nothomb, Julia Deck, Monica Sabolo et Cécile Coulon justifiaient qu'elles dussent d'abord parler longuement de leurs navets respectifs avant d'aborder l’œuvre de Toni Morrison ? Leurs "livres" étaient-ils si nécessaires qu'il faille les promouvoir à tout prix, même au détriment d'une émission qu'il eût fallu entièrement consacrer à Toni Morrison et avec d'autres invités ? Toutes ces interrogations relèvent du fantasme tant il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais la moindre fibre de littérature sous les projecteurs de l'infâme Busnel. Et pour couronner le tout, pour mettre la touche finale à ce qui mériterait au moins des radiations définitives de l'espace public, dans la même émission où l'on prétendait commettre un hommage à Toni Morrison, Cécile Coulon, toujours plus sommitale dans la vulgarité et l'imposture, toujours plus cooptée à la proportion de sa nullité cyclopéenne, nous gratifiait d'une confession vitale : son envie de pisser comme première pensée du matin. En de telles circonstances, le texte qu'on va lire sur Toni Morrison se veut, à bien des égards, la CORRECTION de l'INCORRECTION qu'on a fait subir à cette immense femme de la littérature américaine.
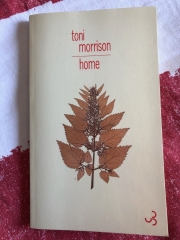 «C’est dans des villages comme celui-ci, pensait-il, que sont nés les hommes qui ont fait le renom de notre peuple. Ils sont issus de l’ombre, du silence et de l’anonymat.»
«C’est dans des villages comme celui-ci, pensait-il, que sont nés les hommes qui ont fait le renom de notre peuple. Ils sont issus de l’ombre, du silence et de l’anonymat.»Ernst Wiechert, Missa sine nomine.
Que la guerre n’est évidemment pas celle que l’on croit
Le choix de situer son roman (1) dans les États-Unis des années 1950 permet à Toni Morrison de réinvestir plusieurs aspects consolidés de la discrimination. Cette enquête littéraire fondamentale à propos de l’architecture ségrégative prend appui sur le personnage de Frank Money, un afro-américain nécessiteux et démobilisé de la guerre de Corée, revenu dans un pays en proie aux désillusions du rêve américain, aux fantasmes du maccarthysme et aux terribles survivances du préjugé racial envers les Noirs. De sorte que le titre du roman, Home, revêt d’emblée une signification polysémique car ce que raconte Toni Morrison insiste tout à la fois sur la sensation du retour au pays natal, la recherche d’un foyer de vie accueillant au cœur d’une nation divisée, la faculté de se construire une citadelle intérieure pour se dresser contre l’opprobre, et, enfin, la capacité d’offrir à autrui une sépulture informelle où il pourra reposer en paix, en l’occurrence, symboliquement parlant, la volonté d’édifier une dernière demeure susceptible de racheter les péchés capitaux d’une époque impure. Le thème funéraire, entendu là comme souvenir de la mort de quelqu’un, revêt une importance philosophique majeure dans Home et il nous aidera pour effectuer un essai d’interprétation de tout le travail romanesque de Toni Morrison.
Le livre se structure en outre par l’entrelacement de deux cadences. D’une part il y a les souvenirs diffus de Frank Money exprimés en première personne, avec cette particularité d’être adressés à l’auteur, parfois de manière provocatrice précisons-le, parfois également à la manière d’un poème en prose, comme si Toni Morrison avait le devoir de recueillir ce chaos mémoriel et d’en reconstituer la logique intime par les voies périlleuses d’une écriture classique, dépourvue de fioritures et de jugements dogmatiques. Puis, d’autre part, il y a la narration en tant que telle, c’est-à-dire les différentes étapes des tribulations de Frank Money à compter de son rapatriement militaire, assorties de l’état de ses relations avec les deux femmes de sa vie et de détails éminents concernant ces deux figures féminines (sa sœur Ycidra, surnommée «Cee», ainsi que sa copine Lily, semble-t-il perdue à jamais à cause de ce que la guerre a fait de lui, mais aussi à cause du spectre de la ségrégation qui le poursuit depuis son enfance).
C’est donc un pays en temps de détresse que Toni Morrison explore. Les premières pages de ce texte dépouillé remontent d’ailleurs une vingtaine d’années en arrière en prenant la voix de Frank, et, ce faisant, elles donnent à la détresse nationale un point d’ancrage identifié, un élément déclencheur particulier et problématique qui trouvera sa solution au terme de cette histoire (cf. pp. 11-3 et 149-153). Cette amorce narrative est implantée dans la Géorgie reculée des années 1930, à Lotus, parmi «les terres cultivées» de la périphérie urbaine (p. 11). Frank et sa petite sœur Ycidra se sont faufilés sous une clôture, fascinés par la proximité des chevaux, indifférents aux multiples panneaux qui pouvaient afficher des messages xénophobes en sus des menaces pour violation de propriété privée. Mais leur émerveillement et leur excitation déclinent aussitôt qu’ils distinguent l’inquiétant ballet d’un enterrement sauvage. Un élément retient l’attention du jeune Frank, une image cauchemardesque, sidérante et redoutable, l’une de ces visions fugitives qui fixent définitivement les oriflammes de la terreur au sein de la conscience qui l’aperçoit : «ce pied noir, avec sa plante rose crème striée de boue, enfoui à grands coup de pelle» (p. 12) dans une fosse négligemment aménagée. La subite apparition de ce brutal ensevelissement laisse les enfants désemparés, surtout la fillette qui est prise de tremblements, d’autant que leur position de témoins oculaires clandestins ne leur permet pas de déceler autre chose que des «pantalons» et «le tranchant d’une pelle» (p. 12). Le manque de visibilité des bourreaux ajouté à la netteté du sinistre outil enrobe la scène d’une aura fantomatique. Il s’agit ni plus ni moins d’une expérience fondatrice pour Frank et Ycidra, et, à l’instar de ceux qui ont vu l’impensable ou l’irreprésentable, tel Amédée de Liljecrona, rescapé de quatre ans d’univers concentrationnaire dans Missa sine nomine, les petits Money pourraient s’approprier cette parole acérée, pénétrante et paralysante comme une vérité qui tue : «Les peuples bien-pensants [mettent] l’enfer dans l’au-delà.» (2)
Les vécus respectifs de la fratrie Money et d’Amédée, baron de Liljecrona, congédient instantanément les mythologies de toutes les espèces. Le rapport étroit qui se devine entre l’épreuve de la ségrégation et l’épreuve concentrationnaire évite de procéder à une forme de romantisation du Mal ou d’expatriation de celui-ci à l’intérieur d’un cadre référentiel abstrait. Quand on a prématurément surpris le pied d’un cadavre noir ou qu’on a longtemps avisé la mort de masse méthodiquement infligée dans un Lager, on en a conclu que l’enfer, loin d’être une notion distante, possède un registre d’incarnation propre qui dédaigne le possible des représentations culturelles en tant qu’il exhibe une réalité concrète, un Mal pur et incommensurable, rétif à la morale de l’art, aux débats éthiques et aux rémissions conventionnelles. Autrement dit, Toni Morrison sécrète un passage du possible au réel, ou, plutôt, elle s’affranchit des possibilités infinies du Mal pour nous confronter immédiatement à l’infini singulier du Mal xénophobique et chromatophobique, véritable fléau américain, véritable guerre endogène au-delà de toutes les guerres exogènes qui ont rythmé l’Histoire du gendarme mondial. Tant et si bien que toute l’œuvre de Toni Morrison est à certains égards la littérature d’un casus belli qui n’en finit pas, l’étirement d’une déclaration de guerre qui paraît s’éterniser, l’Amérique ayant l’air de renouveler à intervalles réguliers son hostilité intrinsèque envers la peau noire.
Ces préambules de réflexion nous amènent à une évidence qui dérange et que Toni Morrison exploite sobrement : le vétéran Frank Money n’est pas davantage en sécurité sur le sol américain par comparaison avec ce qui se passait sur le front coréen. La destruction de la guerre n’est pas du même ordre que la destruction systémique du racisme. Là où la guerre se manifeste en général comme une présence totale et univoque, le racisme se fragmente et contamine les esprits à un niveau de profondeur si préoccupant qu’il en devient souvent irrémédiable. À ce titre, par exemple, les avancées du droit constitutionnel ne peuvent pas être des garanties ultimes contre le racisme. Le célèbre arrêt Plessy vs. Ferguson de 1896 l’a parfaitement illustré. Il stipulait que les États sudistes avaient le droit d’appliquer des mesures de ségrégation dans les lieux publics ou les transports en commun pourvu que celles-ci n’entraînent pas des conditions d’usage moins favorables pour les Noirs. Il en a résulté un genre de blanc-seing non seulement pour séparer ostensiblement les Noirs des Blancs, mais aussi pour flatter les préjugés raciaux en proposant des infrastructures nettement différenciées à destination des populations considérées comme dégradées. Il apparaît ainsi que la théorie de la loi a servi d’argument d’autorité en vue de dissimuler ou de faire oublier les circonstances de sa pratique. L’existence de la loi devait en principe suffire à contenter l’opinion éventuellement progressiste en même temps qu’elle devait réconforter les opprimés. En d’autres termes, ce qui était promulgué de jure n’était pas vraiment suivi de conséquences de facto. Le contexte social dépeint par Toni Morrison le confirme car plus d’un demi-siècle après Plessy vs. Ferguson, les lignes de démarcation physiques et psychiques entre les Noirs et les Blancs ne cessent de s’empâter malgré les bonnes intentions de la légalité.
Cette indéniable et dommageable maturation de la réalité sociale incite Frank Money à redoubler de prudence. Alors âgé de vingt-quatre ans et interné «pendant deux jours» (p. 21) en raison de motifs qui demeurent flous, Frank cherche à s’évader, à se libérer du pouvoir médical qui n’est que l’extension rusée du pouvoir politique, mais il connaît malheureusement l’énorme étendue des forces discriminatoires états-uniennes. Toutes les ramifications de son intelligence et toutes les fibres de son corps ont intériorisé le caractère panoptique de la ségrégation. Que l’on soit dedans ou dehors, à la maison ou dans la rue, à l’hôpital ou au milieu de nulle part, la répression est toujours envisageable, l’œil du pouvoir est inlassablement à l’affût, que ce soit de manière «légale ou illégale» (p. 16). Ce sentiment d’extrême surveillance ou d’épée de Damoclès dépasse les dangers potentiels qui pesaient sur les épaules de Frank lorsqu’il était soldat en Corée. L’universalité du péril blanc pour les Noirs des États-Unis semble donc procéder d’une durée indéterminée tandis que la guerre, fût-elle une guerre poussive ou remarquablement désespérante, ne paraît jamais compromettre le retour de la paix tôt ou tard. Pire encore, tandis que les armes de la guerre, massives et létales, suscitent des effets du même ordre, les armes du racisme américain contemporain, fondées sur la loi ou les dérives de la liberté d’expression, naissent dans une relative modération mais ne sont pas moins létales que celles qui officient durant les conflits balistiques. En fait la létalité du racisme est d’autant plus grave qu’elle est régulièrement l’objet d’un déni et qu’elle s’appuie sur un arsenal juridique prompt à fabriquer des lois qui simulent leur légitimité alors qu’elles amplifient sans doute la criminalisation de tout un groupe ethnique. On en arrive par conséquent à ce paradoxe qui résume le modèle d’un monde blanc américain construit uniquement pour les Blancs occidentaux : les moyens déployés pour maintenir la paix sont considérables, mais loin de justifier que leur absence nous soumettrait à un état de bellum omnium contra omnes, ils nous laissent plutôt songer que c’est à partir du maintien artificiel d’un certain pacifisme qu’une guerre sournoise et désolante continue de sévir. La politique américaine ne serait donc pas le lieu idéal de la paix, mais, tout au contraire, elle serait le lieu d’une guerre tolérée – celle des Blancs contre les Noirs. À une échelle encore plus retorse, elle pourrait très bien être la légalisation d’un espace d’inégalité où les Blancs répandent impunément ou inconsciemment l’épouvante parmi les Noirs. C’est en cela du reste que la bourgeoisie blanche censément accommodante ne fait que fortifier l’existence d’une situation politique intenable : elle critique assidûment l’inégalité qui relègue les Noirs dans la pauvreté ou la mort violente, mais elle ne questionne en aucun cas les rouages d’une société qui permet aux bourgeois de se réaliser tout en déréalisant invariablement la vie de ceux qu’ils défendent (ou feignent de défendre).
En dépit de cette perpétuelle inquiétude que les États-Unis infligent aux Noirs, Frank Money prend le mors aux dents et rejoint subrepticement, à deux pas de son asile, l’Église épiscopale méthodiste africaine de Sion, où le révérend John Locke, à l’aube, recueille les vicissitudes de cet ancien combattant sur le point d’entamer un combat beaucoup plus rude que celui de la Corée. Ce que désire Frank, c’est de rallier la Géorgie, à l’autre bout du pays, malgré sa «population impitoyable» (p. 23) et le risque palpable des «cagoules blanches» (p. 36). L’énumération de ces obstacles perfides corrobore l’existence d’un empire américain négrophobe. La Corée ne fut en quelque sorte qu’un échauffement, une propédeutique à l’horreur du racisme. Le révérend Locke ne s’y trompe pas lorsqu’il commente le recrutement militaire de Frank : «Une armée où les Noirs ont été intégrés, c’est le malheur intégré. Vous allez tous au combat, vous rentrez, on vous traite comme des chiens. Enfin presque. Les chiens, on les traite mieux» (p. 25). Les paroles engagées de ce député de l’Église mettent en exergue un processus organisé de désintégration de l’homme noir. Et le révérend n’oublie pas d’ajouter que la région du Nord n’est pas plus flexible que celle du Sud en ce qui concerne les permissions accordées à l’homme noir. Il y a dans la partie septentrionale du territoire américain une subsistance de «la coutume» qui contient finalement davantage de scélératesse que «la loi» (p. 27). L’abolition de certaines lois injustes n’aura pas fait disparaître l’injustice plus profonde d’une mentalité fasciste qui remanie incessamment la société en abusant du mensonge démocratique. Aussi, ce que semble vouloir signifier le révérend, c’est que le Nord est peut-être plus néfaste que le Sud car on y déploie une hostilité invisible qu’il est difficile de contourner. Les monstres du Sud ont au moins l’indiscrétion de leur outrance, mais le Nord, jouissant d’une réputation de civilité supérieure, n’en est que plus fallacieux dans ses discrètes révisions du racisme étatique.
C’est en définitive toute la limite de la civitas et de ses prétendus atouts républicains parfois trop vite endossés par Hannah Arendt. Dans le cas de cette opposition Nord/Sud, les tenants du savoir-vivre accusent volontiers une frange de la nation de ne pas penser, de dissoudre l’unité citoyenne, ils lui reprochent de faire le lit du Mal par son éventuel défaut de raffinement dialectique, mais ils ne s’aperçoivent pas que la pensée n’est pas toujours un rempart contre la propagation du Mal et qu’elle en est même occasionnellement le meilleur adjuvant. Ainsi la pensée se transforme quelquefois en bien-pensance, en pensée unique, en rationalisation ou en dissolution spéculative de l’incohérence, et les principes d’une morale de la tolérance ne se rendent même plus compte qu’ils ne sont que des chimères ou des boniments, des expédients pour se dédouaner d’agir conséquemment, des illusions réconfortantes qui empêchent d’interroger la mauvaise conscience blanche. Or cela remet en question les vertus de l’hospitalité du Nord et l’attribution de tous les vices inhospitaliers pour les sudistes. Qu’en est-il d’ailleurs de l’hospitalité réelle des Blancs qui vivent dans les vastes cités de Chicago, Boston, New York, Philadelphie ou Washington D.C., des villes où ont inéluctablement proliféré des ghettos noirs comme celui de Harlem, des villes où l’entre-soi blanc a pu se raffermir avec une facilité déconcertante ? Cette hospitalité est probablement l’inverse de ce qu’en dit Louis Massignon. Selon lui, toute hospitalité, si elle veut être véridique, doit héberger pleinement l’Autre sans se l’annexer outre mesure (3). À travers les mots du révérend John Locke, on peut donc postuler que Toni Morrison désapprouve l’esbroufe des nordistes, la manière dont ils accueillent superficiellement les Noirs tout en les rejetant fondamentalement. En allant plus loin, on pourrait suggérer que les Blancs veulent résoudre le problème de la reconnaissance en contraignant les Noirs à ne pas reconnaître leur négritude, en les incitant plutôt à cultiver le souhait d’intégrer à tout prix le monde blanc, en les encourageant à être blanc de fond en comble, en les pressant d’assimiler le «regard blanc» de l’Occident qui sacrifie toutes les différences et qui déteste cordialement la force naturelle, le souffle ancestral de la vitalité. Ce drame de la reconnaissance entravée, outre qu’il se démasque à la dérobée dans Home, n’en est que plus dramatiquement et notoirement introduit par Toni Morrison dès son premier roman – L’œil le plus bleu.
Eu égard à ce qui précède, la volonté de Frank d’atteindre la Géorgie n’est donc pas forcément grevée d’une plus grande incertitude que celle qui consisterait à vouloir élire domicile dans le Nord. Peu importe la destination, la totalité des États-Unis incarne une menace permanente pour les Noirs. Ce qu’il espère, ce qu’il esquisse dans un repli de son âme, c’est de pouvoir venir en aide à sa sœur malade, et, accessoirement, d’être en capacité de conjurer le passé de Lotus afin de vivre sous un toit qui serait «aussi merveilleux que la crèche pour la mère de Dieu» (4). Là se dessine par surcroît l’espérance d’une réconciliation intime, l’expectative d’un cœur apaisé, la possibilité du «pays natal [qui] se retrouve partout où l’on a un toit et un foyer et où l’on peut vaquer à sa besogne avec vaillance et parfois avec gaieté» (5). Il s’agirait par conséquent de renouer autant avec son cœur blessé qu’avec son country of birth défiguré par plus d’un siècle innommable de ségrégation(s). Encore une fois, à l’instar du baron Amédée de Liljecrona qui s’exerce à transsubstantier sa misanthropie, à convertir positivement toute la fureur qu’il a contractée dans les camps, le polytraumatisé Frank Money ne doit pas perdre de vue la tentative de sauver l’humanité qui gît en lui. Les camps de la mort nazis, la guerre de Corée et le racisme américain, s’ils peuvent faire croire que la lumière terrestre s’est gravement détériorée, n’ont tout de même pas la puissance d’altérer la lumière céleste, ne serait-ce déjà que la luminosité magique des étoiles qui subjugue tant le modeste seigneur inventé par Wiechert. Pendant toutes ses années de détention, le baron s’était imaginé «que la lumière se serait éteinte»(6), mais le ciel étoilé a constitué un démenti crucial pour son pessimisme et sa misère de vivre, l’amenant sur la voie d’une monumentale et subtile indulgence. Et tel ce baron qui renaît des cendres du désamour en compagnie de ses frères, Frank, lui, s’achemine auprès de sa sœur souffrante pour essayer de se guérir de ses propres tourments. Sa persévérance, fût-elle heurtée, le hisse au statut d’une rémanence du sacré en des temps féroces de profanation, et lui aussi, peut-être, n’est-il pas prêt à consentir au fait que «[Dieu] nous ait envoyé les démons pour qu’ensuite rien ne soit changé» (7).
Son long périple vers la Géorgie, amorcé dans l’Oregon, réveille en lui des souvenirs barbares de la guerre. Le rouge du sang versé là-bas se superpose à la blancheur de la neige d’ici (cf. p. 27), comme si l’entrepôt de sa mémoire n’était qu’une citerne d’hémoglobine fissurée, maculant le flegme des paysages enneigés d’une irrésistible sauvagerie. Ce voyage en direction de ses racines lui rappelle qu’il a d’abord été motivé par une carrière dans l’armée en vue d’échapper opportunément à la dévoration sociale de Lotus (cf. pp. 43 et 90). C’était aussi le cas pour plusieurs de ses connaissances et amis de Lotus, et deux d’entre eux, Michael Durham et Abraham Stone, sont ignoblement décédés sur le champ de bataille de Corée. Depuis lors, Frank nourrit une culpabilité de survivant (cf. pp. 103-6) qui l’a plongé dans l’alcool, l’envoûtement et l’envie de se racheter en protégeant sa sœur (cf. p. 111). Ces trois aspects de sa personne ont lentement fait succomber sa relation avec Lily. Avec elle, fatalement, il «était toujours hanté par la guerre» (p. 83), par ses camarades scandaleusement tombés et par son inavouable conduite homicide (cf. pp. 141-3), comme s’il était en permanence à côté du présent, en aparté, dépossédé de lui-même et sous l’emprise d’un Tentateur impossible à exorciser. C’est pourquoi Lily a été soulagée du «poids de devoir s’occuper d’un homme qui ne [tourne] pas rond» (p. 87) dès que Frank a pris la ferme décision de plier bagage pour la Géorgie. Dans son esprit massacré par l’expérience infâme de la guerre et par les réticulations méprisables du racisme, Frank fait le pari que les retrouvailles avec sa sœur ébaucheront une espèce de compensation pour ses crimes et pour ceux de son pays.
L’affinité qui unit Frank et Ycidra est d’autant plus élective qu’ils ont traversé une enfance marquée par le sceau de l’exil. Du jour au lendemain, tandis que leurs parents vivaient au Texas, la famille Money a été chassée du Lone Star State en pleine canicule estivale et Ycidra est littéralement «née sur la route» (p. 50). Cette naissance bohémienne aggrave de toute évidence la marginalité de la peau noire. Finalement parvenue en Géorgie avec les siens, la petite fille écopera de la haine de sa grand-mère par alliance, soi-disant ulcérée par sa naissance déshonorante, mais en réalité offensée d’avoir dû accueillir à l’improviste une famille ostracisée (cf. p. 94). Souffre-douleur de cette grand-mère infecte, Ycidra, au commencement de son existence, fait l’épreuve de la persécution qui va défavorablement scander toutes les années de sa jeunesse. Elle et Frank sont «des Hansel et Gretel oubliés» (p. 59), livrés à eux-mêmes, désertés par un père et une mère qui se tuent au travail et qui ne reviennent à la maison qu’à des heures indues. De telles conditions ont certainement retardé ou dévoyé l’apprentissage des rapports humains, d’où, par hypothèse, la propension de «Cee» à être piégée par les hommes. C’est la raison pour laquelle son idylle avec un prénommé Principal se solde par un fiasco intégral et humiliant. Lâchement abandonnée dans la jungle d’Atlanta tout en n’ayant connu de la société que le hameau de Lotus, Ycidra, désormais, doit joindre les deux bouts (cf. pp. 54-6). Ainsi dos au mur, sommée d’affronter la suite des jours, il ne lui vient pas à l’idée que le nouvel emploi qu’elle se dispose à prendre chez le docteur Beauregard Scott (8) relève d’un piège encore plus pervers que sa récente relation sentimentale (cf. pp. 67-73). Elle sera l’assistante de ce docteur considéré comme un «sudiste pur et dur» (p. 69), versé dans l’eugénisme et tant de subdivisions démoniaques de cette pratique. Elle ignore de quoi il retourne par déficit de culture, mais elle l’ignore aussi parce qu’elle est heureuse de s’être assez vite relancée après sa déconfiture amoureuse. Parmi les indices qui auraient pu l’alerter, il y a ce qui était de notoriété domestique entre les murs de la demeure Scott, c’est-à-dire le placement des deux filles du médecin dans un institut spécialisé pour cause de macrocéphalie. Il est permis de supposer que cette difformité crânienne qui a ruiné la vie des deux enfants n’a été que le triste aboutissement des expérimentations d’un père complètement aliéné par l’imposture eugéniste. Au reste, ce n’est qu’au seuil de la mort que «Cee» sera délivrée des griffes de ce docteur Mengele du Goober State. Ses chaînes seront brisées par l’obstination de Frank (cf. pp. 118-120), enfin arrivé
en Géorgie, non sans avoir dû tirer parti des recommandations vitales du Green Book (cf. p. 30).
L’effrayante maigreur d’Ycidra et son état comateux ne laissent planer aucune ambiguïté quant au fait qu’elle a subi des manipulations médicales suspectes. Le trajet vers Lotus depuis Atlanta est décisif et quoique cet endroit ne soit pas exactement un paradis sur terre, c’est là, pourtant, que Frank s’oriente, comme s’il était appelé par une intuition supérieure et par l’indéchiffrable vérité d’un paradoxal home sweet home. Aussi, malgré «le soleil malveillant» de Lotus (p. 125), malgré l’écrasante présence d’un temps qui paraît figé dans l’éternité de l’oppression (cf. p. 127), Ycidra, peu à peu, recouvre la santé grâce aux mains miraculeuses et à «l’amour exigeant» d’Ethel Fordham (p. 132), assistée d’une simple nuée de paysannes dévouées (cf. p. 128). La convalescence d’Ycidra est une aurore symbolique sous le ciel prétendument crépusculaire de Lotus. Ce rétablissement physique a également une valeur d’enseignement, une allure de passage de témoin entre la vieille génération et la nouvelle, et ce que les parents d’Ycidra n’ont pu révéler à leur fille tyrannisée, Ethel Fordham le lui inculque avec la solennité d’une homélie : «Quelque part au fond de toi, il y a cette personne libre dont je parle. Trouve-la et laisse-la faire du bien dans le monde» (p. 133). Œuvre d’évangélisation tout autant que parole testamentaire de Toni Morrison, la profonde portée de ces formules lapidaires démontre à Ycidra que la douceur du foyer n’est pas qu’une banale question d’aménagement du territoire (car Lotus ne ressemble à pas grand-chose), mais qu’elle concerne surtout l’intériorité, le deep down inside ourself, la façon dont on habite en soi-même, la façon, encore, de se rendre capable d’hospitalité totale au mépris de tout ce qu’on aura pu endurer dans le registre partial de l’hostilité. Ces perspectives de sagesse doivent en outre participer de la reconquête d’Ycidra en tant que sujet souverain. Elles doivent aussi l’aider à surmonter le diagnostic de son infécondité provoquée par les délires médicaux de Beauregard Scott, et, aux yeux d’un Frank similairement renaissant, si Ycidra «[est] éviscérée [et] stérile», elle n’est pas du tout «vaincue» (p. 142).
La renaissance de Frank va se parachever dans l’acte de prolonger son foyer intérieur en agissant directement sur la configuration du monde extérieur (cf. pp. 149-153). Il creuse une tombe pour un frère immémoré, soldat inconnu de la guerre que les États-Unis ont officieusement déclarée contre les Noirs depuis plus d’un siècle, peut-être, en l’occurrence, depuis la sévère répression de la révolte menée par l’esclave Denmark Vesey en 1822 sur les terres spasmodiques de la Caroline du Sud. Ce qui a d’abord convaincu Frank de passer à l’action, ce qui l’a déterminé à fomenter un geste puissamment allégorique, c’est le respect fluctuant vis-à-vis de son statut d’ancien combattant de Corée, les vétérans de Lotus n’accordant pas le même degré de bravoure à tous les soldats. Ils ne respectent que les hommes qui ont fait les guerres les plus dévastatrices en fonction du nombre de victimes (cf. p. 144). Par conséquent ces vieux briscards ne glorifient que les anciens des Première et Seconde Guerres mondiales. Il fallait ainsi que Frank inventât les moyens de gagner une place dans le cœur (le home) de ces hommes têtus.
D’autre part, et c’est là tout ce qui justifie l’absence de gratuité dans les romans de Toni Morrison, chaque détail étant voué à rencontrer un écho narratif à tel ou tel moment, Frank découvre, au hasard d’une conversation, ce qui se tramait dans la propriété où lui et Ycidra ont jadis aperçu la mise en terre illicite d’un homme de couleur (cf. pp. 144-8). Si cet endroit maudit a depuis lors brûlé grâce au concours présumé de Dieu, il n’en subsiste pas moins quelque chose de flottant, quelque chose de résolument nuisible et maléfique. On y organisait des combats humains clandestins, des duels à mort où des Noirs devaient tuer d’autres Noirs, et l’on rapporte l’histoire effroyable de ce fils qui a dû commettre un parricide pour rester en vie (car le règlement infernal de ces bagarres spécifiait que les deux combattants désignés seraient tués au cas où les deux s’abstiendraient d’envoyer l’adversaire ad patres). La rumeur s’est d’ailleurs autorisée à dire que ce malheureux fils aurait été libéré de son parricide en mourant à Pearl Harbor, comme si, très explicitement, la guerre 1939-1945 n’arrivait pas à la cheville de l’insupportable guerre raciale perpétrée au sein des États-Unis d’Amérique.
Il y a donc a minima un devoir de mémoire à accomplir pour l’homme enterré à la hâte sur ce terrain damné, un impératif de commémoration d’autant plus essentiel que l’homme en question pourrait être ce père assassiné par son fils. Et pour augmenter la force mystique de son geste, Frank repart vers la fosse indigente avec Ycidra, n’ayant guère de mal à retrouver les os de ce misérable paria, «des os tellement petits» dans l’organique mais tellement titanesques dans l’inorganique du souvenir. La sépulture qu’ils offrent à ce squelette, loin des terres hantées où il ne pouvait jusqu’ici se reposer dans la paix du Seigneur, se tient dorénavant au pied d’un laurier, sous le laurus nobilis qui évoque la victoire et la dignité, les honneurs louablement rendus. L’épitaphe qu’ils choisissent se passe quasiment de commentaire : «Ici se dresse un homme» (p. 152), autrement dit, en jouant sur les sonorités, ici s’érige fièrement un home.
Toni Morrison et le gouvernement des morts
Dans la lignée spirituelle d’Auguste Comte qui exhortait à penser une continuité spatio-temporelle entre les morts les vivants, les premiers devant toujours être les inspirateurs des seconds, on pourrait affirmer de Toni Morrison que non seulement elle écrit pour les morts, pour tous les disparus de la ségrégation, se faisant tout à la fois leur écho littéral et leur incarnation modernisée, mais qu’elle écrit aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore venus au monde, pour les innombrables descendants d’une nation déchirée qui auront la charge d’écouter celle qui toute sa vie aura été la médiatrice d’une parole spectrale, enfouie et tutélaire. De ce point de vue, Toni Morrison n’a jamais interrompu son dialogue avec la crypte afro-américaine, avec la nécropole de ceux qui ont été mortifiés par des siècles et des siècles d’exploitation, d’hypocrisie et de répressions diverses. C’est pourquoi la figure du spectre culmine dans l’œuvre de Toni Morrison, qu’elle soit directe comme dans Beloved avec le fantôme justicier d’une petite fille, ou indirecte comme dans Home avec ce macchabée qui initie une courbe de sainteté sur les destinées respectives de Frank et Ycidra. L’esprit des morts est en cela omniprésent chez Toni Morrison parce que tous ses personnages, plus ou moins, sont assignés à une précarité vitale qui les contraint à évoluer simultanément dans la vie et dans la mort, dans la survie sempiternelle de ceux qui sont en sursis au milieu d’une infinité de dangers. Cette hybridation de la vie et de la mort donne à ces personnages un profil de morts-vivants traqués par une société qui voit d’un mauvais œil la vitalité interlope qui les anime. Ce qui est du reste perturbant pour l’ordre blanc établi, c’est que les Noirs de Toni Morrison exhibent des silhouettes de spectres, comme s’ils étaient les avatars impérissables d’une mélancolique procession, le regard constamment attiré vers les gouffres et les précipices que l’on s’acharne à combler de soleils artificiels. Les Blancs du monde occidental, souvent tentés de valoriser la rupture entre les morts et les vivants, ont donc cette impression embarrassée d’observer les Noirs lestés du cimetière de leurs aînés, accaparés par les voix et les cris de leurs prédécesseurs en souffrance. Il suit de là que chacun de ces personnages afro-américains s’apparente à «un permissionnaire du monde souterrain [venant] de loin en loin s’asseoir au milieu des vivants» (9) afin de les entretenir de l’essentiel – de ce que les morts ont à dire pour ne pas que les vivants aient une vie pire que l’enfer.
Cette dimension abyssale de l’écriture s’attache à traduire l’outre-noir du souterrain métaphysique de la persécution. Toute la géographie de cet abîme des réprouvés repose sur la couleur d’ébène de la peau dont la calamité sécularisée se lit d’ailleurs à fleur de peau (cicatrices d’origines multiples, mutilation de guerre(s), usure précoce, etc.). D’autre part les fantasmes suscités par la peau noire accentuent l’épaisseur sociale de la ségrégation. On impute tant de qualités occultes à la peau noire, tant de représentations magiques, qu’elle en devient tout à fait inhumaine ou corvéable à merci au cœur du périmètre blanc. Il est incontestable en ce sens que la peau noire constitue un destin tragique cependant que la peau blanche, à rebours de tous ses efforts et malgré tout son angélisme plaisamment démocratique, ne fait pour le moment qu’exacerber la tragédie des Noirs. Ce que tend à montrer Toni Morrison, ou du moins ce qu’elle essaie de nous faire sentir, c’est que l’âme noire souffre en raison de sa peau, comme si la peau caractérisait le symptôme d’un assujettissement sensible, la matérialisation d’une séquestration nécessaire qui se poursuit jusqu’aux régions immatérielles. Cela implique un processus de décomposition sociale (la fermeture de toutes les portes) qui coïncide avec un processus de décomposition physique (la fabrication continuelle d’un ossuaire noir). On a ainsi la nette impression que le corps des Noirs fonctionne à l’instar d’un objet à détruire, à anéantir, à pulvériser par quelque moyen que ce soit. Mais l’écriture de Toni Morrison, en tant qu’elle prend racine au plus noir de l’Obscurité, mais, aussi, au plus près du mystère, recueille d’une certaine manière toutes les reliques de l’anéantissement afin d’en élaborer un humus fertilisant pour la composition romanesque. Les corps des persécutés se muent de la sorte en archétype de la terre féconde pour faire naître de nouveaux exemplaires de vitalité, lesquels, de temps à autre, iront jusqu’à la démesure de la vie à dessein de proscrire tout ce qui voudrait injustement les pousser dans la fosse commune des Noirs (ceci pouvant expliquer plusieurs réactions de Frank Money lors de la guerre de Corée, qui, on l’aura compris, ne fut qu’une métaphore des supplices liées à la ségrégation). En un mot, cette logique de la recomposition à partir de la décomposition exprime en fin de compte le cycle même de la nature, un règne de la nécessité primitive qui triomphe des pseudo-nécessités de la ségrégation.
Cette descente parmi les strates les plus englouties du charnier afro-américain induit une forme littéraire quelquefois déroutante. Dans la mesure où la littérature de Toni Morrison retient toutes les époques du mal colonial et du mal esclavagiste, les romans qu’elle écrit prennent parfois l’aspect d’un palimpseste, d’un soudain évanouissement d’un temps pour nous immerger dans un autre temps, car, de toute façon, l’empan de chaque vie noire est une réverbération de toutes les autres vies noires passées ou à venir. On ne recense par conséquent aucune dimension temporelle prééminente dans l’œuvre de Toni Morrison. Cette espèce de temporalité polycéphale illustre les nombreuses sensations que l’on a d’être subitement aspiré, d’être tout à coup transporté vers d’autres existences que celles que l’écrivain était en train de décrire. Il s’agit d’une écriture où les temporalités s’envahissent les unes les autres, où les lendemains de la guerre de Sécession sont analogues aux lendemains de la guerre de Corée par exemple, et cet empiètement des temporalités dénote un bouleversant Te Deum de la souffrance noire qui atteint assurément son apogée dans le gospel, dans cet hymne à la vie purificateur que Toni Morrison se réapproprie tout au long de son roman Le chant de Salomon. Le temps narratif, chez Morrison, se conçoit donc à partir d’un dérèglement primordial parce qu’il tire son origine d’une temporalité traumatisée qui est chaque fois susceptible de faire irruption dans le présent, d’où, évidemment, la multiplication des spectres et des portraits de revenants.
Cette hantise de tous les instants par la matrice de la tragédie xénophobe nous révèle pourquoi les personnages noirs de Toni Morrison ne peuvent pas faire autrement que d’être préoccupés par la souffrance des ancêtres. La pérennité de l’inquiétude est la figuration d’une perpétuité de la catastrophe noire qui s’amplifie d’autant plus que la légalité blanche refuse d’avouer son illégitimité fondamentale. Mais Toni Morrison conjure le statu quo de la domination blanche en ne reculant pas devant l’énormité, en s’emparant du négatif de la mort noire qui lui permet d’extraire le ferment d’une vitalité canonisable. Ce faisant, l’auteur de Home résiste au regard blanc qui passe pour être le summum de la conservation de la vie, alors même que cette vie la plupart du temps bourgeoise projette sur les Noirs l’insidieux substrat de sa vitalité négative. L’œuvre de Toni Morrison procède ainsi à une extension des luttes des consciences pour la reconnaissance sur le fond d’une dialectique hégélienne du maître et de l’esclave. Mais ce qui apparaît aussitôt a de quoi nous désarçonner : Toni Morrison ne fait pas de la mort un principe polémologique, elle en fait au contraire un principe ontologique étant donné que l’être du Noir est mis en équilibre (instable) par une mise à mort systématique et protéiforme orchestrée par les Blancs. Or en tant qu’il accepte la mort, en tant qu’il assume cette charge inouïe à travers la succession de ses souffrances, le Noir devrait en théorie devenir le maître. Toutefois, ce qui se produit perfidement, c’est que, contre toute attente, le Blanc se maintient sur le siège du maître en se préservant criminellement du risque de la mort. Ce retournement dialectique nous expose le gigantisme d’une injustice dont la résolution, plus que jamais, semble exiger des méthodes anti-démocratiques. Les déclarations de guerre, en effet, supposent des représailles à la hauteur des préjudices endurés.
L’ensemble des remarques précédentes nous autorise à tirer deux conclusions simples et affolantes. D’abord que Toni Morrison aura mis toute son énergie de romancière à inculper une Amérique en guerre, à faire le procès d’un pays vérolé par la maladie du racisme et qui n’a toujours pas beaucoup avancé dans le fond de ses mentalités. Ensuite que Toni Morrison n’aura écrit que des romans qui dissèquent le verrou caucasien, la fermeture concrète et abstraite de toutes les portes, la manière dont les Blancs s’arrangent pour défendre leurs suprématies institutionnelles, conceptuelles et traditionnelles. L’image du verrou colporte un hygiénisme moral qui expulse de son orbite tout potentiel de salissure, tout élément trop perturbant ou toute sémantique virile. Au-delà d’un certain seuil indéterminable, une fois franchies les limites invisibles de la bienveillance et du convenable, la tolérance blanche dégénère en intolérance, un peu comme si le sujet de la ségrégation n’était admissible que par le truchement d’opportunités bien définies. Il est difficile en ce sens d’apporter un quelconque crédit au grégarisme des protestations éphémères qui rythment la vie du bourgeois. La bourgeoisie ne se soucie des Noirs qu’à des fins presque divertissantes ou dans le but d’anticiper une troisième partie de dissertation. Elle ne fait symboliquement pénétrer le Noir dans son salon que pour mieux le refouler partout ailleurs. Elle ne lit Toni Morrison, James Baldwin ou Frantz Fanon qu’en suivant une tendance de l’opinion, mais quant à vraiment approfondir la voix de ces oracles, elle ne le peut car elle ne s’en relèverait pas – elle se découvrirait monstrueuse et sa pasteurisation des valeurs en pâtirait. Pour la bourgeoisie et toutes ses ramifications, la littérature de Toni Morrison appartient au domaine de la caution utile. Le verrou caucasien n’en devient donc que plus insurmontable et indépassable : il dévirilise ou il affaiblit le propos intrinsèquement révolté de cette littérature, il absorbe son discours en l’amalgamant au régime dissolvant de la démocratie, et, souvent, il accomplit cela en mimant la révolution sociale et en empruntant la rhétorique officielle de la justice.
Notes
(1) Toni Morrison, Home (Christian Bourgois Éditeur, 2012). Traduction de Christine Laferrière.
(2) Ernst Wiechert, Missa sine nomine.
(3) Louis Massignon, Parole donnée.
(4) Ernst Wiechert, op. cit.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Le prénom de ce médecin renvoie probablement à Toutant de Beauregard, naguère commandant de l’Armée Confédérée.
(9) Ernst Wiechert, op. cit.




























































 Imprimer
Imprimer