« Au-delà de l'effondrement, 68 : Demain les loups de Fritz Leiber | Page d'accueil | Que ma joie demeure de Jean Giono, par Gregory Mion »
25/12/2020
Mesure de la France de Pierre Drieu la Rochelle

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Il faut commencer par noter que Pierre Drieu la Rochelle a toujours souhaité que Mesure de la France, achevé en 1922, soit réédité, lui qui écrivait, en 1944, que ce livre était devenu introuvable depuis qu'il l'avait fait paraître, alors qu'il n'avait que vingt-huit ans. Dans cette réédition par Grasset datant de 1964, nous trouvons d'autres écrits plus tardifs rédigés durant l'hiver 1939-1940, dont un remarquable portrait (bien davantage que l'attentif hommage dont parle Daniel Halévy, p. 17) de Raymond Lefebvre sur lequel nous reviendrons.
Il faut commencer par noter que Pierre Drieu la Rochelle a toujours souhaité que Mesure de la France, achevé en 1922, soit réédité, lui qui écrivait, en 1944, que ce livre était devenu introuvable depuis qu'il l'avait fait paraître, alors qu'il n'avait que vingt-huit ans. Dans cette réédition par Grasset datant de 1964, nous trouvons d'autres écrits plus tardifs rédigés durant l'hiver 1939-1940, dont un remarquable portrait (bien davantage que l'attentif hommage dont parle Daniel Halévy, p. 17) de Raymond Lefebvre sur lequel nous reviendrons.Mesure pour la France ferait hurler de colère le dénataliste fou Renaud Camus qui, après avoir consommé tant d'hommes pour son seul ridicule plaisir, prône désormais leur drastique réduction, mais il est vrai qu'il y a toujours eu plus de saine vigueur, dans une page de Drieu qui eut assez vite (hélas !) la décence de se taire, que dans les près de mille volumes du maître du petit château de Plieux qui, lui, ne rendra pas son âme vérolée avant ses 110 années de bavardages solipsistes. Drieu la Rochelle n'écrit-il pas qu'il est «fanatiquement de ceux qui veulent que la vie continue» (p. 32) alors que nous pourrions affirmer que l'auteur de Tricks est fanatiquement de ceux qui veulent que la vie diminue, surtout si son débordement malsainement migratoire venait marcher sur son carré de potirons cultivés avec l'amour des cucurbitacées qui est celui, on le sait, du nouveau Charles Martel, hélas plus moitrinaire que désintéressé, que la France espérait depuis plusieurs siècles ? J'ai utilisé le terme moitrinaire que j'ai trouvé chez Léon Daudet; imagine-t-on également ce dernier, que, comme Drieu ou même Camus, nous pourrions prétendre être un réactionnaire, imagine-t-on un seul instant Léon Daudet, puissant imprécateur et si réjouissant exemple d'une extrême vitalité de langage, d'une rabelaisienne profusion verbale, en train d'affirmer, pardon : de pleurnicher, à l'instar de Renaud Camus, que la France serait beaucoup trop peuplée ? C'est impensable et il y a, dans la terreur hystérique que manifeste Renaud Camus, toute la rancitude contenue d'un homme qui n'aura jamais joui, comme le rappellent des centaines de passages de textes, que sur la pilosité abondante de ses amants, sans oublier la plupart de leurs orifices, tous stériles en tout cas.
Il est d'ailleurs assez étonnant de voir Drieu, dans Le retour du soldat d'abord, ensuite dans Mesure de la France, citer par deux fois Les Suppliantes d'Eschyle où le grand tragédien fait demander au ciel, par le chœur des Danaïdes, de nouvelles naissances afin de donner des chefs au pays, puis qu'Artémis Hécate, surtout, veille aux couches de ses femmes; dans le second de nos textes, Mesure de la France donc, il évoquera un autre passage de cette même grande pièce de théâtre, parlant des «eaux fécondantes du Nil, qui, chez les hommes, font naître et se multiplier un sang porteur de vie».
Dans sa Préface, Pierre Andreu, qui a consacré plusieurs textes à Drieu, évoque «l'amenuisement du rôle de la France victime de sa lésine sexuelle» (p. 9 de notre édition). Je sais bien que Drieu rattache la question de la natalité à un antique commandement, une loi même, écrit-il, qui «édicte que l'homme aura la volonté de [se] multiplier», sauf à ne même plus parvenir à «se maintenir à l'étiage» et, en conséquence, «promptement il diminuera comme s'il y avait en lui la détermination de s'anéantir. Cette loi est la promesse même faite à notre espèce, notre pacte d'alliance avec les forces du monde, la souche patriarcale de l'empire humain» (p. 41). Je n'occulte pas, mais il ne faudrait toutefois pas donner à cette thématique plus d'importance qu'elle n'en a et, surtout, oublier de la rattacher au tronc de plus en plus sec dont elle n'est qu'une des dernières floraisons, je ne passe pas sous silence la décadence bien sûr qui, d'un bout à l'autre de ses textes, aura été le grand thème de Drieu la Rochelle. Qu'est-ce que la décadence occidentale ? Nous pourrions dire qu'elle est, d'abord, un «fléchissement de tout l'être qui se manifeste tôt ou tard par une moindre énergie de l'intelligence à discerner et à maîtriser les faits» (p. 52) mais aussi, la mort qui est entrée dans l'organisme vivant qu'est la France : «Aujourd'hui, nous, Français, avons plus à faire avec nous-mêmes qu'avec les autres. Notre plus grand ennemi est en nous-mêmes. Il faut que nous nous tournions vers la mort qui est entrée en nous» (p. 91). Ne voyant rien, si peu en tous cas de la mort qui a saisi la France, notre Saroumane gersois a les yeux rivés sur son palantir et, pythie écumante, psalmodie et vocalise de vagues slogans qui, comme tous les slogans, mentent en même temps qu'ils pourrissent le langage, alors même que Camus n'aura pourtant cessé de nous répéter qu'il le vénère.
Dans Mesure de la France, Drieu tente, une fois le constat posé, d'apporter des solutions à ce constat, terrible pour celui qui aime son pays mais ne craint pas d'affirmer, bien des années avant que cette vue ne soit un passage obligé de toute réflexion sur la constitution d'une Europe des nations, que son pays sera balayé de la surface de la planète, ne vivant désormais plus que dans les manuels d'histoire, s'il ne parvient pas à créer des alliances solides, et d'abord, à l'évidence, avec l'Allemagne, mais aussi avec d'autres pays, afin de pouvoir tenter de contrebalancer les immenses puissances russe et américaine. Ses ouvrages ultérieurs, dont le splendide Gilles, délaisseront quelque peu les solutions géopolitiques, plus ou moins romanesques d'ailleurs, pour embrasser une étendue plus grande, recouverte par le déluge de feu de l'Apocalypse car, finalement, «le plus beau dans la décadence, c'est de voir refleurir la barbarie».
Tout est foutu, selon le titre d'un article que Drieu donna à l'éphémère périodique d'Emmanuel Berl intitulé, là encore significativement, Les Derniers Jours et telle mystérieuse notation : «Sur la plage de l'occident il y a un mendiant qui dissimule un poignard» (p. 45) évoque à la fois la possibilité d'une action violente, traître, mais aussi l'extrême appauvrissement d'un continent qui, bien des années après que Drieu la Rochelle se soit donné la mort, est devenu la plage de débarquement de centaines de milliers de mendiants, réalisant la prédiction de Jean Raspail dans son roman le plus célèbre, presque aussi médiocre que tous les autres, Le Camp des Saints.
La décadence physique, morale et spirituelle de la France et même : de l'Occident, s'accompagne d'une illusion de vie, de vivacité, de vitesse. L'homme occidental, n'importe quel Français qui se respecte n'est qu'un échantillon, parfaitement remplaçable, d'un de ces modernes qui sont «des gens dans les affaires, des gens à bénéfices ou à salaires; qui ne pensent qu'à cela et ne discutent que cela. Ils sont tous sans passions, ils sont la proie des vices correspondants» (p. 95) que détaille Drieu (alcool, «drogues, union libre et stérile = homosexualité», mais aussi «courses et cinéma en commun»). Tous, de fait, semblent être heureux, «se promènent satisfaits dans cet enfer incroyable, cette illusion énorme, cet univers de camelote qui est le monde moderne où bientôt plus une lueur spirituelle ne pénétrera», puisque «nous sommes tous les mêmes, tous actionnaires de la Société moderne industrielle au capital de milliards en papier et de milliers d'heures de travail fastidieux et vain» (p. 96) jusqu'à composer, pour demain ou après-demain, pour aujourd'hui en fait, «plus rien qu'une immense chose inconsciente, uniforme et obscure, la civilisation mondiale, de modèle européen» (p. 97).
Drieu demande que l'on se hisse du «plan politique» au «plan spirituel» (p. 101) car il est parfaitement clair pour lui que nous ne pouvons tout de même pas nous sacrifier pour «défendre des banques, des casernes, et les Galeries Lafayette» (p. 102) alors que la technique, cette Machine que Drieu qualifie de «Moloch», menace de tout submerger : «Trop tard ils découvrirent que ces machines (que ce soient des mitrailleuses ou des métiers mécaniques) sont la progéniture rebelle et dévoratrice des hommes» (p. 53). L'expansion technique ne peut, avec l'ivresse de la toute-puissance, que nous donner l'illusion de la vie, comme je l'ai dit, car «le développement pernicieux, satanique, de l'aventure industrielle», qui de plus en plus rapproche les hommes «les uns des autres par ses mille péripéties rapides, les menace, plutôt que de violence, d'une langueur inouïe qui suivra la simulation éhontée de l'effort créateur» (p. 103), l'aventure ne pouvant déboucher, quoi qu'en dise Drieu, que sur la création d'un empire bien plus large que la seule Europe, qui signera la fin de notre liberté, selon la crainte exprimée par Soloviev lorsqu'il a figuré le règne faussement pacificateur de l'Antichrist.
«Troublant abîme du matérialisme moderne», note Drieu, «où sombre l'âme de notre civilisation» (p. 107), car il importe autant de connaître la course, dépourvue de sens, du Progrès, que de remarquer la beauté, la perfection de la machine, que l'auteur déclare être «un chef-d’œuvre vivant» : certes, «elle tourne à vide» car c'est «une réminiscence, un schéma vertigineux de la geste humaine dans l'univers» et que son mouvement, incontestablement enivrant, «laisse une trace désolée» dans l'imagination de l'écrivain qui, semble-t-il revenu de sa fascination trouble, déclare tout de même que «la machine est un artisan automate par quoi l'homme, leurré et épuisé par l'effort même de cet enfantement, prétend se faire remplacer» (p. 113). Il faut donc songer et même : «tout ce à quoi il faut songer, c'est à une réintégration intellectuelle, morale, corporelle» (p. 114) pour permettre une possible Renaissance : «il faut que par un travail souterrain qui renouvelle pierre à pierre les fondements de l'Esprit, ce siècle soit aussi l'amorce d'une époque où l'automatisme menaçant sera surmonté» (p. 115). C'est un pari bien sûr, car il n'est absolument pas ou plus certain qu'il y ait «quelque chose d'immortel dans la tradition» et «dans ceux qui en assurent les enchaînements les plus menacés», comme Drieu l'écrit dans un autre texte recueilli dans ce volume (p. 125).
Je ne sais si Raymond Lefebvre, aujourd'hui bien oublié, y compris dans les rangs communistes dont il a fait partie, a pu être considéré par celui qui fut son ami et au-delà des formules rhétoriques, comme l'un de ceux capables d'assurer «les enchaînements les plus menacés» (2) mais, en tout cas, le portrait que lui consacre Drieu est magnifique. Intitulé L'équipe perd un homme (sur la mort de Raymond Lefebvre), il évoque la destinée d'un personnage apparemment hors du commun (1), véritablement fascinant selon celui qui le côtoya, et qui a disparu en mer de Barents à l’automne 1920, à l’âge de vingt-neuf ans seulement, au retour d’un voyage en Russie soviétique — où il avait assisté au IIe congrès de l’IC. En tout cas, Drieu la Rochelle a pu penser qu'il formerait, avec lui et une poignée d'autres aventuriers au sens le plus noble du terme, une «formidable réalité» qui n'est pas autre chose que «l'esprit de corps, d'équipe» (p. 139), seule capable de soulever une génération qui a connu la terrifiante épreuve de la Grande Guerre (3), et alors même que tant d'hommes ont été pourtant blessés, et pas seulement par les combats au milieu des cadavres éventrés sur le paysage lunaire de Verdun (4), mais «ravagés par des destructions plus fatales qu'une guerre de notre temps, sans dieux ni maitres, ceux-là étant morts, ceux-ci n'étant pas encore nés» (p. 138), auxquels il ne reste plus grand-chose si ce n'est leur jeunesse, qu'il faudra bien, hélas, livrer, pratiquement vierge, à la poursuite du «confort moderne», un nom, par exemple celui de Drieu, de plus grands encore, circulant désormais comme le courant électrique ou, ainsi que s'en désole l'écrivain, «comme l'eau fade, comme le gaz à tous les étages» (p. 140).
Quelle est la perspective morne qui attend Drieu ? Pas autre chose, en fait, qu'un «avenir désolé, fait d'une suite de rendez-vous quotidiens comme les agendas souillés de la fin de l'année», et que Drieu refuse de toutes ses forces puisqu'il est convaincu que les meilleurs «ont été décimés par la guerre», alors même que «ceux qui s'emparent de l'autorité prennent la place d'absents mystérieux» comme l'est désormais Raymond Lefebvre. Il aurait peut-être pu, ce «maître de trente ans» (p. 141), être un grand homme, un chef qu'il aurait ainsi été possible d'approcher et même de toucher car, affirme Drieu, «en dépit de la présence perpétuelle, incurable d'un César, en dépit de la vigueur de la gloire qui va fouailler les adolescents au fond d'un siècle endormi, rien ne vaut le regard même de Napoléon et de sentir ses doigts qui pincent votre oreille» (p. 143). Il aurait même pu être, aux yeux de Drieu, l'un de ces hommes rarissimes, une poignée comme dit l'écrivain, auxquels «incombe le salut de l'espèce», et d'ajouter, magnifiquement : «Aux haltes, on se soulève, on les regarde, on les compte. Parmi la foule affalée, on est effrayé de les voir si peu, qui dressent des silhouettes de grandeur au-dessus du niveau de néant». Raymond Lefebvre a quoi qu'il en soit personnifié, aux yeux de Drieu la Rochelle, «l'esprit de révolte qui est la moitié de Dieu» (p. 156), étrange et belle formule qui nous montre, bien mieux que d'autres sentences tout aussi bien frappées, que la nature profonde de cet écrivain d'ombres et de fulgurances était l'adoration, comme le prouvent d'ailleurs les derniers mots d'un texte intitulé Encore les toits de Paris datant sans doute du mois de mai 1940, mots que je pense pouvoir rapprocher de ceux que j'ai écrits quelque part dans mon propre livre sur Judas, sans bien sûr avoir lu, lorsque je l'écrivis, Mesure de la France : «Ô Dieu, si terriblement et mystérieusement affamé, c'était donc le cri d'amour que tu voulais m'arracher».
Notes
(1) Le lecteur pourra utilement prendre connaissance de sa biographie via cet article.
(2) Sans doute, oui, comme le prouve le magnifique passage que j'ai cité en fin d'article.
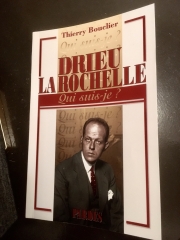 (3) Dans un petit livre à l'écriture très vive paru en 2020 dans la collection Qui suis-je ? chez Pardès, Thierry Bouclier a pu répéter que l'expérience de la Grande Guerre a façonné tous les écrivains qui l'ont connue, pointant ce qu'il considère comme étant une étonnante similarité entre nombre d'entre eux : en effet, c'est «la haine du combat fratricide», qui l'emportera «sur la haine de l'ennemi héréditaire», et l'auteur de poursuivre en demandant à ce que chacun s'interroge «sur tous ces combattants de la Grande Guerre qui, après avoir embrassé, peu ou prou, la cause du fascisme, rejoindront, plus ou moins, le monde de la Collaboration» (p. 32) comme Louis-Ferdinand Céline, Alphonse de Châteaubriant, Marcel Bucard et Joseph Darnand ou encore Paul Chack et Xavier Vallat.
(3) Dans un petit livre à l'écriture très vive paru en 2020 dans la collection Qui suis-je ? chez Pardès, Thierry Bouclier a pu répéter que l'expérience de la Grande Guerre a façonné tous les écrivains qui l'ont connue, pointant ce qu'il considère comme étant une étonnante similarité entre nombre d'entre eux : en effet, c'est «la haine du combat fratricide», qui l'emportera «sur la haine de l'ennemi héréditaire», et l'auteur de poursuivre en demandant à ce que chacun s'interroge «sur tous ces combattants de la Grande Guerre qui, après avoir embrassé, peu ou prou, la cause du fascisme, rejoindront, plus ou moins, le monde de la Collaboration» (p. 32) comme Louis-Ferdinand Céline, Alphonse de Châteaubriant, Marcel Bucard et Joseph Darnand ou encore Paul Chack et Xavier Vallat.(4) Je ne sais si l'expérience de Drieu la Rochelle a pu être rapprochée de celle d'Ernst Jünger, mais il est frappant de noter qu'il a connu, le 23 août et le 29 octobre 1914, «au cours de deux charges à la baïonnette», «une extase» qu'il prétend tranquillement «égale à celles de sainte Thérèse et de n'importe qui s'est élancé à la pointe mystique de la vie» (p. 151).





























































 Imprimer
Imprimer