« L’Énigme de Pie XII de Pier Paolo Pasolini | Page d'accueil | Septembre éternel de Julien Sansonnens »
07/01/2022
Langage et critique de la technique dans l’œuvre d’Ivan Illich, 2, par Baptiste Rappin

 Baptiste Rappin dans la Zone.
Baptiste Rappin dans la Zone. Langage et critique de la technique dans l’œuvre d’Ivan Illich, 1.
Langage et critique de la technique dans l’œuvre d’Ivan Illich, 1.De la langue maternelle à l’uniformisation par le texte
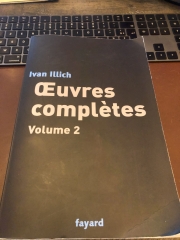 Il faut toutefois dire que, si la grammaire castillane apparaît comme la première tentative d’homogénéisation d’une langue, elle ne l’est en réalité que du point de vue des autorités séculières : dans cette entreprise de codification, en effet, l’Église la précéda en promouvant, en lieu et place du latin, une langue vernaculaire au rang de langue maternelle. C’est pourquoi Illich précise, immédiatement à la suite des développements consacrés à Nebrija, que «cette dépendance à l’égard d’une institution officielle, bureaucratique, pour en obtenir un service aussi indispensable à la subsistance humaine que le lait maternel, tout en étant radicalement neuve et sans parallèle hors de l’Europe, ne constituait pas une rupture avec le passé européen. C’était plutôt un pas en avant logique – un processus d’abord légitimé par l’Église se transformant en une fonction temporelle reconnue et attendue de l’État séculier» (Illich, Le travail fantôme, 2005, p. 139).
Il faut toutefois dire que, si la grammaire castillane apparaît comme la première tentative d’homogénéisation d’une langue, elle ne l’est en réalité que du point de vue des autorités séculières : dans cette entreprise de codification, en effet, l’Église la précéda en promouvant, en lieu et place du latin, une langue vernaculaire au rang de langue maternelle. C’est pourquoi Illich précise, immédiatement à la suite des développements consacrés à Nebrija, que «cette dépendance à l’égard d’une institution officielle, bureaucratique, pour en obtenir un service aussi indispensable à la subsistance humaine que le lait maternel, tout en étant radicalement neuve et sans parallèle hors de l’Europe, ne constituait pas une rupture avec le passé européen. C’était plutôt un pas en avant logique – un processus d’abord légitimé par l’Église se transformant en une fonction temporelle reconnue et attendue de l’État séculier» (Illich, Le travail fantôme, 2005, p. 139). Le penseur date du XIIe siècle, époque de la réforme grégorienne qui repose, entre autres éléments révolutionnaires, sur la codification du droit canon (lien qu’Illich, curieusement, n’établit guère), la formation de l’expression «langue maternelle» : «Ainsi le vernaculaire, par opposition au langage savant, spécialisé – le latin pour l’Église, le francique pour la cour –, était aussi évident dans sa variété que le goût des vins et des plats locaux, les formes des maisons et des outils agricoles, jusqu’au XIe siècle. C’est à ce moment, assez subitement, qu’apparaît l’expression langue maternelle» (Illich, Le travail fantôme, 2005, p. 156). Il pointe alors le rôle des moines de l’abbaye de Gorze, sise en Moselle, et particulièrement active dans le développement de la vie cistercienne. En raison de sa position géographique, la ville de Gorze se trouve à la croisée des langues francique romane; les moines choisirent alors, afin de défendre et d’étendre leur zone d’influence, d’utiliser le francique dans leurs prêches. C’est alors que l’expression « langue maternelle » fut traduite du latin en francique, puis connut un vif succès, quelques siècles plus tard, au moment de la traduction de la Bible par Luther.
Néanmoins, cette promotion de la langue maternelle s’enracine dans une couche encore plus profonde de l’histoire européenne et répond à une impulsion originelle qui, certainement pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, lie la satisfaction des besoins à la prestation de service de professionnels, c’est-à-dire d’une institution. Sans hésitation, Illich identifie ce moment décisif à l’entreprise impériale de Charlemagne : «J’ai depuis lors trouvé une foule d’arguments convergents […] témoignant que les idéologies de l’ère industrielle plongent leurs racines dans la prime renaissance carolingienne. L’idée qu’il n’y a pas de salut sans services individuels fournis par des professionnels au nom d’une mère Église institutionnelle est une de ces phases, restées jusqu’ici inaperçues, sans lesquelles notre époque serait impensable» (Illich, Le travail fantôme, 2005, p. 155). C’est en effet à cette époque, sous l’influence décisive du moine Alcuin qui fut le conseiller de Charlemagne, que la fonction du prêtre dépassa le seul exercice sacerdotal pour embrasser des activités éducatives et sociales visant à répondre aux besoins des paroissiens. Ainsi se forma progressivement une bureaucratie, appelée à se développer sans limites, de laquelle les communautés deviennent dépendantes pour assurer leur survie.
L’extension du domaine de la langue maternelle doit en outre être reliée à une innovation, ou plutôt à une somme d’innovations, qu’Illich explore dans l’ouvrage qu’il consacre à ce personnage charnière qu’est Hughes de Saint-Victor (1096-1141) et plus particulièrement à son Didascalicon. En réalité, Hughes apparaît aux yeux du philosophe comme le dernier exemplaire de ces théologiens qui considéraient le savoir et la lecture comme des tentatives de remédier, ne serait-ce que partiellement, à la chute : «Hugues propose le livre comme un remède pour l’œil. Il implique que la page est un remède suprême : elle permet, par le studium, de regagner en partie ce qu’exige la nature, mais que les ténèbres intérieures pécheresses du lecteur lui dénient désormais» (Illich, Du lisible au visible, 2005, p. 581). Cette fonction sotériologique s’accompagne d’un mode de lecture auquel nous sommes devenus tout à fait étrangers : «Selon une tradition vieille d’un millénaire et demi, à la "voix des pages" fait écho la résonance des lèvres et de la langue en mouvement. L’oreille du lecteur est attentive et s’efforce de saisir ce que la bouche du lecteur articule. De cette manière, la série de lettres se traduit directement en mouvements corporels et induit des impulsions nerveuses. Les lignes sont une piste sonore que le lecteur capte par sa bouche et émet vocalement pour sa propre oreille. Par la lecture, la page est littéralement incarnée» (Illich, Du lisible au visible, 2005, p. 620). Cela signifie donc que le remède de la lecture et du savoir ne réside pas, comme nous serions tentés de le croire de prime abord, dans une compréhension intellectuelle ou dans un effort de contemplation, mais s’accomplit, au moyen de la diction, par l’influx de ce savoir dans le corps, devient effectif, grâce à l’énonciation, à travers l’innervation du corps par le savoir. La lecture est ici un acte liturgique.
Or, «vers la fin du XIIe siècle, le livre revêt un caractère symbolique qu’il conservera jusqu’à nos jours. Il devient le symbole d’un type d’objet inédit, visible mais impalpable, que j’appellerai le texte livresque. Dans la longue histoire sociale de l’alphabet, l’impact de ce développement ne peut être comparé qu’à deux autres événements : l’introduction de l’écriture totalement phonétique, qui se produisit au VIe siècle av. J.-C., faisant du grec une langue sur laquelle le locuteur pouvait réfléchir, et la diffusion de l’imprimerie au XVe siècle, qui fit du texte la matrice d’une nouvelle conception du monde, littéraire et scientifique» (Illich, Du lisible au visible, 2005, pp. 691-692). Cette mutation résulte d’une somme d’innovations à l’origine de la transformation de la page qui, de partition, devint texte : généralisation de la lecture silencieuse et de l’écriture cursive, importation du papier (de Chine), classement alphabétique des mots clefs, index thématique, nouvelle mise en page incluant un espacement des mots, invention du livre portatif. Alors, «après la mort de Hugues, le son des lignes de la page s’évanouit, et la page devient un écran pour l’ordre voulu par l’esprit. Plutôt qu’un moyen de revivre une narratio, le livre théologique et philosophique devient l’extériorisation d’une cogitatio, d’une structure de pensée» (Illich, Du lisible au visible, 2005, p. 680). De fait, le texte s’émancipe de la communauté au sein de laquelle il prenait vie et sens, et devient le reflet objectivé d’une pensée, gagnant ainsi son autonomie par rapport au support; cette déconnexion de l’écriture et de la page rend la première universalisable et disponible pour la prise en charge des besoins par les procédures et les règles de la bureaucratie.
De la religion chrétienne à la religion industrielle
Le raisonnement précédent, qui porte sur la langue et plus précisément sur la langue maternelle, peut être étendu car, pour Illich, l’Église constitue la première institution moderne qui s’impose pour prendre en charge, intégralement, les besoins humains : «Jamais encore on n’avait appelé "mère" une institution officielle, ni considéré comme absolument nécessaire à la vie ce qu’elle dispensait. Les hommes ne pouvaient être sauvés s’ils n’étaient nourris du lait de la foi qui coule de ses mamelles. Voilà l’institution qui est le prototype de l’actuelle pléthore d’institutions occidentales, chacune productrice de choses estimées fondamentalement nécessaires, chacune contrôlée par un clergé différent, professionnellement spécialisé» (Illich, Le travail fantôme, 2005, pp. 110-111). Que notre civilisation soit chrétienne, et même catholique, Illich ne le nie point, mais il ne justifie pas cette affirmation par la foi ou la persistance, au sein même des sociétés sécularisées, de valeurs; il met plutôt en évidence que les institutions modernes, pour la plupart rattachées à l’État – en tout cas : à l’époque où Illich écrit, c’est-à-dire avant la décision d’en finir avec les monopoles d’État pour ouvrir des secteurs d’activité à la concurrence –, prennent l’Église pour modèle biopolitique de gestion des populations. Ainsi s’expliquent, pour le penseur, la genèse et la finalité de l’école moderne, pilier de la Troisième République et de l’État moderne parvenu à la maturité de la raison : «L’école moderne est devenue l’Église établie des temps séculiers. Son origine remonte à ce mouvement pour une scolarité universelle qui apparut il y a deux cents ans et qui se proposait de faire que chacun puisse se joindre à la société industrielle. Dans la métropole industrialisée, l’école représentait l’institution à qui était confiée l’intégration des citoyens» (Illich, Libérer l’avenir, 2003, p. 146).
Mais cette généalogie se trouve plus précisément exposée dans la Némésis médicale dans les pages de laquelle Illich retrouve dans la médecine tous les ingrédients qui firent le succès de la religion catholique : «La profession médicale a largement cessé de poursuivre les objectifs d’une corporation d’artisans appliquant la tradition et ayant recours à l’habileté, à l’apprentissage et à l’intuition. Elle en est venue à jouer un rôle jadis réservé au clergé : elle utilise des principes scientifiques en guise de théologie, des techniciens en guise d’acolytes et la routine hospitalière en guise de liturgie. L’art empirique de guérir celui qui peut l’être n’intéresse plus les médecins : ils sont engagés dans une lutte pour le salut de l’humanité, qu’ils veulent dégager des entraves de la maladie et de l’invalidité, et même de la nécessité de mourir» (Illich, Némésis médicale, 2003, pp. 696-697). Cette dernière citation indique explicitement la structure religieuse de la médecine moderne : elle possède son clergé, c’est-à-dire un ensemble d’experts formés dans le moule de l’université de la société industrielle et consacrés par un diplôme; elle se réfère à un canon : à un ensemble de textes qui consignent le savoir en vigueur et forment la doctrine partagée et admise et constituent ainsi la théologie médicale; elle se déploie à travers une liturgie qui prend l’aspect du protocole de la consultation (récolte d’informations – auscultation – diagnostic – prescription) mais aussi celle des procédures administratives et hospitalières; elle œuvre enfin pour le salut, c’est-à-dire pour la santé définie comme l’absence de maladie ou, selon la fameuse expression du chirurgien René Leriche, «le silence des organes», ce qui rend également compte de l’insigne place de l’analgésie – la réduction de la souffrance dans une société qui ne tolère plus aucune négativité – dans la médecine moderne. Clergé, théologie, liturgie, salut : les ingrédients de la religion structurent quotidiennement l’exercice de la médecine, à telle enseigne que celle-ci pourrait à juste titre être considérée comme la religion scientifique de l’ère industrielle. Et, tout comme son ancêtre, elle fait l’objet d’une adoration aveugle qui dépasse les limites de la raison : «L’attachement et l’allégeance croissante à la thérapeutique affectent aussi l’état d’esprit collectif d’une population. Une demande idolâtre de manipulation remplace la confiance dans la force de récupération et d’adaptation biologique, le sentiment d’être responsable de l’éclosion de cette force et la confiance dans la compassion du prochain qui soutiendra la guérison, l’infirmité et le déclin» (Illich, Némésis médicale, 2003, p. 711). La médecine relève en ce sens de la pensée magique : on attend du praticien le charme ou l’envoûtement par lequel nous recouvrirons la santé, plaçant de la sorte nos espoirs dans la sorcellerie d’un médecin plutôt que de faire confiance à notre corps et à nos proches.
Illich n’hésite pas à généraliser la structure religieuse décelée dans la médecine à l’ensemble des expertises qui forment le savoir professionnel des sociétés modernes : «La transformation d’une profession libérale en profession dominante est équivalente à l’institution légale d’une Église. Les médecins métamorphosés en biocrates, les professeurs en gnosocrates, les entrepreneurs de pompes funèbres en thanatocrates, sont bien plus proches des clergés subventionnés par l’État que des syndicats» (Le chômage créateur, 2005, p. 59). L’industrie tisse le filet social par de multiples fibres institutionnelles; pris dans leurs mailles, nous n’échappons pas à leur discours faussement savants et dogmatiques, nous peinons à esquiver leurs multiples rituels, à chaque instant risquons-nous de tomber nez à nez avec un de leur prêtre, toujours sommes-nous tentés de nous remettre à elles pour prendre en charge notre vie. Qu’il paraît bien téméraire de vouloir s’y soustraire !
La subversion de l’empire industriel par le vernaculaire
Vouloir s’y soustraire ? Certes. Mais comment ? Puisque la puissance de l’institution tient avant tout à l’imposition d’un langage commun qui capture et dirige l’expérience du monde, alors il devient expédient, en premier lieu, de libérer la langue du sabir industriel. Comment dire le monde, comment décrire la société moderne, sans tomber dans le piège pourtant évident de recourir à ses catégories qui ne font, en dernier ressort, que nous reconduire à elle ? Comment échapper à cette tautologie qui nous emprisonne dans une sorte de geôle logique ? Car, comme le soutient Illich, au fur et à mesure des lectures et des études, on se trouve «amené à comprendre que la différence entre les travaux domestiques d’hier et d’aujourd’hui ne peut être décrite avec fidélité par le langage traditionnel, ni non plus exprimée de façon satisfaisante dans le jargon des sciences sociales» (Ivan Illich, Le Genre vernaculaire, 2005, p. 272).
Et cette révolution par le langage de concerner au premier chef le penseur lui-même. Tout à fait capitale est, de ce point de vue, la remarque suivante de Barbara Duden (2003, p. 153) : «Lorsque Ivan Illich s’attela à Némésis médicale en 1975, il n’avait pas encore compris que l’usage des termes empruntés à l’analyse de systèmes, la cybernétique et l’informatique, même s’il en usait en dehors de leur champ d’application, c’est-à-dire comme des métaphores, ruinait ses intentions. Ce livre, comme d’ailleurs d’autres de ses premiers essais, est rempli de catégories inspirées par la technologie de l’information et la pensée systématique comme "intensité", "programme culturel", "input-output", "guidage". Ce n’est qu’à la fin des années 1980 qu’il prit conscience du mauvais usage de ces termes […]». Ce récit nous permet de comprendre deux choses : tout d’abord, si la question du langage n’est pas propre au «Illich seconde période» puisque l’on en trouve des traces dans ses premiers essais, force est de noter que cette attention se radicalise dans les années 1980 grâce à l’identification plus précise de la provenance du langage industriel contemporain. Et voilà qui nous amène directement à notre second point : Illich prend conscience que la cybernétique a infiltré non seulement le langage de la philosophie et des sciences humaines (Freitag, 1995; Dupuy, 1999; Lafontaine, 2004; Rappin, 2014), mais également le parler commun. Ainsi des termes comme «finalité», «objectif», «information», «interaction», «programme», «régulation», «évaluation», etc., sont -ils maniés à la fois par les chercheurs et les managers, par les scientifiques et les hommes de la rue; par leur propriété plastique, ils s’adaptent à tout contexte et chacun peut aisément y projeter le sens qu’il souhaite y déceler.
Ces mots plastiques, Illich, nous l’avions déjà noté plus haut, les nomme «mots clefs» et il les dote d’une fonction primordiale dans l’exercice du pouvoir : «Les mots clefs sont donc plus importants que les termes techniques pour la formation d’un langage industrialisé, parce que chacun dénote une perspective commune à tout l’ensemble dont ils relèvent» (Ivan Illich, Le Genre vernaculaire, 2005, p. 257). En admettant cette distinction entre les mots clefs et les termes techniques, on pourrait alors se risquer à avancer que la cybernétique réussit le tour de force de hisser les termes techniques au rang de mots clefs que les experts de tous les secteurs manient indifféremment au contenu de leur expertise; car le génie propre de la cybernétique consiste précisément à considérer toute entité comme un système opérationnel pouvant être décrit grâce à ses catégories, sans prendre compte l’activité spécifique dudit système. À cet égard, il semble approprié de qualifier le lexique, la syntaxe et la sémantique de la cybernétique de langue maternelle du monde artificiel.
Le vernaculaire est précisément la catégorie qu’Illich exhume et sur laquelle il s’appuie pour subvertir l’emprise industrielle. À cette dernière, qui prétend pouvoir englober la totalité de nos existences dans sa logique utilitariste, il faut opposer une extériorité inaliénable, non assimilable, irréductible. Telles sont précisément la nature et la portée du vernaculaire : «Pour expliquer l’apparition et la suprématie des mots clefs dans une langue, j’en suis arrivé à distinguer entre le parler vernaculaire, qui s’acquiert progressivement par le contact matériel avec des gens qui expriment leur pensée, et la langue maternelle inculquée, qui s’acquiert par l’intermédiaire de gens employés pour nous parler, et pour parler en notre nom» (Ivan Illich, Le Genre vernaculaire, 2005, p. 257). D’un côté, la langue maternelle, que l’on pourrait dire véhiculaire dans la mesure où elle forme la langue officielle de communication d’une société donnée, est brandie et sophistiquée par les experts qui traitent «notre cas» dans des termes abstraits et déconnectés de l’expérience vécue; de l’autre, le parler vernaculaire se forge au contact des voisinages, des amitiés et des coopérations, et tend par voie de conséquence à une certaine adéquation entre langage et réalité subjective. Cette dimension charnelle et enracinée constitue un fonds rebelle, récalcitrant, réfractaire, que le jargon cybernétique, par les voix autorisées des experts et des journalistes, entreprend de coloniser afin d’assujettir la consistance et la profondeur du réel à la nouvelle donne algorithmique.
Du vernaculaire à la convivialité
Loin de se limiter à la dimension langagière, le vernaculaire revêt chez Illich une dimension stratégique globale conçue pour s’opposer point par point à la prétention totalisante des institutions de la société moderne. Observons alors une première déclinaison du vernaculaire, elle concerne le domaine de l’économie : «Le mot "vernaculaire", emprunté au latin, ne nous sert plus qu’à qualifier la langue que nous avons acquise sans l’intervention d’enseignants rétribués. À Rome, il fut employé de 500 av. J.-C. à 600 apr. J.-C. pour désigner toute valeur engendrée, faite dans l’espace domestique, tirée de ce que ‘on possédait, et que l’on se devait de protéger et de défendre bien qu’elle ne pût être un objet de commerce, d’achat ou de vente. Je propose que nous réactivions ce terme simple, vernaculaire, par opposition aux marchandises et à leur ombre. Il me permet de distinguer entre l’expansion de l’économie fantôme et de son contraire : l’expansion du domaine vernaculaire» (Illich, Le travail fantôme, 2005, p. 118). Illich prend le contre-pied des économistes : ceux-ci tendent en effet à scinder l’économie en deux pans, le premier relevant de l’échange marchand, qu’il ait lieu ou non au sein d’une activité formelle, le second recouvrant alors les secteurs non monétarisés. Trop souvent, ce labeur est identifié aux activités de subsistance des sociétés précapitalistes, jugement que le penseur remet en cause en assurant un net départ entre le travail fantôme et les activités vernaculaires. Par «travail fantôme», il entend le travail invisible indispensable à l’essor de la société industrielle, à l’image des corvées ménagères, généralement assumées par les épouses et indispensables au maintien dans l’emploi du mari. Mais le travail fantôme ne se réduit pas à ces tâches domestiques, il englobe une multitude d’autres actions quotidiennes : «J’appelle "travail fantôme" ce complément du travail salarié, à savoir : la plus grande part des travaux ménagers accomplis par les femmes dans leur maison ou leur appartement, les activités liées à leurs achats, la plus grande part du travail des étudiants "bûchant" leurs examens, la peine prise à se rendre au travail et à en revenir. Cela inclut le stress d’une consommation forcée, le morne abandon de son être entre les mains d’experts thérapeutes, la soumission aux bureaucrates, les contraintes de la préparation au travail et bon nombre d’activités couramment étiquetées "vie de famille"» (Illich, Le travail fantôme, 2005, p. 202). Or, il est expédient de ne pas confondre le travail fantôme, sorte de complément naturel au travail salarié, avec les activités vernaculaires qui visent la subsistance et participent de la sorte à une prise d’autonomie : ainsi de la culture du potager qui rend le supermarché superflu, ou du tricot et de la couture qui émancipe le foyer de l’industrie textile.
Illich déploie en outre le vernaculaire dans la direction du sexe et du genre, ce qui lui valut d’amples critiques de la part des féministes. Lisons plutôt, et observons au passage comment la dichotomie des genres s’inspire de la typologie des langages et de l’analyse des activités économiques : «La distinction entre genre vernaculaire et rôle des sexes est comparable à la distinction entre parler vernaculaire et langue maternelle inculquée, entre subsistance et existence économique ou monétaire. Si j’oppose ces termes, c’est parce qu’ils partent de présupposés distincts. Le parler vernaculaire, le genre et la subsistance sont caractéristiques d’une finitude morphologique de la vie communautaire basée sur le postulat, implicite mais souvent exprimé rituellement et représenté mythologiquement, que, tel le corps, la communauté ne peut dépasser sa taille» (Ivan Illich, Le Genre vernaculaire, 2005, p. 291). C’est ainsi que l’apparition de la division sexuelle se révèle être, pour Illich, un trait fondamental du mode de production capitaliste. Les sociétés traditionnelles, qui reposent sur l’encastrement des activités économiques, pour reprendre ici l’expression de Karl Polanyi, appuient la répartition des rôles sur la structure symbolique du monde, et c’est pourquoi elles réservent, selon leurs règles propres, certaines activités aux femmes et d’autres aux hommes. Au contraire, le système capitaliste ramène la différence entre hommes et femmes à une simple propriété biologique, en sorte que les travaux peuvent être indifféremment effectués par les uns ou les autres. En effet, «la théorie économique se fonde sur un sujet qui est cet humain dépourvu de genre, "non genré". Dès lors, la rareté étant admise, le postulat unisexe se propage» (Ivan Illich, Le Genre vernaculaire, 2005, p. 258). Pour Illich, l’anthropologie de l’efficacité qui sous-tend la société industrielle conduit à la réduction de l’être humain à ses compétences, sans tenir compte de leur enracinement communautaire et de la structuration des collectifs en fonction des genres, mais aussi, pourrait-on ajouter, de l’âge.
Le vernaculaire, que le penseur décline dans les dimensions de la langue, de l’activité et du genre, non seulement permet de poser une extériorité aux institutions totales de la modernité, mais il fournit également les fondements anthropologiques du projet convivial, promu par Illich dès 1973 et récemment réactualisé par Alain Caillé (2011). Dans La convivialité, au début des années 1970 donc, le philosophe définit la société conviviale comme la «société où l’outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes»; en d’autres termes, «conviviale est la société où l’homme contrôle l’outil» (Illich, La convivialité, 2003, p. 456). La réponse à l’hégémonie industrielle s’énonce sur le plan technique : à l’hybris de la mégamachine, il faut opposer la modestie de l’outil convivial dont toutes les propriétés furent détaillées par l’auteur et qui apparaît, à cette époque, comme le moyen du retour à l’autonomie. À cette focalisation sur l’outil font alors écho les volontés de déprofessionnalisation et de déscolarisation de l’auteur. La découverte plus tardive du vernaculaire, loin de rendre caduques ces réflexions, montre en même temps la limite de ce mode de raisonnement : on ne saurait en effet critiquer le système technicien en lui restant strictement immanent. Se sont alors fait jour, au cours des années 1980, des conditions de possibilité anthropologiques, relatives à la langue, à l’activité ainsi qu’au genre, en somme au vernaculaire, qui permettraient de ménager un espace habitable pour le projet convivial.
Bibliographie
*Sauf indication contraire, la ville d'édition est toujours Paris.
Alain Caillé, Pour un manifeste du convivialisme, Lormont, Le bord de l’eau, 2011.
Barbara Duden [2003], «Illich, seconde période», trad. Jean Robert, Esprit, 2010, p. 136-157.
Jean-Pierre Dupuy [1994], Aux origines des sciences cognitives, Paris, Éditions La Découverte, coll. Sciences humaines et sociales, 1999.
Michel Freitag, Le naufrage de l’université et autres essais d’épistémologie politique, Éditions La Découverte / MAUSS, 1995.
Ivan Illich [1971], Libérer l’avenir. Appel à une révolution des institutions, dans Œuvres complètes, Volume 1, Éditions Fayard, 2003.
Ivan Illich [1971], Une société sans école, dans Œuvres complètes, Volume 1, Éditions Fayard, 2003.
Ivan Illich [1973], La convivialité, dans Œuvres complètes, Volume 1, Éditions Fayard, 2003.
Ivan Illich [1975], Énergie et équité, dans Œuvres complètes, Volume 1, Éditions Fayard, 2003.
Ivan Illich [1975], Némésis médicale. L’expropriation de la santé, dans Œuvres complètes, Volume 1, Éditions Fayard, 2003.
Ivan Illich [1977], Le chômage créateur, dans Œuvres complètes, Volume 2, Éditions Fayard, 2005.
Ivan Illich [1981], Le Travail fantôme, dans Œuvres complètes, Volume 2, Éditions Fayard, 2005.
Ivan Illich [1983], Le Genre vernaculaire, dans Œuvres complètes, Volume 2, Éditions Fayard, 2005.
Ivan Illich [1991], Du lisible au visible : la naissance du texte. Un commentaire du Didascalicon de Hughes de Saint-Victor, dans Œuvres complètes, Volume 2, Éditions Fayard, 2005.
Anselm Jappe, Béton, arme de construction massive du capitalisme, Éditions L’Échappée, 2020.
Céline Lafontaine, L’empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Éditions du Seuil, 2004.
Thierry Paquot, La langue pour habiter, Sens-Dessous, n°17, 2016a, p. 79-89.
Thierry Paquot, Langue maternelle, Hermès, La Revue, n°75, 2016b, p. 60-63.
Baptiste Rappin, Au fondement du Management. Théologie de l’Organisation, Volume 1, Nice, Éditions Ovadia, coll. Chemins de pensée, 2014.
Françoise Thom, La langue de bois, Julliard, 1987.
Lien permanent | Tags : philosophie, machine, travail, ivan illich, technique, baptiste rappin |  |
|  Imprimer
Imprimer


























































