Rechercher : le pont de cassandra
Angelus ex Machina, 4 : la voie de la dévolution

29/08/2006 | Lien permanent
Seamus Heaney ou la familiarité de l'effroi

 Je ne savais pratiquement rien de ce grand poète et voici que, lisant l'entretien accordé par Michel Déon à L'Atelier du roman paru en septembre, je note ces lignes (pp. 32-3) : «Je suis heureux que vous me parliez de Seamus Heaney. Je l'aime beaucoup. L'homme est absolument exquis. [...] Et puis c'est un grand poète, un poète naturel, complexe parfois, mais sans que cela en ait l'air. Jamais il ne force son talent, un peu comme T. S. Eliot à qui il me fait penser. Rien à voir avec le pauvre Char et la plupart des poètes français contemporains». Ce qui m'a surpris, je crois, dans les poèmes de cet Irlandais, est effectivement l'étonnant mélange entre simplicité, je pourrais dire rusticité et rutilance, irruption inopinée du nouveau, et, parfois, éclair de la grâce, comme s'il s'agissait coûte que coûte, en explorant le passé (par exemple celui que symbolise la découverte de corps humains de l'âge de fer remarquablement bien conservés par les tourbières du Jutland au Danemark, dont Heaney fera un poème intitulé The Tollund Man, L'Homme de Tollund), en retrouvant quelque peu de sa force mais aussi de l'horreur de ses cérémonies sacrificielles dont la science valide l'existence, d'innerver un présent qui, du moins en Irlande du Nord, ne semble jamais très éloigné, comme affleurant à la surface du sol, ou bien visible par une lucarne que les vieux bardes ont connue. Un mot sur cette lecture des poèmes d'Heaney, laquelle aurait été je crois parfaitement impossible à Paris ou dans toute autre grande ville, s'il est vrai que certains lieux perdus, préservés, sauvages, non seulement orientent le sens de nos lectures, mais se mêlent au livre lui-même, lui communiquent en quelque sorte leur silence, deviennent ce livre d'une certaine façon. Et le silence, quelle sottise de croire qu'il est le même quel que soit le lieu où nous tentons de l'écouter, de comprendre ce qu'il veut nous dire : il y a autant de silences qu'il y a de langues, même si, comme celles-ci, les silences se réduisent comme peau de chagrin à la surface de notre globe hurlant. Chaque haut-lieu s'éloigne du vacarme et, en échange de notre attention et de notre écoute, laisse sourdre un silence qui lui est propre, à nul autre pareil. Car, s'il est bien vrai qu'un grand texte est comme l'éclosion d'un possible infini, un paysage grandiose peut tout aussi bien, comme s'il était le rival du livre en train d'être lu, nourrir ses pages et celui qui les lit d'un silence tout bruissant de mille voix tragiques et oubliées.Ainsi, extrait de La lucarne, ce poème, splendide :«For certain ones what was written may come true :They shall live on in the distanceAt the mouths of rivers.For our ones, no. They will re-enterDryness that was heaven on earth to them,Happy to eat the scones baked out of clay.For some, perhaps, the delta’s reed-bedsAnd cold bright-footed seabirds always wheeling.For our ones, snuffAnd hob-soot and the eat off ashes.And a judge who comes between them and the sunIn a pillar of radiant house-dust.»
Je ne savais pratiquement rien de ce grand poète et voici que, lisant l'entretien accordé par Michel Déon à L'Atelier du roman paru en septembre, je note ces lignes (pp. 32-3) : «Je suis heureux que vous me parliez de Seamus Heaney. Je l'aime beaucoup. L'homme est absolument exquis. [...] Et puis c'est un grand poète, un poète naturel, complexe parfois, mais sans que cela en ait l'air. Jamais il ne force son talent, un peu comme T. S. Eliot à qui il me fait penser. Rien à voir avec le pauvre Char et la plupart des poètes français contemporains». Ce qui m'a surpris, je crois, dans les poèmes de cet Irlandais, est effectivement l'étonnant mélange entre simplicité, je pourrais dire rusticité et rutilance, irruption inopinée du nouveau, et, parfois, éclair de la grâce, comme s'il s'agissait coûte que coûte, en explorant le passé (par exemple celui que symbolise la découverte de corps humains de l'âge de fer remarquablement bien conservés par les tourbières du Jutland au Danemark, dont Heaney fera un poème intitulé The Tollund Man, L'Homme de Tollund), en retrouvant quelque peu de sa force mais aussi de l'horreur de ses cérémonies sacrificielles dont la science valide l'existence, d'innerver un présent qui, du moins en Irlande du Nord, ne semble jamais très éloigné, comme affleurant à la surface du sol, ou bien visible par une lucarne que les vieux bardes ont connue. Un mot sur cette lecture des poèmes d'Heaney, laquelle aurait été je crois parfaitement impossible à Paris ou dans toute autre grande ville, s'il est vrai que certains lieux perdus, préservés, sauvages, non seulement orientent le sens de nos lectures, mais se mêlent au livre lui-même, lui communiquent en quelque sorte leur silence, deviennent ce livre d'une certaine façon. Et le silence, quelle sottise de croire qu'il est le même quel que soit le lieu où nous tentons de l'écouter, de comprendre ce qu'il veut nous dire : il y a autant de silences qu'il y a de langues, même si, comme celles-ci, les silences se réduisent comme peau de chagrin à la surface de notre globe hurlant. Chaque haut-lieu s'éloigne du vacarme et, en échange de notre attention et de notre écoute, laisse sourdre un silence qui lui est propre, à nul autre pareil. Car, s'il est bien vrai qu'un grand texte est comme l'éclosion d'un possible infini, un paysage grandiose peut tout aussi bien, comme s'il était le rival du livre en train d'être lu, nourrir ses pages et celui qui les lit d'un silence tout bruissant de mille voix tragiques et oubliées.Ainsi, extrait de La lucarne, ce poème, splendide :«For certain ones what was written may come true :They shall live on in the distanceAt the mouths of rivers.For our ones, no. They will re-enterDryness that was heaven on earth to them,Happy to eat the scones baked out of clay.For some, perhaps, the delta’s reed-bedsAnd cold bright-footed seabirds always wheeling.For our ones, snuffAnd hob-soot and the eat off ashes.And a judge who comes between them and the sunIn a pillar of radiant house-dust.» Je cite à présent la traduction de Patrick Hersant, à mon sens, et c'est hélas une constante tout au long de ces deux recueils, trop souvent éloignée de l'évidence dans laquelle semblent frappés les mots anglais :«Pour certains, ce qui était écrit pouvait s’avérerCeux-là continueront de vivre au loinÀ l’embouchure des fleuves.Pour les nôtres, non. Ils retrouverontL’aridité qui fut pour eux ciel sur la terre,Heureux de manger les galettes moulées dans l’argile.Pour certains, peut-être, les roseaux du deltaEt le survol des froids oiseaux de mer aux pattes vives.Pour les nôtres, quelques reniflements,La suie des cheminées, la chaleur des cendres.Et un juge dressé entre eux et le soleilDans une éclatante colonne de poussière.»Je me permet d'évoquer un autre extrait de poème (intitulé Continuer in L’étrange et le connu [1996] (Gallimard, coll. Du monde entier, 2005), pp. 34-5 : «Cette scène-là, où Macbeth éperdu s’abandonneAu cauchemar – car voici de nouveau les sorcièresEt les visions sorties du chaudron – Avait quelque chose de familier.»Qu'a écrit Seamus Heaney dans sa propre langue ? Voici : «That scene, with Macbeth helpless and desperateIn his nightmare – when he meets the hags againAnd sees the apparitions in the pot – I felt at home with that one all right.»
Je cite à présent la traduction de Patrick Hersant, à mon sens, et c'est hélas une constante tout au long de ces deux recueils, trop souvent éloignée de l'évidence dans laquelle semblent frappés les mots anglais :«Pour certains, ce qui était écrit pouvait s’avérerCeux-là continueront de vivre au loinÀ l’embouchure des fleuves.Pour les nôtres, non. Ils retrouverontL’aridité qui fut pour eux ciel sur la terre,Heureux de manger les galettes moulées dans l’argile.Pour certains, peut-être, les roseaux du deltaEt le survol des froids oiseaux de mer aux pattes vives.Pour les nôtres, quelques reniflements,La suie des cheminées, la chaleur des cendres.Et un juge dressé entre eux et le soleilDans une éclatante colonne de poussière.»Je me permet d'évoquer un autre extrait de poème (intitulé Continuer in L’étrange et le connu [1996] (Gallimard, coll. Du monde entier, 2005), pp. 34-5 : «Cette scène-là, où Macbeth éperdu s’abandonneAu cauchemar – car voici de nouveau les sorcièresEt les visions sorties du chaudron – Avait quelque chose de familier.»Qu'a écrit Seamus Heaney dans sa propre langue ? Voici : «That scene, with Macbeth helpless and desperateIn his nightmare – when he meets the hags againAnd sees the apparitions in the pot – I felt at home with that one all right.» Dans ce poème de Seamus Heaney, Macbeth n'est donc pas seulement éperdu mais impuissant et désespéré dans son cauchemar, les sorcières n'arrivent pas comme par enchantement mais il est dit que le héros les rencontre, sans que la moindre relation de cause ne soit établie entre les deux actions, le cauchemar et la rencontre maléfique, sans que nous devions donc encore supposer une défaillance de sa volonté ou bien le réveil heureux suivant le mauvais rêve. Il les rencontre parce qu'il le désire et les voit parce qu'il refuse, figé de peur, de fermer les yeux. De plus, si la trivialité bonhomme de la dernière expression est maladroitement atténuée par la traduction qu'en donne Hersant, que dire encore du terme choisi pour pot, si ce n'est que notre langue en gomme l'aspérité presque ordurière, le mot pot (et encore, nous tenons compte d'un usage vernaculaire propre à l'anglais parlé au Canada) ne signifiant chaudron que lorsqu'il suit l'adjectif cooking ?Peu importe du reste puisque l'édition donnée par Gallimard offre aux lecteurs du poète le texte d'origine qui, selon l'adage, aussi ancien que certain, est trop souvent trahi par les approximations d'Hersant (à mon sens insuffisamment pointées par l'article assez complaisant, sur ce point de la traduction, de Clíona Ní Ríordain paru dans la plus récente livraison de la Quinzaine littéraire). Quelques extraits de poèmes, indifféremment choisis dans les deux recueils, offrent je crois une idée assez précise de l'écriture de Heaney :«The first words got pollutedLike river water in the morningFlowing with the dirtOf blurbs and the front pages.My only drink is meaning from the deep brain […].»Dans la traduction d'Hersant :«Les premiers mots furent polluésComme l’eau du fleuve au matinCoulant avec la crasseDes jaquettes glorieuses et des éditoriaux.Je m’abreuve au seul sens surgi de l’esprit profond […].»Et encore, premier poème d'un recueil intitulé Le rameau d'or, évident souvenir de Frazer mais aussi de T. S. Eliot : «And now this is «an inheritance» – Upright, rudimentary, unshiftably plankedIn the long ago, yet willable forwardAgain and again and again, cargoed withIts own dumb, tongue-and-groove worthinessAnd un-get-roundable weight.» «C’est aujourd’hui «un héritage» – Vertical, rudimentaire, inébranlablement ancréDans l’autrefois, mais transmissible à nouveauEncore et encore et encore, tout chargéDe sa propre valeur muette, mortaises et tenonsComme de sa masse incontournable.»Et, pour finir, extrait d'Ajustages :«All gone into the world of light ? PerhapsAs we read the line sheer forms do crowdThe starry vestibule. OtherwiseThey do not. What lucency survivesIs blanched as worms on nightliness I would lift,Ungratified if always well preparedFor the nothing there – which was only what had been there.»«Partis vers la lumière ? À la lecture de ce versDe pures formes viendront peupler, qui sait ?Le vestibule étoilé. Sans celaRien de tel. Ce qu’il reste de lueurÀ la pâleur des larves de mes pêches nocturnes,Décevantes toujours malgré ma préparationÀ l’absence – cette ancienne présence.»
Dans ce poème de Seamus Heaney, Macbeth n'est donc pas seulement éperdu mais impuissant et désespéré dans son cauchemar, les sorcières n'arrivent pas comme par enchantement mais il est dit que le héros les rencontre, sans que la moindre relation de cause ne soit établie entre les deux actions, le cauchemar et la rencontre maléfique, sans que nous devions donc encore supposer une défaillance de sa volonté ou bien le réveil heureux suivant le mauvais rêve. Il les rencontre parce qu'il le désire et les voit parce qu'il refuse, figé de peur, de fermer les yeux. De plus, si la trivialité bonhomme de la dernière expression est maladroitement atténuée par la traduction qu'en donne Hersant, que dire encore du terme choisi pour pot, si ce n'est que notre langue en gomme l'aspérité presque ordurière, le mot pot (et encore, nous tenons compte d'un usage vernaculaire propre à l'anglais parlé au Canada) ne signifiant chaudron que lorsqu'il suit l'adjectif cooking ?Peu importe du reste puisque l'édition donnée par Gallimard offre aux lecteurs du poète le texte d'origine qui, selon l'adage, aussi ancien que certain, est trop souvent trahi par les approximations d'Hersant (à mon sens insuffisamment pointées par l'article assez complaisant, sur ce point de la traduction, de Clíona Ní Ríordain paru dans la plus récente livraison de la Quinzaine littéraire). Quelques extraits de poèmes, indifféremment choisis dans les deux recueils, offrent je crois une idée assez précise de l'écriture de Heaney :«The first words got pollutedLike river water in the morningFlowing with the dirtOf blurbs and the front pages.My only drink is meaning from the deep brain […].»Dans la traduction d'Hersant :«Les premiers mots furent polluésComme l’eau du fleuve au matinCoulant avec la crasseDes jaquettes glorieuses et des éditoriaux.Je m’abreuve au seul sens surgi de l’esprit profond […].»Et encore, premier poème d'un recueil intitulé Le rameau d'or, évident souvenir de Frazer mais aussi de T. S. Eliot : «And now this is «an inheritance» – Upright, rudimentary, unshiftably plankedIn the long ago, yet willable forwardAgain and again and again, cargoed withIts own dumb, tongue-and-groove worthinessAnd un-get-roundable weight.» «C’est aujourd’hui «un héritage» – Vertical, rudimentaire, inébranlablement ancréDans l’autrefois, mais transmissible à nouveauEncore et encore et encore, tout chargéDe sa propre valeur muette, mortaises et tenonsComme de sa masse incontournable.»Et, pour finir, extrait d'Ajustages :«All gone into the world of light ? PerhapsAs we read the line sheer forms do crowdThe starry vestibule. OtherwiseThey do not. What lucency survivesIs blanched as worms on nightliness I would lift,Ungratified if always well preparedFor the nothing there – which was only what had been there.»«Partis vers la lumière ? À la lecture de ce versDe pures formes viendront peupler, qui sait ?Le vestibule étoilé. Sans celaRien de tel. Ce qu’il reste de lueurÀ la pâleur des larves de mes pêches nocturnes,Décevantes toujours malgré ma préparationÀ l’absence – cette ancienne présence.»
04/06/2011 | Lien permanent
De Roux le provocateur, Hallier l'imposteur

Lettre de Dominique de Roux à Raymond Abellio (9 juin 1966) citée par Jean-Luc Barré.
«S'il te semble, me lisant, être un peu figurant dans ta propre biographie, ne l'impute qu'au flou de ta pensée et à tes compromissions dans le siècle qui rendent difficile la libre parole».
Sarah Vajda
Notre longue discussion (dans un bar où, selon ses propres termes, on peut tout de même s'entendre) avec Pierre-Guillaume de Roux, a eu lieu finalement dans son bureau surchargé de livres et de manuscrits mais j'ai éte ému de revoir ce placide géant, ayant terminé, la veille, ma lecture de la superbe biographie (publiée par Fayard) que Jean-Luc Barré a consacrée à son père : le provocateur, l'intempestif, l'inactuel Dominique de Roux.
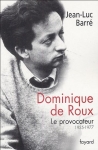 Outre les portraits subtils et émouvants consacrés par Barré à Robert Vallery-Radot (quel lecteur de Georges Bernanos a pu oublier le rôle que joua ce confesseur des âmes auprès du tragique romancier ?), Michel Bernanos dont les romans crépusculaires demeurent hélas méconnus et Ezra Pound qui comme tant d'autres furent fascinés par la frénésie prodigieuse de l'auteur de Maison jaune, cette très belle biographie est capitale quant à un aspect, à mon sens encore méconnu, de l'éditeur et écrivain : on y prend conscience de l'admirable, du fulgurant talent d'épistolier de Dominique de Roux. Un exemple, parmi une multitude réellement fascinante, de lettre, écrite à Robert Vallery-Radot, le 9 mars 1967 : «Il faut revenir à la Parole, à la simplicité évangélique de l’Écriture, et pour cela nous débarrasser de tant de vieux stocks de mots, de tant de livres, de tant de haines historiques récentes, repartir avec dans la valise les quelques livres choisis pour l’Ordre, pour recréer dans l’île déserte».
Outre les portraits subtils et émouvants consacrés par Barré à Robert Vallery-Radot (quel lecteur de Georges Bernanos a pu oublier le rôle que joua ce confesseur des âmes auprès du tragique romancier ?), Michel Bernanos dont les romans crépusculaires demeurent hélas méconnus et Ezra Pound qui comme tant d'autres furent fascinés par la frénésie prodigieuse de l'auteur de Maison jaune, cette très belle biographie est capitale quant à un aspect, à mon sens encore méconnu, de l'éditeur et écrivain : on y prend conscience de l'admirable, du fulgurant talent d'épistolier de Dominique de Roux. Un exemple, parmi une multitude réellement fascinante, de lettre, écrite à Robert Vallery-Radot, le 9 mars 1967 : «Il faut revenir à la Parole, à la simplicité évangélique de l’Écriture, et pour cela nous débarrasser de tant de vieux stocks de mots, de tant de livres, de tant de haines historiques récentes, repartir avec dans la valise les quelques livres choisis pour l’Ordre, pour recréer dans l’île déserte».De toute urgence, il faut que paraisse un recueil des lettres de Dominique de Roux pour rendre justice à son génie de l'ellipse ; j'ai été, sur ce point, rassuré, sans que je puisse pour le moment en dire davantage.
D'autres qualités sont à noter dans cette somme de Barré, par exemple la minutie de l'analyse consacrée par l'auteur à la période, dernière, touffue, riche en légendes et fantasmes de toutes espèces, que nous pourrions définir d'un terme barbare : esthético-politique. Non seulement le ralliement de Dominique de Roux à une sorte de gaullisme intemporel mais plus encore sa prescience d'une régénération définitive, messianique, qu'il croira dénicher dans les forêts de l'Afrique et au creux scintillant des vieilles légendes lusitaniennes.
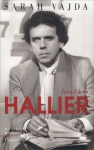 Comme, je le répète souvent, les hasards n'existent point, Sarah Vajda a fini par retrouver un exemplaire de sa propre biographie consacrée à Jean-Edern Hallier (parue chez Flammarion en 2003) qui on le sait connut longuement Dominique de Roux, avant, comme toujours, de se séparer de son ami. Je viens juste d'en commencer la lecture, à vrai dire passionnante. Un point tout de même, que je confirmerai ou infirmerai en cours de route : plus qu'une biographie, cet ouvrage prolixe, au style surchargé, bien souvent d'une fulgurance assassine, est un essai sur le mal français, sur le mal dont souffre l'écriture française depuis, au moins, plusieurs décennies. En quelques mots qui auront valeur de diagnostic : les écrivains n'écrivent plus mais parlent et, surtout, jouent à se vouloir écrivains, alors qu'ils ne sont que de pathétiques bavards...
Comme, je le répète souvent, les hasards n'existent point, Sarah Vajda a fini par retrouver un exemplaire de sa propre biographie consacrée à Jean-Edern Hallier (parue chez Flammarion en 2003) qui on le sait connut longuement Dominique de Roux, avant, comme toujours, de se séparer de son ami. Je viens juste d'en commencer la lecture, à vrai dire passionnante. Un point tout de même, que je confirmerai ou infirmerai en cours de route : plus qu'une biographie, cet ouvrage prolixe, au style surchargé, bien souvent d'une fulgurance assassine, est un essai sur le mal français, sur le mal dont souffre l'écriture française depuis, au moins, plusieurs décennies. En quelques mots qui auront valeur de diagnostic : les écrivains n'écrivent plus mais parlent et, surtout, jouent à se vouloir écrivains, alors qu'ils ne sont que de pathétiques bavards...En fait, cette biographie corrosive, en s'attaquant au simulacre bavard que fut Hallier, a dénoncé et fait éclater, avec courage et, surtout, je l'ai dit, un style éclatant auquel nous ne sommes hélas plus habitués, la baudruche du petit monde parisien des arts et lettres, gonflée à l'hélium sollersien, qui par tous les moyens tenta de s'engouffrer dans le siphon halliéresque. Comme je comprends que ce livre de feu ait dérangé les imbéciles, qui ont dû paraître tout penauds de se voir dépouillés de leur masque et, d'abord, la petite cohorte des fous d'Hallier !... Ainsi, sur l'ouvrage de Charles Ficat, Stations, dont l'un des trois textes chante le génie halliéresque, Sarah Vajda rappelle qu'il «omet simplement de se souvenir du poids d'or [qu'Hallier] tentait de recevoir en échange, des intermédiaires qui vendaient les dessins qu'il signait et des à-valoir reçus pour des livres-fœtus, comme des voyages offerts pour des reportages jamais rendus, servant de décor à des romans à demi écrit» (278). Déjà, en lisant ces quelques lignes, on imagine le danger réel qui guette notre pauvre biographe. Mais, bien vite, son cas va devenir réellement désespéré, l'auteur risquant cette fois un lynchage en règle pour avoir osé certaines de ses attaques. Ainsi, ce qui semblera aux imbéciles parfaitement impardonnable est le crime de lèse-majesté que commet Sarah Vajda en critiquant la bouffonnerie triomphante, généralisée : «Ce fut un siècle où Hallier ne faisait pas rire en se comparant à Homère, à Tacite ou à Tite-Live, un siècle où un journal à scandale, où fleurissait l'insulte, se réclamait de Karl Kraus pour qui l'injure privée relevait de l'idéologie petite-bourgeoise et devait, pour cela, être bannie» (280). Car écrire sur Hallier c'est sonder le ventre pourri de la France : «Si tu n'as pas écrit l'histoire du XXe siècle comme tu te plaisais à le rêver, tu en as si bien épousé les courbes que, désormais, vos visages se superposent, comme il m'a plu d'assembler les lignes de ta vie jusqu'à dessiner un portulan de France» (402).
Dès lors, Sarah Vajda semblera une déicide en puissance en reniflant la pourriture française, imputant, au passage, la rapidité de la contamination à quelques agents insignes, hérités d'une période trouble : «Que le régime de Vichy, héritier en bien des points de la IIIe République, ait fort mal obéi aux lois de l'hospitalité dans un pays où l'immigration ne représente guère une des constantes du génie national, n'indique pas qu'elle doive s'étendre aux citoyens qui, à leur tour, en useraient fort mal et que le loup une fois dans la bergerie, il faille laisser impunis les crimes commis par les victimes proches et lointaines du colonialisme et de l'esclavage. Ce grand désordre de la pensée française s'enracine dans la dangereuse culpabilité vichyste de l'après-guerre. Sollers, plus encore qu'Hallier contribuera à fortifier le méchant mythe des deux France où se font face, en un éternel combat, une France-fée née de l'affaire Dreyfus, entrée, presque unanime, en résistance et son double noir, sorcière nationale, entrée, massive, en collaboration» (132). L'attaque est rude mais ne faut-il point crier au scandale lorsque l'on lit la suite et qu'en un éclair nous comprenons que Sarah Vadja paraît déterminée à enfoncer la dague jusqu'au plus profond de la blessure française ? : «Hélas pour nos Jivaros, quelques esprits chagrins ont travaillé à l'anéantissement de ce mensonge que les manuels scolaires débitent à l'envi, mensonge vivifié dans les années 1980-1990, chargé d'exorciser le pays maudit. Quiconque refuse cette version se voit qualifié d'ennemi du genre humain : ennemi de cette belle France née casquée, armée, sous son nimbe de Lumières, à l'instant précis où Camille Desmoulins arrachait une feuille de platane dans les jardins du Palais-Royal et inventait ce qui deviendra la cocarde tricolore, qu'aucun sang pur ne saurait ternir. Aux armes bon docteur Guillotin ! A ce conte fameux, les gauchistes français, en dépit de leurs flirts avec le PC et de leurs trahisons successives, apporteront leur caution. Tout ce qui ne fleure pas bon la gauche pour Philippe Sollers s'avoue résurrection de Vichy, cadavre puant sorti des placards nationaux. Vichy-fiction, toujours. La question juive a servi d'écran au pays pour éviter de poser sur la balance le poids des idéologies, des folies et des passions françaises» (133). Jubilatoire ! Férocité implacable de la vérité, que le biographe ne peut que malaisément étayer (mais la vérité a-t-elle besoin de démonstrations pesantes ?) si ce n'est en exposant une intuition terrible : «[...] le nazisme n'a montré un visage humain aux Français travaillant en Allemagne, que parce que les juifs avaient, à l'avance, servi de monnaie d'échange» (404). Car, les derniers chapitres de la biographie, boursouflés et fiévreux, en témoignent, la question juive, à laquelle Hallier parut ne strictement rien comprendre que de grossier et de parodique, est le centre secret du livre de Sarah Vajda, le trou noir dévorant toute écriture : en tombant dans le vortex, les hautes paroles rayonnent une dernière fois et les mauvaises, les fausses (singulièrement donc, celles d'Hallier) se contentent, ma foi, de chuter sans gloire.
Entre ces deux ouvrages irremplaçables, de nombreuses passerelles, de nombreux passages. Aucun, je crois, sauf peut-être, l'évocation d'Abellio, commune aux deux auteurs, n'est plus attirant et secret que le portrait d'Ezra Pound, un de mes actes de lecture manqué lorsque, en hypokhâgne je crois, je commençais à lire les Cantos dans une édition de poche, le regard dubitatif, soupçonneux de mon professeur de français ajoutant à mon embarras face à une prose aussi complexe, essentielle, hermétique bien souvent.
Résumons-nous : la fine biographie écrite par Jean-Luc Barré m'a donné envie de lire ou de relire Dominique de Roux, celle de Sarah Vajda m'a dissuadé de lire les bizarres ouvrages de celui, Hallier, qui se rêva grand écrivain et ne fut que pitre surnuméraire, leur préférant et de loin les propres livres de Sarah, comme cette biographie de Barrès que je vais lire de toute urgence. C'est que Barré est un ouvrier honnête (je tiens ce qualificatif pour un compliment) et Vajda, dans la démesure et, parfois, la confusion de son écriture, un véritable écrivain qui eût dû, pour maîtriser le flot torrentiel, confronter sa propre maîtrise littéraire aux fulgurantes sécheresses d'un Dominique de Roux. Hallier, en somme, ressemble trop à son biographe si je puis dire et, par avance, en incarne les démons contradictoires.
Pour finir, ces deux livres me conduisent, de nouveau, devant les figures solitaires et terriblement silencieuses, injustement tues et effacées, de Pound et d'Abellio.
Parfois, comme par miracle, un siècle tout entier est sauvé de l'insignifiance par quelques brefs éclats d'amitiés remarquables.
15/10/2005 | Lien permanent
Dans la gorge de l'ombre, par Lucien Suel

29/10/2005 | Lien permanent
La France, une peau de chagrin, par Raphaël Dargent

 Dernier exemple en date de cette intransigeance et des ravages de l’«historiquement correct» : l’universitaire Olivier Pétré-Grenouilleau, spécialiste de la question et auteur d’un remarquable ouvrage intitulé Les traites négrières (chez Gallimard), vient d’être accusé de révisionnisme et traduit en justice par un collectif des Antilles au seul motif qu’il affirme, preuves à l’appui, que les traites négrières ne furent pas le seul fait des Européens mais également des Arabes et... des Africains eux-mêmes ! L’historiquement correct, que dénonçait il y a deux ans Jean Sévillia dans un ouvrage indispensable, n’en finit donc pas de faire des ravages. «Analysant le monde d’hier d’après les critères de notre époque, l’historiquement correct traque l’obscurantisme, l’impérialisme, le colonialisme, le racisme, le fascisme ou le sexisme à travers les siècles. Que ces mots n’aient pas de sens hors d’un contexte précis, l’historiquement correct s’en moque : son but n’est pas de comprendre le passé, mais d’en fournir une version conforme à la philosophie dominante.» (1) On ne peut mieux dire. Le procès perpétuel de la France Pourquoi une société oublieuse de son passé craindrait-elle l’anachronisme ? Pourquoi un peuple rivé à l’instant présent, sans recul ni perspective, redouterait-il l’injustice ? Qu’aurait-on besoin d’une conscience historique (et d’une conscience tout court) et d’un peu de la foi de nos ancêtres quand il y a le Tribunal pénal international ou la Cour européenne des Droits de l’Homme ? Au contraire, nous vivons l’absolue loi du présent et à cette aune tout le passé est revisité. Prétention de l’homme moderne ! Notre temps se veut d’éternité, nos valeurs indépassables, nous prétendons être les derniers. Dans ce contexte, la France est régulièrement traînée au banc des accusés et c’est toute son histoire qui y est jugée à l’aune des critères actuels et de la bien-pensance post-moderne. Il n’y a pas jusqu’à notre hymne national qui ne soit contesté, jugé trop violent ou trop «nationaliste». Faut-il rappeler que c’est Jacques Chirac lui-même qui ouvrit l’ère de cette repentance devenue endémique, lorsque le 16 juillet 1995, il évoqua la responsabilité de la France – de la France et non pas de l’État français, non pas de Vichy – dans les persécutions contre les juifs ? Se rendait-il compte que disant cela, il reconnaissait en fait la légitimité de Vichy (Vichy, c’était donc la France ?), contredisait, lui le prétendu gaulliste, Charles de Gaulle lui-même, et faisait du Général le traître que Pétain dénonça ? Qu’on s’en souvienne tandis qu’il nous parle aujourd’hui de patriotisme : contre la France, c’est lui qui tira le premier. J’aime à citer ce proverbe chinois : «Le poisson pourrit toujours par la tête !» Dernièrement, ce fut donc le tour de Napoléon d’être condamné. C’est ainsi qu’on vit les autorités françaises boycotter le bicentenaire de sa plus grande victoire, Austerlitz, alors même qu’elles avaient peu de mois auparavant envoyé le porte-avion Charles-de-Gaulle, fleuron de notre marine, célébrer la plus sévère défaite de la marine française, Trafalgar. Bel exemple de haine de soi ! Symbole parmi les symboles : le 2 décembre dernier, pendant que le service minimum de la célébration était assuré par quelques troupes devant la colonne Vendôme, Jacques Chirac faisait le paon… au Mali ! Quant à Dominique de Villepin – Villepin qui écrivit Les Cent-jours, Villepin le napoléonide –, il était en visite à Amiens pour évoquer… la non-discrimination ! Le Premier ministre expliqua, lorsque l’on s’en étonna, qu’il n’y avait «pas de consensus autour d’Austerlitz»; il cédait ainsi à la pression de quelques associations communautaires d’Antillais, de Guyanais et Réunionnais qui accusaient l’Empereur d’avoir rétabli l’esclavage, et donnait crédit aux inepties professées à grand renfort de médias par un certain Claude Ribbe lorsque celui-ci n’hésitait pas, loin de toute vérité historique, à comparer Napoléon à Hitler et à mettre sur le même plan les 20 000 individus concernés par le rétablissement de l’esclavage et les millions de déportés morts sous le joug nazi ! On n'en finira décidément jamais d’admirer le courage des plus hautes autorités de notre pays. Aux «indigènes de la République» qu’on n’osa pas froisser, l’historien Pierre Nora répondit dans un Plaidoyer pour les indigènes d’Austerlitz dans Le Monde du 12 décembre : «La France ? Elle se décommande, elle se fait toute petite, elle se fait excuser, elle se cache derrière son petit doigt.» Quant à l’historien Thierry Lentz, président de la Fondation Napoléon, tout en ne niant pas les faits, il les mit en perspective et précisa dans Le Figaro du 22 décembre : «Pendant tout l’épisode, c’est bien l’Angleterre qui eut le monopole de la traite dans le monde et ne s’en priva pas, ce que les tabloïds britanniques ont, eux, passé sous silence dans leur récent déchaînement de francophobie au sujet du «French Hitler» qu’aurait été Napoléon.» Comment veut-on après une telle honte que quelques rappeurs n’écrivent pas ces fortes paroles : «Je pisse sur Napoléon et le général de Gaulle»? Comment veut-on après ça que des jeunes déstructurés, désorientés, déracinés, aiment notre pays et veuillent sa réussite ? Comment des Français d’adoption ou issus de l’immigration pourraient-ils aimer la France quand ses plus hautes autorités ne l’aiment pas elles-mêmes ? Il s’agit aujourd’hui de bannir toute fierté nationale et de se complaire dans l’autodénigrement. On attend la suite. A quand le procès des Croisades ? A quand celui de la Révocation de l’Édit de Nantes ? A quand celui d’Auguste Thiers ? Cette sale besogne qui consiste à réécrire l’histoire de France pour la noircir, est aussi une vaste entreprise de lavage de cerveaux. La Gauche s’y complaît. Depuis 2001, Bertrand Delanoë s’est engagé dans une politique de renomination des rues de Paris pour satisfaire aux revendications de toutes sortes d’associations communautaires. C’est ainsi par exemple qu’il a débaptisé la rue Richepance, du nom du général coupable selon des associations noires d’avoir réprimé la révolte des noirs de la Guadeloupe et justement rétabli l’esclavage sur ordre de Bonaparte… Amnésie de la Gauche, lâcheté de la Droite La Gauche a la mémoire courte, tellement courte d’ailleurs, qu’elle s’oublie elle-même et ne sait plus qui elle est ni dans quel sens elle doit aller, vers Bayrou ou dans la direction de Besancenot. François Hollande ou Jack Lang étaient-ils bien inspirés de faire le procès en colonisation de la Droite quand on sait qu’en 1880 c’est la Gauche de l’époque, désireuse d’apporter «la civilisation» au reste du monde, qui réclamait la colonisation, et la Droite, plus soucieuse des deniers publics et de l’Alsace-Lorraine, qui y était hostile ? Jules Ferry, qu’on loue pour sa politique scolaire, ne fut-il pas surnommé Le Tonkinois, eu égard à son engagement colonial ? La Gauche, toujours prompt par ailleurs à donner des leçons d’anti-racisme au peuple français et à accuser la Droite de frayer avec l’extrême-droite, a-t-elle oublié l’antisémitisme de Jaurès ? Et instruira-t-on un jour le procès des «compagnons de route» du communisme comme on instruisit à juste titre celui des collaborateurs avec le nazisme ? Chance pour la Gauche : le peuple français ne connaît pas son histoire et ces vieilles lunes se sont perdues dans les limbes de la modernité matérialiste. Il faut en convenir : l’histoire est toujours celle du vainqueur et en l’occurrence la Gauche, ses valeurs, son idéologie, sa vision de la France et du monde, ont gagné sur toute la ligne. La Droite a abdiqué ses valeurs propres, l’autorité, la tradition, le pragmatisme, la liberté pour céder à l’égalitarisme, au droits-de-l’hommisme, au progressisme de la Gauche. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter les paroles consensuelles et bien-pensantes de Jacques Chirac et celles, verbeuses et jésuitiques, de son disciple Dominique de Villepin, lyrique Premier ministre qui s’aime davantage qu’il n’aime la France. Et quand certains à droite tentent de briser le consensus pour rétablir quelques vérités premières, ils sont cloués au pilori, accusés de toutes les tares et tous les extrémismes. S’excuser d’être français Encore une fois, me voici amené à faire l’éloge de Nicolas Sarkozy, chose proprement ahurissante il y a encore peu. Je sais bien que d’autres que lui parlent vrai mais parmi ceux qui peuvent raisonnablement succéder à Jacques Chirac à la Présidence de la République, l’actuel ministre de l’Intérieur est le seul à le faire avec autant de netteté. Il faut lui reconnaître cette grande qualité : il ne craint pas de mettre sa popularité en jeu lorsqu’il dit les choses telles qu’elles sont et conteste la repentance ambiante. Ainsi quelle ne fut pas ma satisfaction lorsque je l’entendis, alors qu’il était interrogé sur France 3 le 7 décembre dernier au sujet de la fameuse loi concernant la colonisation et sur Austerlitz, affirmer avec force «qu’il faut cesser avec la repentance permanente en France pour revisiter notre histoire. […] cette repentance permanente qui fait qu’il faudrait s’excuser de l’histoire de France, permettez-moi de vous le dire, parfois touche aux confins du ridicule. […] Les Anglais, ça ne les gêne pas de fêter Trafalgar. Permettez-moi de vous dire qu’on ne peut pas réduire Napoléon aux aspects négatifs de son action. Et ne pas célébrer Austerlitz n’a pas beaucoup de sens. Donc justement, laissons les historiens faire ce travail de mémoire, et arrêtons de voter sans arrêt des lois pour revenir sur un passé revisité à l’aune des idées politiques d’aujourd'hui. C’est le bon sens.» Quelle ne fut pas aussi ma satisfaction de lire sous sa plume ceci : «Nous assistons à une dérive préoccupante. Tout semble bon pour instruire le procès de la France et faire assaut d’auto-dénigrement.» Puis, dans une allusion à peine voilée à l’intervention du président de la République : «On assiste au développement en France chez certains individus et parfois même au sein de l’État à une tendance irrépressible à la repentance systématique.» Fustigeant la «funeste inclinaison au reniement de soi», le président de l’UMP feint de s’interroger : «Finira-t-on, un jour prochain, par s’excuser d’être français ?». Peut-on être plus clair ? Dans la lâcheté ambiante, qui confine parfois à la collaboration pure et simple avec les adversaires de la France, les paroles de Nicolas Sarkozy font du bien. Je sais bien ce que l’on va dire. J’entends déjà la critique poindre : «Il est devenu sarkozyste !». Il faut pourtant que les choses soient bien claires : je ne serai jamais ni «sarkozyste», ni «villepiniste», ni «villiériste», ni «chevènementiste» ni quoi ce soit d’autre. Je déteste les écuries. Je n’ose même plus me dire «gaulliste» eu égard au nombre d’opportunistes et d’hurluberlus qui se définissent comme tel. La seule étiquette que je revendique est celle de «patriote», étiquette intemporelle et qui n’appartient à personne. C’est pourquoi, et afin de répondre par avance à mes contradicteurs, je peux d’ores et déjà annoncer qu’en 2007, je soutiendrai, au premier tour puis au deuxième tour, le candidat qui selon moi défendra le mieux les intérêts de la France. Voilà ce que j’ai toujours fait, en conscience, depuis que j’ai l’honneur de pouvoir voter. Il se peut, en tous les cas il n’est pas exclu, qu’au deuxième tour, ce candidat soit Nicolas Sarkozy. J’ai pour habitude de juger sur pièce et non par principe. J’ai suffisamment critiqué Nicolas Sarkozy et sa politique pour avoir le droit de reconnaître quand il a raison. Or, dans ces affaires de repentance et de haine de soi, c’est lui qui a raison. Quelques «jeunes gens» bien tranquilles… J’ai dit déjà, dans un article précédent, combien le Ministre de l’Intérieur avait également eu raison lorsqu’il qualifia les auteurs des émeutes urbaines de novembre dernier de «racailles» et de «voyous» alors que le Président de la République et le Premier ministre, la Gauche et les médias bien-pensants ne voulaient y voir que des «jeunes». Et bien, nous venons la semaine dernière de vivre, à une échelle moindre, la même situation. Alors qu’on apprit, avec trois jours de retard, qu’une cinquantaine de barbares avaient investis le 1er janvier au matin le train Nice-Lyon, tout saccagé, rançonné et violenté les passagers, créant une véritable panique, les médias continuaient, en évoquant les responsables de tels actes, de parler de «jeunes gens». Il faut être bien charitable pour souhaiter que ceux qui persistent à utiliser un vocable aussi lâche ne croisent jamais, pour leur malheur, cette sorte de «jeunes gens» ! C’est Nicolas Sarkozy à nouveau qui rétablit les mots dans leur sens et condamna, lors du Journal de vingt heures de TF1, cette scandaleuse expression. Et regretter que la plupart de ceux qui avait été arrêtés avait dû être relâchés du fait de leur âge, ordonnance de 45 oblige. Ce qui n’empêchait pas pour sa part Jacques Chirac d’assurer le plus solennellement du monde que «les auteurs de tels actes seraient punis» ! Le fait est que parmi la poignée qui fut arrêtée, se trouvaient nombres d’étrangers ou de jeunes Français d’origine étrangère. Qui peut contester le fait qu’il y a bien une composante identitaire à ces violences ? Qu’on me comprenne bien. Je ne dis pas, je n’ai jamais dit, que c’était là la seule composante, je ne dis pas, je n’ai jamais dit qu’il n’y avait pas aussi une composante proprement sociale. Je ne fais pas non plus d’amalgame et je ne condamne pas toute une catégorie de la population française ou vivant en France parce que certains de ses membres commettent les pires actes. Mais les faits parlent d’eux-mêmes. Qu’on en juge. Petite ville de l’orléanais : une bande de ces «jeunes gens», casquettes vissées sur le crâne, doigt levé bien haut, insultent les passants, leur promettent que «le pays sera bientôt à eux, qu’ils vont faire régner la terreur», ils crachent sur certains, des grands-mères sont moquées. A Épinal, une semaine après, devant un centre commercial, même scène mais ce sont des jeunes filles qui invectivent la foule et promettent au pays, le leur, aux sales Français, qu’elles sont, le même sort. Comment se peut-il que ces deux exemples, éloignés de plusieurs centaines de kilomètres, que des personnes dignes de foi m’ont personnellement raconté, n’illustrent pas un phénomène plus général ? C’est pourquoi j’ose dire qu’il y a un lien entre le désamour français que j’ai évoqué plus haut et ces violences gratuites à relents identitaires ou communautaires. Je ne prétends pas que ce lien soit nécessairement de cause à effet mais j’affirme que le procès instruit perpétuellement à la France est un facteur aggravant. On ne peut accréditer sans cesse l’idée selon laquelle la France s’est rendue coupable de ségrégation, d’esclavagisme, de torture vis-à-vis d’Algériens, d’Africains, d’Antillais et s’étonner après cela que des jeunes issus de l’immigration, en désespérance sociale et faute de repères, en veuillent à la France et aux Français. On n’est pas aimable lorsque l’on ne s’aime pas soi-même. Pour une réforme intellectuelle et morale Qu’est donc devenu notre pauvre pays en si peu de temps, en trente ans à peine ? Comme il est loin le temps où l’historien Pierre Chaunu pouvait écrire : «Dans l’esprit des Français, à quelque famille qu’ils appartiennent, à partir de motivations différentes, l’image de la France est gratifiante. […] La France a reçu, au ciel des mots et des entités sociales, dès le berceau, une charge affective exceptionnellement forte et vivace.» (2) Comme il est loin le temps où son Président se faisait «une certaine idée de la France», la comparant à «la princesse des songes, la madone aux fresques des murs» ! La France est un peu comme la peau de chagrin décrite par Balzac en 1831 : c’est comme si à chacune des émotions qu’elle avait fait partager, à chacune des idées et des œuvres qu’elle avait offertes au monde, à chacune des grandes choses qu’elle avait réalisées, elle avait rétréci. La France n’est plus qu’une peau de chagrin. Une pauvre peau de chagrin, une peau de misère qui n’exauce plus rien et ne fait plus rêver, une vieille peau piétinée, déchirée, brûlée. C’est comme si la France avait épuisé tout le capital de grandeur, d’exemplarité et d’amitié que la Providence lui avait accordée à la naissance.
Dernier exemple en date de cette intransigeance et des ravages de l’«historiquement correct» : l’universitaire Olivier Pétré-Grenouilleau, spécialiste de la question et auteur d’un remarquable ouvrage intitulé Les traites négrières (chez Gallimard), vient d’être accusé de révisionnisme et traduit en justice par un collectif des Antilles au seul motif qu’il affirme, preuves à l’appui, que les traites négrières ne furent pas le seul fait des Européens mais également des Arabes et... des Africains eux-mêmes ! L’historiquement correct, que dénonçait il y a deux ans Jean Sévillia dans un ouvrage indispensable, n’en finit donc pas de faire des ravages. «Analysant le monde d’hier d’après les critères de notre époque, l’historiquement correct traque l’obscurantisme, l’impérialisme, le colonialisme, le racisme, le fascisme ou le sexisme à travers les siècles. Que ces mots n’aient pas de sens hors d’un contexte précis, l’historiquement correct s’en moque : son but n’est pas de comprendre le passé, mais d’en fournir une version conforme à la philosophie dominante.» (1) On ne peut mieux dire. Le procès perpétuel de la France Pourquoi une société oublieuse de son passé craindrait-elle l’anachronisme ? Pourquoi un peuple rivé à l’instant présent, sans recul ni perspective, redouterait-il l’injustice ? Qu’aurait-on besoin d’une conscience historique (et d’une conscience tout court) et d’un peu de la foi de nos ancêtres quand il y a le Tribunal pénal international ou la Cour européenne des Droits de l’Homme ? Au contraire, nous vivons l’absolue loi du présent et à cette aune tout le passé est revisité. Prétention de l’homme moderne ! Notre temps se veut d’éternité, nos valeurs indépassables, nous prétendons être les derniers. Dans ce contexte, la France est régulièrement traînée au banc des accusés et c’est toute son histoire qui y est jugée à l’aune des critères actuels et de la bien-pensance post-moderne. Il n’y a pas jusqu’à notre hymne national qui ne soit contesté, jugé trop violent ou trop «nationaliste». Faut-il rappeler que c’est Jacques Chirac lui-même qui ouvrit l’ère de cette repentance devenue endémique, lorsque le 16 juillet 1995, il évoqua la responsabilité de la France – de la France et non pas de l’État français, non pas de Vichy – dans les persécutions contre les juifs ? Se rendait-il compte que disant cela, il reconnaissait en fait la légitimité de Vichy (Vichy, c’était donc la France ?), contredisait, lui le prétendu gaulliste, Charles de Gaulle lui-même, et faisait du Général le traître que Pétain dénonça ? Qu’on s’en souvienne tandis qu’il nous parle aujourd’hui de patriotisme : contre la France, c’est lui qui tira le premier. J’aime à citer ce proverbe chinois : «Le poisson pourrit toujours par la tête !» Dernièrement, ce fut donc le tour de Napoléon d’être condamné. C’est ainsi qu’on vit les autorités françaises boycotter le bicentenaire de sa plus grande victoire, Austerlitz, alors même qu’elles avaient peu de mois auparavant envoyé le porte-avion Charles-de-Gaulle, fleuron de notre marine, célébrer la plus sévère défaite de la marine française, Trafalgar. Bel exemple de haine de soi ! Symbole parmi les symboles : le 2 décembre dernier, pendant que le service minimum de la célébration était assuré par quelques troupes devant la colonne Vendôme, Jacques Chirac faisait le paon… au Mali ! Quant à Dominique de Villepin – Villepin qui écrivit Les Cent-jours, Villepin le napoléonide –, il était en visite à Amiens pour évoquer… la non-discrimination ! Le Premier ministre expliqua, lorsque l’on s’en étonna, qu’il n’y avait «pas de consensus autour d’Austerlitz»; il cédait ainsi à la pression de quelques associations communautaires d’Antillais, de Guyanais et Réunionnais qui accusaient l’Empereur d’avoir rétabli l’esclavage, et donnait crédit aux inepties professées à grand renfort de médias par un certain Claude Ribbe lorsque celui-ci n’hésitait pas, loin de toute vérité historique, à comparer Napoléon à Hitler et à mettre sur le même plan les 20 000 individus concernés par le rétablissement de l’esclavage et les millions de déportés morts sous le joug nazi ! On n'en finira décidément jamais d’admirer le courage des plus hautes autorités de notre pays. Aux «indigènes de la République» qu’on n’osa pas froisser, l’historien Pierre Nora répondit dans un Plaidoyer pour les indigènes d’Austerlitz dans Le Monde du 12 décembre : «La France ? Elle se décommande, elle se fait toute petite, elle se fait excuser, elle se cache derrière son petit doigt.» Quant à l’historien Thierry Lentz, président de la Fondation Napoléon, tout en ne niant pas les faits, il les mit en perspective et précisa dans Le Figaro du 22 décembre : «Pendant tout l’épisode, c’est bien l’Angleterre qui eut le monopole de la traite dans le monde et ne s’en priva pas, ce que les tabloïds britanniques ont, eux, passé sous silence dans leur récent déchaînement de francophobie au sujet du «French Hitler» qu’aurait été Napoléon.» Comment veut-on après une telle honte que quelques rappeurs n’écrivent pas ces fortes paroles : «Je pisse sur Napoléon et le général de Gaulle»? Comment veut-on après ça que des jeunes déstructurés, désorientés, déracinés, aiment notre pays et veuillent sa réussite ? Comment des Français d’adoption ou issus de l’immigration pourraient-ils aimer la France quand ses plus hautes autorités ne l’aiment pas elles-mêmes ? Il s’agit aujourd’hui de bannir toute fierté nationale et de se complaire dans l’autodénigrement. On attend la suite. A quand le procès des Croisades ? A quand celui de la Révocation de l’Édit de Nantes ? A quand celui d’Auguste Thiers ? Cette sale besogne qui consiste à réécrire l’histoire de France pour la noircir, est aussi une vaste entreprise de lavage de cerveaux. La Gauche s’y complaît. Depuis 2001, Bertrand Delanoë s’est engagé dans une politique de renomination des rues de Paris pour satisfaire aux revendications de toutes sortes d’associations communautaires. C’est ainsi par exemple qu’il a débaptisé la rue Richepance, du nom du général coupable selon des associations noires d’avoir réprimé la révolte des noirs de la Guadeloupe et justement rétabli l’esclavage sur ordre de Bonaparte… Amnésie de la Gauche, lâcheté de la Droite La Gauche a la mémoire courte, tellement courte d’ailleurs, qu’elle s’oublie elle-même et ne sait plus qui elle est ni dans quel sens elle doit aller, vers Bayrou ou dans la direction de Besancenot. François Hollande ou Jack Lang étaient-ils bien inspirés de faire le procès en colonisation de la Droite quand on sait qu’en 1880 c’est la Gauche de l’époque, désireuse d’apporter «la civilisation» au reste du monde, qui réclamait la colonisation, et la Droite, plus soucieuse des deniers publics et de l’Alsace-Lorraine, qui y était hostile ? Jules Ferry, qu’on loue pour sa politique scolaire, ne fut-il pas surnommé Le Tonkinois, eu égard à son engagement colonial ? La Gauche, toujours prompt par ailleurs à donner des leçons d’anti-racisme au peuple français et à accuser la Droite de frayer avec l’extrême-droite, a-t-elle oublié l’antisémitisme de Jaurès ? Et instruira-t-on un jour le procès des «compagnons de route» du communisme comme on instruisit à juste titre celui des collaborateurs avec le nazisme ? Chance pour la Gauche : le peuple français ne connaît pas son histoire et ces vieilles lunes se sont perdues dans les limbes de la modernité matérialiste. Il faut en convenir : l’histoire est toujours celle du vainqueur et en l’occurrence la Gauche, ses valeurs, son idéologie, sa vision de la France et du monde, ont gagné sur toute la ligne. La Droite a abdiqué ses valeurs propres, l’autorité, la tradition, le pragmatisme, la liberté pour céder à l’égalitarisme, au droits-de-l’hommisme, au progressisme de la Gauche. Il suffit pour s’en convaincre d’écouter les paroles consensuelles et bien-pensantes de Jacques Chirac et celles, verbeuses et jésuitiques, de son disciple Dominique de Villepin, lyrique Premier ministre qui s’aime davantage qu’il n’aime la France. Et quand certains à droite tentent de briser le consensus pour rétablir quelques vérités premières, ils sont cloués au pilori, accusés de toutes les tares et tous les extrémismes. S’excuser d’être français Encore une fois, me voici amené à faire l’éloge de Nicolas Sarkozy, chose proprement ahurissante il y a encore peu. Je sais bien que d’autres que lui parlent vrai mais parmi ceux qui peuvent raisonnablement succéder à Jacques Chirac à la Présidence de la République, l’actuel ministre de l’Intérieur est le seul à le faire avec autant de netteté. Il faut lui reconnaître cette grande qualité : il ne craint pas de mettre sa popularité en jeu lorsqu’il dit les choses telles qu’elles sont et conteste la repentance ambiante. Ainsi quelle ne fut pas ma satisfaction lorsque je l’entendis, alors qu’il était interrogé sur France 3 le 7 décembre dernier au sujet de la fameuse loi concernant la colonisation et sur Austerlitz, affirmer avec force «qu’il faut cesser avec la repentance permanente en France pour revisiter notre histoire. […] cette repentance permanente qui fait qu’il faudrait s’excuser de l’histoire de France, permettez-moi de vous le dire, parfois touche aux confins du ridicule. […] Les Anglais, ça ne les gêne pas de fêter Trafalgar. Permettez-moi de vous dire qu’on ne peut pas réduire Napoléon aux aspects négatifs de son action. Et ne pas célébrer Austerlitz n’a pas beaucoup de sens. Donc justement, laissons les historiens faire ce travail de mémoire, et arrêtons de voter sans arrêt des lois pour revenir sur un passé revisité à l’aune des idées politiques d’aujourd'hui. C’est le bon sens.» Quelle ne fut pas aussi ma satisfaction de lire sous sa plume ceci : «Nous assistons à une dérive préoccupante. Tout semble bon pour instruire le procès de la France et faire assaut d’auto-dénigrement.» Puis, dans une allusion à peine voilée à l’intervention du président de la République : «On assiste au développement en France chez certains individus et parfois même au sein de l’État à une tendance irrépressible à la repentance systématique.» Fustigeant la «funeste inclinaison au reniement de soi», le président de l’UMP feint de s’interroger : «Finira-t-on, un jour prochain, par s’excuser d’être français ?». Peut-on être plus clair ? Dans la lâcheté ambiante, qui confine parfois à la collaboration pure et simple avec les adversaires de la France, les paroles de Nicolas Sarkozy font du bien. Je sais bien ce que l’on va dire. J’entends déjà la critique poindre : «Il est devenu sarkozyste !». Il faut pourtant que les choses soient bien claires : je ne serai jamais ni «sarkozyste», ni «villepiniste», ni «villiériste», ni «chevènementiste» ni quoi ce soit d’autre. Je déteste les écuries. Je n’ose même plus me dire «gaulliste» eu égard au nombre d’opportunistes et d’hurluberlus qui se définissent comme tel. La seule étiquette que je revendique est celle de «patriote», étiquette intemporelle et qui n’appartient à personne. C’est pourquoi, et afin de répondre par avance à mes contradicteurs, je peux d’ores et déjà annoncer qu’en 2007, je soutiendrai, au premier tour puis au deuxième tour, le candidat qui selon moi défendra le mieux les intérêts de la France. Voilà ce que j’ai toujours fait, en conscience, depuis que j’ai l’honneur de pouvoir voter. Il se peut, en tous les cas il n’est pas exclu, qu’au deuxième tour, ce candidat soit Nicolas Sarkozy. J’ai pour habitude de juger sur pièce et non par principe. J’ai suffisamment critiqué Nicolas Sarkozy et sa politique pour avoir le droit de reconnaître quand il a raison. Or, dans ces affaires de repentance et de haine de soi, c’est lui qui a raison. Quelques «jeunes gens» bien tranquilles… J’ai dit déjà, dans un article précédent, combien le Ministre de l’Intérieur avait également eu raison lorsqu’il qualifia les auteurs des émeutes urbaines de novembre dernier de «racailles» et de «voyous» alors que le Président de la République et le Premier ministre, la Gauche et les médias bien-pensants ne voulaient y voir que des «jeunes». Et bien, nous venons la semaine dernière de vivre, à une échelle moindre, la même situation. Alors qu’on apprit, avec trois jours de retard, qu’une cinquantaine de barbares avaient investis le 1er janvier au matin le train Nice-Lyon, tout saccagé, rançonné et violenté les passagers, créant une véritable panique, les médias continuaient, en évoquant les responsables de tels actes, de parler de «jeunes gens». Il faut être bien charitable pour souhaiter que ceux qui persistent à utiliser un vocable aussi lâche ne croisent jamais, pour leur malheur, cette sorte de «jeunes gens» ! C’est Nicolas Sarkozy à nouveau qui rétablit les mots dans leur sens et condamna, lors du Journal de vingt heures de TF1, cette scandaleuse expression. Et regretter que la plupart de ceux qui avait été arrêtés avait dû être relâchés du fait de leur âge, ordonnance de 45 oblige. Ce qui n’empêchait pas pour sa part Jacques Chirac d’assurer le plus solennellement du monde que «les auteurs de tels actes seraient punis» ! Le fait est que parmi la poignée qui fut arrêtée, se trouvaient nombres d’étrangers ou de jeunes Français d’origine étrangère. Qui peut contester le fait qu’il y a bien une composante identitaire à ces violences ? Qu’on me comprenne bien. Je ne dis pas, je n’ai jamais dit, que c’était là la seule composante, je ne dis pas, je n’ai jamais dit qu’il n’y avait pas aussi une composante proprement sociale. Je ne fais pas non plus d’amalgame et je ne condamne pas toute une catégorie de la population française ou vivant en France parce que certains de ses membres commettent les pires actes. Mais les faits parlent d’eux-mêmes. Qu’on en juge. Petite ville de l’orléanais : une bande de ces «jeunes gens», casquettes vissées sur le crâne, doigt levé bien haut, insultent les passants, leur promettent que «le pays sera bientôt à eux, qu’ils vont faire régner la terreur», ils crachent sur certains, des grands-mères sont moquées. A Épinal, une semaine après, devant un centre commercial, même scène mais ce sont des jeunes filles qui invectivent la foule et promettent au pays, le leur, aux sales Français, qu’elles sont, le même sort. Comment se peut-il que ces deux exemples, éloignés de plusieurs centaines de kilomètres, que des personnes dignes de foi m’ont personnellement raconté, n’illustrent pas un phénomène plus général ? C’est pourquoi j’ose dire qu’il y a un lien entre le désamour français que j’ai évoqué plus haut et ces violences gratuites à relents identitaires ou communautaires. Je ne prétends pas que ce lien soit nécessairement de cause à effet mais j’affirme que le procès instruit perpétuellement à la France est un facteur aggravant. On ne peut accréditer sans cesse l’idée selon laquelle la France s’est rendue coupable de ségrégation, d’esclavagisme, de torture vis-à-vis d’Algériens, d’Africains, d’Antillais et s’étonner après cela que des jeunes issus de l’immigration, en désespérance sociale et faute de repères, en veuillent à la France et aux Français. On n’est pas aimable lorsque l’on ne s’aime pas soi-même. Pour une réforme intellectuelle et morale Qu’est donc devenu notre pauvre pays en si peu de temps, en trente ans à peine ? Comme il est loin le temps où l’historien Pierre Chaunu pouvait écrire : «Dans l’esprit des Français, à quelque famille qu’ils appartiennent, à partir de motivations différentes, l’image de la France est gratifiante. […] La France a reçu, au ciel des mots et des entités sociales, dès le berceau, une charge affective exceptionnellement forte et vivace.» (2) Comme il est loin le temps où son Président se faisait «une certaine idée de la France», la comparant à «la princesse des songes, la madone aux fresques des murs» ! La France est un peu comme la peau de chagrin décrite par Balzac en 1831 : c’est comme si à chacune des émotions qu’elle avait fait partager, à chacune des idées et des œuvres qu’elle avait offertes au monde, à chacune des grandes choses qu’elle avait réalisées, elle avait rétréci. La France n’est plus qu’une peau de chagrin. Une pauvre peau de chagrin, une peau de misère qui n’exauce plus rien et ne fait plus rêver, une vieille peau piétinée, déchirée, brûlée. C’est comme si la France avait épuisé tout le capital de grandeur, d’exemplarité et d’amitié que la Providence lui avait accordée à la naissance.  «Nous ne nous aimons plus, voilà la chose, analyse fort justement Jacques Julliard. Comme si l’âme collective de la France, ce mythe nécessaire, était en train de se dissoudre.»(3) Je ne cesse pour ma part d’appeler à un sursaut patriotique – je dis patriotique et non pas nationaliste. Il y a quelques mois, François Taillandier évoquait auprès de moi la nécessité de constituer une Université France pour rassembler tous les esprits soucieux de définir et de redéfinir l’idée nationale. C’est bien là ce qu’il faudrait faire : une autre Académie française, non pas seulement destinée à régler la langue mais conçue pour la promouvoir et avec elle la littérature, l’histoire, la politique de la France. Pour l’instant il nous faut œuvrer à notre mesure réelle et rassembler le petit groupe de ceux qui forment aujourd’hui, dans des temps difficiles de renoncement et de haine de soi, ce qu’on pourrait appeler un conservatoire national. Ernest Renan n’écrivait-il pas à la fin du XIXe siècle : «Un pays n’est pas la simple addition des individus qui le composent; c’est une âme, une conscience, une personne, une résultante vivante. Cette âme peut résider en un fort petit nombre d’hommes» ou encore «L’âme d’une nation ne se conserve pas sans un collège officiellement chargé de la garder» ?(4) Soyons ce conservatoire, soyons ce collège ! C’est une immense réforme qu’il faut préparer en effet. Une réforme des esprits. Une réforme des consciences. Exactement, pour être fidèle à Renan, une réforme intellectuelle et morale. Sans quoi, nous n’arrêterons pas les barbares, leur bêtise crasse et leur force débile. (1) : Jean Sévillia, Historiquement correct (Perrin, 2003). (2) : Pierre Chaunu, La France. Histoire de la sensibilité des Français à la France (Robert Laffont, 1982). (3) : Jacques Julliard, Le Malheur français (Flammarion, 2005). (4) : Ernest Renan, La réforme intellectuelle et morale (éditions Complexe, 1990).
«Nous ne nous aimons plus, voilà la chose, analyse fort justement Jacques Julliard. Comme si l’âme collective de la France, ce mythe nécessaire, était en train de se dissoudre.»(3) Je ne cesse pour ma part d’appeler à un sursaut patriotique – je dis patriotique et non pas nationaliste. Il y a quelques mois, François Taillandier évoquait auprès de moi la nécessité de constituer une Université France pour rassembler tous les esprits soucieux de définir et de redéfinir l’idée nationale. C’est bien là ce qu’il faudrait faire : une autre Académie française, non pas seulement destinée à régler la langue mais conçue pour la promouvoir et avec elle la littérature, l’histoire, la politique de la France. Pour l’instant il nous faut œuvrer à notre mesure réelle et rassembler le petit groupe de ceux qui forment aujourd’hui, dans des temps difficiles de renoncement et de haine de soi, ce qu’on pourrait appeler un conservatoire national. Ernest Renan n’écrivait-il pas à la fin du XIXe siècle : «Un pays n’est pas la simple addition des individus qui le composent; c’est une âme, une conscience, une personne, une résultante vivante. Cette âme peut résider en un fort petit nombre d’hommes» ou encore «L’âme d’une nation ne se conserve pas sans un collège officiellement chargé de la garder» ?(4) Soyons ce conservatoire, soyons ce collège ! C’est une immense réforme qu’il faut préparer en effet. Une réforme des esprits. Une réforme des consciences. Exactement, pour être fidèle à Renan, une réforme intellectuelle et morale. Sans quoi, nous n’arrêterons pas les barbares, leur bêtise crasse et leur force débile. (1) : Jean Sévillia, Historiquement correct (Perrin, 2003). (2) : Pierre Chaunu, La France. Histoire de la sensibilité des Français à la France (Robert Laffont, 1982). (3) : Jacques Julliard, Le Malheur français (Flammarion, 2005). (4) : Ernest Renan, La réforme intellectuelle et morale (éditions Complexe, 1990).
15/01/2006 | Lien permanent
Conte de la barbarie ordinaire, par Sarah Vajda




28/04/2009 | Lien permanent
Lointain écho de Bossuet, par Réginald Gaillard

 À propos de Langue morte. Bossuet, de Jean-Michel Delacomptée (Gallimard, coll. L’un et l’autre, 2009).Cet article a initialement paru dans le Cahier critique des Éditions Corlevour qui publient la belle revue NuncL’on ne peut écrire sur un livre qui n’a pas, de part en part, traversé votre esprit. Aussi n’est-il de note de lecture que personnelle, intime; celle-ci le sera, a fortiori. Évoquer de manière positive un éloge de Bossuet, pour l’ancien protestant que je suis, fût-il converti au catholicisme depuis plusieurs années, demeure un geste étrange, comme si le retenait encore quelque fidélité à ses attaches anciennes, ou demeurait encore quelque rancœur à l’égard d’un de ceux qui ont combattu avec le plus d’acharnement la Réforme. Mais, en un sens, ma position est un peu celle de l’auteur de ce très bel essai consacré à l’Aigle de Meaux, un texte libre et personnel comme il convient à la collection L’un et l’autre de Gallimard : je puis dire ainsi que Bossuet «me procure, lui le censeur, cet évêque aux mots si âpres, ce cerbère lyrique de l’orthodoxie la plus stricte, une sorte de repos, d’inattendu bien-être».Delacomptée, intime du Grand Siècle, après avoir arpenté les terres de Racine, de La Boétie, d’Ambroise Paré, se penche donc sur le cas de Bossuet, ancienne gloire des lettres françaises, jadis encore si lu, aujourd’hui réduit à un simple nom. Quel lien nous relie encore à Bossuet ? S’il en est encore un, il est pour le moins ténu. Comme le titre du livre le laisse supposer, ce n’est pas seulement le latin d’église, dans lequel Bossuet disait sa messe, qui est langue morte, c’est tout – ou presque – Bossuet qui est mort. L’un de nos plus grands représentants de la langue française n’est plus qu’un cénotaphe : il reste une apparence, un nom, au mieux un souvenir, mais, derrière, il n’est aucune poussière de son corps. Et même le souvenir de sa langue s’estompe aussi; comme Delacomptée le rappelle… qu’a-t-on lu sérieusement de lui ? Quelques sermons, quelques oraisons, étudiés au lycée, ou à l’université : au mieux, et encore, notre auteur parle de sa propre génération, car, pour ceux qui sont nés dans le dernier quart du XXe siècle… Il ne lui resterait donc plus, à ce cher Bossuet, qu’«un voile de gloire, comme un succès d’estime. Il y a longtemps qu’on ne lit plus Bossuet». Car, Bossuet, c’était trente et un volumes in-octavo ! Nous n’en lisons plus que quelques centaines de pages… Et ses Mémoires, son Journal, rédigés par son secrétaire, l’abbé Ledieu n’ont pas été réédités depuis 1928; cela en dit long sur l’indifférence que soulève Bossuet : il «se dessèche sur les rayons des bibliothèques». Et Delacomptée de constater à juste titre que «tombent dans l’indifférence les astres du siècle de Louis XIV : Lully, Racine etc. dont on ne connaît plus que quelques fragments. On dit «Grand» ce siècle car il est, entre autres, l’apogée du classicisme français. Faut-il en déduire que les siècles qui suivirent ne furent que déclin ? Delacomptée n’adopte pas la pose réactionnaire; il sait que la langue de Chateaubriand, Proust, ou, plus près de nous, celle de Richard Millet n’est pas décadente. Mais la langue du XVIIe est de nos jours considérée comme la plus grande, la plus aboutie, la plus épanouie; elle reste le modèle. Et elle a trouvé sa formulation dans quelques rares esprits, dont Bossuet. Alors, l’œuvre de l’aigle restera-t-elle langue morte pour les générations à venir ? Il faut dire que toute la matière chrétienne de ses livres est aujourd’hui illisible en raison de la déchristianisation de notre société. Il convient de déceler ce qu’il a cependant encore à nous dire, nous enseigner, nous transmettre, trois siècles passés.La langue, justement, une certaine relation à la langue française. Delacomptée cite une lettre de Bossuet pleine d’enseignement sur l’usage de la langue. Voilà une leçon qui n’est pas seulement valable pour les rois, mais pour nombre d’entre nous : «…vous violez les règles de la grammaire dans vos compositions, mais nous blâmons moins la faute que le manque d’attention. Vous confondez aujourd’hui l’ordre des paroles, demain ce sera l’ordre des choses. Car en parlant contre les lois de la grammaire, vous mépriserez celles de la raison. Une langue tenue, une langue retenue, ce n’est pas l’appauvrir : c’est la gouverner pour bien gouverner. Qui la néglige, néglige sa pensée.» Et de grands écrivains ne s’y sont pas trompés : Paul Valéry, Paul Claudel, et combien d’autres, le considéraient comme un maître, et comme un chef-d’œuvre son Histoire des variations des Églises protestantes. Sur cette question du style, Delacomptée nous donne peut-être la clef : «…contraint par ses fonctions […] Bossuet s’était réservé, comme liberté propre, le style. […] C’est là qu’il se retrouvait. Il prenait rendez-vous avec la beauté pour écarter les idées funestes, se défendre de la mort en la rendant sublime par la puissance des mots».Enfin, Bossuet constitue, par sa fidélité, un modèle de comportement, car il fut, si l’on en croit le portrait que dresse Delacomptée, un homme tout entier au service de ce en quoi il croyait, un service à l’image du Christ. Au service de l’Église, de la foi, de ses paroissiens, de la couronne. L’auteur nous rappelle son engagement sur tous les fronts. D’abord dans son diocèse, en prêtre, au service des hommes, cependant que le théologien ferraillait à travers opuscules et mémoires, en défenseur âpre et farouche des dogmes, contre la Réforme, mais aussi contre ce qu’il considérait comme les errements à l’intérieur même de l’église catholique : ainsi ses controverses avec Richard Simon. Notons qu’il commit là sa plus belle erreur, car celui-ci est considéré comme le père de l’exégèse telle qu’on la pratique de nos jours. Qu’importe, l’urgence aux yeux de Bossuet était de protéger l’église, ce qui ne pouvait se concevoir sans le strict respect de la tradition. Ouvrir une brèche dans ses fondements, c’était courir le risque que s’effondre l’édifice tout entier. Bossuet, avant Dostoïevski, préférait être avec le Christ (ou du moins l’idée qu’il s’en faisait), plutôt qu’avec la vérité.Au service encore, en tant que précepteur, du Dauphin – piètre élève dont Delacomptée nous livre un portrait saisissant de dureté – semble-t-il méritée. Enfin, il nous fait ressentir la douceur de sa direction spirituelle auprès de Me Cornuau, d’Albert ou du Mans, une douceur qui retrouverait certainement son efficacité à la lecture de sa correspondance spirituelle, car les tourments des âmes ne varient pas avec les siècles.Delacomptée attise avec brio notre curiosité pour ce monument littéraire que reste Bossuet. Il met avec délicatesse en scène l’orateur sur le point de prendre la parole en chaire, et la langue de l’essayiste se plaît à épouser les accents de l’art oratoire tel que le concevait Bossuet : élevé, efficace, et non sans élégance. Ces qualificatifs pourraient être les maîtres mots de l’écriture de Bossuet, et l’on sent combien Delacomptée fut à bonne école auprès des écrivains du XVIIe. L’œuvre de Bossuet, nous promet notre auteur, est pour tout le monde : même «l’athée fatigué de la trivialité des temps» – cet athée n’est autre que Delacomptée lui-même, comme il le précise un peu plus loin – sera touché par «l’élévation de ses ouvrages». Oui, contre le «terrible poids du jour» que ressent le monde moderne, lire Bossuet et relire. Finalement, c’est une authentique vita, comme il s’en écrivait pour les saints, que Delacomptée nous offre. De la naissance, à la mort ; il nous dépeint un homme entier, non sans travers ni fautes, certes, mais néanmoins un grand homme, de lettres comme d’église, qu’il ne conviendrait pas à nos mémoires d’oublier.À ceux qui doutent encore de la grandeur de cet écrivain, de son «humanisme», comme il faut dire aujourd’hui, Delacomptée rappelle l’idée que Bossuet se faisait de l’homme, une idée qui donnerait matière à réfléchir à plus d’un, notamment à ces catholiques lefebvristes que l’on réintègre aujourd’hui dans l’église. Ainsi l’entame de sa Politique tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, le livre I, article I, proposition V annonçait en titre, parlant de l’homme donc : «Une même race : une même nation, un même genre, une souche unique». Pour cela seulement l’évêque de Meaux mériterait d’être relu. Et merci à J-M Delacomptée de nous y inviter de manière si élégante et raffinée.
À propos de Langue morte. Bossuet, de Jean-Michel Delacomptée (Gallimard, coll. L’un et l’autre, 2009).Cet article a initialement paru dans le Cahier critique des Éditions Corlevour qui publient la belle revue NuncL’on ne peut écrire sur un livre qui n’a pas, de part en part, traversé votre esprit. Aussi n’est-il de note de lecture que personnelle, intime; celle-ci le sera, a fortiori. Évoquer de manière positive un éloge de Bossuet, pour l’ancien protestant que je suis, fût-il converti au catholicisme depuis plusieurs années, demeure un geste étrange, comme si le retenait encore quelque fidélité à ses attaches anciennes, ou demeurait encore quelque rancœur à l’égard d’un de ceux qui ont combattu avec le plus d’acharnement la Réforme. Mais, en un sens, ma position est un peu celle de l’auteur de ce très bel essai consacré à l’Aigle de Meaux, un texte libre et personnel comme il convient à la collection L’un et l’autre de Gallimard : je puis dire ainsi que Bossuet «me procure, lui le censeur, cet évêque aux mots si âpres, ce cerbère lyrique de l’orthodoxie la plus stricte, une sorte de repos, d’inattendu bien-être».Delacomptée, intime du Grand Siècle, après avoir arpenté les terres de Racine, de La Boétie, d’Ambroise Paré, se penche donc sur le cas de Bossuet, ancienne gloire des lettres françaises, jadis encore si lu, aujourd’hui réduit à un simple nom. Quel lien nous relie encore à Bossuet ? S’il en est encore un, il est pour le moins ténu. Comme le titre du livre le laisse supposer, ce n’est pas seulement le latin d’église, dans lequel Bossuet disait sa messe, qui est langue morte, c’est tout – ou presque – Bossuet qui est mort. L’un de nos plus grands représentants de la langue française n’est plus qu’un cénotaphe : il reste une apparence, un nom, au mieux un souvenir, mais, derrière, il n’est aucune poussière de son corps. Et même le souvenir de sa langue s’estompe aussi; comme Delacomptée le rappelle… qu’a-t-on lu sérieusement de lui ? Quelques sermons, quelques oraisons, étudiés au lycée, ou à l’université : au mieux, et encore, notre auteur parle de sa propre génération, car, pour ceux qui sont nés dans le dernier quart du XXe siècle… Il ne lui resterait donc plus, à ce cher Bossuet, qu’«un voile de gloire, comme un succès d’estime. Il y a longtemps qu’on ne lit plus Bossuet». Car, Bossuet, c’était trente et un volumes in-octavo ! Nous n’en lisons plus que quelques centaines de pages… Et ses Mémoires, son Journal, rédigés par son secrétaire, l’abbé Ledieu n’ont pas été réédités depuis 1928; cela en dit long sur l’indifférence que soulève Bossuet : il «se dessèche sur les rayons des bibliothèques». Et Delacomptée de constater à juste titre que «tombent dans l’indifférence les astres du siècle de Louis XIV : Lully, Racine etc. dont on ne connaît plus que quelques fragments. On dit «Grand» ce siècle car il est, entre autres, l’apogée du classicisme français. Faut-il en déduire que les siècles qui suivirent ne furent que déclin ? Delacomptée n’adopte pas la pose réactionnaire; il sait que la langue de Chateaubriand, Proust, ou, plus près de nous, celle de Richard Millet n’est pas décadente. Mais la langue du XVIIe est de nos jours considérée comme la plus grande, la plus aboutie, la plus épanouie; elle reste le modèle. Et elle a trouvé sa formulation dans quelques rares esprits, dont Bossuet. Alors, l’œuvre de l’aigle restera-t-elle langue morte pour les générations à venir ? Il faut dire que toute la matière chrétienne de ses livres est aujourd’hui illisible en raison de la déchristianisation de notre société. Il convient de déceler ce qu’il a cependant encore à nous dire, nous enseigner, nous transmettre, trois siècles passés.La langue, justement, une certaine relation à la langue française. Delacomptée cite une lettre de Bossuet pleine d’enseignement sur l’usage de la langue. Voilà une leçon qui n’est pas seulement valable pour les rois, mais pour nombre d’entre nous : «…vous violez les règles de la grammaire dans vos compositions, mais nous blâmons moins la faute que le manque d’attention. Vous confondez aujourd’hui l’ordre des paroles, demain ce sera l’ordre des choses. Car en parlant contre les lois de la grammaire, vous mépriserez celles de la raison. Une langue tenue, une langue retenue, ce n’est pas l’appauvrir : c’est la gouverner pour bien gouverner. Qui la néglige, néglige sa pensée.» Et de grands écrivains ne s’y sont pas trompés : Paul Valéry, Paul Claudel, et combien d’autres, le considéraient comme un maître, et comme un chef-d’œuvre son Histoire des variations des Églises protestantes. Sur cette question du style, Delacomptée nous donne peut-être la clef : «…contraint par ses fonctions […] Bossuet s’était réservé, comme liberté propre, le style. […] C’est là qu’il se retrouvait. Il prenait rendez-vous avec la beauté pour écarter les idées funestes, se défendre de la mort en la rendant sublime par la puissance des mots».Enfin, Bossuet constitue, par sa fidélité, un modèle de comportement, car il fut, si l’on en croit le portrait que dresse Delacomptée, un homme tout entier au service de ce en quoi il croyait, un service à l’image du Christ. Au service de l’Église, de la foi, de ses paroissiens, de la couronne. L’auteur nous rappelle son engagement sur tous les fronts. D’abord dans son diocèse, en prêtre, au service des hommes, cependant que le théologien ferraillait à travers opuscules et mémoires, en défenseur âpre et farouche des dogmes, contre la Réforme, mais aussi contre ce qu’il considérait comme les errements à l’intérieur même de l’église catholique : ainsi ses controverses avec Richard Simon. Notons qu’il commit là sa plus belle erreur, car celui-ci est considéré comme le père de l’exégèse telle qu’on la pratique de nos jours. Qu’importe, l’urgence aux yeux de Bossuet était de protéger l’église, ce qui ne pouvait se concevoir sans le strict respect de la tradition. Ouvrir une brèche dans ses fondements, c’était courir le risque que s’effondre l’édifice tout entier. Bossuet, avant Dostoïevski, préférait être avec le Christ (ou du moins l’idée qu’il s’en faisait), plutôt qu’avec la vérité.Au service encore, en tant que précepteur, du Dauphin – piètre élève dont Delacomptée nous livre un portrait saisissant de dureté – semble-t-il méritée. Enfin, il nous fait ressentir la douceur de sa direction spirituelle auprès de Me Cornuau, d’Albert ou du Mans, une douceur qui retrouverait certainement son efficacité à la lecture de sa correspondance spirituelle, car les tourments des âmes ne varient pas avec les siècles.Delacomptée attise avec brio notre curiosité pour ce monument littéraire que reste Bossuet. Il met avec délicatesse en scène l’orateur sur le point de prendre la parole en chaire, et la langue de l’essayiste se plaît à épouser les accents de l’art oratoire tel que le concevait Bossuet : élevé, efficace, et non sans élégance. Ces qualificatifs pourraient être les maîtres mots de l’écriture de Bossuet, et l’on sent combien Delacomptée fut à bonne école auprès des écrivains du XVIIe. L’œuvre de Bossuet, nous promet notre auteur, est pour tout le monde : même «l’athée fatigué de la trivialité des temps» – cet athée n’est autre que Delacomptée lui-même, comme il le précise un peu plus loin – sera touché par «l’élévation de ses ouvrages». Oui, contre le «terrible poids du jour» que ressent le monde moderne, lire Bossuet et relire. Finalement, c’est une authentique vita, comme il s’en écrivait pour les saints, que Delacomptée nous offre. De la naissance, à la mort ; il nous dépeint un homme entier, non sans travers ni fautes, certes, mais néanmoins un grand homme, de lettres comme d’église, qu’il ne conviendrait pas à nos mémoires d’oublier.À ceux qui doutent encore de la grandeur de cet écrivain, de son «humanisme», comme il faut dire aujourd’hui, Delacomptée rappelle l’idée que Bossuet se faisait de l’homme, une idée qui donnerait matière à réfléchir à plus d’un, notamment à ces catholiques lefebvristes que l’on réintègre aujourd’hui dans l’église. Ainsi l’entame de sa Politique tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, le livre I, article I, proposition V annonçait en titre, parlant de l’homme donc : «Une même race : une même nation, un même genre, une souche unique». Pour cela seulement l’évêque de Meaux mériterait d’être relu. Et merci à J-M Delacomptée de nous y inviter de manière si élégante et raffinée.
16/12/2009 | Lien permanent
L'Offense de Ricardo Menéndez Salmón

 À propos de Ricardo Menéndez Salmón, L'Offense (Actes Sud, coll. Lettres hispaniques, 2009).
À propos de Ricardo Menéndez Salmón, L'Offense (Actes Sud, coll. Lettres hispaniques, 2009).Édités en Espagne par Seix Barral, deux tout récents romans de Ricardo Menéndez Salmón, Derrumbe et El corrector restent à traduire (du moins espérons-le...) en français par les éditions Actes Sud qui, comme toujours, font un travail (ne serait-ce que de relecture) remarquable. L'Offense, très court ouvrage, baigne tout entier dans une atmosphère étrange que ses toutes dernières pages font basculer dans le fantastique, lorsque le personnage principal de cet excellent texte ayant valeur de parabole, Kurt Krüwell, assiste à la projection, au milieu d'officiers allemands réunis dans une luxueuse demeure sise en plein Londres, d'un film amateur de l'armée allemande.
Ce film est celui qui rejoue la scène, dramatique, durant laquelle Kurt a perdu toute forme de sensibilité de ses terminaisons nerveuses : la mort d'une petite centaine de villageois français enfermés dans une église à laquelle le feu est mis, mesure extrême de représailles prise par un officier allemand qui a assisté à des atrocités perpétrées par les résistants contre une poignée de soldats du Reich.
Ne sachant pratiquement rien de cet auteur dont je découvre l'écriture, je ne puis qu'évoquer une autre lecture à laquelle L'Offense m'a immédiatement fait songer, ne serait-ce que par l'apparente froideur du style et le fait que le texte, certes fort discrètement, est riche de bien des références littéraires (notamment à Flaubert, peut-être à Melville, Kurt ressemblant à un Bartleby que la vision du Mal aurait sidéré) : Le Bourreau de Pär Lagerkvist.
Le communiqué de presse évoque, assez curieusement, l'exemple de Kurtz, le célèbre aventurier de Joseph Conrad devenu idole démoniaque à la source du fleuve que Marlow remonte pour rencontrer celui que, sur le continent africain, les colons européens lui présentent immanquablement comme un homme exceptionnel. Je veux croire que, plutôt qu'à la ressemblance entre les prénoms de ces deux personnages, Kurt et Kurtz, quelque attachée de presse d'Actes Sud s'est souvenue que cet auteur, nouveau dans le superbe catalogue de son employeur, a publié un essai intitulé Travesías del mal : Conrad, Celine, Bolaño (Papeles del Aula Magna de la Universidad de Oviedo, 2007) dont, hélas, je ne sais absolument rien.
Je ne vois que deux passages susceptibles d'être directement rapprochés, par leur vocabulaire (ainsi de cette Parque industrieuse rappelant les deux petites vieilles silencieuses accueillant Marlow dans les bâtiments de la compagnie qui va l'embaucher) comme par leur thématique (le vide, le jugement, etc.) de la longue nouvelle de Conrad, l'une des matrices de laquelle bien des ouvrages, pas uniquement anglo-saxons, sont sortis comme d'un chaudron de sorcières. Voici le premier de ces passages : «Car pendant que la [caméra] Paillard terminait de dérouler ses entrailles mécaniques comme une Parque industrieuse, et que dans le cœur muet de Kurt se bousculaient des émotions aussi anciennes que le monde et l’abject récit qui le nomme, l’ancien tailleur entra dans cette minute épouvantable où chaque homme doit rendre des comptes à l’éternité ou au pur néant […]» (p. 134), et le second qui nous montre Kurt quelque temps après qu'il a assisté à l'ignoble spectacle qui, étrangement, a retiré de sa chair toute forme de sensibilité : «Cette êpokhe dramatique, cette muraille levée par Kurtz entre ses terminaisons nerveuses et leur stimuli, s’avérait pour le moins aussi éloquente qu’atroce car elle constituait, toujours selon Lasalle [docteur et directeur du sanatorium Notre-Dame de Rocamadour où séjourne Kurt] – qui, ne l’oublions pas, était citoyen d’un pays occupé, pillé et humilié par une armée ennemie qui avait fait de la discipline sa vertu capitale et de la terreur son héraut le plus insigne –, le paradigme de la lâcheté européenne : depuis les annexions d’avant-guerre et la conception hitlérienne du Blitzkrieg, le continent avait plié devant le fascisme et opté pour la paralysie, une paralysie fatidique et volontaire» (p. 64).
Cette dernière image faisant de la chair de Kurt le réceptacle de l'horreur d'une époque tout entière, évoque toutefois, par le biais cette fois-ci des analyses d'Hannah Arendt, le livre de Joseph Conrad. En effet, dans une lettre de l'éminente philosophe à Waldemar Gurian datée du 30 avril ou du 1er mai 1943 (1), nous pouvons noter ce passage : «Encore à propos d'Au cœur de l'obscurité [sic] : ce que je voulais dire, c'est que pour la première et unique fois à ma connaissance, ce petit livre fait le portrait d'un «nazi». Par ailleurs, c'est un document remarquable sur l'avenir inéluctable de «l'homme blanc» sur le «continent noir». C'est dans le monumental Les origines du totalitarisme qu'Hannah Arendt évoquera le conte ambigu et fascinant de l'écrivain : «La nouveauté de la ruée vers l'or sud-africain tenait à ce que, cette fois, les chercheurs de fortune n'étaient pas nettement à l'extérieur de la société civilisée, mais au contraire très clairement un sous-produit de cette société, un inévitable résidu du système capitaliste, voire les représentants d'une économie produisant sans relâche une superfluité d'hommes et de capitaux. Les hommes superflus, «les bohémiens des quatre continents » qui se ruèrent vers le Cap avaient encore beaucoup de traits communs avec les aventuriers du passé. [...] Leur seul choix avait été un choix négatif, une décision à contre-courant des mouvements de travailleurs, par laquelle les meilleurs de ces hommes superflus, ou de ceux qui étaient menacés de l'être, établissaient une sorte de contre-société qui leur permit le moyen de réintégrer un monde humain fait de solidarité et de finalités. Ils n'étaient rien en eux-mêmes, rien que le symbole vivant de ce qui leur était arrivé, l'abstraction vivante et le témoignage de l'absurdité des insitutions humaines. Ils étaient l'ombre d'événements avec lesquels ils n'avaient rien à voir. Comme M. Kurtz dans Au cœur des Ténèbres de Conrad, ils étaient «creux jusqu'au noyau», «téméraires sans hardiesse, gourmands sans audace et cruels sans courage». Ils ne croyaient en rien et «pouvaient se mettre à croire à n'importe quoi – absolument n'importe quoi». Exclus d'un monde fait de valeurs sociales reconnues, ils s'étaient vus renvoyés à eux-mêmes et n'avaient toujours rien sur quoi s'appuyer, si ce n'est çà et là, une étincelle de talent qui les rendait aussi dangereux qu'un Kurtz. Car le seul talent qui pût éclore dans leurs âmes creuses était ce don de fascination qui fait un «splendide chef de parti extrémiste». Les plus doués étaient des incarnations ambulantes de la rancœur, tel l'Allemand Carl Peters (peut-être le modèle de Kurtz) qui admettait ouvertement qu'il en «avait assez d'être compté au nombre des parias et voulait faire partie d'une race de maîtres*». Mais, doués ou non, ils étaient «tous prêts à tout, du pile ou face au meurtre prémédité», et, à leurs yeux, leurs semblables n'étaient «rien de plus, d'une manière ou d'une autre, que cette mouche». Ainsi introduisirent-ils – ou, en tout cas, apprirent-ils vite – le savoir-vivre convenant au futur type de criminel pour qui le seul péché impardonnable est de perdre son sang-froid» (2).
Notes
(1) Archiv des Hannah Arendt-Zentrums, Cont. 10.7., citée par Antonia Grunenberg, in Hannah Arendt - Martin Heidegger, une histoire d'amour (Payot, 2009), p. 273.
(2) Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem (Gallimard, 2002), pp. 456-7, chapitre VII intitulé Race et Bureaucratie, de la partie L'Impérialisme.
01/12/2009 | Lien permanent
Le Romantisme allemand de Douglas Sirk, par Francis Moury

04/01/2010 | Lien permanent
Dans l'obscur royaume de Giorgio Pressburger

 À propos de Giorgio Pressburger, Dans l'obscur royaume (Actes Sud, 2011).
À propos de Giorgio Pressburger, Dans l'obscur royaume (Actes Sud, 2011).Rappel
Dante dans la Zone.
Dans l'obscur royaume a été évoqué par Thierry Guinhut dans la Zone et par cette note d'Éric Bonnargent, publiée sur L'Anagnoste en même temps que notre propre critique.
À tout prendre, je préfère encore lire un roman qui s'inspire plus ou moins directement, avec une réussite variable, de L'Enfer de Dante, comme La Main de Dante de Nick Toshes, La Fin des temps de Murakami Haruki, le très mauvais La Porte des Enfers de Laurent Gaudé ou le prodigieux Sous le volcan de Malcolm Lowry, plutôt que le texte inutilement savant de Giorgio Pressburger, dont l'intérêt strictement littéraire, stylistique, du moins dans sa traduction française, n'est hélas pas aussi visible que la triple gueule du Satan congelé dévorant, au fond de l'Enfer dantesque, trois pécheurs insignes.
Cette absence d'écriture digne de ce nom, toujours présente dans les œuvres de deux auteurs que nous pourrions rapprocher de Pressburger par leur caractère mitteleuropéen, Sebald et Magris, n'est pas même compensée par l'intérêt purement intellectuel que nous pourrions trouver à lire un essai déguisé bien davantage qu'un roman véritable puisque la thèse de l'auteur est pour le moins simpliste, inepte même, et ne s'explique pas seulement, espérons-le du moins, par le fait que l'auteur est né en 1937 dans une famille juive massacrée par les Nazis : le Mal n'a qu'un seul visage, celui de la Shoah longuement mûrie dans les cervelles occidentales de plus en plus malades (1), et ce cataclysme a été annoncé par des dizaines d'écrivains, tous présents dans ce livre, que l'auteur interroge sans beaucoup de talent, qu'il fait répondre d'une façon parfois ridicule sinon odieuse et dont il nous livre, au moyen de notes se voulant impartiales (et ne l'étant absolument pas), les principaux éléments bio-bibliographiques.
À quoi nous sert, à l'heure où des centaines de milliers de pages d'articles sont à notre disposition, de connaître les dates de naissance et de mort d'Hannah Arendt ou de Paul Celan si c'est pour obliger la première à défendre son amour pour Martin Heidegger (détesté, nous l'aurons compris, par Pressburger) et le second à pérorer, dans une copie pas même digne d'un élève de seconde, sur son suicide ?
Cependant, pour excessives dans leur nombre, parfois franchement ridicules dans leur contenu je l'ai dit (2) que sont ces notes, elles constituent le seul réel intérêt de ce livre, dans la relation complexe et problématique qu'elles tissent avec le récit qu'elles explicitent ou obscurcissent, dans le jeu de mise à distance ironique et polyphonique qu'elles instaurent. Certains mauvais lecteurs, petits khâgneux et professeurs ayant une âme de petit khâgneux se contentent de ce genre de maigre dialectique, vague discours second en ce sens qu'il creuse le texte premier d'une profondeur spéculaire qui ici n'est guère patente, dialectique et ruse si vite éventées qui font frémir, dit-on, les journalistes du Nouvel Observateur et de Télérama.
S'il s'agit, pour Giorgio Pressburger, d'amener ses lecteurs à lire les livres de Goethe, Trakl, Celan, Heidegger, Arendt, Benjamin, Scholem, Pound, Céline, Hamsun, Michelstaedter et tant d'autres auteurs qu'il évoque pour étayer sa thèse bancale, je ne suis pas certain que ce but ait été atteint, tant la façon dont l'auteur nous les présente est convenue, plate, artificielle, et ne dépasse guère l'empan minuscule d'un article de vulgarisation sur ces écrivains article qui, au moins, est dans son bon droit en nous donnant des éclaircissements d'ordre biographique. La vulgarisation, surtout lorsqu'elle est ratée (que dire, ainsi, de ces nombreuses incursions de Pressburger dans le domaine des sciences !) signe la mort d'un roman qui se doit de convoquer de tout autres puissances que celles de la clarté universitaire, voire de la fausse transparence, de la fausse culture propre à l'écriture journalistique.
Voici ainsi les quelques lignes où Pressburger évoque, assez lamentablement, Edith Stein, mêlant énumération sans la moindre invention des travaux de la philosophe et larmoiements œcuméniques triviaux, sans compter une attaque en bonne et due forme, qui ne brille pas par son originalité, de l'Église (3) : «Oui, je suis Edith, je suis nue devant toi. Je suis une religieuse, et pourtant je n'éprouve aucune honte. Dans une demi-heure, je ne serai plus que fumée. Ce moi dans lequel se décide chacun de mes actes libres n'existera plus, pour l'éternité. mais ce que j'ai écrit en en quoi je crois, mes études sur Husserl et sur saint Thomas, mes études sur le féminin, sur le château de l'âme, dans lequel règnent des lois différentes de celles du dehors, tout cela restera. Et il restera ma mort, qui tentera de transformer la terrible faute des assassins en bénédiction pour victimes et bourreaux. Je vais ainsi, avec ce corps qui est le mien, nu, exposé, exhibé comme le vrai, le splendide étendard de l'âme. Je vais me transformer en autre chose» (p. 114). Ailleurs (p. 53), c'est Walter Benjamin qui est évoqué pour le moins maigrement, superficiellement, ridiculement, au moyen de quelques pauvres lignes que l'on dirait avoir été recopiées d'une quatrième de (mauvaise) couverture : «Comment pensiez-vous concilier deux visions du monde aussi différentes : le matérialisme et la théologie, et la kabbale ? Votre monde s'est effondré. Dieu ne tolère pas de telles unions, et l'histoire aussi se venge sur nous».
L'aspect formel de l'ouvrage de Pressburger, que les mauvais lecteurs salueront comme un de ces tours de force que, naguère, ils évoquèrent à propos d'un roman tout juste passable, Zone de Mathias Enard, n'est pas le seul point, loin s'en faut, qui nous déplaît fortement. Il y a plus grave que la prétention, après tout délicieuse et pouvant être riche de multiples enseignements, d'un auteur à se commenter lui-même. La littérature ne craint pas le jeu, elle a juste horreur des précieuses ridicules, de ceux qui jouent sans esprit véritable de jeu. J'ai évoqué, plus haut, la question du Mal. Giorgio Pressburger, pressé de mettre en scène, à tout bout de chapiteau, la Shoah qui, si j'ai bien compris, est l'Enfer ayant dévoré le XXe siècle, ne fait en fin de compte que la diluer, en gommer l'irrévocable unicité, en la plongeant dans une mer remplie de tous les cadavres que porte la Terre depuis la création de l'homme, de la même façon qu'un assassin est, pour Pressburger, absolument semblable à tous les autres assassins (cf. p. 106) : «Je ne peux vous dire le nom de ce fleuve, c'est vous qui devez le trouver, dans votre esprit. Je ne peux vous dire que ceci : il coule partout sur Terre : au Rwanda, en France, en Serbie, en Hongrie, en Asie, en Amérique latine. il aspire et submerge une multitude de vies» (p. 31).
Cet œcuménisme de l'horreur (voir encore la page 158, faisant danser les morts du Cambodge à la Sibérie, de Sarajevo au Chili, de l'Afrique du Sud «aux dolines de Trieste»), au lieu de provoquer une salutaire réaction de colère, nous endort, alors que le Mal tel que le décrivait son plus implacable connaisseur, Dante, avait ceci de fascinant qu'il paraissait d'une prodigieuse inventivité, inventivité du reste inscrite dans les chaires mêmes des damnés, déclinée, avec une méticulosité extrême, par les tourments auxquels les pécheurs étaient condamnés jusqu'à la fin des temps.
Certes, on pourrait m'objecter que le Mal tel que Dante le décrit est finalement d'une écœurante banalité : tant de forfaits, de viols, de meurtres, de larcins, minuscules ou grandioses, tant de tortures raffinées et abjectes excoriant les chairs des condamnés qui de toute façon se réduisent à la figure monumentale et congelée, marmoréenne et animale dans sa méthodique mastication, de Satan trônant au plus profond recès de l'Enfer. Cet argument, absolument recevable, ne suffirait cependant pas à sauver l'ouvrage de Pressburger, qui, parce qu'il nous semble privé de la contrepartie lumineuse, l'ascension de la montagne du Paradis par Dante, ne peut que nous offrir un Mal non seulement monolithique mais résolument plat, d'une platitude que ne soulève aucun ferment de lumière, que ne boursoufle aucun grumeau de clarté, fût-elle aussi lointaine que fragile et, je l'ai dit, que ne sauve pas une écriture digne de ce nom.
Et cette lumière, n'est-ce pas l'écriture qui, métaphoriquement, doit signifier son lent travail à l’œuvre dans les ténèbres, puisque tout grand livre s'écrit à contre-nuit, non pas contre la nuit, mais du sein même des ténèbres ? Or, que voyons-nous dans l'ouvrage de Pressburger ? Bien des références (trop), bien des auteurs et des notes de bas de page (infiniment trop), bien des platitudes (en surnombre), mais pas la plus petite trace d'une écriture digne de ce nom qui pourrait, à tout le moins, constituer la perle parfaite d'une huître aussi grossière. Je doute même que la technique de l'association des idées si cher au maître viennois, produise autre chose que de pathétiques clichés dans le livre de Pressburger : «La femme était Marina Tsvetaïeva en personne. Marina des fleurs» (p. 201), cette évocation de la poétesse faisant suite à la traversée d'un pré couvert de fleurs...
Nous y voyons aussi la nuit dans laquelle se débattent Freud et son patient, de la noirceur, des cris et des grincements de dents, mais attendus et comme obligés par l'évocation de la Shoah, quelques intrusions dans la physique exotique des trous noirs et le physique contrefait de Stephen Hawking, leur spécialiste (note 10 page 105) et une écriture, passable (4), sans émotion autre que forcée, parfois misérabiliste, comiquement compatissante plutôt que compassionnelle, un art qui me semble incapable de figurer la quête et l'enjeu d'une délivrance, réduite, ici, à sa plus sordide expression, la guérison au terme d'une cure psychanalytique, comme si Virgile, magnifique cicérone pour Dante et annonciateur du Verbe pour Hermann Broch, avait dû céder sa place au bon docteur Freud guettant les associations d'idées dans de ridicules jeux de mots !
Comment expliquer cet échec, pour le moins flagrant, de l'écrivain ? Non pas parce que son ouvrage n'est en aucun cas un roman, ni même une fiction empruntant à plusieurs registres (poétique, théâtral, celui, aussi, de l'essai), puisque cette hétéronomie des genres a pu, chez d'autres auteurs comme Sebald, constituer une terre riche de promesses pour celui qui était désireux de la retourner afin d'en explorer les cavernes aux puits oubliés. Cet échec s'explique sans doute davantage par le fait que, dans ce livre, Pressburger fait bien plus office de pontifiant et fort partisan idéologue (5) que d'écrivain ayant pris le soin, selon ses propres mots, de «s'identifier même à ce que l'on déteste, que l'on refuse, que l'on hait de toutes ses forces» (p. 191).
Car Pressburger ne s'identifie qu'à celles et ceux qu'il a pris le soin de déclarer victimes, refusant tout net, comme nous le voyons à propos de Martin Heidegger qu'il refuse de faire parler ou même de nous montrer (évoquant ainsi, on le suppose, le mot de Husserl déclarant qu'il ne serait jamais question, dans son cours, de Heidegger), refusant tout net de ne serait-ce que prêter sa voix aux salauds ou déclarés tels.
Un tel travail, à charge, et que dire des nombreuses allusions à des théories conspirationnistes (concernant les prétendus suicides de certains des personnages évoqués), ne s'inspire que fort lointainement de l'écriture de Dante (contrairement à l'opinion qu'exprime Giuseppe Leonelli dans sa critique du livre de Pressburger parue dans la Republica du mois de décembre 2008), Dante qui, certes, a plus d'une fois condamné à l'Enfer des peines surhumaines ses propres ennemis mais qui s'est fait lui-même le juge de ses propres injustices en dirigeant son double vers la montagne du purgatoire puis les sphères lumineuses de l'empyrée, pour le purger et le purifier de toute faute.
Finalement, c'est encore l'auteur lui-même, Giorgio Pressburger, qui juge le plus durement son propre texte, déclarant (note 12 de la page 152) qu'«écrire un nom, le tirer de ses lectures et de ses informations, ce n'est pas là être écrivain, mais copiste».
Le copiste avait au moins l'honnêteté et l'humilité de ne pas révéler son identité, afin de nous transmettre le plus fidèlement possible les grands textes du passé.
Notes
(1) Nous croyons retrouver dans cette thèse si peu fondée une vieille antienne sans cesse répétée par George Steiner, rappelée, quoique d'une façon plus subtile par Sven Lindqvist dans son essai consacré à Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, Exterminez toutes ces brutes ! : «Les camps d'extermination, la barbarie du monde contemporain de l'auteur sont, selon lui, le résultat d'une longue élaboration consciente de la civilisation occidentale – gréco-latine, judéo-chrétienne et nordique», note 18 p. 24.
(2) Par exemple la vingt-sixième de la page 25, qui se présente ainsi : «J'ai faim26», la note elle-même commentant donc : «C'est l'allégorie des enfers, mais aussi des camps d'extermination réalisés par l'homme. Mais c'est aussi la condition quotidienne des deux tiers de l'humanité, actuelle et passée. Virgile le savait». Virgile savait donc, également, lui qui savait tout, qu'il figurerait dans un ouvrage aussi bavard que peu convaincant...
(3) Cf. p. 120.
(4) Je ne sais rien de l'original, en italien, traduit par Marguerite Pozzoli, mais force est de constater que telle note (la huitième de la page 123) expliquant que l'auteur a utilisé des «sonorités sifflantes et certaines vocales» afin de «faire appel à l'imagination auditive, et non visuelle, du lecteur» tombent à plat et provoquent un effet comique involontaire, puisque la traduction française n'a même pas tenté d'adapter, à tout le moins, les jeux de langue du texte original. Autre exemple, qui figure aux pages 177 et 178, où Pressburger entremêle création d'un poème, à peu près nul, et son explication, aussi raffinée qu'involontairement comique devant l'objet ridicule qui lui sert de support.
(5) Il suffit de lire les pages que Pressburger consacre aux terroristes de la Fraction Armée Rouge dont les actes pourraient nous être compréhensibles, voire excusables, à condition de lire... Macbeth, cf. pp. 188-94; il suffit de lire que le marxisme n'a pas échoué, que c'est au contraire «l'échec de ceux qui ne voient plus de chemin pour faire quelque chose de concret, à part ceci : accélérer la fin», qu'il faut stigmatiser, p. 206.
15/06/2011 | Lien permanent
























































