Rechercher : Achab (Séquelles)
Au-delà de l'effondrement, 34 : De la destruction comme élément de l'histoire naturelle de W. G. Sebald

 W. G. Sebald dans la Zone.
W. G. Sebald dans la Zone. L'Effondrement de Hans Erich Nossack.
L'Effondrement de Hans Erich Nossack. Acheter De la destruction comme élément de l'histoire naturelle sur Amazon.
Acheter De la destruction comme élément de l'histoire naturelle sur Amazon.Étrange texte que celui qui, d'abord prononcé sous forme de conférences à Zurich qui valurent à leur auteur beaucoup de courriers, parut finalement en un livre intitulé Guerre aérienne et littérature.
Étrange ou plutôt paradoxal puisque son sujet, qualifié de «nouvelle réalité sans visage» (p. 20) et de «savoir sans commune mesure avec l'entendement normal» (p. 23), échappe aux pouvoirs de la littérature, y compris, nous le verrons, lorsque l'auteur se veut purement froid et objectif : «Mais les insuffisances et les crispations de lettres et écrits divers parvenus à mon domicile ont précisément révélé que l'expérience vécue par des millions de gens dans les dernières années de la guerre, cette humiliation nationale sans précédent, n'a jamais été réellement mise en mots et que ceux qui étaient directement concernés ne l'ont ni partagée ni transmise aux générations suivantes» (1).
Toutefois, avant d'incriminer la faiblesse descriptive du langage aux prises avec l'horreur absolue, sans doute faut-il ne pas craindre d'affirmer que, comme Sebald le fait dès la préface de son texte dont la dernière partie n'hésitera pas à évoquer ses propres souvenirs d'une enfance qui connut les conséquences de la guerre, l'échec de la représentation littéraire de la guerre aérienne et de la destruction de plusieurs grandes villes allemandes tient au fait, honteux, que les écrivains de ce pays ravagé «étaient principalement soucieux de retoucher l'image qu'ils livreraient à la postérité» (p. 11). Sebald, à ce sujet, n'est jamais plus clair que lorsqu'il écrit, dans le second essai qui forme ce volume, intitulé L'écrivain Alfred Andersch, que nombre d'écrivains allemands, dont Andersch, ont compris et utilisé la «littérature comme moyen de rectifier [leur] biographie» (p. 142). Et l'auteur d'enfoncer le clou : «L'effort tenté par l'émigration intérieure pour compenser dans l'art le déficit moral par une résistance symbolique est devenu dans l'écriture d'Andersch [...], la fable du sauvetage d'œuvres d'art proscrites, qui se réhabilitent dans l'exil. Je doute qu'on puisse dire de telles fictions rétrospectives qu'elles finissent par constituer une esthétique de la résistance» (p. 143), puisque nous pouvons constater que «la corruption linguistique et la rhétorique qui tourne en rond ne sont que les symptômes visibles d'une tournure d'esprit faussée» (p. 129) que trahissent les différents textes de cet auteur dont la «vie intérieure [était] tourmentée par l'ambition, l'amour-propre, la rancœur et la rancune» si difficilement recouverts par une œuvre littéraire dont «la méchante doublure fait jour de toutes parts» (p. 144).
L'indicible, dont il est tant question dans l'essai de Sebald, porte donc un nom moins prestigieux si on le ramène aux proportions étriquées de la honte ou bien d'une peur tellement envahissante qu'elle en devient capable de masquer l'odeur de pourriture qui n'a pas pu manquer d'assaillir les survivants, qu'ils soient saints ou brigands, intellectuels ou simples ouvriers, lâches ou courageux, écrivains ou parfaits anonymes. Offusqué, Sebald constate pourtant que cette odeur pestilentielle n'a guère incommodé puisque «apparemment, ces miasmes n’ont pas atteint l’odorat des survivants restés sur les lieux de la catastrophe» (p. 18) alors qu'ils ont gêné Sebald, bien des années après que les cadavres ont été retirés de sous les ruines. Il est vrai, ajoute Sebald, que «la vie sociale» qui naît au milieu même des ruines représente l'aptitude des hommes «à oublier ce qu'ils ne veulent pas savoir, à détourner le regard de ce qu'ils ont devant eux» (p. 50).
Il y a, il doit y avoir pourtant autre chose que la lâcheté ou la peur pour expliquer l'étrange carence de témoignages fiables consacrés à la destruction presque totale de plusieurs villes allemandes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une «donnée purement immatérielle», un «flot d'énergie psychique, intarissable jusqu'à ce jour, dont la source est le secret gardé par tous les cadavres emmurés dans les fondations de notre système politique», un «secret qui a lié les Allemands dans les années de l'après-guerre, qui continue encore de les lier plus efficacement que tout objectif concret n'aurait su le faire» (p. 24) : «Même la littérature dite «des ruines», dont tant se réclamaient et qui revendiquait pour programme une vision intransigeante de la réalité, même cette Trümmerliteratur […] s’avère, à y regarder de plus près, un instrument adapté à l’amnésie individuelle et collective, vraisemblablement régulé par des processus plus ou moins conscients d’autocensure et destiné à occulter un monde dont le sens échappe» (p. 21).
Conscience, inconscience, autocensure, «refoulement» même (cf. p. 23) et mutisme (2) mais aussi, et c'est ce point qui nous intéresse puisqu'il nous permet de dépasser la seule dimension du traumatisme psychologique, événement dont le sens échappe, ne peut qu'échapper à celles et ceux qui pourtant l'ont vu de leurs propres yeux et dont les mots, s'il s'avère qu'ils en ont, seront de toute façon impuissants à tenter de donner quelque idée : «La réalité de la destruction totale, qui échappe à la compréhension tant elle paraît hors norme, s’estompe derrière des tournures toutes faites comme «la proie des flammes», «la nuit fatidique», «le feu embrasait le ciel» [etc.]. Leur fonction est de masquer et de neutraliser des souvenirs vécus qui dépassent le concevable» (p. 35).
Sebald va plus loin, en évoquant le cas de Viktor Klemperer, pourtant redoutablement armé pour connaître le sens des mots et leur portée, lorsqu'il écrit : «Même ce que Viktor Klemperer consigne dans son journal sur la fin de Dresde reste dans les limites fixées par la convention du langage. Sachant ce que nous savons aujourd’hui de la fin de Dresde, il nous paraît invraisemblable que quelqu’un qui, à l’époque, a vu des terrasses de Brühl le panorama de la ville en flammes ait pu en réchapper sans garder de séquelles psychiques. L’emploi d’une langue intacte, qui apparemment continue de fonctionner normalement dans la plupart des récits de témoins oculaires, suscite des doutes quant à l’authenticité de l’expérience dont ils gardent la trace» (pp. 35-6).
Faudrait-il donc utiliser, après l'effondrement, une langue qui se serait elle-même effondrée et, si oui, à quoi pourrait ressembler une telle langue ? Sebald ne donne pas vraiment de réponse à cette question fascinante, ne cite même pas le nom de l'écrivain que nous pourrions le plus spontanément évoquer à ce propos, Paul Celan, bien que la tentative littéraire entreprise par le grand poète déborde la seule question des bombardements alliés sur des villes allemandes.
Une autre solution est envisageable et c'est même, à vrai dire, celle que semble privilégier Sebald qui, plutôt qu'une langue effondrée ou portant la trace plus ou moins convaincante de l'événement indicible (3) (ou ayant dépassé le seuil du supportable (cf. p. 86) et les «profondeurs du traumatisme subi par ceux qui ont fui les épicentres de la catastrophe» (p. 95)) dans sa structure même, recommande d'utiliser une langue s'efforçant d'atteindre l'objectivité comme seul outil capable de rendre compte de ce qui s'est produit : «L’idéal de vérité qui, dans son récit de l’effondrement de Hambourg, se dégage du texte [de Nossack], ou pour le moins d’amples passages du texte écrits avec une objectivité dénuée de toute prétention, s’avère, au vu de la destruction totale, la seule raison légitime de continuer à faire œuvre de littérature. À l’inverse, tirer des ruines d’un monde anéanti des effets esthétiques ou pseudo-esthétiques est une démarche faisant perdre à la littérature toute légitimité» (p. 61).
J'ai moi-même évoqué le beau texte de Nossack, dans la toute première de mes notes consacrées au thème post-apocalyptique et je ne suis pas certain que cet auteur, plus qu'un autre, soit parvenu à décrire ce qui a eu lieu dans l'Allemagne toute proche d'être vaincue, l'horreur de dizaines de milliers de civils brûlés vifs, emprisonnés sous des tonnes de gravats ou condamnés à survivre comme des rats dans des ruines rapidement colonisées par une végétation étonnamment luxuriante.
En fait, c'est comme si la description directe de l'indicible ne pouvait avoir lieu selon la thèse de Günther Anders qui a forgé le terme supraliminaire pour décrire toute événement excédant nos capacités de représentation, comme si l'objectivité était de toute façon une contrainte absolument impossible à tenir (4) en pareil cas, et qu'il faille dès lors privilégier une voie torve, humble, acceptant de longer la faille sans jamais désirer plonger directement le regard dans le gouffre. C'est cette esthétique qui me semble fascinante dans certains des meilleurs textes de Kafka et, plus récemment, de celui que nous pourrions nommer l'un de ses continuateurs directs, Kertész, comme dans le texte qui s'intitule Le drapeau anglais.
Quelques pages avant la fin de son essai, Sebald livre une autre hypothèse, remarquable dans les conclusions que nous pourrions en tirer puisqu'elle admet que le langage humain ne peut de facto plus avoir cours au moment où une destruction majeure a rendu l'homme à son état naturel, l'ayant destitué de sa position éminente au sein de la création. C'est en tout cas dans le grand roman Docteur Faustus que Thomas Mann nous livre «l'histoire critique d'un art qui tend de plus en plus vers une conception apocalyptique du monde, et en même temps l'aveu de sa propre implication» (p. 54). Une telle assertion évoque à nos yeux l'exemple de la trilogie romanesque d'Ernesto Sábato, singulièrement de L'Ange des ténèbres.
C'est d'ailleurs cette lecture qu'ont retenue les responsables de l'édition française du texte de Sebald intitulé, sobrement, dans sa langue originale, Littérature et guerre aérienne, puisqu'ils ont donné à sa traduction française un titre magnifique, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle emprunté à un projet de livre de Lord Solly Zuckerman, comme nous l'indique Sebald lui-même (cf. p. 41) qui précise son point de vue sur «L'histoire de l'industrie comme livre ouvert de la pensée et de l'affectivité», se demandant si «la théorie matérialiste de la connaissance ou toute autre théorie épistémologique» reste valides «au regard d'une telle destruction, ou bien celle-ci n'est-elle pas bien plutôt l'exemple irréfutable que les catastrophes couvant pour ainsi dire sous notre main puis se déclenchant apparemment sans crier gare, dans une sorte d'expérience, anticipent le moment où, de notre histoire que nous avons crue si longtemps autonome, nous retombons dans l'histoire de la nature» (p. 74).
L'image qui annonce cette hypothèse est à cet égard révélatrice, où Sebald décrit les conditions de survie des Allemands parmi les ruines de leurs propres villes rasées jusqu'au sol : «Nous sommes dans la nécropole d’un peuple étrange, incompréhensible, arraché à son existence civile et à son histoire, régressant à l’état de tribus itinérantes vivant de la cueillette» (p. 46).
Voici donc l'hypothèse que retient Sebald sans toutefois la développer, hypothèse finalement plus intéressante que celle qui ne concerne que les traumatismes d'ordre psychologique (5) et qui infirme également une autre hypothèse, émise en tout début d'ouvrage et qui faisait de la destruction la suite logique d'un processus strictement rationnel (6) : «L’histoire de l’industrie comme livre ouvert de la pensée et de l’affectivité – la théorie matérialiste de la connaissance ou toute autre théorie épistémologique restent-elles valides au regard d’une telle destruction, ou bien celle-ci n’est-elle pas bien plutôt l’exemple irréfutable que les catastrophes couvant pour ainsi dire sous notre main puis se déclenchant apparemment sans crier gare, dans une sorte d’expérience, anticipent le moment où, de notre histoire que nous avons crue si longtemps autonome, nous retombons dans l’histoire de la nature ?» (pp. 73-4).
«Quoi qu’il en soit, il n’est pas facile d’invalider la thèse selon laquelle nous ne sommes pas parvenus jusqu’ici à faire émerger dans la conscience collective, par des descriptions littéraires ou historiques, les horreurs de la guerre aérienne» (p. 100), voici les mots par lesquels Sebald termine son essai, sans vraiment apporter de réponse satisfaisante à cette question si ce n'est, peut-être, par l'ensemble des textes qu'ils a écrits plutôt que par ce seul texte polémique, comme autant de miroirs où l'auteur, comme une espèce de Léon Bloy assagi et privé de Dieu, a pu vérifier à quoi «ressemblent les abîmes de l’histoire. Tout s’y retrouve pêle-mêle et quand on y plonge le regard, on est saisi d’effroi et de vertige (p. 81).
Notes
(1) W. G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle (Actes Sud, traduction de Patrick Charbonneau, 2004), p. 10. Le texte original date de 1999. Sans autre mention, toutes les pages citées entre parenthèses renvoient à cette édition.
(2) «Le mutisme, le repliement sur soi et l’impassibilité expliquent pourquoi nous savons si peu sur ce que les Allemands ont vu et pensé dans la demi-décennie entre 1942 et 1947. Les ruines dans lesquelles ils vivaient sont restées la terra incognita de la guerre» (p. 41).
(3) «Il est certain qu’il existe tel ou tel texte bien informé sur le sujet, mais les rares documents que nous a transmis la littérature sont qualitativement et quantitativement sans commune mesure avec les expériences extrêmes vécues à l’époque par l’ensemble de la population» (p. 77).
(4) À ce propos, Sebald écrit : «Si, pour éclairer ceux qui ont réchappé de la destruction totale avec leur vie pour tout bagage, des écrivains se réclament encore une fois, bien qu’il se soit* définitivement compromis dans la pratique sociale, de ce modèle d’une élite détentrice d’un savoir secret, exerçant une action efficace avant et au-dessus de l’État, c’est bien là le signe d’une permanence idéologique dont l’opiniâtreté dépasse leur conscience, et à laquelle ils n’auraient pu faire pièce qu’en gardant les yeux rivés sur la réalité» (p. 59). * Le texte donne «bien qu'ils se soient». J'ai donc corrigé sans pouvoir vérifier le texte allemand, l’accord devant être fait, à mon sens, avec le terme modèle, Sebald étant de fait coutumier des inversions de proposition, comme il avouera d'ailleurs qu'un de ses lecteurs lui en a fait le reproche !
(5) C'est dans la troisième partie de son essai que l'auteur évoque ses propres souvenirs, non point des bombardements alliés, mais de leurs conséquences visibles sur le paysage dans lequel le jeune enfant a grandi : «Mais peut-être ces bribes de souvenirs épars nous permettront-elles de comprendre qu’il est impossible de sonder les profondeurs du traumatisme subi par ceux qui ont fui les épicentres de la catastrophe» (p. 95).
(6) «La destruction totale n’apparaît donc pas comme l’issue effroyable d’une aberration collective mais comme la première étape de la reconstruction réussie» (p. 18).
05/09/2011 | Lien permanent
L’Amérique en guerre (32) : Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo, par Gregory Mion

 L'Amérique en guerre.
L'Amérique en guerre. «La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer.»
«La guerre en somme c’était tout ce qu’on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer.»Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit.
L’Amérique a engendré beaucoup d’enfants terribles et parmi eux se trouve l’incorruptible Dalton Trumbo, écrivain, scénariste et réalisateur, connu pour son antimilitarisme farouche et pour son opposition à toutes les dérives relatives au renforcement d’une société de contrôle. Ainsi Dalton Trumbo, dès la fin des années 1940, refusa de se plier aux enquêtes nationales qui désiraient assommer le cinéma d’Hollywood afin de prouver que cette industrie californienne était de connivence avec l’idéologie communiste. Il dut alors affronter une longue traversée du désert, vivre et travailler comme un clandestin, mais ses convictions et sa créativité ne diminuèrent d’aucune façon et il fut réhabilité en 1960 par Otto Preminger et Kirk Douglas, à travers un mouvement d’intelligence qui rappelle la divine réhabilitation de David Rousset après l’assimilation tant attendue des écrits d’Alexandre Soljenitsyne en France métropolitaine. C’est du reste au début des années 1970 que Dalton Trumbo connaît une sorte d’apothéose, lorsque son film Johnny s’en va-t-en guerre reçoit le Grand Prix du jury à Cannes, une œuvre tirée du roman éponyme que son réalisateur avait publié en 1939 et qui fustigeait les faiseurs de guerre, les scélérats de la politique, les roublards opportunistes du Mal qui ont mené à l’impensable massacre de 14-18 où les crucifiés du champ de bataille, du premier jusqu’au dernier, auront été tués sur des millions de Croix Inversées absurdement dressées entre deux fronts presque immobiles, entre deux camps misérablement tisonnés par des esprits criminels exploitant la crédulité humaine. Bien évidemment nous voulons plutôt mettre en lumière les qualités de Johnny s’en va-t-en guerre dans sa version romanesque (1), dans sa fatalité de livre pacifiste paru au commencement d’une autre guerre mondiale, dans sa fatalité de texte résistant dont même la version cinématographique, trois décennies plus tard, devra se heurter à une nouvelle ambiance belliqueuse – celle de la guerre du Vietnam. On aurait donc raison de faire de Dalton Trumbo un intempestif, un homme remontant le courant de son siècle pour comprendre sa source infernale et pour éviter sa mortelle embouchure, un homme qui, dans le sillage d’un Louis-Ferdinand Céline, a définitivement catalogué la guerre sous les attributs d’une «immense» et «universelle moquerie» (2), sous les aspects d’une «foutue énorme rage qui poussait la moitié des humains, aimants ou non, à envoyer l’autre moitié vers l’abattoir» (3).
Deux préfaces – l’une de 1959 et l’autre de 1970 – éclairent les intentions de l’auteur et surtout ses désarrois (cf. pp. 7-15). Tout d’abord Trumbo insiste sur la dimension romantique de la Grande Guerre, sur le fait que ce conflit s’est amorcé le sourire aux lèvres, avec des scènes de liesse publique, dans une espèce d’enthousiasme morbide qui modifiait la courbe relaxante et peut-être lassante de la Belle Époque, nuage noir venant rompre la monotonie d’un ciel immaculé. Cette euphorie populaire ne reflète cependant que la manipulation orchestrée par les autorités politiques, les discours aménagés par les «scholars of war» (4), spéculateurs professionnels en temps de détresse et soucieux de «mordre assez profondément dans les personnes et dans les choses» (5) par l’intermédiaire d’un fructueux casus belli. Là réside en outre le nerf de la guerre si l’on peut dire : la mise en place d’un état d’esprit exalté dans la soldatesque et dans les familles n’a pour but que de cacher la mise en place d’une entreprise strictement économique au sein des inaccessibles bureaux décisionnaires des nations belligérantes. Les enjeux de l’argent n’ont jamais été aussi importants que pendant les longs mois d’anéantissement qui ont assombri le monde entre l’été 1914 et l’automne 1918. Des puissances financières combattaient dans l’abstrait en parallèle des douteuses et concrètes batailles qui ensanglantaient les terres d’Europe, et l’appât du gain, ici et là, entérinait le mot ultérieur de Simone Weil qui devait faire de l’argent «le passe-partout de la puissance» (6), la tumeur maligne capable de vaincre tous les tissus vivants de la civilisation, la clé diabolique destinée à verrouiller tous les liens nécessaires, tous les échanges indispensables, tout ce qui peut contribuer à incarner un «échelon vers Dieu» (7) – un metaxu. Et dans la seconde préface, rédigée en guise d’addendum aux réprimandes initiales, l’infatigable Trumbo rejette en bloc l’ignominie du Vietnam. Il s’agit d’un maléfique prolongement des causes et des raisons qui ont fabriqué la Grande Guerre – un tourbillon d’argent et de fatuités politiciennes – et qui astreint désormais la jeunesse américaine à une alternative insoutenable : croupir dans une cellule de prison aux États-Unis (par refus de s’engager) ou finir dans un cercueil au fin fond de l’Asie (par le biais d’une irréductible létalité).
Le cas fictif – mais ô combien révélateur des souffrances injustifiables et véridiques de la guerre ! – de Joe Bonham, à savoir le pauvre Johnny expédié au carnage et créé par l’imaginaire de Dalton Trumbo, concentre à lui tout seul l’accumulation des horreurs déchaînées par la rupture calculée ou convulsive de la paix. Qu’elle soit argumentée ou suscitée par un irrépressible déluge de pulsions barbares, la guerre n’est jamais autre chose qu’un échec flagrant de l’humanité ou un démenti radical de nos facultés d’avoir supplanté le règne de l’animalité en nous-mêmes. Blessé au-delà de toute gravité médicale au mois de septembre 1918, le G. I. Bonham, d’emblée, apparaît comme l’héritier en naïveté de son paternel puisque celui-ci, apprend-on, n’a pas été exaucé par le rêve américain faute d’en avoir intégré les divers éléments de brutalité morale. De l’aveu même du fils mutilé qui gît dans un lit catastrophique de douleurs et de séquelles incurables, depuis les lointains foyers d’une mémoire qui constitue son ultime rapport au monde des vivants, l’enfant Bonham, donc, se souvient du corps étendu de son père, de cette défunte silhouette vaincue par une société trop cannibale, préfiguratrice de sa propre défaite de troufion dupé, de jeune homme bradé aux encycliques de Satan, et il émet cette touchante conclusion : «Je suis désolé pour toi papa. Tu n’as pas bien réussi dans la vie et tu n’aurais jamais bien réussi et il vaut mieux que tu sois mort. Il faut être plus vif et plus dur de nos jours que tu ne l’étais papa» (p. 24). Ainsi l’impotente progéniture se ressouvient de son géniteur tombé au combat de la lutte sociale accrue et ces deux emblèmes de l’écroulement – père et fils – s’enlacent en une seule et même allégorie de l’innocence américaine perdue. Le père a été fidèle aux idéaux de l’Amérique originelle, fondée par une brillante association de cerveaux exceptionnels, et le fils, en héritage, a poursuivi les principes d’une sublime patriarchie qui n’a pas su anticiper les désastres successifs de la guerre civile, du capitalisme sacralisé et le choc, le douloureux choc de la guerre mondiale en 1917, le scandale de l’équilibre national reconquis après la Sécession et brisé par le déséquilibre extérieur d’une Europe aux abois, tout cela participant de ce que l’historien Henry Farnham May a justement nommé la fin de l’innocence américaine. D’une certaine manière, l’état de grâce américain a duré environ jusqu’à la moitié du XIXe siècle, puis l’ordre ancien s’est peu à peu désintégré dans les tensions raciales et les conquêtes d’argent, ruinant l’idéalisme des Pères fondateurs, ruinant par ailleurs la confiance d’un peuple qui s’est senti dérangé, voire mystifié, au moment où le président Wilson a défendu l’entrée en guerre des États-Unis en citant l’urgence de se battre pour le modèle démocratique, pour la liberté et pour le droit universel, autant de phrases ronflantes émises par un homme a priori pacifique et cherchant à valider son basculement dans une ordonnance guerrière. Or ce que Dalton Trumbo a l’intention de faire avec son livre à la fois provocateur et révoltant, c’est de condamner, sans la moindre ambiguïté, l’outrecuidance des grands discours qui défendent l’indéfendable en usant d’une fibre missionnaire et dont les pseudo-principes ne font qu’ajouter du malheur au malheur, ne font que proposer des remèdes qui accentuent le Mal car gagner la guerre, pour les États-Unis, ce n’est pas vraiment rétablir la paix mondiale mais plutôt s’assurer une position de dirigeant planétaire afin de préparer d’autres guerres, afin de semer plus librement la malédiction des intérêts économiques tout en s’épargnant un cataclysme intramuros visible (mais en ne reculant pas devant le recrutement national de centaines de milliers de bidasses, l’enrôlement de millions d’hallucinés par le visage hallucinogène de l’Oncle Sam, en vue, naturellement, de nourrir la Machine de Guerre qui n’est autre que le terrifiant synonyme de la Machine du Capital).
Tout cet effondrement moral de l’Amérique, nous le découvrons depuis le lit d’hôpital de Joe Bonham, depuis l’étrange perspective d’un Américain qui n’est plus qu’une matière cérébrale active reposant au sein d’une matière corporelle désactivée par un degré d’infirmité qui dépasse toute proportion admise. C’est pourquoi les chapitres du roman procèdent à une sorte d’alternance entre une collection inaltérée de souvenirs et l’auto-description d’une conscience qui se rend progressivement compte de l’horreur de la situation. En effet Joe Bonham est devenu sourd à cause du fracas d’un obus, mais, de surcroît, il est devenu aveugle et muet, délesté de sa physionomie faciale et de sa sensibilité correspondante, privé, par conséquent, des singularités du visage que Levinas considérait à l’instar d’une épiphanie de l’humanité, réduit à une gueule cassée, à une insupportable grimace, à quoi il faut adjoindre une amputation des quatre membres qui laisse l’infortuné fantassin dans une invivable condition de tronc de chair surmonté d’une tête démolie, un contexte de totale dépendance où sa vie et sa mort appartiennent exclusivement à un dispositif clinique (après que sa vie de soldat a été la propriété intégrale de la sournoise volonté politique). Tant et si bien que la vie de Joe Bonham n’est plus une vie, elle n’est qu’une apparence de vie suspendue aux exploits médicaux et aux aberrations de l’acharnement thérapeutique (cf. pp. 119-120 et 207), et pourtant, quelque part dans les abysses de ce corps brisé, la flamme de l’esprit brûle d’une lucide colère et d’un appétit de communication avec l’univers des vivants. Il y a également des fractions de ce corps qui sont encore en capacité de ressentir qu’on les touche, qu’on s’agite autour de cette masse inerte ou presque, réceptives aux mains des infirmières et aux vibrations des déplacements environnants. Ce sont en outre ces fragiles accointances avec la dynamique de la vie qui maintiennent Joe Bonham à distance de la folie et qui le préservent de succomber aux ténèbres du «terrible silence» (p. 129) caractérisant son destin quasiment végétatif, un destin beaucoup plus sombre que celui que décrivait Faulkner dans Monnaie de singe en explorant le mystère du soldat Donald Mahon, lui aussi comateux, lui aussi défiguré par la guerre, mais dont le corps devait garder une configuration et une mobilité acceptables.
Cela dit, au début de sa résurgence parmi les impressions conscientes, la confirmation de la surdité ne gêne pas réellement le vétéran Bonham (cf. p. 28). Le fait d’être sourd le dispense du vacarme de la noire symphonie d’un monde en guerre. Et tandis que l’acoustique le fuit, tandis que la débauche martiale du présent le tient à l’écart et que les espoirs d’une ataraxie future ne sont pas même envisageables, Joe Bonham se réfugie dans le demi-jour du passé, retrouvant les silhouettes de ses parents, les amours naissantes de son père et de sa mère, les douces aspérités de son enfance vécue dans le Colorado. Néanmoins ce clair faisceau de sa mémoire ne peut pas éviter l’obscurité d’un passé plus récent, le passé de la tranchée, le passé de la mort omniprésente qui vient s’intercaler au milieu de ses réminiscences apaisantes. Ainsi la remémoration de son enfance le ramène à ce moment magique où le bon peuple du Colorado fut témoin de l’atterrissage du premier aéroplane, où les ahurissements étaient nombreux devant la prouesse technique, rappelant du reste les tableaux faulknériens de Pylône et quelques autres vrilles spectaculaires colligées dans Sartoris. Et ce vestige mémoriel de l’enfant ébahi se complète d’un vestige sonore où le petit Joe se ressouvient des mots de «l’inspecteur des écoles» (p. 39), de l’allocution passionnée de M. Hargraves, de l’apologie du Progrès où il était question de souligner le potentiel pacificateur de l’aéroplane, la promesse inhérente à la machine volante qui permettrait à l’avenir de réduire «les distances entre les nations et les peuples» (p. 39), de créer un large supplément de liaisons humaines durables par les moyens d’une contraction spatiale toujours plus convaincante. C’était là une chimère qu’on aurait pu adosser aux balbutiements de la physique relativiste où toute espèce de plissement de l’espace devait engendrer une dilatation du temps, où le pli de la Terre entière devait supposer un concorde éternelle, mais, la guerre étant à l’horizon de l’Occident chaque fois que le Capital a besoin d’un catalyseur, la science de l’aviation et la science en tant que telle, inévitablement, n’allaient pas pouvoir s’empêcher de se détourner des conséquences fastes pour s’engouffrer dans les conséquences néfastes, la paix n’étant pas aussi intéressante que la guerre quand il s’agit de sauter sur les occasions de s’enrichir et de bâtir de rapides monopoles (cf. pp. 34-45). On est donc attristé du contraste qui existe entre l’enfant-Joe qui revoit les merveilleuses chorégraphies de l’aéroplane et le Joe-dénaturé qui tire les conclusions qui s’imposent vis-à-vis des perverses connivences qui unissent la marche en avant des sciences et l’idéologie de la guerre – tel un paroxysme de ce que Schumpeter a pu baptiser la destruction créatrice pour déduire le cycle naturel du capitalisme. Qu’est-ce à dire sinon que l’enfant pensait que son monde fantastique était indestructible et que sa vie d’adulte continuerait selon les mêmes formes d’émerveillement ? La désillusion s’est par ailleurs manifestée précocement : l’adolescence de Joe a été perturbée par l’énormité de la rumeur venue d’Europe, par la débâcle qui faisait rage là-bas et qui ne cessait d’induire de louches attirances en Amérique, par tout ce sang versé à l’autre bout de l’ancien monde et dont les flots épouvantables envahissaient l’océan et finissaient par rejoindre les sacro-saints rivages du Nouveau Monde. Par la suite, ce qui a positivement bouleversé les repères de Joe, c’est la participation de la Roumanie à ce saccage continental et bientôt international, l’implication inattendue de ce pays si exotique et si inconnu dans son imaginaire de novice (cf. p. 44), la maudite compromission d’une contrée si reculée qu’on a de la peine à se la représenter à l’avant-poste du naufrage, capable même, peut-être, d’envoyer à la conscription la légende vampirique du château de Bran afin de sucer les sangs de l’ennemi. Alors «son père mourut et l’Amérique entra en guerre et il dut y participer et voilà où il en était» (p. 45), le voilà mûr pour l’embrigadement, pour la collaboration à l’effort de guerre, pour la trahison de sa liberté malgré toute sa réserve à l’égard des arguments interventionnistes. À ce stade de ses introspections, l’intime conviction de Joe pourrait se résumer comme cela : dès que les États-Unis ont rallié la sarabande ignoble de la guerre en 1917, la vérité de l’innocence – fût-elle une innocence résiduelle – a été anéantie au profit du mensonge mondial de la démocratie soi-disant menacée de mort.
La guerre aura presque tout pris à Joe Bonham (hormis son indignation et sa fureur de la transmettre) : elle lui aura pris son apparence et elle aura dévoré une grosse quantité de son essence – et même son amour. À la veille de traverser l’Atlantique, Joe entretenait une relation avec Kareen, sa fiancée de dix-neuf ans. Il l’aimait comme Apollinaire aimait Lou (8) à l’heure de la mobilisation générale. Le gâchis de cet amour est d’autant plus cruel que Joe se rappelle une parenthèse de tendresse où son bras gauche avait servi de coussin protecteur à Kareen (cf. p. 57), ce bras gauche maintenant disparu (cf. pp. 48-50), son bras droit également (cf. pp. 62-3), ses jambes à l’avenant (cf. pp. 91-2), tous ses atouts de délicatesse amputés par une objective chirurgie militaire qui n’a aucune sorte de prévenance pour les chocs subjectifs qu’elle inflige. Dans le cas particulier de Joe, il fallait opérer coûte que coûte, repousser les limites de la traumatologie, profiter du fait que l’éclat de la bombe n’avait pas touché «la veine jugulaire et l’épine dorsale» (p. 116). La chirurgie se révèle ainsi moins guérisseuse qu’aggravante : elle prolonge la guerre en dépossédant le soldat de plusieurs parties de lui-même et en lui adjugeant un corps tout juste bon à remplir une fonction respiratoire qui donnera au Capital le droit d’affirmer que la guerre n’est pas tout à fait meurtrière, que des hommes en réchappent, que des héroïsmes s’y forgent. Au fond la chirurgie des blessures de guerre est une soustraction du physique achevant le processus de soustraction psychique induit par l’inquiétante fréquentation du champ d’honneur où l’humanité se déshonore. Tout cela découle d’une législation illégitime de la guerre qui vient se substituer à la loi non écrite et légitime de l’amour, à l’ordre juste du Lien, à la douceur de ce qui est transitif, et dans de telles conditions de renversement de l’Union par le fanatisme de la désunion politiquement organisée, la terre que les hommes sont censés avoir en partage ne peut devenir qu’une tromperie, une monumentale et mauvaise plaisanterie (cf. p. 60). Et le rire de cette plaisanterie est si ma
04/02/2023 | Lien permanent
Le Monstre de Stephen Crane, par Gregory Mion

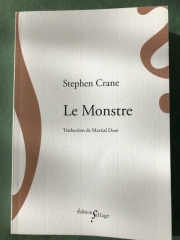 «En ces régions près de la mer la brume accompagne la tombée du jour et je me souviens d’avoir effrayé les enfants qui sortaient du pastorat.»
«En ces régions près de la mer la brume accompagne la tombée du jour et je me souviens d’avoir effrayé les enfants qui sortaient du pastorat.»Guy Dupré, Les Fiancées sont froides.
Lorsque Stephen Crane fait paraître Le Monstre (1) en 1898, il ne lui reste que deux ans à vivre. Il ne lui aura pas fallu plus d’une décennie pour remplir éperdument des milliers de pages et pour devenir un solide minerai de la littérature américaine. Récemment, d’ailleurs, Paul Auster lui a consacré une ample et belle biographie (2) où il redonne à ce prodige originaire du New Jersey une largeur d’épaules pleinement méritée. Celui qui fut journaliste à la ville comme à la guerre, poète et romancier, ami de Joseph Conrad et d’Henry James à la faveur de ses stations en Angleterre, celui-ci, ce jeune garçon que la mort attendait dans sa vingt-neuvième année au coin sud-ouest de l’Allemagne, ce Rimbaud du Garden State, donc, devait avoir une influence sur Ernest Hemingway et sur tant d’autres écrivains de sa patrie dont l’économie stylistique se justifie par la remarquable envergure d’une vision qui n’a pas besoin de simagrées pour frapper les sens.
Il n’y a pas de textes démesurément longs dans le répertoire de Crane, pas non plus de phrases filiformes, mais le torrent n’en est pas moins là, infatigable et redoutable, tonitruant déluge métaphysique emportant le lecteur dans une incroyable dimension de la connaissance universelle. Il ne semble pas qu’il existe un illustre problème de la vie humaine que Stephen Crane aurait manqué de poser ou négligé de soupçonner. Il a tant vécu avec la mort aux trousses que chacun de ses écrits fut pour ainsi dire le testament d’un enfant précoce impatient de nous révéler une partie de ses idées. Or quiconque a traversé le petit empan de sa longévité créatrice avec la mort pour meilleure amie a toujours eu plusieurs coups d’avance sur l’échiquier de l’expérience et de la compréhension du monde. En effet, quand on jette un œil rétrospectif sur l’existence d’une certaine jeunesse littéraire fauchée en plein vol par la maladie, le suicide, l’accident, l’homicide ou par toutes les versions de la tragédie que l’on voudra bien recenser, on s’aperçoit que le dernier jour de ces météores est la cause de tous les jours précédents, comme si la mort violente ou douloureuse, prématurée de surcroît, avait été constamment devinée, prédisposant ces futurs martyrs des agonies ingrates à s’infliger une espèce de martyre consonant parmi les inconfortables gradins de l’écriture la plus décisive. Un même anneau d’intuitions et d’urgence à les traduire en langage romanesque ou poétique unit donc Stephen Crane, Thomas Wolfe et Sylvia Plath sur sa périphérie, pour ne sélectionner ici qu’une trilogie d’identités flagrantes, un trio de vies américaines abrégées, un triptyque humain entièrement aiguillé par l’épreuve de la mort imminente et dont les livres sont de pures encyclopédies des grandes questions qui agitent l’honnête homme.
Avec Le Monstre, «la plus puissante et complexe de ses nouvelles» (3) selon Paul Auster, le génial Stephen Crane propose une courte mais intense radiographie de la mauvaise conscience de son pays. Le décor est planté au sein de la modeste cité fictive de Whilomville (New York), réplique imaginaire de Port Jervis où Crane a passé de nombreux moments de son enfance. L’histoire qu’il raconte serait inspirée par le lynchage d’un Afro-américain qui a endeuillé Port Jervis en 1892. D’autres sources évoquent la présence d’un groupe d’hommes défigurés dans cette même ville et souffrant d’une réprobation tacite. La désolation existentielle de ces malheureux aurait impressionné Crane. En outre, Paul Auster rapporte un événement de Port Jervis où deux vétérans de couleur, un 4 juillet de la fin des années 1870, ont été grièvement blessés à la suite d’un coup de canon festif qu’ils étaient chargés d’opérer. L’un de ces hommes a vite succombé à ses blessures mais l’autre a survécu, non sans être affligé de séquelles importantes au niveau du visage. Il apparaît ainsi que ces trois circonstances de la défiguration, qu’elles soient respectivement impliquées par le racisme, la nature ou le coup du sort, ont probablement semé dans l’esprit de Stephen Crane les semences de son propre monstre et surtout les compromettantes ramifications d’une société monstrueuse incapable de négocier avec ce qui bouleverse le socle janséniste de ses normes.
De sorte que le parcours d’Henry Johnson dans Le Monstre constitue la synthèse des persécutions physiques et psychologiques susmentionnées. Homme de couleur également, le personnage inventé ou reformulé par Stephen Crane cumule deux rameaux de la monstruosité, deux variantes d’une tératologie qui vont devenir absolument réciproques : d’une part il est déjà observé d’une manière latente comme un être contre-nature en raison de sa peau noire, et, d’autre part, la décomposition de son visage pendant un incendie va définitivement le reléguer parmi le camp retranché des disgraciés. La laideur morale induite par la couleur de sa peau sera calamiteusement homologuée par les conséquences de l’incendie qui a ravagé la maison du docteur Ned Trescott, son employeur et son protecteur. On a même la conviction que l’opinion n’attendait qu’une franche opportunité pour transformer la virtualité de sa haine vis-à-vis de Johnson en réelles manifestations d’hostilité. Les préjugés et les lois se sont délivrés de beaucoup de leurs hypocrisies en s’adossant aux réactions viscérales inférées par la transgression des lois de la nature. En d’autres termes, il a fallu que l’apparence physique d’Henry Johnson se dégrade subitement pour que la dégradation des mentalités se trouve un alibi en béton. Le dégoût indirect motivé par les préjugés racistes a rencontré son commode prolongement par le biais du dégoût direct motivé par un visage mutilé. Une aveuglante différence corporelle alourdit la charge d’une autre différence du même ordre (la peau noire) et légitime peu à peu l’inégalité devant les lois explicites et implicites sinon de toute une nation, du moins de toute une ville. Parce qu’il est noir et défiguré, Henry Fleming doit être logiquement inférieur à tous les étages de la société américaine. On ne le reconnaît plus en tant que citoyen dans la mesure où son visage a objectivement disparu. Et d’un point de vue subjectif, on ne reconnaît en lui que le monstre, on ne perçoit de lui que le contrevenant à toutes les lois juridico-naturelles, on ne voit que les agrégats d’une morphologie en lambeaux dont la calcination faciale a sévèrement compliqué la destinée de son propriétaire. Il n’est plus qu’un monstre au carré dont la situation sur Terre s’avère plus invivable que celle de John Merrick, l’Homme-Éléphant que le chirurgien Frederick Treves a émancipé de son infortune en 1886 en l’arrachant des griffes d’un forain qui l’exploitait comme phénomène de foire (4).
Cela dit, eu égard à l’une de ces coïncidences textuelles dont raffolait un W. G. Sebald et que d’aucuns auront déjà relevée, c’est aussi un médecin qui sauve en maigre partie – et passagèrement – Henry Johnson d’une totale extermination de sa mémoire et de son corps. Pourquoi du reste cet acharnement de Ned Trescott à vouloir préserver son misérable palefrenier de l’irréversible infamie qui s’est abattue sur lui avec la vigueur d’une foudre infernale ? Sans aucun doute parce que Johnson a sauvé l’enfant du docteur d’une mort assurée dans les flammes lors du terrible incendie. Mais il est indispensable de créditer ce médecin par d’autres voies que les simples et prévisibles actions de la gratitude. À l’inverse de tous ses voisins et même de sa femme, à l’inverse de tout un peuple qui ne parvient pas à digérer le vieux schisme de la guerre civile et le déplacement symbolique de la malédiction ségrégationniste au plus profond de sa conscience, le docteur Ned Trescott ne se laisse pas envahir par la majorité oppressive et par les survivances d’un nationalisme morbide. Il a sûrement compris que la monstruosité se dissimule ailleurs que sur la personne crucifiée d’Henry Johnson, d’autant qu’un médecin, de surcroît, conserve en général un calme olympien au contact des pires difformités. Ce qui est radicalement monstrueux, en fin de compte, c’est la conversion néfaste de l’héroïsme en nouveau péché capital, la destitution volontaire d’un acte courageux et la fabrication simultanée d’une mauvaise réputation, tout cela en vue de cacher les répugnantes exhalaisons d’une certaine conscience américaine. Dès lors, au lieu d’accuser frontalement un Noir d’avoir osé marcher sur les plates-bandes d’un héroïsme qui eût mieux convenu à un Blanc, la foule nourrit le prétexte du monstre afin d’entériner un rejet qu’elle n’avouera jamais précisément et à dessein de mieux s’exercer au pantomime d’un rejet charnel très arrangeant. On répète ici et là que Fleming effraie les enfants, les vieillards et toutes les âmes nobles à cause de son apparence ignoble, on construit un discours public accommodant avec les valeurs du troupeau fascisant, mais on ne désire nullement mettre en évidence la vérité potentielle de cette répulsion organisée. Peu d’entre ces gens ordinaires et si représentatifs de la banalité du Mal auraient eu l’audace de pénétrer dans l’enfer de l’incendie pour secourir un petit garçon promis à une mort atroce. Or il est inacceptable qu’un Noir ait eu l’impudence de réussir là où l’homme blanc de ces quartiers tranquilles eût vraisemblablement échoué.
D’une façon encore plus préoccupante, le comportement de la multitude rancunière tient de l’emprise, comme si la somme de ces individus était le reflet d’une parole négativement transcendante issue d’un Grand Inquisiteur dostoïevskien qui aurait emménagé en Amérique du Nord après avoir atomisé l’Espagne d’antan. Les notions de tolérance et de charité pourtant archi-communes aux églises américaines ont visiblement été remplacées par des dogmes qui menacent les fondations de l’humanité. Le bannissement qui touche Henry Johnson de plein fouet procède d’un renversement des piliers religieux et du renforcement d’un culte profanateur. Les rues et les demeures de Whilomville se sont possiblement détournées des repères sacrés de jadis (whilom and holy commitments) pour adopter un arsenal inédit de préceptes inhumains. Ce n’est pas tant que l’Église a disparu – car elle subsiste sous sa forme architecturale – mais elle paraît avoir détruit ses principes historiques au profit d’un fonctionnement sectaire et diablement épurateur. Le regard du Christ qui n’aurait pas omis d’embrasser une brebis égarée comme Henry Johnson s’est complètement éclipsé du centre et des faubourgs de Whilomville. Désormais ne se fomentent ici que des fausses communautés où la pratique religieuse a été dévoyée en stratégies de purification et en modèles politiques embryonnaires qui s’apprêtent à contaminer l’univers et spécifiquement la vieille Europe, toujours nostalgique de ses inquisitions, toujours hallucinée par les relents persistants de son trouble passé. Ce que l’on reproche à Henry Johnson, c’est son éclatante innocence, son mirobolant sacrifice, sa Croix érigée au milieu d’une capitale du ressentiment, et, pour cela, on lui prépare un second bûcher après le premier bûcher accidentel qui l’a estropié. Toutefois, ce que l’on souhaite par-delà l’imminente extermination de Johnson (que Crane ne décrit pas mais qu’il présage avec un sens inouï du signe annonciateur), c’est, indubitablement, un nuisible royaume de la masse, l’affirmation d’un grégarisme de la soumission aux pieds de l’Impuissance et d’un grégarisme de la répugnance envers toute réelle Puissance. À cet égard, on se rend tout à fait compte que l’homme noir, pour ces néo-fascistes de l’État de New York, cristallise l’ensemble des attributs de la lumière divine et qu’il est donc impératif de le discréditer au plus vite. Et bien qu’ils aient affaire à un homme noir défiguré et cognitivement diminué, celui-ci n’en est que davantage haï du fait même que ses afflictions renvoient nécessairement à l’élévation, à la gloire, à la promesse d’un relèvement dans l’œil omniscient de Dieu.
Il est par conséquent facile de comprendre que cette chronique locale mise en scène par Stephen Crane déborde la sphère géographique d’une bourgade ordinaire de l’État de New York et qu’elle investit un champ de problèmes philosophiquement vertigineux. À lui seul, le personnage d’Henry Johnson est une dialectique de la persécution et une éventuelle résurrection du Christ. Quant aux insistances du docteur Ned Trescott, elles se développent à l’instar d’un baroud d’honneur, d’un refus provisoire de capituler, preuve que la démocratie en Amérique ne s’est pas encore totalement changée en citrouille ou en despotisme visqueux. En outre, les tensions relatives au poumon urbain de Whilomville semblent héritées d’une matrice européenne peu reluisante, une matrice incubée depuis la construction de la nation américaine au XVIIIe siècle et relancée selon des tropismes autochtones inséparables de la Guerre de Sécession, une matrice, finalement, déployée sur plusieurs décennies hantées par le spectre de l’esclavage légal ou excusé, aboutissant aux plus abominables et irrémédiables désunions sous le patronage d’un concept unioniste captieux. C’est la raison pour laquelle les scandaleuses étapes de la répudiation d’Henry Johnson sonnent en quelque sorte le glas de l’Amérique et anticipent le retour de ce Mal matriciel sur le Vieux Continent, comme si la cité de Whilomville avait fait l’objet d’un jumelage politique avec d’anciennes cités espagnoles et que le ténébreux résultat de cette alliance durable, culminant avec le triste dénouement sous-entendu par Stephen Crane, s’apprêtait à migrer séance tenante sur le territoire européen pour féconder cette terre babylonienne en usant d’un sexe démoniaque et parfaitement aguiché.
Notes
(1) Stephen Crane, Le Monstre (Éditions Sillage, 2021), traduction de Martial Doré.
(2) Paul Auster, Burning Boy.
(3) Ibid.
(4) Frederick Treves, Elephant man. C’est à partir de ce récit que David Lynch a bâti son film éponyme.
09/02/2022 | Lien permanent
L’Amérique en guerre (30) : L’invaincu de William Faulkner, par Gregory Mion

 L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.
L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.«Est-ce que ça pleure, un colonel ?»
Gilbert Cesbron, Notre prison est un royaume.
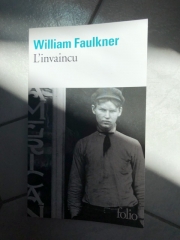 La lecture de L’invaincu (1) permet de remonter dans le temps de la famille Sartoris et de découvrir ce que furent l’enfance et la jeunesse de Bayard Sartoris, celui-là même qui succombera environ quatre décennies plus tard d’une crise cardiaque dans la voiture de son petit-fils après une effrayante sortie de route (2). Réchappé des balles perdues de la guerre de Sécession et des tensions de la Reconstruction au milieu d’un Sud exsangue et vindicatif, Bayard Sartoris, toutefois, ne l’aura pas emporté sur la malédiction des morts violentes dans sa famille, celle-ci étant un peu l’équivalent des Kennedy au cœur de l’univers faulknérien. On le découvre en outre âgé d’une douzaine d’années au lendemain de la reddition de Vicksburg, à l’été 1863, lorsque les troupes fédérales de Grant ont définitivement brisé l’endurance des troupes confédérées de Pemberton. Et lui, adolescent sudiste échaudé par les rumeurs et les mythologies de la guerre, reproduit en miniature le siège de Vicksburg avec son décor de fortune et ses soldats de plomb, recommençant à satiété les mouvements de la bataille en compagnie de Ringo, son ami de douze ans également, nègre et inconscient des enjeux réels de l’assaut qui vient de se terminer sur les rives du Mississippi. Ce binôme en noir et blanc schématise à l’orée de cette histoire le symbole de l’innocence, le caractère inexpugnable de l’enfance euphorique, Bayard et Ringo étant à ce moment-là «au-dessus de tout, invaincus comme deux phalènes, deux plumes chevauchant plus haut que l’ouragan» (p. 13). D’ailleurs l’un et l’autre sont tantôt Grant, tantôt Pemberton, ignorant les mérites respectifs de ces war leaders, méconnaissant totalement l’ironie de la déroute enregistrée à Vicksburg puisque cette défaite du Sud aura pour conséquence d’accélérer la libération officielle des esclaves et donc le changement de statut de toute la population noire (du moins en théorie). Autrement dit, sans qu’il n’en sache rien, le pré-pubère Ringo est déjà sommairement affranchi dans sa relation avec Bayard, mais l’union de ces deux innocents est moins contrainte qu’obligée, à l’inverse de quelques nègres du domaine Sartoris qui ne seront pas longs à assimiler la réalité d’un nouveau paradigme existentiel.
La lecture de L’invaincu (1) permet de remonter dans le temps de la famille Sartoris et de découvrir ce que furent l’enfance et la jeunesse de Bayard Sartoris, celui-là même qui succombera environ quatre décennies plus tard d’une crise cardiaque dans la voiture de son petit-fils après une effrayante sortie de route (2). Réchappé des balles perdues de la guerre de Sécession et des tensions de la Reconstruction au milieu d’un Sud exsangue et vindicatif, Bayard Sartoris, toutefois, ne l’aura pas emporté sur la malédiction des morts violentes dans sa famille, celle-ci étant un peu l’équivalent des Kennedy au cœur de l’univers faulknérien. On le découvre en outre âgé d’une douzaine d’années au lendemain de la reddition de Vicksburg, à l’été 1863, lorsque les troupes fédérales de Grant ont définitivement brisé l’endurance des troupes confédérées de Pemberton. Et lui, adolescent sudiste échaudé par les rumeurs et les mythologies de la guerre, reproduit en miniature le siège de Vicksburg avec son décor de fortune et ses soldats de plomb, recommençant à satiété les mouvements de la bataille en compagnie de Ringo, son ami de douze ans également, nègre et inconscient des enjeux réels de l’assaut qui vient de se terminer sur les rives du Mississippi. Ce binôme en noir et blanc schématise à l’orée de cette histoire le symbole de l’innocence, le caractère inexpugnable de l’enfance euphorique, Bayard et Ringo étant à ce moment-là «au-dessus de tout, invaincus comme deux phalènes, deux plumes chevauchant plus haut que l’ouragan» (p. 13). D’ailleurs l’un et l’autre sont tantôt Grant, tantôt Pemberton, ignorant les mérites respectifs de ces war leaders, méconnaissant totalement l’ironie de la déroute enregistrée à Vicksburg puisque cette défaite du Sud aura pour conséquence d’accélérer la libération officielle des esclaves et donc le changement de statut de toute la population noire (du moins en théorie). Autrement dit, sans qu’il n’en sache rien, le pré-pubère Ringo est déjà sommairement affranchi dans sa relation avec Bayard, mais l’union de ces deux innocents est moins contrainte qu’obligée, à l’inverse de quelques nègres du domaine Sartoris qui ne seront pas longs à assimiler la réalité d’un nouveau paradigme existentiel. En prolongement des légendes véhiculées par la guerre (et subséquemment du mépris des vérités les plus tangibles), précisons que dans l’œil juvénile de Bayard, son père John Sartoris, pourtant d’une taille très modeste, lui apparaît comme agrandi par la guerre, d’une certaine manière surélevé par «les choses qu’il faisait» et par ses missions spéciales accomplies «en Virginie et dans le Tennessee» (p. 16). Se manifeste ici la typique démiurgie du paternel combattant pour l’ordre présumé juste, une divinisation d’autant plus probante qu’elle est associée à la défense immodérée de la cause sudiste débordant notablement le seul contexte de la guerre. Et dans l’appareil sensoriel de l’enfant observant son père exhaussé au rang de colonel et de personnalité d’un imaginaire Hall of Fame du Sud, l’odorat suit les conclusions de la vue, l’odeur de son géniteur étant celle «de la poudre et de la gloire» (p. 16), rétrospectivement corrigée par la lucidité de la raison et par l’évidence historique, le parfum du triomphe se dégradant après des lustres d’objectivité renforcée en un relent de «déclin sarcastique» (p. 16), alors prélude aux inévitables perditions de la Confédération. Ce que l’enfant halluciné avait pressenti dans le registre de l’apothéose, le narrateur adulte l’amende et le reformule dans le registre de l’abaissement, instruit des mauvais tournants de l’armée sudiste et des séquelles stratégiquement irréversibles impliquées par la capitulation de Vicksburg. Il se peut ainsi que l’année 1863 fût pour le Sud l’extension d’un vain combat et la certitude que la substance intellectuelle du mouvement sécessionniste se muât dès lors en Cause Perdue. Du reste, en pure contradiction avec cette chronique de la défaite annoncée, l’immature Bayard ne s’intéresse pas tellement au détail des protagonistes et de leurs faits d’arme, il n’a pas vraiment de représentation claire de Nathan Bedford Forrest ou de John Hunt Morgan (cf. p. 22), tout le monde se trouvant en quelque sorte subsumé dans l’individualité fascinante de son père, mais il a plutôt un sentiment générique des événements, un enthousiasme à l’idée du cumul des «canons», des «étendards» et des «hurlements anonymes» (p. 22). La dramaturgie apportée par le conflit du Nord et du Sud ajoute là du piment au sein de l’âge tendre et donne aux éléments prosaïques de la vie une qualité inouïe, comme si, finalement, tout devait revêtir une cape magique en dépit des dangers sous-tendus par la guerre civile. Aux récits naturellement épiques de l’enfance, la guerre adjoint les superlatifs dont elle est l’entremetteuse, comme le monstre des romans d’épouvante intensifie subitement la moindre minute vécue.
Le son de cloche psychologique est néanmoins différent du côté de la plupart des nègres qui sont employés à la plantation des Sartoris. Ils vivent la lente agonie du Sud à l’instar d’une espérance et ils se figurent des rêves d’émancipation. Alors que pour Bayard la guerre est un prolongement de la joie de vivre et un réseau inextricable de fantasmes, elle est, pour les nègres, une promesse de joie parmi le quotidien très concret de la servitude, une insoutenable attente qui s’en remet aux impénétrables volontés du destin. Au nombre de ces fébriles obstinés de la délivrance, il y a Loosh, un utopiste enragé, pariant sur le fait que «le général Sherman (3) va balayer la terre» (p. 30) et rédimer toute la race des nègres. Aussitôt sa mère Louvinia le reprend, douchant ses visions d’apocalypse, le traitant «[d’imbécile] de nègre» (p. 30) et lui assénant une question qui tuerait n’importe quel illuminé de justice : «Est-ce que tu te figures qu’y a assez d’Yanquis dans le monde entier pour battre les blancs ?» (pp. 30-1). Mais quoi qu’il en soit de la majorité blanche qui pourra toujours compter sur la tyrannie du nombre et sur l’autodénigrement des minorités, la durée de la guerre, objectivement, repousse le Sud dans les cordes de l’atonie, allant même jusqu’à délaver le gris caractéristique des uniformes confédérés qui «avaient presque la couleur des feuilles mortes» (p. 54) après trois ans d’ineffable rivalité. Sur ce fond de délabrement matériel et de décrépitude immatérielle, le colonel John Sartoris doit joindre les deux bouts, maintenir les apparences, alimenter le folklore du midi séparatiste. Il est impératif que l’on continue à dire de lui que c’est une terreur et qu’il terrorisera encore longtemps «tous ces salauds aux ventres bleus» (p. 61). Cette réputation l’arrange bien parce que d’autres voix que celles-ci prétendent qu’il serait incapable de protéger sa plantation, et que, ce faisant, il préfèrerait s’esquiver vers un je-ne-sais-quoi de batailles officieuses plutôt que d’assurer la sécurité de sa maison et de ses occupants (cf. p. 62). Or les absences de John Sartoris (qu’elles soient légitimes ou non), en effet, provoquent un resserrement de l’étau fédéral autour de sa propriété familiale et exploitante, ce qui précipite Bayard, sa grand-mère Rosa et Ringo sur la route, embarqués sur une charrette dans laquelle l’aînée a tenu à introduire une lourde malle d’argenterie, symbole des ultimes richesses encore préservées du saccage nordiste, sorte de sarcophage à l’intérieur duquel seraient momifiées toutes les inaltérables valeurs du Sud.
Ce périple en forme de sauve-qui-peut – Rosa s’écartera d’ailleurs de l’itinéraire convulsif des deux puceaux – est cependant d’une troublante brièveté puisque les fugitifs rencontrent John Sartoris sur leur chemin (cf. pp. 71-82). Ils reviennent tous au domaine sur l’ordre du colonel, la grand-mère over a second phase, et cette dernière, opiniâtrement, n’oublie pas d’enterrer la malle d’argenterie comme si c’était un veau d’or, un talisman de tout le Sud, un cœur de la vitalité dissidente qui cesserait immédiatement de battre si par malheur il échouait entre les sales mains des unionistes. Puis de nouveau John Sartoris reprend le large en «sacré cochon de rebelle» (p. 84), peut-être par couardise, peut-être par jusqu’au-boutisme héroïque, on ne le sait pas, et sitôt l’ombre du colonel envolée pour d’indéfinissables directions, le spasmodique Loosh persuade sa femme Philaldelphie qu’ils sont à présent libérés (non sans avoir usé de la malle secrète à l’égal d’un passe-muraille), que les tuniques bleues sont sur le point d’achever le travail, que le vent de l’indépendance ne saurait désormais plus s’arrêter de souffler sur ces terres dévastées d’iniquité. Il songe sans doute à une inversion de la malédiction, à un châtiment délocalisé, une calamité enfin adressée aux bourreaux des nègres (cf. pp. 84-7). À ce degré d’excitation où l’adrénaline remanie les neurones en particules accélérées de l’onirisme, Loosh, au même titre que ses semblables opprimés, incarne «l’irrésistible besoin de mouvement qui bouillait» (p. 93) chez les nègres prisonniers des plantations et des mentalités esclavagistes. L’effondrement du bastion de Vicksburg, en jetant l’inertie dans les organes sudistes, aura suscité une spectaculaire cinétique dans les âmes noires. Métaphoriquement parlant, la chute du barrage de Vicksburg, tel un Malpasset inondant Fréjus un soir de décembre 1959, aura laissé passer l’eau foudroyante des États-Unis, faisant place nette à la fulguration de l’unité prête à neutraliser toutes les résistances extrêmes de la dualité. À la suite de Vicksburg, l’âme et le corps de l’Amérique pouvaient commencer à se réunir, l’esprit de l’Union rejoignant la matière vigoureuse de la désunion, l’intelligence se rapatriant progressivement dans ses meilleures virilités. Et les nègres, à la faveur de cet élan qui se confirme, se dirigent vers tous les points cardinaux qui ne seraient pas le Sud, marée humaine devenant un lyrique affluent du Mississippi, un débit de justice, une cataracte étoilée (cf. pp. 117-8). L’exode nègre est en outre si puissant que non content de se superposer au majestueux Mississippi, il reflète la suprématie du Jourdain (cf. p. 105), la sensation d’un baptême décisif qui serait les prémisses d’une purification de l’Amérique. C’est l’occasion d’aller de l’avant et d’oublier cette «triste affaire» de la guerre «qui traînait misérablement depuis tantôt trois ans» (p. 109). La vérité saute aux yeux : l’héroïsme du Sud n’existe plus – ce sont dorénavant les nègres qui sont les pionniers d’une fondamentale dépense d’énergie et qui montrent la voie de la future charpente de la maison américaine ressuscitée.
Parallèlement à cette ferveur et en pathétique divergence avec le sens de l’Histoire, Rosa Millard, Bayard Sartoris et l’influençable Ringo s’activent selon les forces négatives de la réaction, partant à la recherche de la malle dérobée et de leurs nègres opportunistes (cf. pp. 126-134). Cette loufoque expédition déclenche un enchaînement de circonstances aggravantes pour Rosa et ses vassaux : ce n’est pas leur malle qu’ils récupèrent, mais une dizaine de malles ainsi que d’innombrables nègres et une quantité impressionnante de mulets, le tout obtenu en fonction d’un usage croissant de faux documents (cf. p. 144), trompant les troupes qui croient que ces diverses réquisitions émanent de l’état-major le plus assermenté. S’ensuit une réédification aussi hâtive que sidérante du domaine des Sartoris, avec, en contrepoids psychique, une certaine mansuétude de Rosa qui autorise les nègres déboussolés à quitter les rangs pour persévérer dans leur jonction des territoires fédéraux (cf. p. 130). Mais ces nègres sont tellement «égarés dans la liberté» (p. 153) qu’ils n’osent pas saisir leur chance, éventuellement stupéfaits par l’habileté de cette grand-mère et assurément captifs de leurs habitudes serviles. Aussi, pour se racheter différemment devant l’étrange immobilisme de ces nègres, devant ce suicide social couronnant le chapitre des trop longues persécutions, la vieille Rosa distribue l’argent issu des ventes animalières à quelques désespérés du Sud. Elle mêle un geste de vertu à la chorégraphie de son vice et dans sa tête submergée de principes confédérés, il n’est pas impossible qu’elle se dise que les faux documents, à tout prendre, ne sont pas pires que la falsification axiologique colportée par le Nord.
Reste que ce petit manège de faux-monnayeurs ne tarde pas à être démasqué. Lorsqu’un lieutenant de l’Union débarque à la propriété des Sartoris avec toutes les preuves accablantes de ces forfaits, il déclare, la mort dans l’âme : «Que Dieu ait pitié du Nord s’il passe jamais par la tête de Davis ou de Lee de former une brigade de grands-mères et de nègres orphelins, et de nous envahir avec ça !» (p. 161). La déploration de ce gradé constate l’infinie stratigraphie de la dégradation du Sud et de son peuple jadis souverain – aujourd’hui asservi aux méprisables soumissions qu’il voudrait voir subsister. Sera-t-on même surpris d’apprendre que Rosa Millard meurt assassinée par un ex-Confédéré – Grumby – prostitué aux sinistres méthodes des frustrés de la gâchette qui n’ont pas réussi à tuer suffisamment de Yanquis ? On ne sera même pas étonné de découvrir que cette consanguinité dans la débâcle (un sudiste revanchard exécutant une sudiste aux abois) n’a pu trouver son aboutissement que par l’intermédiaire d’un Snopes, Ab Snopes en l’occurrence, un des membres dégénérés de cette famille abâtardi qui tient un rôle central dans l’œuvre de Faulkner (cf. pp. 172-3). Et de déperdition en déperdition, au fur et à mesure du dévoiement des valeurs, il fallait bien que Bayard abîmât son innocence et qu’il vengeât sa grand-mère en tuant Grumby, escorté de surcroît par l’embarrassant panurgisme de Ringo (cf. p. 205). Ces périphéries de la guerre exhibent des tendances beaucoup plus problématiques au sein de la vie méridionale courante et minimisent largement le retour sain et sauf du colonel John Sartoris, héros ou imposteur (4), peu importe, mais nécessairement lié à la radioactivité exponentielle de son patronyme ruiné.
Consécutivement à ces épisodes frontaux et latéraux de la guerre de Sécession, une elliptique embardée temporelle nous transporte à la «singulière époque» (p. 216) de la Reconstruction. Pour les femmes du Sud abattu et péniblement renaissant, toutefois, un continuum de détresse les enveloppe de son écrasant suaire parce qu’elles n’ont jamais connu autre chose que la «monotone continuité remplie des habituelles folies de leurs hommes» (p. 217). Veuves pour la plupart d’entre elles, et, pour les plus infortunées, un ou plusieurs enfants portés en terre à côté des époux décimés, ces femmes sont pourtant les glorieuses et discrètes dépositaires de la mémoire sudiste, les vivantes acharnées au milieu des morts offensés, les détentrices d’un temple spirituel abyssal qui permet d’augurer par le truchement de leurs infatigables mains la rénovation d’un genre de temple de Salomon au cœur des États humiliés par la faillite militaire, un temple qui serait le domicile d’une Arche d’Alliance régénérée pour les furieux nostalgiques de la confédération. Si les hommes du midi américain sont fous, les femmes, elles, sont lucides et besogneuses malgré la somme de leurs infortunes, et, en cela, elles réorientent la dynamique de la folie masculine dans la dynamique génératrice inhérente à la nature féminine. On l’a vu précédemment avec Rosa Millard : son âge avancé ne l’a pas empêchée de jouer des coudes et de rebâtir l’empire des Sartoris – fût-ce d’une façon provisoire – en utilisant les ressorts combinés de la résilience et de la rationalité, autant de qualités dont n’auraient pas pu faire preuve le fuyant John Sartoris et l’apprenti sudiste Bayard Sartoris. D’où l’hypothèse que le vieux Sud est moins déterminé par ses hommes que par ses femmes, les premiers souffrant quelquefois d’un délire mégalomaniaque incompatible avec les intérêts d’une terre orgueilleuse et irrédente. Si le Sud peut donc se prescrire des largesses de haine raciale, de même que des lois et des ordres spécifiques (cf. pp. 221-233), si l’obscénité de ces propensions régionales peut se réincarner ici ou là, c’est qu’elle est compensée par la sobriété des femmes, par la patience de ces Pénélope américaines qui retisseront toujours ce que les hommes auront impudemment détissé.
Du reste, dans la lignée de ces quelques aberrations phallocratiques, le vétéran John Sartoris est finalement tué par balles (comme le fut Rosa). Mais ce qui dissocie Rosa de John, c’est que celui-ci «a été obligé de tuer trop de gens et [que cela] ne vaut rien pour un homme» (p. 251), tandis que celle-là n’aura eu le démérite que de vouloir garder la tête haute pendant que les hommes l’avaient basse. Ce qui a également pressé le décès brutal de John Sartoris, c’est son ambition politique d’emprunt, sa conviction que ses états de service au demeurant nébuleux feraient de lui un candidat idéal pour la cicatrisation du Sud. Aussi s’est-il affublé de «cet air faussement oratoire d’avocat», avec des «yeux arrogants qui, durant les deux dernières années, avaient revêtu cette sorte de pellicule transparente qu’ont ceux des animaux carnassiers, et derrière laquelle ils regardent un monde que les ruminants ne regardent jamais» (p. 256). Sauf que le prédateur John Sartoris s’est soudainement retrouvé dans la position de la proie, piégé sur un champ de bataille inédit, le terrain de la politique et du déséquilibre mental, rattrapé dans sa course en avant par un homme plus fou que lui, plus coriace et plus authentique probablement, par Ben Redmond en l’occurrence, par cette Némésis aux allures de justice divine qui nous rappelle que le colonel Sartoris n’a peut-être pas tant combattu que cela dans la mesure où il n’a pas su esquiver l’impérialisme d’un seul adversaire. Il s’ensuit que cet assassinat politique – ou plus vraisemblablement providentiel – engendre une transaction ontologique dans le clan des Sartoris (cf. p. 236), Bayard devenant à cet instant préci
05/09/2022 | Lien permanent
Heureux est l’homme de François Esperet, par Gregory Mion

 Gagneuses de François Esperet, ou la poétique de la délivrance.
Gagneuses de François Esperet, ou la poétique de la délivrance. Sangs d’emprunt de François Esperet : sucs poétiques et artères scabreuses.
Sangs d’emprunt de François Esperet : sucs poétiques et artères scabreuses. Visions de Jacob de François Esperet : une poésie de la naissance.
Visions de Jacob de François Esperet : une poésie de la naissance. Larrons de François Esperet : une croix pour les malfrats.
Larrons de François Esperet : une croix pour les malfrats. Ne restons pas ce que nous sommes de François Esperet.
Ne restons pas ce que nous sommes de François Esperet.«L’Empire d’occident croula sous le choc.»
J.-K. Huysmans, À rebours.
«Aussi, le genre humain ne s’y est jamais trompé, et l’infaillible instinct de tous les peuples, en n’importe quel lieu de la terre, a toujours frappé d’une identique réprobation les titulaires de la guenille ou du ventre creux.»
Léon Bloy, Le Désespéré.
 Insufflé par le premier Psaume auquel son titre se dévoue éperdument, le nouveau livre poétique de François Esperet, Heureux est l’homme (1), peut se lire comme l’hagiographie d’un «va-nu-pieds céleste» (p. 51) dans le Paris babylonien d’aujourd’hui. La voix du poète – incantatoire – s’assimile de manière assez autobiographique à la voix du prêtre – obstinée du Royaume. C’est la relative nouveauté de ce texte de François Esperet qui renforce un lien construit au fil de ses œuvres antérieures entre une apologétique de la précarité et une mystique intensifiée year-over-year, en disciple cumulatif de Jack Kerouac et de James Agee, mais aussi en humble gardien de Grégoire de Nazianze et de Basile de Césarée (2) : on y retrouve ainsi tout le bois flotté des échoués de l’existence, blanchâtres vestiges osseux peut-être enlisés sur une plage des quais de Seine devenue outrageusement pérenne, sordides carcasses de sauriens déshérités, tombés de fatale pauvreté, miroirs brisés des larrons désespérés de vivre (3), légataires des prostituées contractuelles des trottoirs du vice mais femmes titulaires en vertu (4), les uns et les autres saisis par l’œil purifiant du poète. On les retrouve donc à l’avant-poste de la tourmente, ces précurseurs et ces successeurs de la grâce, on les suit dans Paname écrasée d’inégalités, mais, cette fois, le regard inspiré d’un chemin des crêtes parnassiennes s’agrandit d’un regard lesté de plus hautes bénédictions, résultat des sacrements amassés par François Esperet ces dernières années au sein de la vocation orthodoxe, ex-artisan du diaconat récemment ordonné prêtre par le métropolite Antoine de Chersonèse du subsistant – et consolateur – patriarcat de Moscou.
Insufflé par le premier Psaume auquel son titre se dévoue éperdument, le nouveau livre poétique de François Esperet, Heureux est l’homme (1), peut se lire comme l’hagiographie d’un «va-nu-pieds céleste» (p. 51) dans le Paris babylonien d’aujourd’hui. La voix du poète – incantatoire – s’assimile de manière assez autobiographique à la voix du prêtre – obstinée du Royaume. C’est la relative nouveauté de ce texte de François Esperet qui renforce un lien construit au fil de ses œuvres antérieures entre une apologétique de la précarité et une mystique intensifiée year-over-year, en disciple cumulatif de Jack Kerouac et de James Agee, mais aussi en humble gardien de Grégoire de Nazianze et de Basile de Césarée (2) : on y retrouve ainsi tout le bois flotté des échoués de l’existence, blanchâtres vestiges osseux peut-être enlisés sur une plage des quais de Seine devenue outrageusement pérenne, sordides carcasses de sauriens déshérités, tombés de fatale pauvreté, miroirs brisés des larrons désespérés de vivre (3), légataires des prostituées contractuelles des trottoirs du vice mais femmes titulaires en vertu (4), les uns et les autres saisis par l’œil purifiant du poète. On les retrouve donc à l’avant-poste de la tourmente, ces précurseurs et ces successeurs de la grâce, on les suit dans Paname écrasée d’inégalités, mais, cette fois, le regard inspiré d’un chemin des crêtes parnassiennes s’agrandit d’un regard lesté de plus hautes bénédictions, résultat des sacrements amassés par François Esperet ces dernières années au sein de la vocation orthodoxe, ex-artisan du diaconat récemment ordonné prêtre par le métropolite Antoine de Chersonèse du subsistant – et consolateur – patriarcat de Moscou. Il ne fait alors aucun doute que l’association d’un fort sens poétique (révélé avec les compositions initiatiques des Sangs d’emprunt (5)) et d’un sens religieux toujours accentué donne à ce livre une dimension énorme, une incroyable capacité de captation de la réalité, une faculté de conscience non plus vécue séparément du monde dans le registre de la représentation mais directement incorporée aux choses, transcendance humaine – trop humaine – enfin confondue au poème de l’immanence divine, enfin réconciliée avec elle-même et ce qui l’enveloppe since the dawn of time. Aussi les mots préliminaires de cette légende dorée du saint «Pachtoune» aperçu d’abord au quartier de la «Cité» (p. 9) vibrent comme un repentir de la conscience détrônée du malheur du schisme représentationnel, comme un aveu remarquable de l’homme d’Église écrivain, terrassé par la misère de ce duplicata d’un commandant Massoud dégradé, recevant cette vision de la détresse matérielle non pas tant comme le facile symbole d’une gloire spirituelle qu’il faudrait célébrer, mais plutôt, dans l’immédiat, «comme un reproche au prêtre» (p. 9) qui a longtemps navigué sur des hauteurs casuistiques ahurissantes qui l’empêchaient parfois – fût-ce rarement – de s’abaisser à la source du monde. En cela, dès le début de ce mémento écrit en l’honneur du foudroyant misérable déplacé de ses déserts régaliens par quelque occulte étiologie occidentale, il y a une impuissance du prêtre qui s’abstient de convoquer trop vite la toute-puissance de Dieu pour résoudre le problème de la pauvreté. À vrai dire, ce que le poète édifié ressent, c’est moins la nécessité de s’en remettre à Dieu que le flagrant délit de la présence de Dieu au sein même de ce clochard somnolant à Cité, la possibilité que Dieu se soit fait homme à travers le corps de cet infortuné, exigeant ainsi que l’on descende aux confins de la Terre avant de s’estimer admissible au trajet ascendant d’une échelle de Jacob.
Dès lors s’engage un chassé-croisé à la fois réel et imaginaire entre le religieux et son alter ego en altissima paupertas. Le rythme de cette probable sarabande – qui pourrait se dérouler en fonction des accords inquiétants de Georg Friedrich Haendel – est toutefois décidé par le gisant meurt-de-faim de Cité tant le charisme de sa privation frappe l’abondance de cœur de l’aède ecclésiastique. Celui-ci devine la souveraineté de celui-là, sa fulgurante législation de lumière, sa bravoure de modeste bateau en papier qu’on aurait lancé dans un hideux caniveau tributaire de l’impitoyable Seine dévoreuse de Paul Celan, bateau enfantin qui tiendrait son cap contre toute attente, tel ce brave petit bateau évoqué par Malcolm Lowry dans son recueil de nouvelles Écoute notre voix ô Seigneur…, vulnérable embarcation mais vénérable véhicule des énergies sacrées, chancelante patrie de tous les eccentric outsiders de Lowry, de tous ceux qui sont sous la coupe d’une «âme humaine en cabotage» (6) au milieu des goulets d’étranglement d’une société trompeusement conviviale. Et à voir l’extrême indigence de ce dramatique et littéral mendiant qui dort sur l’île la plus onéreuse de la planète, réconforté par les miasmes thermiques d’une bouche de chaleur, à voir cette robinsonnade de l’irréversible dérive, la question que posait Lowry se répète (la question qui concernait les passagers figurés du petit bateau dodelinant de sa voile abandonnée au hasard), le point d’interrogation de ces maudits marins revient à la charge : «Comment l’âme peut-elle endurer cette sorte de démolition et pourtant survivre ?» (7) Par quel miracle de la volonté ce paria de Cité persévère dans la vie sinon par la volonté du pourvoyeur de toutes les choses ? Par quelle ironie du supra-prolétariat ce gueux quasiment végétatif continue-t-il ses rarissimes déambulations et ses changements de position sur son museau urbain qui le réchauffe de sa douteuse haleine ? Au service de ce comateux de la voierie, on se demande un peu en désespoir de cause s’il existe un score de Glasgow pour mesurer la fuite de sa conscience dans les fonts baptismaux de l’inexpugnable dénuement. Mais quoi qu’il en soit de cette conscience qui paraît inaccessible et perdue, il faut se l’imaginer heureuse comme l’homme du Psaume originel, à rebours de la conscience malheureuse qui vit encore divorcée de la Création. C’est la destination que doit se fixer le poète s’il veut être digne de ce qu’il est : s’avancer jusqu’aux territoires inexplorés du bohémien archétypal pour tuer la conscience malheureuse et la précipiter dans les abysses du flux de la conscience suprême – cet endroit où le très-bas rejoint le très-haut.
En d’autres termes, si le poète a l’intention de se mettre au niveau de celui qui semble avoir uni en lui tout ce qui est désuni pour les mentalités communes, il va lui falloir se revêtir du dénuement, se parer de la nudité d’une vie que rien ne rattache à la litigieuse épaisseur des combinaisons sociales. Or c’est là que François Esperet se distingue de livre en livre : non seulement il parvient à manifester l’autorité de la vie partout où l’opinion identifie des hommes et des femmes subordonnés aux carcans sinon de la mort imminente, du moins de la mort sociale, mais il parvient aussi à révéler toute l’apothéose des humiliés qu’il choisit de décrire moins sous l’angle d’une horrible crucifixion du Juste que sous les aspects du Christ pantocrator inondé de lumière. Telle est par conséquent la poésie de François Esperet : non pas une mise en croix des pauvres gens qui se regarderait comme la réécriture moderne, auto-satisfaite et mind-easing d’une Histoire biblique vouée à la répétition, mais plutôt un refus de stigmatiser les stigmates, un rejet du romantisme de la souffrance, ceci à dessein de convertir nos courtes vues sociologiques en longues vues mystagogiques, nous découvrant ainsi une part du mystère, une part de la vérité définitive, une part de l’évidence la moins évidente et pourtant la plus certaine, à savoir que les malheureux sont le point de passage ultime de l’illumination bienheureuse. À cet égard, aucun poète, aucun homme de lettres et même aucun homme en général ne devrait limiter sa parole au maniable répertoire de la mortification quand il s’exprime au sujet des suprématistes de la calamité. Le cas échéant, ce serait commettre une cinquième grande erreur après les quatre grandes erreurs cataloguées par Nietzsche, ce serait ne pas voir que notre monde se complaît à glorifier les offenseurs et à offenser les glorieux, que ce monde abîmé de sentences illicites assigne aux seconds les péchés capitaux des premiers, et que, ce faisant, nous altérons nos façons de parler en qualifiant de photophores ceux qui sont sournoisement satanophores, négligeant de mieux parler de ceux auxquels on ne réserve habituellement que des éléments de langage, des champs lexicaux prévisibles ou des raccourcis théoriques. À tous ces écueils potentiels, François Esperet oppose un langage qui ne fait ni l’économie d’une matière infâme, ni l’économie d’une antimatière sublime, incessamment au chevet des montrés-du-doigt tout en les reliant au principe de l’intensité de Dieu, ne serait-ce que parce que les plus démunis d’entre les hommes sont toujours les plus vivement intégrés aux plénitudes surnaturelles. Aussi n’est-il pas contradictoire que le trimardeur de Cité soit constamment baigné des mots du premier Psaume et que son hagiographie ne bascule pas dans les lexiques d’une complaisante martyrologie.
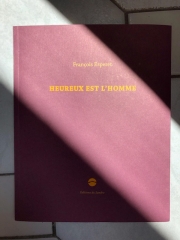 Il est donc indubitable que «l’ange immobile» (p. 34) endormi sur les satanés trottoirs de l’Occident impur aura sa «part au Royaume» (p. 11). Il y est même déjà presque arrivé tant les moindres fibres de sa personne font de lui un irrédent des régions divines. Ce «fol esclave en cavale» (p. 15) interrompue par le dur sommeil de la débâcle majorée, ce phénoménal «ascète rivé à son enfer» (p. 12), cet animal sauvage de l’Orient libérateur, nul n’a le droit de remettre en question sa recevabilité dans les provinces pacifiées du Règne de Dieu. Peu importe les déterminations qui le réduisent à la condition d’un bouc-émissaire, peu importe les apparences, il demeure celui devant lequel tremblent toutes les brebis galeuses et devant lequel jubilent tous les saints emboucanés, chef de file des «barbares à [nos] portes au cœur de [nos] cités les âmes perdues les pures» (p. 11), sultan régulier parmi la dangereuse irrégularité de l’imposture parisienne, divulgateur, en son apocalyptique virginité, de la tragédie séculaire qui s’acharne à croire que le Mal réside à la périphérie de Paris ou sur le rebord des voies piétonnes alors qu’il prolifère intra-muros, au centre même des monarchies institutionnelles dont la France tire une déconcertante et fâcheuse vanité. La localisation réprobatrice de la soi-disant mauvaise graine conjuguée à l’accommodante rédemption de tout le débraillé psychique de l’Occident retarde ainsi le Grand Soir d’une réforme des esprits – ce n’est pas demain la veille que les quartiers chics apprendront la chance qu’ils auraient de subir une invasion des anges qui aussitôt susciterait l’évacuation des démons. Ce n’est pas non plus de sitôt que l’œil de la bourgeoisie persécutrice verra les affinités célestes de celui qui «se dissimulait sous un suaire de l’Assistance publique des hôpitaux» (p. 13). Il ne reste ici que l’optique infiniment dimensionnelle de la poésie et de l’orthodoxie poussée à son maximum de perméabilité pour s’emparer de cet alité de l’asphalte et le relever de son épuisement. Et par le truchement de ce sensible redressement du paralytique de Cité où se rejoue le miracle de Capharnaüm (8), par un effet accru de pénétrabilité de toutes les strates de la réalité paralysée, François Esperet se livre à l’improbable (pour qui ne le connaît pas) mais nécessaire (pour qui le connaît) sanctification des «bagnards» de la maladie tels qu’ils gisent inanimés dans «un Lazaret [de] Hyères» (p. 14), destinataires de l’almanach des maladies orphelines à tendance curarisante, cérébro-lésés des accidents vasculaires à séquelles irrémissibles, femmes, enfants et hommes dévastés de malchance, désabusés du «ciel inique» (p. 14), imprégnés cependant d’une équité plus vaste qui donne à pressentir un matin de justice. De Paris à Hyères, du secteur de Cité aux topographies de l’Almanarre où se dresse ironique l’hôpital San Salvadour, pôle de la douleur sommitale côtoyant les plages de l’euphorie maximale, de ce Nord indifférent à ce Sud où le «clergé soignant le bas-clergé des pauvres» (p. 14) ne peut que torcher des corps impatients de «l’incinérateur attenant» (p. 14), l’apostolat du poète bâtit une arche de la souffrance rédimée, un palladium de prières serinées pour les défaits de la nation, non sans oublier de dire anaphoriquement «merde à Vauban» sous la férule militante de Léo Ferré (p. 14), condamnant ceux qui embastillent et réhabilitant les embastillés – respectivement les manufacturiers de l’inégalité et les ayants droits du mépris de tout droit.
Il est donc indubitable que «l’ange immobile» (p. 34) endormi sur les satanés trottoirs de l’Occident impur aura sa «part au Royaume» (p. 11). Il y est même déjà presque arrivé tant les moindres fibres de sa personne font de lui un irrédent des régions divines. Ce «fol esclave en cavale» (p. 15) interrompue par le dur sommeil de la débâcle majorée, ce phénoménal «ascète rivé à son enfer» (p. 12), cet animal sauvage de l’Orient libérateur, nul n’a le droit de remettre en question sa recevabilité dans les provinces pacifiées du Règne de Dieu. Peu importe les déterminations qui le réduisent à la condition d’un bouc-émissaire, peu importe les apparences, il demeure celui devant lequel tremblent toutes les brebis galeuses et devant lequel jubilent tous les saints emboucanés, chef de file des «barbares à [nos] portes au cœur de [nos] cités les âmes perdues les pures» (p. 11), sultan régulier parmi la dangereuse irrégularité de l’imposture parisienne, divulgateur, en son apocalyptique virginité, de la tragédie séculaire qui s’acharne à croire que le Mal réside à la périphérie de Paris ou sur le rebord des voies piétonnes alors qu’il prolifère intra-muros, au centre même des monarchies institutionnelles dont la France tire une déconcertante et fâcheuse vanité. La localisation réprobatrice de la soi-disant mauvaise graine conjuguée à l’accommodante rédemption de tout le débraillé psychique de l’Occident retarde ainsi le Grand Soir d’une réforme des esprits – ce n’est pas demain la veille que les quartiers chics apprendront la chance qu’ils auraient de subir une invasion des anges qui aussitôt susciterait l’évacuation des démons. Ce n’est pas non plus de sitôt que l’œil de la bourgeoisie persécutrice verra les affinités célestes de celui qui «se dissimulait sous un suaire de l’Assistance publique des hôpitaux» (p. 13). Il ne reste ici que l’optique infiniment dimensionnelle de la poésie et de l’orthodoxie poussée à son maximum de perméabilité pour s’emparer de cet alité de l’asphalte et le relever de son épuisement. Et par le truchement de ce sensible redressement du paralytique de Cité où se rejoue le miracle de Capharnaüm (8), par un effet accru de pénétrabilité de toutes les strates de la réalité paralysée, François Esperet se livre à l’improbable (pour qui ne le connaît pas) mais nécessaire (pour qui le connaît) sanctification des «bagnards» de la maladie tels qu’ils gisent inanimés dans «un Lazaret [de] Hyères» (p. 14), destinataires de l’almanach des maladies orphelines à tendance curarisante, cérébro-lésés des accidents vasculaires à séquelles irrémissibles, femmes, enfants et hommes dévastés de malchance, désabusés du «ciel inique» (p. 14), imprégnés cependant d’une équité plus vaste qui donne à pressentir un matin de justice. De Paris à Hyères, du secteur de Cité aux topographies de l’Almanarre où se dresse ironique l’hôpital San Salvadour, pôle de la douleur sommitale côtoyant les plages de l’euphorie maximale, de ce Nord indifférent à ce Sud où le «clergé soignant le bas-clergé des pauvres» (p. 14) ne peut que torcher des corps impatients de «l’incinérateur attenant» (p. 14), l’apostolat du poète bâtit une arche de la souffrance rédimée, un palladium de prières serinées pour les défaits de la nation, non sans oublier de dire anaphoriquement «merde à Vauban» sous la férule militante de Léo Ferré (p. 14), condamnant ceux qui embastillent et réhabilitant les embastillés – respectivement les manufacturiers de l’inégalité et les ayants droits du mépris de tout droit. Cette réciprocité des douleurs est aussi l’occasion de blâmer l’État-Providence (cf. p. 14) : aucun décret sur la misère et aucune allocation de solidarité ne sont compatibles avec une compréhension approfondie des causes qui provoquent la déchéance. Au contraire, selon un mouvement de cession des possibles qui dissimule en vérité une cynique annexion à l’impossible, plus l’État fait preuve d’activisme, plus les initiatives se multiplient envers les faibles, moins le périmètre d’un enfer sur terre diminue. Il en va finalement des bonnes volontés de l’État comme d’une balourde philosophie du care : c’est précisément parce qu’on insiste beaucoup sur l’attention portée à autrui que celui-ci n’existe que très partiellement au sein d’un dispositif impersonnel de protection (ou à l’intérieur des spéculations d’intellectuels bien nourris). Dans son inimitable scansion – délestée du balisage de la virgule et du point – qui se déroule à l’instar d’un fleuve de sévère probité par opposition à la friponnerie des agents officiels de la République, tel un Nil torrentueux qui viendrait sauver les cœurs stériles, François Esperet accuse une sorte d’interventionnisme hygiéniste, dénigrant les manières à la fois littérales et symboliques de «[perfuser l’ascèse]» (p. 14) des pénitents de la rue, de leur infliger une espèce d’impérialisme du «glucose» afin qu’à «l’aube ils se découvrent attachés à la poche de leurs droits nos devoirs insinués dans leurs veines» (p. 14). Ce genre d’éthique de la sollicitude – ou de socialisme exhibitionniste – n’a l’air que d’une immunité que l’État s’achète au prix avantageux de son incompréhension réitérée des créatures explicites de Dieu. À Paris ou à Hyères, on meurt d’un surcroît de rigueur étatique et d’un déficit de reconnaissance des ministres de la béatitude. À Paris, regrettablement, des frères en béatitude vont rejoindre Paul Celan dans les eaux de la délivrance et à Hyères, fâcheusement, le spectre de Saint-John Perse se cabre de stupéfaction à la vue des solitaires de San Salvadour. Partout le rabaissement des pauvres fait rage et exhorte à ce que la mission primordiale des vivants consiste à redresser les abaissés, à se souvenir que la descente du Christ a induit le même type de fléchissement de soi-même en vue d’aider ceux qui ont été astreints à l’étiage de la société.
Mais pour colossale que soit la négation du vagabond lambinant sur le cadastre qui fut jadis la fierté des mémorialistes et qui aujourd’hui n’est plus que la fatuité des monstres du tourisme, lui, malgré tout, malgré son altitude outragée, s’affirme comme un irradié de l’énergie blanche qui sanctionne les passants escroqués par la magie noire (cf. p. 17). Tandis que les uns dorment en marchant, le cénobite de Cité, incontestablement, marche d’une démarche prophétique en dormant. Il n’est pas victime de ces «marchands de sommeil» contre lesquels Alain mettait ses élèves en garde et qui désiraient perpétrer les fondations d’un grégarisme consumériste (9). En dépit du «feu souterrai
21/08/2022 | Lien permanent
Pèlerin parmi les ombres (Nécropole) de Boris Pahor, par Gregory Mion

 «Non seulement l’écriture de l’histoire est superficielle mais aussi l’histoire elle-même. Elle ne livre toujours que des résultats, et toujours transmet des fleurs au lieu des racines.»
«Non seulement l’écriture de l’histoire est superficielle mais aussi l’histoire elle-même. Elle ne livre toujours que des résultats, et toujours transmet des fleurs au lieu des racines.»Günther Anders, Sténogrammes philosophiques.
«Les foules ne deviennent pas nazies ou quelque chose de similaire par révolte, mais plutôt par conformisme.»
Imre Kertész, Journal de Galère.
«Quelles scolopendres sous cette pierre ?»
Gesualdo Bufalino, Le semeur de peste.
Hier encore, à Trieste jadis auréolée de l’illustre présence de James Joyce, aux extrémités orientales de l’Italie où vient se ressasser l’Adriatique, un homme de presque 109 ans continuait de se tenir bravement debout et cet homme s’appelait Boris Pahor. Il a connu l’imprescriptible scélératesse des camps de concentration, d’où, peut-être, le miracle de sa longévité, le prodige de son opiniâtreté à vivre (du 26 août 1913 au 30 mai 2022). Et comme certains des malheureux qui ont dû mesurer leur humanité désolée à l’inhumanité réitérée des fours crématoires du nazisme, tels Primo Levi et Imre Kertész, telles aussi Etty Hillesum et Charlotte Delbo, comme ceux-là, incoerciblement, Boris Pahor a écrit non pas tant pour fonder une jurisprudence que pour se libérer d’abord de cette fatale énormité, pour liquider la douleur, usant pour ce faire du témoignage, du récit de l’inconcevable malignité exterminatrice, moyen culturel qui succède probablement au moyen naturel que Hegel mentionnait quand il décrivait le pouvoir apaisant des larmes, le pouvoir de la consolation directe par l’acte de pleurer (1). Ainsi nous choisissons d’aborder les pages de cet écrivain italien d’expression slovène, des pages impératives qui prennent assurément la suite des larmes de sang, des pages qui se découvrent alors non pas sous la coupole d’une autorité – qui de toute façon ne se fût pas reconnu le moindre droit d’absolutisme de la souffrance tant l’humilité des dannati della Terra est sans limite – mais sous l’arche d’une expérience particulière du tourment qui dévoile quelque chose de l’universelle destinée des hommes. Ainsi nous voulons parler de ce toccante scrittore né à Trieste du temps où la géopolitique situait ce vaste port de commerce en Autriche-Hongrie, romancier déporté dans les enfers de l’Europe raciste et revenu dans sa ville de naissance à l’instar d’Ulysse revenant dans son île d’Ithaque, grandissante personnalité de la littérature internationale au fil du XXe siècle titubant (notamment admiré par Claudio Magris), désormais ex-doyen mondial des lettres par anecdote, puis, surtout, empêcheur par essence de la définitive perdition. En effet la lecture de Pèlerin parmi les ombres (2), sous-titré Nécropole, rappelle ô combien les digues morales d’une civilisation demeurent fragiles, à plus forte raison quand celle-ci a pu se croire immunisée contre de nouvelles possibilités de s’effondrer. Dès lors il est en fin de compte radicalement obligatoire de redoubler d’efforts et de vigilance au lendemain d’une chose aussi barbare que la Shoah. C’est la condition sine qua non pour que l’optimisme prudent de Boris Pahor ne devienne pas caduc et c’est au prix d’une inlassable rumination des leçons de l’Histoire que nous ne trahirons pas la «confiance dans le genre humain» (p. 252) de ce rescapé du plus infâme déshonneur qui se sera jusqu’ici abattu sur le monde.
La défunte mémoire de Boris Pahor, laquelle ne s’est sans doute jamais délestée des souvenirs concentrationnaires, son hôte aurait-il même atteint les mille ans d’âge qu’il n’en eût pas été autrement, cette mémoire, avec ce livre si important, se réactive narrativement plusieurs décennies après la détention de son auteur au camp de Natzweiler-Struthof à l’occasion d’une visite des anciens districts de son martyre. De retour au Struthof au milieu des vacanciers, des curieux et des scolaires, Boris Pahor se sent comme «dans un cimetière silencieux dont [il a] été l’habitant, d’où [il est] parti en congé et où [il revient] maintenant» (p. 219). Il est évidemment à la marge de cette foule européenne endimanchée, en périphérie de cette reconstitution d’une masse indolente qui a d’ores et déjà consenti à d’autres fascismes, à d’autres déclinaisons de l’hétéronomie maximale. Passant et repassant devant les baraquements où s’accomplissait avec une méprisable rigueur la méthodologie du génocide des Juifs pendant que l’aigle noir du Troisième Reich volait haut, l’homme typique de l’Europe réunifiée manque de révolte, il manque même de tout, et ses enfants, héritiers de cette insouciance, ne peuvent réagir différemment alors qu’il faudrait que leurs mains sortent de leurs poches et qu’elles «ébranlent ce bâtiment de malheur» (p. 123), qu’elles détruisent la version acceptable et visitable du Struthof. Ce serait le cas échéant une destruction de la Destruction, une mort de la Mort, une spectaculaire manière de certifier que les générations actuelles ont été suffisamment dégoûtées par ces atrocités pour ne pas que les démons d’hier aient la moindre chance de ressusciter. Mais nous savons ce qu’il en est, comme Heinrich Böll le savait (3), comme W. G. Sebald le savait, lui qui, dans son mélancolique exil anglais, n’a cessé de suivre à la trace le Mal résiduel d’une Europe furieusement décevante, nous savons donc que la Shoah ne fut que la confirmation d’une tendance qui était à l’œuvre depuis longtemps, qu’elle fut pour ainsi dire la promotion simultanée de tous les trafiquants d’ivoire occidentaux de tous les cœurs des ténèbres planétaires, et, dans ses prétendues phases descendantes, nous savons, comme László Krasznahorkai le sait par exemple, que cette charogne idéologique s’est prolongée en diverses compromissions, en terribles capillarités de la perversion reformulée, en multiples procédés consistant à ravaler la façade du Vieux Continent de sorte à faire oublier que l’intérieur de cette antique maison n’a peu ou prou rien modifié de son immonde mobilier. Aussi, malgré toutes les espérances de Boris Pahor, on ne saurait se mentir, on ne saurait détourner le regard vis-à-vis de cette «humanité [comptant] toujours un certain nombre de gens qui font les chemins de croix, qui visitent les sanctuaires et les tombes, que nous considérons habituellement comme les meilleurs, les plus nobles, alors qu’en réalité il n’est pas certain que ces bonnes âmes améliorent l’histoire» (p. 123). En cela «tout indique que les cœurs compatissants ne font qu’accompagner les événements, [qu’ils] ne les provoquent pas, [qu’ils] sont comme les saules pleureurs qui se contentent de se pencher profondément sur le lieu où un silence infini règne sur l’extermination bruyante ou muette» (p. 123). Autrement dit nous ne saurions convertir une tranquille passivité en activité viscérale, une figure imposée en créativité, ces multitudes charitables étant presque plus criminelles par leur inertie que les méchants par leur frénésie. Et à présent que Boris Pahor vient de refermer subrepticement le chapitre centenaire de son existence, l’Europe, a priori du moins, n’est plus qu’une machine administrative dirigée par des invertébrés, un énorme musée des horreurs passées qui n’a pas l’air de s’alarmer de la catastrophe qui vient, une catastrophe aux contours encore imprécis, mais une catastrophe quoi qu’on en dise car aucune valeur digne de ce nom ne peut émerger d’un système où l’on revendique tant de libertés au sein de tant de servitudes. Pas davantage qu’une valeur respectable ne peut concourir au statut de modèle pérenne à une période où l’Europe, en tout état de cause, n’a pas terminé de résoudre l’avilissante équation de ses dépôts alluvionnaires d’antisémitisme.
Nous avouons par conséquent ne pas tout à fait partager les vues de Boris Pahor sur l’avenir pacifié de notre monde. Et lui non plus n’est pas complètement naïf en dépit de ses intermittentes mansuétudes. Outre qu’il soit plutôt rassuré en ce qui concerne le caractère «incommunicable» des camps (p. 58), comme si la magnitude de cette abomination était devenue incompatible avec nos esprits modernes et bien éduqués, il ne peut s’empêcher d’être dubitatif en constatant plusieurs «légèretés» touristiques «au pied du Calvaire du XXe siècle» (p. 231). Disons qu’il est difficile de discriminer entre le droit inaliénable de poursuivre les finalités du bonheur et l’absolu relâchement d’un peuple qui s’est dégradé en troupeau consumériste. C’est d’ailleurs cette hypothétique uniformisation qui pose problème, ce préoccupant nivelage des nations de l’Ouest, ce bâton tendu pour se faire battre, auto-enfermement dans un registre néo-fascisant car soumis à des idoles aussi frauduleuses que les précédents totems totalitaires. Pourtant – et d’une manière si convaincante qu’on en est désarçonné – Boris Pahor montre que ce qui l’a partiellement sauvé du camp relève de sa plasticité psychologique en général et de son donno delle lingue en particulier, lequel reposait sur son usage des flexibilités de la langue slovène pour maîtriser tant la langue de l’ennemi que les langues de ses compagnons d’infortune (cf. p. 28). Il insiste au demeurant sur la bénédiction du tempérament adaptatif et inventif de l’âme slovène, ce qui, d’un point de vue élargi, constitue un éloge de la liberté se heurtant aux nombreux automatismes qui dégradent aujourd’hui l’âme de l’Europe technicienne et pro-capitaliste. On comprend de la sorte le trouble de Boris Pahor lorsqu’il observe ces processions d’excursionnistes du faramineux scandale nazi, ces promeneurs du dimanche qui agissent peut-être moins par devoir qu’en conformité avec un devoir, ces agrégats d’individus psychiquement homogènes et en cela possiblement hermétiques au bariolage des anciens pyjamas rayés, comme si, abjectement, ce tragique univers de la rayure, loin d’être démodé ou répulsif, désignait par un saut temporel et ontologique tous ceux qui ne sont pas inclus dans l’appareil contemporain de la standardisation. En d’autres termes, être Juif naguère et maintenant, être Juif ici ou là-bas, ce serait posséder un certain degré de déviation par rapport à la norme centralisée, ce serait incarner une différence transitive intolérable – impardonnable eût dit Cristina Campo – au milieu d’un monde où le Même a imposé le diktat d’une similarité intransitive. Quiconque diffère de nos jours, quiconque s’affirme comme puissance de différenciation, celui-là est Juif par nature ou par assimilation, celui-là porte sur ses épaules la marque de la zébrure qui ne convient pas à l’identité préférentielle en vigueur. C’est pourquoi les Juifs ont été souvent rayés de la carte : ils transportent en eux et autour d’eux l’aura de la diversité divine qui contrarie les ambitions successives de l’unité maligne. Telle est la synthèse potentielle des pensées et des intuitions de Boris Pahor au moment où il avise les premiers cadastres du Struthof – à peine arrivé au seuil de ce pressant pandémonium, il en perçoit les puantes survivances, les épouvantables redistributions, les récentes métamorphoses qui essaient de faire croire aux vacanciers gémissants que le Mal a été définitivement licencié de ses hauts quartiers d’autrefois.
Du reste, au châtiment de ce retour en terra maledetta, s’ajoutent les sporadiques réminiscences des persécutions du proto-fascisme à l’égard des Slovènes, comme un «la» funeste sur la partition existentielle de Boris Pahor, comme la preuve d’une «perfidie aux aguets» (4) qui devait plus tard éclater sous la forme de l’Endlösung der Judenfrage. Il se souvient du théâtre de Trieste qui a été réduit en cendres pendant l’été 1920 (cf. p. 30). Il se remémore dans le sillage de cette rage enflammée toute «la panique d’une communauté déniée» (p. 30), toute la vilenie de ces «incendies fascistes» (p. 161), tout le délire épurateur d’un État qui «a tenté d’éliminer l’ennemi slovène de son propre sol» (p. 68). Et au fin fond de cette galerie cauchemardesque trône le ressouvenir des instituteurs slovènes expulsés des écoles de Trieste (cf. p. 190), emblèmes de la probité chassés par les étendards de la fourberie, agents de la culture évacués par les agents de l’ignorance. Ainsi le monde réputé civilisé n’avait plus besoin de craindre les loups de la barbarie parvenus à ses portes – ils étaient déjà là, déjà radioactifs, annexés au faux système universaliste de l’Europe des Lumières, hideuse chenille grossissant imparablement au cœur du fruit occidental. Il en a résulté un contexte superlatif de pourriture, une substitution du ciel étoilé kantien par une «lueur d’étoile jaune» (5), une justification progressive de l’instinct génocidaire et de ses innommables procédés. Par conséquent le Struthof ne fut que le prolongement des scènes de proscriptions vécues par le petit enfant qu’était Boris Pahor, un enfant de sept ans, prématurément aguerri aux palinodies maléfiques où l’humanité s’engage corps et âme dans l’inhumanité. Que représentaient donc ces Slovènes ostracisés – dans le meilleur des cas – sinon les présages de la cruauté des camps de concentration de l’Allemagne hitlérienne ? L’assombrissement du ciel enfantin de Boris Pahor préfigurait malheureusement le «ciel vosgien» (p. 42) du Struthof, ce ciel étrange, obstrué, saturé, comme vomi par la cheminée principale du camp, un ciel privé de tout repos puisque la nuit, sans relâche, on pouvait y voir «une couronne de feu», un diadème infernal «[suspendu] au-dessus de la cheminée [prépondérante] comme la flamme d’une raffinerie clandestine» (p. 42).
Autour de ce phallus industriel de la combustion s’est développée la «peur collective des crématoires» (p. 37), l’effroi de toute une société martyrisée, arasée, composée pour l’essentiel de tondus, de squelettes et de musulmans au sens que Primo Levi donne à ce dernier terme, ces trois catégories étant le plus fréquemment confondues en une seule personne, avec, en guise d’aplanissement de toutes les consciences et d’annulation de tous les reliefs singuliers de telle ou telle origine, «l’égalité immuable [suscitée par] la faim [et par] la cendre» (p. 36). Ce sont là les effectifs majoritaires et désintégrés du Struthof, les réprouvés de l’ordre fasciste, les hommes croulants que Boris Pahor a eu tant et tant de fois entre ses mains – morts ou vifs – puisqu’il occupait dans l’organigramme du camp la fonction mêlée d’infirmier et d’interprète, avec, en supplément insoutenable, une charge de manutentionnaire des cadavres, un «travail de fossoyeur» (p. 134). Autant dire que Boris Pahor était la plupart du temps astreint aux lois du Krankenrevier (abrégé en revier), aux us et coutumes de la léproserie, sorte d’antichambre du «gosier métallique» du four, ultime escale avant d’être soumis à la question du «sphinx de fer» (p. 59). À cet endroit qui semble localisé à l’embouchure de tous les fleuves des Enfers et à la source de toutes les inspirations diaboliques, le courageux Boris Pahor a vu l’inconcevable, l’inimaginable, accumulant des visions qui jetteraient n’importe qui dans la folie. Son œil s’est confronté aux maigreurs maladives, aux maquis des pubis que l’on mène à la tonte, aux entassements de macchabées qui évoquent les toiles suffocantes de Zoran Mušič, le tout s’agrégeant en une espèce de «secte des bannis» (6), de circonscription secrète des parias diarrhéiques déféquant des hectolitres d’angoisse. C’était là une mécanique arbitraire et féroce de l’excommunication raciale, brutalement répétitive d’un camp à l’autre, le récit de Boris Pahor s’aventurant quelquefois sur les territoires mémoriels de ses transferts, de ses changements d’adresse au Lager, lui qui fut lamentablement déplacé entre le Struthof, Dachau, Dora, Bergen-Belsen et Harzungen, sombre litanie d’une engeance topographique.
Un tel environnement d’holocauste paraît même en mesure d’altérer les réserves spirituelles du recours aux forêts défendu par Ernst Jünger, car la forêt, au Struthof, vigoureuse et culminante, a paru se cabrer afin de ceindre le camp d’une impénétrable cloison végétale, protégeant les bourreaux des regards indiscrets, isolant les prisonniers des rumeurs extérieures de la vie, dissimulant au monde vivant les monstruosités du monde mort. Les aveux de Boris Pahor à ce sujet sont éloquents de lucidité blessée et significatifs de l’invincible verrou qui avait séquestré la vie de chacun de ces bannis dans une littérale désolation : «Bien sûr, cette forêt n’y était pour rien mais je ne lui en tenais pas moins rigueur de ce qu’elle offrait en son épaisseur un refuge à la mort; en elle je condamnais toute la nature qui se dresse en traits verticaux vers le soleil sans changer de direction quand la lumière du soleil avait perdu toute signification. Je m’insurgeais contre les arbres car, de leur obscurité, auraient dû surgir les troupes de combattants si longtemps attendues qui auraient empêché le sacrifice de ces jeunes filles alsaciennes : j’ai projeté dans ces arbres toute mon impuissance et maintenant ils sont là, muets, raides, comme cette malédiction s’était incarnée en eux, comme si elle les avait imprégnés» (pp. 43-4). Les séquelles d’une perception biaisée par la tyrannie concentrationnaire ont ainsi vocation à durer et à tendre vers l’irréversible traumatisme. Quelles que soient les beautés de la nature que l’on voudrait louer, contempler, mimer, ou plus franchement que l’on voudrait opposer au ressort de corruption du camp, celles-ci, invariablement, se trouveraient enlaidies dans l’immédiat de la comparaison et dans le médiat d’une profanation du sens esthétique. Le principe de dénaturation du camp est si redoutable qu’il rend aveugle à la beauté et qu’il engendre une ophtalmopathie chronique dont le risque majeur repose sur la contamination de tout le dispositif moral de l’œil intérieur. De telle sorte qu’avoir été au camp, c’est avoir été privé en partie ou totalement de sa faculté de voir la beauté, de sa capacité à voir le concret ou l’abstrait de la grâce, et, à l’inverse, c’est avoir été doté d’une propension à sentir un insurmontable débit de laideur à l’endroit même où quelquefois la pureté triomphe. Face à la generazione des plus convaincants élans de la vitalité, le camp, tel qu’en lui-même la fureur de détruire le glorifie, organise une réplique massive de la corruzione et répand dans les esprits des survivants affligés les ténèbres du pessimisme. Il faut alors s’efforcer de cohabiter avec cet élément corrosif de la mentalité et de la sensibilité
16/06/2022 | Lien permanent

























































