Rechercher : bernanos, lapaque
Notre avant-guerre de Robert Brasillach

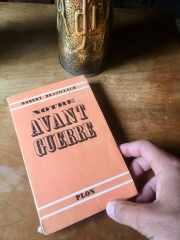 C'est sans doute une phrase en apparence banale de Notre avant-guerre (1) paru en 1941 qui nous donne le meilleur aperçu de l'étonnante lucidité dont a su faire preuve, du moins jusqu’à un certain point, Robert Brasillach : «Un nouveau venu, Louis-Ferdinand Céline, avait inventé en 1932 une sorte d’épopée de la catastrophe et de l’injure avec le Voyage au bout de la nuit» (p. 172). Ce jugement constitue un magnifique raccourci du génie célinien et Brasillach nommera une fois de plus le romancier, aux dernières pages de son livre, évoquant «une sorte de prophète, un Ézéchiel de la bouffonnerie macabre et de la verve ordurière» (p. 304). Qu'ajouter d'autre, en effet, aux textes et à la personnalité de Céline, ainsi ramassés en quelques mots ?
C'est sans doute une phrase en apparence banale de Notre avant-guerre (1) paru en 1941 qui nous donne le meilleur aperçu de l'étonnante lucidité dont a su faire preuve, du moins jusqu’à un certain point, Robert Brasillach : «Un nouveau venu, Louis-Ferdinand Céline, avait inventé en 1932 une sorte d’épopée de la catastrophe et de l’injure avec le Voyage au bout de la nuit» (p. 172). Ce jugement constitue un magnifique raccourci du génie célinien et Brasillach nommera une fois de plus le romancier, aux dernières pages de son livre, évoquant «une sorte de prophète, un Ézéchiel de la bouffonnerie macabre et de la verve ordurière» (p. 304). Qu'ajouter d'autre, en effet, aux textes et à la personnalité de Céline, ainsi ramassés en quelques mots ?Connu essentiellement comme écrivain plutôt que critique cinématographique, une passion qu'il exerça avec un grand talent, Robert Brasillach, dans ce livre où il a assemblé ses souvenirs de la période précédant immédiatement le début de la Seconde Guerre mondiale, n'évoque finalement qu'assez peu la vie littéraire de son époque, même si défilent dans ces pages les noms de Maurice Bardèche, Thierry Maulnier, Charles Maurras, Jacques Bainville, Lucien Rebatet (cf. pp. 215-6), Paul Gadenne (2), Paul Claudel, Henry de Montherlant, Jean Giraudoux et bien d'autres encore, comme Georges Pitoëff qui lui a semblé «incarner exactement certaine âme moderne, déséquilibrée par le heurt des instincts, rêvant de vie ardente et d’absolu», génial Hamlet (cf. p. 97), «type parfait d’un monde privé d’appui» (p. 42), auquel il consacre des pages bouleversantes (cf. pp. 318-20).
La mention de ses propres lectures, hormis quelques titres qui ont marqué les esprits, comme le premier roman de Georges Bernanos (3), semble avoir encore moins d'importance aux yeux de Brasillach : «[…] et je me rappelle toujours l’impression de torrent et d’orage que fit soudain parmi nous le premier livre de Georges Bernanos, que Léon Daudet fit découvrir avec tant de passion» (p. 33). C'est peu, tout de même, y compris lorsque l'on fait son miel de phrases concentrées comme des éclairs.
Peut-être faut-il expliquer cette relative rareté des évocations concernant la littérature proprement dite (alors que la presse est bien davantage mentionnée) par le fait que, comme pour Julien Gracq, la littérature est pour Brasillach, avant toute chose, le miroir le plus fidèle de la réalité perdue de l'enfance, et aussi, l'adolescence venue, une affaire de «bande, pour le meilleur et pour le pire, et ce qu'on nommera, pour choquer les bourgeois, le sens du gang» (p. 222) : «Car nous n’étions pas loin de penser que la littérature n’a de valeur que pour fournir des mots de passe» (p. 94), s'il est vrai que la littérature ou peut-être tout simplement les livres, objets bien plus mystérieux que les textes étranges ou tout bonnement indéchiffrables qu'ils renferment, ont, aux yeux d'un enfant, une vertu talismanique : «Je n’y vois, pour ma part, que la suite toute naturelle de mon enfance, quand nous mettions avec amabilité un livre entre les mains du petit camarade qui venait nous voir, en lui disant : «Tu ne comprendrais pas nos jeux.» Puis, la politesse ainsi satisfaite, nous retournions à nos îles désertes et nos grammaires inventées» (p. 168).
Peut-être encore l'écriture, très belle et si souvent émouvante, de Notre avant-guerre tient-elle sa qualité littéraire du fait qu'elle se soucie finalement assez peu de ce qui est devenu, de nos jours et dans notre Babylone des lettres, ce que quelques arbitres d'élégance ont appelé la vie littéraire, autant le dire, la littérature ayant déchu de sa solitude pour croupir dans un de ces bassins où les pieds sales se décantent dans les piscines, avant de patauger, à peu près propres espérons-le, dans le bain commun.
Les bien-pensants pousseront de petits cris à la seule évocation de celui qui écrivit, avec Gabriel Marcel, Henri Massis et Charles Maurras, un livre tel que Pour la défense de l'Occident en 1935, où il prenait clairement position pour l'Italie fasciste, tandis que Bernanos et Mauriac dénonçaient sans relâche l'imposture que constituait à leurs yeux la croisade du Duce en Éthiopie. Ces mêmes bien-pensants, pourvu qu'on puisse leur supposer une sensibilité littéraire minimale, ne pourront que reconnaître toutefois la beauté classique de l'écriture de Brasillach qui évoque admirablement celles et ceux qu'il a connus sans jamais nous entretenir de ses petits tracas personnels. Renaud Camus et Gabriel Matzneff, pour ne citer que deux des plus affligeants diaristes de notre époque, devraient ainsi et de toute urgence se plonger dans la lecture (la relecture, espérons-le, à leur grand âge) du livre de Brasillach, où la petite histoire est chevillée à la grande, sans que jamais la première ne phagocyte ridiculement la seconde. Il est vrai, suis-je bête, qu'il n'y a plus vraiment d'histoire, en tout cas française, à l'heure où, sur leur page blanche qui va vite se couvrir de milliards de phrases, Matzneff et Camus font éclater leurs petits boutons remplis de sébum égotiste et éjaculent quelques gouttelettes d'un plaisir devenu pornographique, absolument banal, à force d'avoir été taylorisé.
Robert Brasillach, lui, se tient à une tout autre hauteur que celle de nos solipsistes maniaques et imperturbablement bavards. Il se tient à la hauteur que lui commande l'urgence absolue des temps qu'il a connus et traversés en en ayant miraculeusement décanté le suc, comme Ernst Jünger a pu capter la vérité mystérieuse et si subtile d'une époque tout entière obsédée par la Guerre aux multiples manifestations, toute grondante des orages d'acier dont il sut mieux qu'un autre apprécier la beauté dangereuse : «Ceux qui aimeront vivre tout court, écrit ainsi magnifiquement Brasillach, ne sauront pas ce que fut d'en attendre la permission des dieux de la guerre» (p. 351).
Cette notation réduit à néant les jugements si prompts de celles et ceux qui, de la guerre, des débordements qu'elle provoque, des horreurs inavouables, des erreurs tragiques, des lâchetés incompréhensibles et des accomplissements magnifiques ne savent rien de plus, désormais, que ce qu'ils en ont lu et vu sur des images d'archive, à moins qu'ils n'aient fait leurs classes devant le grand écran des salles obscures, où ils ont tenté, eux aussi après tout, d'aller sauver le soldat Ryan.
Ce qui intéresse Robert Brasillach, c'est quoi qu'il en soit, bien moins la littérature que, nous dit-il, «la figure que forment dans le temps et l'espace les êtres humains» (p. 245), et cette figure est, faut-il le préciser, la seule qui trace un motif réellement continu si nous tenons compte des multiples coupures et recommencements qui façonnent la vie la plus lisse et même plate. De fait, nous ne sommes pas étonnés de constater que c'est aux toutes dernières pages de son livre que Robert Brasillach mentionne l'héritier de Charles Maurras pour lequel l'admiration a toujours été fidèle, Pierre Boutang, décrit comme un «garçon agrégé de philosophie, marié, père de deux bébés, et qui ressemblait à Bonaparte jeune, mais très blond» (p. 351), comme s'il s'agissait, pour Brasillach, de poser des jalons qui «indiqueraient la route, plus tard, à d'autres que nous, et à nous-mêmes, nous en étions sûrs» (p. 352). Bien sûr, il se trompait lourdement sur ce dernier point.
Certaines des plus belles pages qu'il m'a été donné de lire sur la jeunesse perdue (4) se trouvent sans conteste dans le livre de Brasillach et il ne me semble point sot d'affirmer que quelque remarquable secret de la prose française s'est tristement perdu depuis cette époque, pourtant pas si éloignée de la nôtre, et tellement lointaine d'elle qu'une île légendaire nous semblerait une destination moins farfelue, époque où l'écriture parvenait, par le génie de sa légèreté, à rendre évident l'éclat de l'or enfoui : «Je me demande parfois […] [s’]il ne pourrait pas venir un jour un poète qui chanterait cette terre lointaine, un peu énigmatique, cette île de la jeunesse où la jeunesse elle-même ne s’abrite qu’avec méfiance» (p. 110) tandis que, dans une image superbe, Brasillach parvient à unir la plus haute fugacité de l'instant foudroyant avec l'évidence douloureuse que les êtres ne meurent pas tant que le mutisme des choses semble conserver quelque parcelle de leur souvenir si éphémère : «Je regarde notre reflet ancien, parfois, dans la glace d’un épicier-confiseur, rue Gay-Lussac, avant d’arriver au boulevard Saint-Michel. Nous nous y arrêtions toujours quand nous sortions le soir : ce reflet a dû y rester» (p. 65). Nous irons vérifier.
Il est à ce titre impossible de ne pas mentionner les pages qui se mêlent à celles où il n'en finit pas de déambuler dans les rues de Paris (5), où l'auteur évoque sa vie à l'École Normale, toutes frémissantes du sentiment d'une inconcevable liberté et d'une vie haute (6), aussi bien physique qu'intellectuelle, qui semblera une incongruité risible à notre époque si avide de rentabilité, des corps comme des cerveaux. Je me permets de citer longuement tel passage, où l'écriture admirable de Brasillach semble mimer le périlleux mouvement d'une reconquête et, pourquoi ne pas écrire ce mot en le dépouillant de sa dimension kierkegaardienne chrétienne, d'une répétition (7) : «Les plus obtus de nos camarades, comme nous tous, sentaient le prix de ces instants uniques, qu’aient connus sans doute, à la fin de leur vraie jeunesse, tous les étudiants. Nous avions vingt-deux, vingt-trois ans : les mois qui allaient suivre nous éloigneraient dans quelque ville de garnison, puis ce serait la vie qui commencerait, une carrière, un appartement, l’argent à gagner, peut-être le mariage, la maturité à coup sûr. Encore un instant de liberté, dans l’oasis de l’École, au milieu du Paris surchauffé, sous les arbres atteints par l’été brûlant. Encore un instant de bonheur. Nous goûtions ces minutes mortelles, enchantés qu’elles fussent mortelles, ivres de nos proches souvenirs, ivres de l’amitié, de la camaraderie, des découvertes les plus profondes, de la frivolité merveilleuse de notre vie. Un peu de temps encore, et il faudrait abandonner ces trésors, fermer ces pages. Un peu de temps, sous le ciel pur, devant le regard ironique des soixante bustes. Un peu de temps à courir les cinémas de quartier pour revoir les films de sept années, les jardins, les cafés, Paris nocturne sous les lampions du 14 juillet, un peu de temps, pour dire adieu à notre adolescence» (p. 128).
Ce lent et remarquable exercice de remémoration n'a pourtant qu'un seul but, qui n'est pas l'évocation de la vie littéraire française durant l'entre-deux guerres et pas même, non plus, le souvenir de la jeunesse exaltante. Ce qui donne au livre de Brasillach un poids si évident, une réelle présence, c'est à n'en pas douter le destin de l'auteur, qu'il n'est sans doute point besoin ici de rappeler. C'est aussi la lente dissection du phénomène de fascination que le fascisme exerça sur certains esprits, ce dernier pouvant être considéré comme le véritable marionnettiste de bien des personnages dont Brasillach évoque la mémoire : «C’est précisément l’heure où nous arrivions, l’heure d’où l’on peut sans doute dater le commencement de l’avant-guerre» (p. 3).
Et ce commencement est celui de la montée d'une nouvelle lumière, superbement décrite par l'auteur, qui en singularise en quelques lignes la nature votive, éminemment religieuse, du moins para-religieuse, singeant la ferveur des croyants : «On ne sortait pas d’années meurtrières et fuligineuses, éclairées de biais par les torches multipliées des congrès nazis» (p. 161). Ailleurs, Brasillach décrit de nouveau la montée implacable du nazisme par la métaphore de la lumière naissante, comme s'il se souvenait du titre étrange du premier roman de Georges Bernanos paru en 1926, et qu'il prêtât à l'idéologie meurtrière la caractéristique satanique d'une contre-lumière : «On voyait à travers l’Europe commencer déjà en discours une guerre de religion, qui durerait plus de cinq années, et nous en regardions de loin monter les premières flammes. Ainsi était définitivement ruiné, autour de nous, cet univers de papier et de nuages auxquels nos aînés avaient cru. Cela aurait été un autre songe, sans doute, que d’applaudir bruyamment à l’intrusion têtue de la réalité dans les apparences : elle n’avait rien d’aimable, certes, mais elle était la réalité, et voilà tout. Elle surgissait, comme le gros globe allongé du soleil qui jaillit de la mer, brusque et furieux. Et tout était oublié des brumes de l’aube, et devant l’astre naissant, il fallait bien admettre que beaucoup de peuples, beaucoup d’hommes à travers la planète, le reconnaissaient comme lumineux et brûlant, et ne voulaient plus entendre parler de ce qui avait précédé» (p. 133).
Il faut bien l'admettre en effet, surtout si l'on remarque que Robert Brasillach ne cesse d'insister sur la nullité de la vie intellectuelle politique française, et, dit-il, de la «primauté de la bassesse» (p. 188), de la «vulgarisation de l'immoralisme» qui en est le corollaire, source, à ses yeux, de l'éclosion de l’œuf fatidique, alors même qu'échoue la révolution nationale du 6 février 1934 (8) : «Alors la nation retournait à ses plaisirs, aux revues de fin d’année, aux journaux illustrés. On publiait les confessions de vedettes de music-hall, on lançait le mot de sex-appeal. Tout le capital de luxe et de luxure qu’avait amassé pour quelques privilégiés l’après-guerre était dilapidé en publications à grand tirage, et la foule avait sa part des vices et des joies réservées aux riches. Ce temps est le temps de la vulgarisation de l’immoralisme. Aussi comment s’étonner si, détournés d’un régime qui gâchait ainsi le meilleur de la nation, beaucoup voyaient avec une curiosité accrue se poursuivre à l’étranger des expériences souvent menaçantes, mais animées de l’esprit de grandeur ? Sans Violette Nozières, sans Stavisky, sans le sex-appeal, sans les journaux du soir, on n’aurait peut-être pas regardé au-delà des frontières comme on l’a fait durant ces années-là» (p. 162).
Ces années-là ressemblent à un mauvais rêve tout plein de voix furieuses et tétanisantes (9), éructant leur rêve de grandeur et de force dans un «rayonnement d'incendie» (p. 132), comme celles qu'écoutait Armand Robin, quoi qu'on en dise, et quelles que soient les réserves émises par celles et ceux qui les ont vécues, et qui ne les trouvèrent sans doute point si mauvaises : «On discutait de l’érotisme et on faisait un succès à l’Amant de lady Chatterley, de Lawrence. La France avait besoin de songes, la France sursautait parfois devant quelque cauchemar, mais elle se rendormait précipitamment. C’était le temps du sommeil» (p. 101).
Ce temps du sommeil aura produit un monstre, le fascisme, que Robert Brasillach évoque en s'inspirant par exemple d'un ouvrage d'Alain Laubreaux intitulé La terreur rose et surtout, à mon sens, d'une vision toute bernanosienne consistant à dissiper l'enflure, le néant dont Max Picard disséquera l'incarnation labile en la personne d'Adolf Hitler : «il faut y lire ces aventures inouïes : une vieille dame poursuivie en justice pour avoir gardé chez elle une mitrailleuse allemande rapportée par son fils tué à la guerre, un infirmer laissant mourir un malade dans un hôpital parce que sa journée de travail était terminée. Il faut y joindre le mort de ce petit garçon de sept ans, Paul Gignoux, tué par des enfants à Lyon parce qu'il portait des billets pour une vente de charité et qu'il était donc un petit fasciste. L'odieux et le grotesque se mêlent à chaque instant dans cette histoire inimaginable, dont nous avons été les si récents témoins» (p. 180).
Brasillach poursuit sa démonstration en affirmant que «l'esprit fasciste» (p. 184) qui n'est finalement rien d'autre qu'une certaine forme d'exaltation de la jeunesse (cf. p. 349), tout à tour qualifié d'«esprit anticonformiste d'abord, antibourgeois [où] l'irrespect y avait sa part», mais encore «esprit opposé aux préjugés, à ceux de la classe comme à tout autre» et enfin «esprit même de l'amitié, dont nous aurions voulu qu'il s'élevât jusqu'à l'amitié nationale» (p. 283), naît dans «une atmosphère de gabegie, d'excès, de démagogie et de bassesse» (p. 184), la décomposition d'un régime expliquant de fait à ses yeux la fascination, après tout légitime, pour un pouvoir qui n'hésite pas à utiliser le langage si puissant des mythes, des images et des symboles, fussent-ils ceux des nuits de Walpurgis (10) ainsi que, aussi surprenant que cela puisse nous sembler, de la poésie (11) : «On le vit naître. Nous l'avons vu naître. Parfois, nous assistions à ces incroyables défilés de 1936, ces vastes piétinements de foules énormes, entre la place de la République et la place de la Nation. De l'enthousiasme ? Je n'en suis pas sûr. Mais une extraordinaire docilité : c'est vers un but rouge et mystérieux qu'allait le destin français, et les passants levaient le poing, et ils se rassemblaient derrière les bigophonistes libres penseurs, les pêcheurs à la ligne antifasciste, et ils marchaient vers les colonnes de la place du Trône décorées de gigantesques drapeaux. On vendait de petits pantins : le colonel de La Rocque. On promenait, à la mode russe, des images géantes : les libérateurs de la pensée, Descartes, Voltaire, Karl Marx, Henri Barbusse. C'était bouffon et poussiéreux, l'esprit primaire devenu maître de tout» (pp. 184-5).
Et l'auteur de n'avoir jamais de mots assez durs pour condamner la situation de la France du Front populaire, à ses yeux responsable de tous les maux : «Et la France, que faisait-elle ? Elle vivait sous le régime du Front populaire, tantôt à direction socialiste, tantôt à direction radicale, sous la menace perpétuelle du chantage communiste. Mais dans la jeunesse, on pouvait voir aussi, sans forcer les choses, se préciser cet esprit préfasciste qui était peut-être né, malgré tout, aux environs du 6 février 1934. On le retrouvait, cet esprit, dans les ligues tant qu'il y eut des ligues, parfois chez certains membres du P. S. F. malgré les tasses de thé, au Parti Populaire Français de Doriot, et dans la foule des sans-parti» (p. 278).
Ailleurs, Brasillach semble retrouver les mots mêmes de Georges Bernanos pour décrire l'espèce de mauvais rêve que constitue la France de cette époque précédant immédiatement la guerre, singulièrement la période de la première mobilisation, fausse alerte qui pouvait déjà préfigurer, pour qui savait lire les grandes figu
20/05/2012 | Lien permanent
La Colline inspirée de Maurice Barrès

 Maurice Barrès dans la Zone.
Maurice Barrès dans la Zone.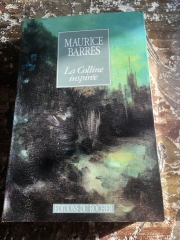 On sait peut-être qu'un écrivain atteint une couche profonde, assez mystérieuse de son art lorsque, à la surface de son texte, en apparence du moins, rien ne nous permet de déceler l'agitation des profondeurs, tout ce qui gronde et s'ébroue, flanc abrupt et colossal de monstre prodigieux, créatures privées de visions mais déterminées à atteindre l'air libre, océan de vase agité par des courants intérieurs, flot et même «avalanche de choses informes, obscures, enchevêtrées» (p. 225). Il est des lieux où souffle l'esprit, comme l'assure le fameux titre du premier chapitre de La Colline inspirée ici présentée dans la collection Alphée des éditions du Rocher (1) mais, à vrai dire, c'est sur ce beau roman que souffle l'esprit, gros d'une dimension qui l'excède, que ce dernier évoque pourtant, par une multitude de signes, d'abord naturels puisque les paysages y jouent un rôle essentiel (et, même, tiennent «au vieux prophète», Léopold Baillard, «de longs discours universels», p. 224) et en nous faisant voir, apercevoir du moins, la cohorte agitée, la «longue suite de héros qui trouvaient dans la pensée d'une alliance avec le ciel un principe d'action» (p. 18). Voici, au passage, quel aura été la seule affaire réelle de Barrès : dans la pensée d'une alliance avec le ciel le principe d'action. Quels que soient, donc, les reproches que nous pourrions adresser à Vintras et à ses suiveurs enthousiastes dont les frères Baillard, et Barrès ne manque pas de les moquer en les traitant de charlatans (2), nous devons reconnaître à tout le moins que ce sont, tous, des personnages qui «entreprennent de rétablir une magistrature spirituelle» et veulent de toutes leurs forces «raviver le surnaturel sur les cimes de leur pays» (p. 21) soit, autrement dit, unir ou plutôt réunir la terre et le ciel.
On sait peut-être qu'un écrivain atteint une couche profonde, assez mystérieuse de son art lorsque, à la surface de son texte, en apparence du moins, rien ne nous permet de déceler l'agitation des profondeurs, tout ce qui gronde et s'ébroue, flanc abrupt et colossal de monstre prodigieux, créatures privées de visions mais déterminées à atteindre l'air libre, océan de vase agité par des courants intérieurs, flot et même «avalanche de choses informes, obscures, enchevêtrées» (p. 225). Il est des lieux où souffle l'esprit, comme l'assure le fameux titre du premier chapitre de La Colline inspirée ici présentée dans la collection Alphée des éditions du Rocher (1) mais, à vrai dire, c'est sur ce beau roman que souffle l'esprit, gros d'une dimension qui l'excède, que ce dernier évoque pourtant, par une multitude de signes, d'abord naturels puisque les paysages y jouent un rôle essentiel (et, même, tiennent «au vieux prophète», Léopold Baillard, «de longs discours universels», p. 224) et en nous faisant voir, apercevoir du moins, la cohorte agitée, la «longue suite de héros qui trouvaient dans la pensée d'une alliance avec le ciel un principe d'action» (p. 18). Voici, au passage, quel aura été la seule affaire réelle de Barrès : dans la pensée d'une alliance avec le ciel le principe d'action. Quels que soient, donc, les reproches que nous pourrions adresser à Vintras et à ses suiveurs enthousiastes dont les frères Baillard, et Barrès ne manque pas de les moquer en les traitant de charlatans (2), nous devons reconnaître à tout le moins que ce sont, tous, des personnages qui «entreprennent de rétablir une magistrature spirituelle» et veulent de toutes leurs forces «raviver le surnaturel sur les cimes de leur pays» (p. 21) soit, autrement dit, unir ou plutôt réunir la terre et le ciel. L'exaltation de notre écrivain est bien réel, même s'il peut se montrer ironique, lorsqu'il écrit ainsi, en tête du chapitre 4 : «Arrière ces yeux médiocres qui ne savent rien voir, qui décolorent et rabaissent tous les spectacles, qui refusent de reconnaître sous les formes du jour les types éternels et, sous une redingote ou bien une soutane, Simon le magicien et le sorcier moyenâgeux» car, ceux-là, ces yeux si décidément médiocres qu'ils ne comprennent même plus ce qu'ils voient, «amoindriraient l'intérêt de la vie» (p. 61).
Ce qui importe en fait avant tout à Maurice Barrès, c'est la capacité consciente, la plus consciente possible à tout le moins, de comprendre qu'il fait office de messager, ou pour le dire d'une autre façon : qu'il remplit un rôle, comme Léopold Baillard, en finissant par découvrir le mage Vintras, comprendra quelle est sa mission terrestre, ayant reçu de l'hérésiarque «un mythe à sa portée, le mythe pour lequel il avait été conçu» (p. 115). La fin du roman, qui parvient à une espèce de dialogue pacifié entre ce que nous pourrions appeler l'esprit éternel de la nature et l'ordre imposé par une autorité spirituelle définie, en l'occurrence l’Église, ordre artificiel donc quoi qu'on en dise, montrant que l'ascension vers la colline inspirée est, aussi, une descente sous les différentes strates ayant constitué, au fil des âges, la terre lorraine, la profondeur de la très riche terre lorraine où s'enracinent nos personnages : «C'est un océan, une épaisseur d'âmes qui m'entourent et me portent comme l'eau soutient le nageur» (p. 286), belle image tout de même un peu inquiétante, qui charrie tout un tas de choses qui toutes ne portent pas forcément un nom.
La colline de Sion-Vaudémont est un de ces lieux où «notre nature produit avec aisance sa meilleure poésie, la poésie des grandes croyances», et cela alors même qu'un «rationalisme indigne de son nom veut ignorer ces endroits souverains» (p. 11). La colline est le lieu même du romanesque, des «sentiments romanesques, depuis longtemps perdus, [qui] se réveillent en nous : l'espoir de quelque inattendu, le souvenir d'images aimées bien effacées» (pp. 190-1) et nous aurions donc tort de nous étonner naïvement que soit là-bas «le lieu d'un grand épanouissement spirituel» (p. 191), ni même que Barrès fasse de sa chère colline le lieu de pèlerinage d'ombres célèbres, «Faust, Manfred, Prospero ! éternelle race d'Hamlet qui sait qu'il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel qu'il n'en est rêvé dans notre philosophie, et qui s'en va chercher le secret de la vie dans les songeries de la solitude !» (p. 287).
Le christianisme, finalement, n'est que l'un des maillons de la longue chaîne spirituelle dont la colline inspirée constitue l'attache, et rien ne nous indique, du reste, que ce maillon sera le dernier. Il n'est en tout cas pas du tout le premier, et c'est peut-être le sens sous-jacent du roman que d'interpréter l'hérésie vintrasienne comme quelque remontée des profondeurs, ou bien comme l'ondulation d'un des anneaux de l'immense animal, restant en partie inconnu, qui constitue «une expérience si vaste» et comme «les incidents d'une longue phrase de vérité» (p. 290). Le paganisme est l'un de ses anneaux, assurément antérieur au christianisme, même si nous ne savons là encore pas grand-chose, sinon strictement rien, des cultes, grotesques, orgiaques ou sanguinaires, qui ont précédé l'époque dont témoigne telle «petite statuette de bronze» (p. 231), Léopold lui-même, le téméraire Léopold pouvant à bon droit être considéré comme «ce suprême disciple qui, le dernier, posséda le dépôt d'une science divine», et qui «remonte jusqu'au bout la perspective ouverte sur le passé» puisqu'il «désire de recueillir les pépites d'or que roulent mystérieusement les ruisseaux de la colline», et parce qu'il s'échappe alors «d'un vol incertain, mal guidé, à travers les siècles» pour remonter «vers les autels indigènes, vers un monde inconnu qu'il ne sait pas nommer, mais qu'il aspire à pleine âme» (p. 233).
Il y a quelque chose, parfois, ô certes assez discrètement, de ce lourd tellurisme, attirant vers le sol, courbant les reins et même les esprits vers la terre grasse, comme une immense boule magnétique organisant la mystérieuse géographie des lignes de force, dans le premier roman de Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan (3) et, au cas où l'on trouverait le terme tellurisme trop fort, il y a quelque chose, dans les romans les plus inquiétants du Grand d'Espagne comme Monsieur Ouine de cette intime compénétration entre le charnel et même le humble (et non bas) matériel et le spirituel pour aboutir à une espèce de matérialisme surnaturel, il est vrai abondamment exploré par Huysmans : «Ce qui donne sa couleur unique et profonde au tableau, c'est que ces gens sont rassemblés pour débattre les intérêts matériels les plus terre à terre, en même temps que les plus folles aspirations religieuses» (p. 79).
Quoi qu'il en soit, quelque chose monte des profondeurs, gronde à la surface et se concentre, comme s'il s'agissait de la foudre attirée par un paratonnerre, sur la colline inspirée : «Est-ce une île nouvelle qui monte à la surface et que le vaste flot de l’Église officielle ne parviendra pas à submerger ?» (p. 116), et c'est encore une image d'excavation que Barrès emploie pour évoquer la résurgence du paganisme : «On voudrait s'arrêter; on se dit que personne ne vit d'un mensonge, qu'il y a là sans doute une réalité à demi recouverte, un terrain de tourbe où jadis un beau lac reflétait le ciel. On s'attarde auprès de cette vase, on rêve de saisir ce qui peut subsister d'un Verbe dans les bégaiements de Vintras. Ah ! si nous pouvions pénétrer en lui jusqu'à ces asiles de l'âme que rien ne trouble, où repose sans mélange, encore préservé des contacts de l'air et des compromis du siècle, ce que notre nature produit d'elle-même avec abondance !» (p. 144). Fous ou sains d'esprit, charlatans et imposteurs ou hommes de bonne foi, sincères, il n'en reste pas moins que Barrès ne cesse de nous montrer que ses personnages puisent à une réserve souterraine, cachée aux yeux de ceux qui, à la différence de nos fins sourciers, ne
 savent pas où chercher les veines profondes d'une eau d'autant plus vivifiante qu'elle reste à l'abri de toute forme de pollution. Voici encore un exemple de ce mouvement de descente irrésistible vers un gisement invisible puis d'extraction, de rapide remontée qui semble mimer l'exaltation contagieuse de cet étrange squelette point tout à fait minéral, de cet homme point complètement de chair pourrie que montre telle splendide sculpture de Bar-le-Duc (dite du Transi de René de Chalon) que cite notre roman ! : «L'univers est perçu par Vintras d'une manière qu'il n'a pas inventée, et qui jadis était celle du plus grand nombre des hommes. Il appartient à une espèce quasi disparue, dont il reste pourtant quelques survivants ! Quelle n'est pas leur ivresse ! Vintras est allé jusqu'à cette mélodie qu'ils soupçonnaient, dont ils avaient besoin. Il l'a reconnue, saisie, délivrée. Elle s'élève dans les airs. Ils palpitent, croient sortir d'un long sommeil, accourent. Vintras exprime l'ineffable» (p. 145).
savent pas où chercher les veines profondes d'une eau d'autant plus vivifiante qu'elle reste à l'abri de toute forme de pollution. Voici encore un exemple de ce mouvement de descente irrésistible vers un gisement invisible puis d'extraction, de rapide remontée qui semble mimer l'exaltation contagieuse de cet étrange squelette point tout à fait minéral, de cet homme point complètement de chair pourrie que montre telle splendide sculpture de Bar-le-Duc (dite du Transi de René de Chalon) que cite notre roman ! : «L'univers est perçu par Vintras d'une manière qu'il n'a pas inventée, et qui jadis était celle du plus grand nombre des hommes. Il appartient à une espèce quasi disparue, dont il reste pourtant quelques survivants ! Quelle n'est pas leur ivresse ! Vintras est allé jusqu'à cette mélodie qu'ils soupçonnaient, dont ils avaient besoin. Il l'a reconnue, saisie, délivrée. Elle s'élève dans les airs. Ils palpitent, croient sortir d'un long sommeil, accourent. Vintras exprime l'ineffable» (p. 145).Léopold, assurément, présente «un mélange de platitude et d'extravagance, mais en lui le passé était plein de vitalité» et c'est encore «en lui, comme des plus vieilles couches de la sensibilité et du tuf [Bernanos encore !] éternel de l'homme, [que] jaillissent des sources quasi taries» (p. 172). Ce «quelque chose d'antique» a tout intérêt à être maîtrisé par l’Église pesant de tout le poids de son autorité et de «toutes les forces de la hiérarchie échelonnées jusqu'à Rom» (p. 237), institution vers laquelle ne semble guère aller la sympathie profonde de l'écrivain Maurice Barrès, bien conscient qu'ils ne reviendront jamais, «les siècles de jadis» et que s'ils «sont blottis, tout fatigués et dénaturés contre nos âmes, et que dans un cri, dans un mot, dans un chant sacré, ils se lèvent d'un cœur sonore», alors ce sont tous les cœurs qui «en seraient bouleversés» (p. 232).
La question essentielles demeure, à mon sens du moins, posée, que nous pourrions figurer par cette alternative moins sommaire qu'il n'y paraît : est-ce que nous assistons à un mouvement de balancier finalement assez naturel en constatant la cavalcade furieuse des forces anciennes, qu'importe que pèse sur elles le couvercle du dogme chrétien, ou bien est-ce parce que la colline inspirée trône depuis longtemps déjà sur une paroisse morte, comme l'illustre le personnage de Léopold Baillard qui lui-même, nous dit Barrès, expérimente une lente dissolution de son christianisme que, «du fond de son être montent de vagues formes, tous les débris d'un monde» (p. 234) et que s'animent, comme le mouvement d'un «long serpent dont la tête s'avance et qui se coupe, disparaît par fractions dans les granges et les portes cochères, aussitôt refermées, sans que la marche de l'ensemble soit arrêtée un moment» (p. 241), «des parties obscures de l'âme» (p. 248), quelques signes néfastes de «l'attrait de ces régions délaissées qui subsistent toujours au fond de nos cœurs et de ces rêves brouillés auxquels personne aujourd'hui, dans notre monde intellectuel, ne donne plus de sens ni de voix» (pp. 261-2) ? Parier sur la première hypothèse serait affirmer que, en dépit de tant de coups, parfois rudes, reçus, la forteresse chrétienne tient encore à peu près debout, alors que le fait de privilégier la seconde interprétation, ce serait admettre que Barrès, comme plus tard Bernanos dans Monsieur Ouine a plus ou moins obscurément senti la vitalité nouvelle, peut-être même jamais réellement perdue mais atténuée pendant les siècles durant lesquels l’Église a étendu son rigide royaume terrestre, du Grand Dieu Pan célébré par Arthur Machen. Quelque confrontation plus poussée entre La Colline inspirée et le dernier roman de Bernanos pourrait, sur ce point d'une résurgence d'une «atmosphère magique, encore accrue par le thème énigmatique exhalé de la fosse d'où venait de surgir le petit dieu inconnu» (p. 236), devrait sans doute être menée.
Je n'oserais choisir entre ces deux voies interprétatives, mais Maurice Barrès, lui, semble estimer que c'est depuis bien trop longtemps que notre monde, débarrassé de ses légendes, de ses «fées au bord des fontaines», de ses fantômes rôdant dans les cimetières, est en train de mourir, Léopold Baillard, lui-même présenté comme «las d'une religion dont l'autel ne nourrissait plus ses prêtres» (p. 216), ayant en somme désappris ce que son éducation l'empêchait de voir, s'étant, contre vents et marées, insultes et railleries, tenu droit pour faire une place à ces esprits tourmentés qui néanmoins «flottent toujours sur leurs domaines, et que nous verrions si notre âme avait reçu l'éducation appropriée» (p. 227).
Notes
(1) Ce livre a été publié en 1993, le lieu d'édition étant Monaco. La copie du texte barrésien est assez soignée (cf. p. 67, un et non «une faible d'esprit»).
(2) Voici ce qu'il est dit, par exemple, de Léopold Baillard : «Du milieu de ses obscures redondances, assez pareilles aux orchestrations d'un charlatan de foire, il terrifiait son monde en prédisant la catastrophe finale, puis il le rassurait en offrant de donner après l'office, dans la sacristie, un mot de passe qui garantirait le salut» (p. 105).
(3) Notons d'ailleurs, ici ou là, un ton, moins même, une simple phrase, que l'on pourrait dire, rétrospectivement bien sûr, bernanosiens dans le texte de Barrès : ce n'est pas seulement «Et maintenant c'est l'heure intime, l'heure du crépuscule» (p. 77) qui annonce l'auteur de Sous le soleil de Satan, mais aussi ce genre de notation : «Est-ce l'aube déjà ou sa mémoire surexcitée qui lui fait distinguer vaguement sur les murailles, dans leurs grands cadres, les portraits des saints fondateurs d'ordres ?» (pp. 49-50). Remarquons que Bernanos, évoquant la présence maligne auprès de celui qui n'est pas encore le saint de Lumbres, saura être beaucoup plus explicite que Barrès décrivant la visite faite à Léopold, par une entité dont nous ne connaissons pas l'origine, divine ou infernale : «Soudain, il sentit quelque chose entrer dans sa chambre et s'arrêter auprès de son lit. Une sueur d'effroi couvrit tout son corps, mais il ne pensa pas à lutter, ni à appeler. Ce qu'il sentait là, près de lui, vivant et se mouvant, c'était abstrait comme une idée et réel comme une personne. Il ne percevait cette chose par aucun de ses sens, et pourtant il en avait une communication affreusement pénible» (p. 54). Nous pourrions également songer à Huysmans décrivant, dans En Route, l'expérience, comparable bien qu'évoquée beaucoup plus longuement, de Durtal. Nous retrouvons aussi dans La Colline inspirée l'idée chère à Huysmans puis à Massignon d'une substitution mystique lorsque le Père Aubry paie, en quelque sorte, pour le salut de Léopold Baillard (cf. p. 273), dont la déchéance est du reste comparée à la passion du Christ.
19/12/2021 | Lien permanent
L'Ascension de Monsieur Baslèvre d'Édouard Estaunié

 L'Ascension de Monsieur Baslèvre, publié par Édouard Estaunié en 1917, est un roman oublié que l'excellent Charles Du Bos a pu rapprocher de Confession de minuit de Georges Duhamel, écrivant, dans ses remarquables Approximations, qu'il aurait pu s'agir d'un texte presque parfaitement réussi «si la philosophie y [était demeurée] toujours dans l'éloquence des faits eux-mêmes», ajoutant toutefois que c'est une «excellente peinture d'un homme quelconque, mais dont l'ascension précisément consiste en la lente genèse d'une conscience de nature toute morale» (2). Charles Du Bos, d'une sensibilité esthétique aussi rare qu'exceptionnelle, ne fait pas l'erreur de penser que le sommet que Monsieur Baslèvre gravit à son insu, du moins pour une bonne partie de l'ascension, lui réserverait une illumination d'ordre spirituel, voire religieux; le personnage d'Estaunié se dépouille de toutes ses vieilles peaux, mais la béatitude dans laquelle, vivant, il pénètre, n'est pas la joie pure du saint.
L'Ascension de Monsieur Baslèvre, publié par Édouard Estaunié en 1917, est un roman oublié que l'excellent Charles Du Bos a pu rapprocher de Confession de minuit de Georges Duhamel, écrivant, dans ses remarquables Approximations, qu'il aurait pu s'agir d'un texte presque parfaitement réussi «si la philosophie y [était demeurée] toujours dans l'éloquence des faits eux-mêmes», ajoutant toutefois que c'est une «excellente peinture d'un homme quelconque, mais dont l'ascension précisément consiste en la lente genèse d'une conscience de nature toute morale» (2). Charles Du Bos, d'une sensibilité esthétique aussi rare qu'exceptionnelle, ne fait pas l'erreur de penser que le sommet que Monsieur Baslèvre gravit à son insu, du moins pour une bonne partie de l'ascension, lui réserverait une illumination d'ordre spirituel, voire religieux; le personnage d'Estaunié se dépouille de toutes ses vieilles peaux, mais la béatitude dans laquelle, vivant, il pénètre, n'est pas la joie pure du saint.Cette ascension discrète n'a bien évidemment rien à voir, toute laïque qu'elle demeure et quand bien même elle serait auréolée d'une étrange accointance avec le royaume des morts, avec celle, de pure force et de volonté intraitable, de Rastignac dans Le Père Goriot, même si Justin Baslèvre, dont les prénom et patronyme résument, comme on le voit souvent chez tel ou tel personnage de Georges Bernanos, la tranquille médiocrité d'un haut fonctionnaire se contentant de n'exécuter que les tâches qui lui incombent, est lui aussi monté à la capitale depuis son Limousin natal; de fait, le seul à nous deux, maintenant ! qu'il pourrait oser hurler, mais dans sa tête uniquement, aurait le caractère secret et spéculaire de quelque cœur simple, d'une vie minuscule qui, ayant vu un visage de femme qui l'a frappé, se met subitement à vivre ou plutôt revivre, s'élève à une hauteur insoupçonnée.
J'ai évoqué Bernanos et ce n'est pas seulement la caractérisation, par un patronyme ridicule, de la médiocrité d'un personnage, songeons ainsi à Pernichon, qui peut rendre intéressant le roman d'Estaunié car, comme chez le Grand d'Espagne, nous ne percevons, dans L'Ascension de Monsieur Baslèvre, que les linéaments d'un drame de la conscience qui se joue dans les profondeurs, au dernier recès comme l'eût écrit l'auteur de Sous le soleil de Satan ou, bien mieux encore pour illustrer ce rapprochement de sourde fermentation, L'Imposture. Bien sûr, le travail de la grâce, chez Estaunié, semble être infiniment plus fragile que chez Bernanos, et nous avons du reste quelque mal à parler de grâce autrement qu'à titre de métaphore, Albert Thibaudet ayant pu à juste titre affirmer qu'Estaunié cherchait une espèce d'équivalent laïque à cette dernière, une illumination qui n'aurait guère besoin d'une transformation de fond en comble de la personne qu'elle visite et remodèle et retourne sur elle-même, en somme, convertit.
Ce n'est à vrai dire pas la seule façon de rapprocher Georges Bernanos, du moins dans son premier roman publié en 1926, d'Estaunié, comme on a pu citer, à son propos, d'autres romanciers fins psychologues tels que Paul Bourget, René Bazin ou Marcel Prévost : j'ai ainsi noté un tic d'écriture dont ne se débarrassera pas tout de suite Bernanos romancier et qui, dans le roman d'Estaunié, finit par agacer par la petite musique professorale qu'il dégage, comme un résumé ramassant en quelques mots bien frappés l'intérêt d'un cours; cela donne, par exemple : «Si simple et si retirée qu'on l'imagine pourtant, une vie est toujours guettée par le destin» (p. 12) ou encore : «Il suffit d'une secousse légère pour détacher la scorie du lingot et découvrir le métal pur» (p. 134), et tant d'autres occurrences toutes bâties sur le même patron monodique, qui ont pu laisser penser qu’Édouard Estaunié n'était qu'un auteur à thèse.
Tout est médiocre, du moins en apparence, chez Justin Baslèvre aux yeux de qui «la pâte humaine dût être exclusivement consommée sous l'espèce administrative» (p. 11) qui, encore, tire gloire «du fait que, dans sa division, chaque matin les gens s'emboîtaient devant leurs tables comme des parapluies dans les cases d'un vestiaire, y demeuraient leurs six heures rigoureusement et disparaissaient ensuite sans qu'on en sût plus rien jusqu'au lendemain» (p. 28), ce même falot personnage qui, pourtant, avant même de voir le visage de l'épouse, Claire, d'une de ses anciennes connaissances que l'on verra vite gruger son petit monde féminin, comprendra qu'il y a en lui un être qu'il ne soupçonnait pas, résolu à bouleverser sa propre vie (cf. p. 24), tout prêt à l'emporter vers l'inconnu se tenant, tranquille, attendant sa minute, à un coin de rue ou dans l'intérieur bonhomme d'un appartement, comme si tout n'était qu'affaire de tension, de résistance et, finalement, de libération, de largage des amarres vers la puissante houle dont on ne sait trop où elle vous mènera : «On voit aussi des bâtons accrochés à la rive qui, saisis par le courant, se tendent, reviennent à la place primitive et semblent libérés : l'eau pourtant n'arrête pas son cours, et brusquement, à l'heure dite, terre et bois, tout est emporté vers l'inconnu...» (p. 30), conclut ainsi Édouard Estaunié dans l'un de ces passages si décidément didactiques, mais dont le didactisme ne parvient pas tout à fait à gâcher la beauté, et nomme à vrai dire chacun des assauts discrets, presque insaisissables, que l'invisible mène autour des êtres les plus butés.
 Comme dans La Vie secrète datant de 1908, tout est frémissement, non-dit, approche de l'inconnu, secret jalousement gardé, motif dans le tapis aussi, comme l'illustra génialement Henry James et, d'un mot que n'eût point désavoué Gabriel Marcel qui par bien des aspects de sa réflexion rejoint celle d'Estaunié (3), mystère, dans L'Ascension de Monsieur Baslèvre car, «dès qu'on approche un être humain on touche à l'inconnu» (p. 44), car, dès qu'on l'approche, on soupçonne le jeu de puissantes forces qui, bien qu'invisibles, ont «quelque chose de fatal et de puissant comme le remous de la mer», comme s'il s'agissait décidément de prendre de la hauteur, de corps, de parole et d'esprit, en désertant le plancher des vaches, des veaux et même des lièvres auxquels fait songer le ridicule patronyme de notre fonctionnaire, et de la hauteur pour, non pas contempler d'un point de vue privilégié la surface balayée de «brises nonchalantes», mais pour pénétrer dans «un creux de la houle» et ainsi pour y voir, «épouvanté par le déchaînement de force et la puissance de destruction individuelle qu'il recèle» (p. 58), l'essentiel, autre nom du mystère à l’œuvre selon l'écrivain.
Comme dans La Vie secrète datant de 1908, tout est frémissement, non-dit, approche de l'inconnu, secret jalousement gardé, motif dans le tapis aussi, comme l'illustra génialement Henry James et, d'un mot que n'eût point désavoué Gabriel Marcel qui par bien des aspects de sa réflexion rejoint celle d'Estaunié (3), mystère, dans L'Ascension de Monsieur Baslèvre car, «dès qu'on approche un être humain on touche à l'inconnu» (p. 44), car, dès qu'on l'approche, on soupçonne le jeu de puissantes forces qui, bien qu'invisibles, ont «quelque chose de fatal et de puissant comme le remous de la mer», comme s'il s'agissait décidément de prendre de la hauteur, de corps, de parole et d'esprit, en désertant le plancher des vaches, des veaux et même des lièvres auxquels fait songer le ridicule patronyme de notre fonctionnaire, et de la hauteur pour, non pas contempler d'un point de vue privilégié la surface balayée de «brises nonchalantes», mais pour pénétrer dans «un creux de la houle» et ainsi pour y voir, «épouvanté par le déchaînement de force et la puissance de destruction individuelle qu'il recèle» (p. 58), l'essentiel, autre nom du mystère à l’œuvre selon l'écrivain. Bien des fois nous pouvons lire ce genre de phrase : «La soirée dont M. Baslèvre s'effrayait, fut ainsi la plus simple, la moins fertile en incidents que l'on pût imaginer : l'essentiel y demeura souterrain, moins fait de gestes que de résonances intérieures, de paroles prononcées que de mouvements inexprimés» (p. 78), l'intrigue du roman n'ayant bien sûr aucun intérêt, ce dernier demeurant dans ce qui nous est caché de prime abord, puis méthodiquement révélé par une écriture aux vertus cachées, une langue qui ne paye absolument pas de mine pour ainsi dire et que l'on dirait armée d'une force pourtant implacable dans la modestie de ses effets, et capable de forer le métal le plus dur avec plus d'efficacité qu'une foreuse en diamant maniée par un auteur sûr de sa vélocité et de ses effets grandiloquents, montrant d'un signe du menton la formidable profondeur qu'il a pu atteindre. Chez Estaunié, bien au contraire, il s'agit de parvenir à capter, sans même devoir s'y attarder, deux ou trois faits dessinant, «comme des rides, le travail intérieur qui couvait sous les apparences normales» s'il est vrai que : «Pour retracer une évolution ainsi dissimulée, il faudrait, avec des mots sans contour, reproduire des mouvements encore plus impalpables. Le voyage d'un cœur ressemble à une croisière : on y passe d'un hémisphère à l'autre sans que l'horizon change...» (p. 87). Quoi qu'il en soit, sans même que nous ayons bougé plus de quelques mètres d'une scène à l'autre, l'espèce de drame statique auquel nous convie Estaunié nous donne un assez clair aperçu des courants qui parcourent les plus profondes vallées sous-marines, laissant parfois s'échapper, vers la surface, une drôle de créature pâle et presque complètement transparente sur laquelle Estaunié pose un nom connu de tous : quoi, c'était donc cela la jalousie ? C'est donc cela, l'amour ?
Dans cette tâche qui est, autant qu'une ascension, un éveil (4), il serait faux de croire que, sous leur platitude et immobilité apparentes, les choses sont inertes ou muettes; c'est tout le contraire, même, selon Estaunié, comme il le montre plus d'une fois, notamment dans un magnifique début de chapitre où il évoque les maisons parisiennes qui, en raison des êtres qu'elles abritent, s'accordent intimement aux personnalités dont elles ne cessent plus, alors, de rappeler le souvenir : «On reconnaît aux seules heures d'allumage ou d'extinction les maisons de riches et les maisons de pauvres, celles où l'on épargne, et celles où l'on gâche. Au total, chacune révèle l'âme de ses habitants, tant est puissante la pénétration des choses par celui qui s'en sert» (p. 68), comme le montrera du reste la volonté de Monsieur Baslèvre d'acquérir l'appartement, sans rien toucher à son ameublement, où Claire a vécu avec son mari puis est morte si soudainement.
L'attention aux «toutes petites choses», qu'un rayon de lumière «projeté plus tard» mettra en relief «pour faire découvrir rétrospectivement combien elles étaient grandes» (p. 89), n'est que l'autre aspect de la remarquable faculté de concentration d'Estaunié sur ce qu'il importe de révéler, car c'est bien «au plus creux du sillon, sous une terre qui paraît morte, que s'élabore le prodigieux enfantement du blé qui doit lever» (p. 92), sur ce qu'il importe encore de parvenir à entendre et écouter, à retenir, tu, à l'abri des confidences et d'une parole dispendieuse, dans son esprit, et cela qu'importent les mots prononcés puisque, au-delà «des phrases ainsi jetées du bout des lèvres, d'autres phrases dont le sens était perceptible pour eux seuls» (p. 111, il s'agit de Monsieur Baslèvre et de la maîtresse du mari de Claire, Melle Fouille) doivent être lues.
C'est donc dans un décor des plus anodins, certes pas médiocre puisque le romancier parvient à magiquement animer les scènes les plus humbles de la vie parisienne, que se lève l'invisible qui nous déborde de toutes parts, qu'il est impossible de rejeter comme une harassante chimère dès lors qu'on a cru apercevoir son existence, au détour je l'ai dit d'un mot, moins que cela, d'un geste esquissé, d'un silence : il n'y a ainsi «jamais de véritable fin aux aventures humaines et toutes s'achèvent pourtant» (p. 114), l'amour bien sûr ne constituant pas une exception à cette règle puisqu'il est bien certain, comme se laisse à le penser Monsieur Baslèvre, qu'un grand amour muet est certainement «la plus belle fleur qui ait jamais paré une âme humaine» (p. 121), qu'importe qu'elle n'ait éclose que quelques heures et, j'allais même dire : peu importe qu'elle ait eu le temps de laisser échapper sa subtile et éphémère fragrance (5).
 C'est ainsi dans l'absence absolue, la mort de l'être aimé, qu'Estaunié croit saisir la réelle présence qui jamais ne s'altérera, le décor, le paysage, les demeures, les objets permettant, à ceux qui restent, de découvrir avec une certitude et une joie bouleversantes les traces de la morte partout présente, adressant même des signes discrets mais irréfutables, passée toutefois la douleur, véritable sas nous permettant d'accéder au monde supérieur qui ceint le nôtre, douleur dont la «limite excède la conception humaine» (p. 154), mais qui ne renversera pas Monsieur Baslèvre qui, depuis sa rencontre avec Claire, a relevé la tête. C'est au prix d'un dépouillement total, Monsieur Baslèvre n'ayant jamais su, du temps qu'elle était encore en vie, si Claire l'aimait comme lui l'aimait, passionnément, ou même si elle l'aimait, que la présence de l'aimée sera reconquise, cette fois-ci définitivement, mais les étapes de cette dépossession qui est glorieuse reprise ont pu être atroces avant de s'épurer vers la libération finale, qui est, je l'ai dit, moins une consolation qu'une douce certitude d'être en présence même de celle qui a disparu : «Ainsi, pas un lieu où se donner désormais l'illusion d'approcher d'elle : chez lui, pas une photographie. Sans la lettre à laquelle il n'osait toucher, il aurait pu croire que l'aventure n'avait pas existé : à coup sûr, elle paraissait finie et seuls des souvenirs, revenant par grandes ondes, ridaient de loin en loin la surface du temps, tels des cercles sur un lac quand une pierre vient de toucher le fond» (p. 171). C'est ainsi que Monsieur Baslèvre conquiert Claire, et peut jouir de «la beauté de l'aimée purifiée au creuset de l'épreuve et sans cesse grandie», Claire, par-delà sa mort, ayant peu à peu obligé celui qui ne lui aura, tout au plus, qu'une ou deux fois tenu la main, «à comprendre ce qu'est l'amour et quels renoncements l'élargissent en faisant monter l'âme ! comme, guidé par elle, il avait gravi la côte et toujours respiré un air plus vif !» (p. 172).
C'est ainsi dans l'absence absolue, la mort de l'être aimé, qu'Estaunié croit saisir la réelle présence qui jamais ne s'altérera, le décor, le paysage, les demeures, les objets permettant, à ceux qui restent, de découvrir avec une certitude et une joie bouleversantes les traces de la morte partout présente, adressant même des signes discrets mais irréfutables, passée toutefois la douleur, véritable sas nous permettant d'accéder au monde supérieur qui ceint le nôtre, douleur dont la «limite excède la conception humaine» (p. 154), mais qui ne renversera pas Monsieur Baslèvre qui, depuis sa rencontre avec Claire, a relevé la tête. C'est au prix d'un dépouillement total, Monsieur Baslèvre n'ayant jamais su, du temps qu'elle était encore en vie, si Claire l'aimait comme lui l'aimait, passionnément, ou même si elle l'aimait, que la présence de l'aimée sera reconquise, cette fois-ci définitivement, mais les étapes de cette dépossession qui est glorieuse reprise ont pu être atroces avant de s'épurer vers la libération finale, qui est, je l'ai dit, moins une consolation qu'une douce certitude d'être en présence même de celle qui a disparu : «Ainsi, pas un lieu où se donner désormais l'illusion d'approcher d'elle : chez lui, pas une photographie. Sans la lettre à laquelle il n'osait toucher, il aurait pu croire que l'aventure n'avait pas existé : à coup sûr, elle paraissait finie et seuls des souvenirs, revenant par grandes ondes, ridaient de loin en loin la surface du temps, tels des cercles sur un lac quand une pierre vient de toucher le fond» (p. 171). C'est ainsi que Monsieur Baslèvre conquiert Claire, et peut jouir de «la beauté de l'aimée purifiée au creuset de l'épreuve et sans cesse grandie», Claire, par-delà sa mort, ayant peu à peu obligé celui qui ne lui aura, tout au plus, qu'une ou deux fois tenu la main, «à comprendre ce qu'est l'amour et quels renoncements l'élargissent en faisant monter l'âme ! comme, guidé par elle, il avait gravi la côte et toujours respiré un air plus vif !» (p. 172).Ainsi, il semble assez peu important, à la toute fin d'une aventure humaine de toute façon condamnée à s'arrêter tôt ou tard, qu'une ville change, que certains immeubles ou même quartiers entiers soient détruits; certes, «à Paris, les pierres roulent comme les gens et passent avec eux» (p. 174), mais il est possible, par le biais d'une ascension toute intérieure dont Monsieur Baslèvre aura figuré les stations profanes, de se dépouiller de tout, tout ayant été sacrifié, les lieux et les êtres, y compris «la mémoire de Claire»; alors, la cime est atteinte et, après, comme l'affirme Estaunié désireux de donner un visage pour le moins stoïque au mystère grondant, vivant, qui se minéralisera ou au contraire se diluera peut-être faute d'être perpétuellement nourri par autre chose qu'une sorte d'équilibre cosmique, quelque bizarre et probablement intenable point de Lagrange de l'âme (6), et reprendra la place insignifiante qui aura toujours été la sienne, et, après donc, «il n'y a plus que la sérénité des espaces solitaires...» (p. 194).
Notes
(1) Édouard Estaunié, L'Ascension de Monsieur Baslèvre (Le Livre moderne illustré, J. Ferenczi et fils, éditeurs, d'après les bois gravés par Girard, 1938). La première édition de ce roman, chez Perrin, date de 1921. Plusieurs fautes sont à signaler comme : sans et non «sais crises» ( p. 26); tant je vous l'ai dit et non «tant que je vous l'ai dit» (p. 98); mon et non «moi passé» (p. 101); la manquant devant «sincérité de la passion» (p. 120); il et non «li ne quittait pas» (p. 145); une et non «un de ses mains» (p. 151). Une réédition datant de 2000, préfacée par Jacques Jaubert, est disponible aux éditions Mémoire du livre, à laquelle nous renvoyons.
(2) Charles Du Bos, Approximations (Éditions des Syrtes, 2000), p. 593.
(3) Le point de convergence le plus frappant entre Estaunié et Gabriel Marcel est la méditation aussi constante que douloureuse sur la mort, que le premier définit, superbement, en quelques mots, comme étant «du silence, alors qu'on interroge» (p. 177), définition admirable que n'eût point désavouée, je crois, l'auteur d'Homo viator.
(4) Voir En chemin vers quel éveil ? (Gallimard, 1971).
(5) Quelques minutes de recherche nous apprennent que, comme René Boylesve, Édouard Estaunié aura aimé en secret une jeune fille qui en épousera un autre sans avoir eu connaissance de ses sentiments.
(6) Je sais bien que ce n'est pas la conclusion à laquelle parvient Estaunié, car la fin de notre roman parle, bien au contraire, d'une «immense tendresse [qui est] hors d'atteinte, défiant les hasards de l'existence» qui illumine le chemin de Monsieur Baslèvre, puisque «Claire ne le quitterait plus» et que, sûr de l'aimer, étant indifférent au fait de savoir si c'est «elle qui vivait en lui ou lui en elle», il était certain de «lui répondre par une constance égale, et dormeur éveillé n'aurait pu découvrir s'il vivait le rêve ou la réalité !...» (p. 206).
12/01/2023 | Lien permanent
Lettre(s) pour emmerder les catholiques progressistes

 À Robert Vallery-Radot, le 15 janvier 1964.Mon père,Votre lettre n’a fait que confirmer ce que je ressens dans mon apocalypse actuelle, m’incitant à poursuivre plus totalement encore le but que je me suis défini de préparer la terre aux levains futurs, puisqu’il faut que le grain se meure et que nous, nous devons passer sous la meule comme certaines autres générations ont dû mourir au feu. Nous mourrons de solitude. Notre mort sera légère et sèche comme la poussière qui vole. Tout remonte à la guerre d’Espagne, à l’ouverture des temps modernes – le dernier romantisme guerrier – et à cette fin des Temps modernes un été de 1945 à Berlin. Depuis 1945, on assiste dans le monde occidental à un morcellement de la littérature, de même qu’une terre sans eau se craquelle et sur la croûte âpre tous ceux qui avaient du talent à vingt ans à la Libération sont morts ivres de désespoir de s’être pris pour des étoiles. En notre temps, certains avaient entrepris de fixer le langage pour repartir sur le sable. Et notre époque si intelligente, qui a toute la solitude des machines, ne secrétera de grands créateurs que dans cinquante ans peut-être (en serons-nous ?). En attendant, dans le crépuscule, sur nos cerveaux humides et ondulants, se préparera l’avenir. Et nous, qui faisons tout pour avoir des frères, notre solitude est si totale que, petites silhouettes enfermées dans nos lanternes, nous nous fabriquons des lumières avant la dissolution dans l’infini.Dominique de Roux, Il faut partir. Correspondances inédites 1953-1977 (Fayard, 2007), p. 196.
À Robert Vallery-Radot, le 15 janvier 1964.Mon père,Votre lettre n’a fait que confirmer ce que je ressens dans mon apocalypse actuelle, m’incitant à poursuivre plus totalement encore le but que je me suis défini de préparer la terre aux levains futurs, puisqu’il faut que le grain se meure et que nous, nous devons passer sous la meule comme certaines autres générations ont dû mourir au feu. Nous mourrons de solitude. Notre mort sera légère et sèche comme la poussière qui vole. Tout remonte à la guerre d’Espagne, à l’ouverture des temps modernes – le dernier romantisme guerrier – et à cette fin des Temps modernes un été de 1945 à Berlin. Depuis 1945, on assiste dans le monde occidental à un morcellement de la littérature, de même qu’une terre sans eau se craquelle et sur la croûte âpre tous ceux qui avaient du talent à vingt ans à la Libération sont morts ivres de désespoir de s’être pris pour des étoiles. En notre temps, certains avaient entrepris de fixer le langage pour repartir sur le sable. Et notre époque si intelligente, qui a toute la solitude des machines, ne secrétera de grands créateurs que dans cinquante ans peut-être (en serons-nous ?). En attendant, dans le crépuscule, sur nos cerveaux humides et ondulants, se préparera l’avenir. Et nous, qui faisons tout pour avoir des frères, notre solitude est si totale que, petites silhouettes enfermées dans nos lanternes, nous nous fabriquons des lumières avant la dissolution dans l’infini.Dominique de Roux, Il faut partir. Correspondances inédites 1953-1977 (Fayard, 2007), p. 196.
22/07/2007 | Lien permanent
The Road by Cormac McCarthy

«They are gone now. Fled, banished in death or exile, lost, undone. Over the land sand and wind still move to burn and sway the trees, the grasses. No avatar, no scion, no vestige of that people remains. On the lips of the strange race that now dwells there their names are myth, legend, dust.»
Cormac McCarthy, The Orchard Keeper (New York, Vintage International, 1993 [1965]), p. 246.
«What discordant vespers do the tinker’s goods chime through the long twilight and over the brindled forest road, him stooped and hounded through the windy recrements of day like those old exiles who divorced of corporeality and enjoined ingress of heaven or hell wander forever the middle warrens spoorless increate and anathema.»
Outer Dark (New York, Random House, 1968), p. 229.
«Were there darker provinces of night he would have found them.»
Child of God (New York, Vintage International, 1993 [1973]), p. 23.
To the memory of Vincent Murlin. May you find, along the white road, some warmth and solace
To be sure, Cormac McCarthy’s The Road brings to mind the bare-bones writing style of the early Hemingway and the late Beckett, crammed with silences which, at times, seem to take up more space than the text itself. Such writing reminds us of Shakespeare’s darkest tragedies (and of the fiery exuberance of his language, a point André Bleikasten, who doesn’t know English, disregards, to his own loss), the imagery of demonic symbolism that Conrad disseminates, like puzzling enigmas, the length of the river slowly navigated by Marlow, the aimless wandering of the characters in Steinbeck’s The Grapes of Wrath, the thought expressed in Golding’s The Lord of the Flies to the effect that savagery cannot be superseded by progress, the flimsiness of the veil that separates us from that savagery barely hidden by the veneer of proper feelings and advanced technology, as can be seen in H. G. Wells’ The Island of Doctor Moreau (as well as in The Time Machine and in The War of the Worlds). But it is primarily from Cormac McCarthy’s earlier novels (1), especially No Country for Old Men, that The Road has taken nourishment for itself. The concluding lines of that novel describe the Sheriff’s dream (in which he sees himself as a boy who, in the middle of the night, follows on the steps of his father, who, while holding in front of him a makeshift lamp, disappears in the darkness) which lays the stage for the adventure plot that unfolds in The Road.
McCarthy adopts the high-strung writing style, admirably precise and superbly concise of his earlier novels, though he does not adopt their unrestrained rhythm. He doesn’t abstain – in a more far-reaching manner than in the previous novel – from evoking the somber beauty of a devastated world. Nor does he abandon, even for a brief moment, the aimless wandering of his two protagonists. McCarthy’s writing thus evokes the hypnotic atmosphere of Bernanos’ tormented Monsieur Ouine, and seems to turn away from a world destroyed by all-out nuclear war so as to go looking for the last trace of charity hidden away somewhere in the universe.
So where is such charity to be found ? In a few essential gestures of survival, in the words exchanged between a father and his son, in the painful dream of a long-lost, broken world, in a few encounters – as beautiful as they are rare – with those men who have not reverted to savagery. It is barely discernible in a society that, from now on, finds itself ravaged and devastated.
It is, then, a time of wolves, of ancient legends, an age in which a father and his son must withstand unremitting harshness: McCarthy at least does not hesitate to remind us that men can hold themselves up without any societal support. In short, in the eyes of these two human beings, the number of survivors who have turned into wolves is, when you get down to it, totally unimportant, because they have decided to support each other and hold on to each other to avoid sinking into the abyss.
Savagery must be willfully desired, embraced, like a mistress worthy of her name. It cannot take hold of the man if the latter has divested himself of the clear vision of Good and Evil.
Kurtz has become savagery incarnate (if erratically so) only because he has allowed himself to be overwhelmed by the dark torrent. To tell the truth, he was empty, as Conrad, and T. S. Eliot remarked afterwards, and Bernanos and Broch later confirmed.
McCarthy’s most sinister characters can never be explained away by recourse to such regrettable social causes as would make our responsibility entirely fade away in the throes of dismal sociological misery: an unhappy childhood, an abused mother, an alcoholic, slightly fraudulent father, an upbringing in a broken-down housing project, and so on.
Consider Suttree: a social outcast, a poor devil, a drifter who, despite it all, is a great man with his mind full of endless nonsense. There is no question as to why bad literary journalists, ever since the publication of No Country for Old Men, have criticized this novelist for being patronizing, conservative, and even reactionary. For crying out loud! Why do these nitwits not let us read in peace McCarthy’s novels, and why have they not been able to see that this novel, a vision of absolute devastation, inaugurates more than it destroys, in as much as it inaugurates on the basis of destruction itself. I will return to this shortly.
Whatever McCarthy’s apparent digressions might be, he stamps in the novel his masterly seal with an imprint which had never before been so admirably to the point as it is in The Road. In an atmosphere of imminent danger, his prose ventures through many unimaginable realms – beginning with his old recollections of the father, of the longing for an immemorial past – all the way to a dizzy fall into the abyss of space and the exploration of arcane regions of the Earth. And all of this, in the end, in order to once again whirl, like an appeasing breeze, around the father and the son… a breeze that leads them toward unassuming adventures. When all is said and done, is not the novelist’s proper role to lead, given the fact that he gives birth to characters who find sustenance in their own blood ? (2).
At no moment does McCarthy distance himself from his characters: he observes them, prepares small surprises for them (a shelter, food, clothes), lays out before them a road charged with rich symbolic meaning. The via rupta is the path he opens up by tearing through the wall of adversity. In this post-apocalyptic world, described by the novelist as merciless and deserted, immobility is death itself (a description based in all likelihood on the conclusions made popular by Carl Sagan and his team of scientists in The Cold and the Dark (3). The road is the typical image of Bernanos’ narrative, which deeply moved Julien Gracq, as the latter has acknowledged in one of his literary essays. For its part, the aimlessly shifting road is one of McCarthy’s favorite narrative settings, which he never tires of portraying time and again in each one of his novels.
Cormac McCarthy literally approaches his characters as if he were a Good Samaritan overwhelmed by the pity he feels for the dwellers of the earth. At the same time, it is the young one who seems to give the father the strength necessary to keep on walking, whatever the cost (see the child’s own words, p. 222) toward the less savage and bleak seaboard.
Our novelist (and for similar reasons, one of his most touching creations : the child) deserves to be called Christophoros (4), a name used by Bloy to describe the secret role of the Revealer of the Globe, as he himself called Christopher Columbus. The road and the act of discovery are two sides of one and the same reality. As symbols, they have given rise to the most renowned literary and metaphysical Odysseys our culture has produced.
What does this savage and blasting novel reveal to us ? The inauguration of a new Christianity which cares very little whether Rome has been destroyed or not. And yet we don’t hear anything about the Church. We have been provided only with a few scant details which, it would seem, barely caught McCarthy’s attention : it is said (p. 16) that America has been run over by «bloodcults». As opposed to Maurice Dantec, Cormac McCarthy ridicules the accounts of the epic and bloody struggles described by the enemies of the Church to the last representatives of the Order (5). He doesn’t even seem concerned, as it progresses through Iron Ages, about the skull, hidden away in some basement, laughing derisively at Leibowitz, whose wisdom will restore life back to civilization (which itself shall reappear, a few centuries following the Renaissance, destroyed, for all purposes, by the great conflagrations).
This new Christianity, therefore, will be totally identical with the first communities that originally heard the Good News – they will also have to go into hiding and live constantly exposed to the threat of extermination. And yet, it will survive. The question of the existence of God will not even be paramount. Quite possibly, God Himself has been swept away by the dust and ashes that enveloped the entire world, the seas and the oceans, darkening the atmosphere and veiling the sun.
What’s the sense, then, of summoning back the voice of Job ? Must he be cursed (p. 16), must he give in to despair (p. 34), must he wildly think that true life – in this almost completely dead world – has perhaps taken refuge in death itself (p. 24) ? Must he say to the unbelieving that He – that God – has gone insane and is being worshiped by men who have turned into beasts – and is hiding in the son who protects the father to his last measure of strength, calling him simply Dad ? Without a home in the world, the child has not become dispirited upon witnessing madness, despair (his mother’s, who has committed suicide), pestilence, and Evil. The young one has managed to preserve the power of speech, for it is God Himself who goes on speaking, since «If he is not the word of God God never spoke.» (p. 4).
That heart-wrenching fragility of beauty – which, at any rate, has been for ever lost – is in and of itself sufficient for Cormac McCarthy. And this extreme nakedness, this emaciation of language itself (cf. pp. 80, 156) – which can be reduced to a few amorphous sounds (p. 53) – this unceasing danger, these puny foundational gestures, allow him to assert that light cannot be devoured by the dark. «He lay watching the boy at the fire. He wanted to be able to see. Look around you, he said. There is no prophet in the earth's long chronicle who's not honored here today. Whatever form you spoke of you were right.» (p. 233).
The impression is that what has survived the catastrophe are but the remains of ancient Hebrew prophecies, of desert, cold, dark, lifeless lands, and of a few aimless drifters looking for whatever remains of peace and light. These few things are ever before the eyes of Cormac McCarthy, and, as a result, as for Meister Eckhart, his true home is Nothingness, the new and indestructible Ark of the Covenant. It is out of Nothingness that these essential things are found all over again, since this Nothingness is now the be-all and end-all. «He kicked holes in the sand for the boy’s hips and shoulders where he would sleep and he sat holding him while he tousled his hair before the fire to dry it. All of this like some ancient anointing. So be it. Evoke the forms. Where you’ve nothing else construct ceremonies out of the air and breathe upon them.» (p. 63).
Notes
(1) Novels to which McCarthy seems to be alluding when he evokes those «old tales of courage and justice» (p. 41).
(2) The French translation of George Steiner’s novel gets the title wrong : it is not The Transporting [transport] of A. H., but the bearing or carrying [portage], as I pointed out in an article published in the Cahier de l’Herne dedicated to that author. The consequences of such a misreading become clear when the reader realizes that Steiner’s intention – fairly obvious in itself – consisted in drawing a parallel between the fate of Hitler and that of Christ.
(3) It was Carl Sagan’s idea to create and attach the famous gold-plated copper disk – an interstellar message in a bottle of sorts, as journalists fancifully described it – to the Pioneer 10 and 11 probes, which were sent to the edge of the solar system and beyond in the 1980’s.

(4) The approximate etymology of the Greek name for Christopher (Christophoros) would be «he who bears Christ in himself» or «the bearer of Christ.»
(5) A point in common, if not two, between McCarthy’s and Dantec’s texts, is the corruption of language, as evidenced in many particular details of Dantec’s novel. In my view, Dantec goes about it in such a biomechanical way that in the end it does not seem quite convincing. Later on, he uses the same darkening of the atmosphere by a dust cloud into which everything disappears.
16/12/2008 | Lien permanent
La littérature sous le soleil noir de la violence, 3

26/06/2012 | Lien permanent
Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson et Nous sommes tous morts de Salomon de Izarra

 Robert Louis Stevenson dans la Zone.
Robert Louis Stevenson dans la Zone.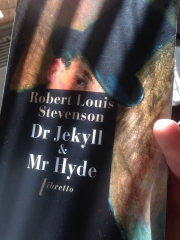 Acheter Dr Jekyll et Mr Hyde sur Amazon.
Acheter Dr Jekyll et Mr Hyde sur Amazon.Superbement traduit par Armel Guerne, l'un des textes les plus connus du grand Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hyde publié en 1885, frappe par le méthodique et progressif procédé de dévoilement de l'horreur qui fait écrire à son traducteur et préfacier qu'il «faut admettre que l'imagination étend sa royauté bien au-delà du règne des images inconsistantes et que, donnée à l'homme pour le renseigner sur les pauvretés de son intelligence, elle est faite mystérieusement comme un miroir feuilleté, comme une nasse d'un cristal subtil où se prennent parfois, et restent prisonnières, le temps d'un rêve, les proies vivantes de l'inconnaissable» (1).
Il ne s'agit pas seulement d'un dévoilement, une technique que Stevenson, bien avant Arthur Machen qui saura si bien s'en inspirer, maîtrisera de plus en plus visiblement, comme le montre l'exemple du magistral Maître de Ballantrae que nous pourrions rapprocher, en effet, d'un «miroir feuilleté» à la profondeur ténébreuse, mais du fait de dénouer, d'ouvrir les nœuds que Dieu a voulu garder fermement noués et serrés, comme nous l'enseigne l'épigraphe et que Stevenson, comme plus tard Melville, eux, souhaitent à tout prix dénouer. Se contenter d'affirmer que ce texte ne serait que l'illustration de la thématique du double est donc une bêtise universitaire, et Armel Guerne, qui toujours se tint éloigné des mandarins de toutes espèces, a eu raison de prétendre que la dimension véritable du court roman de Stevenson ne pouvait qu'excéder assez violemment l'empan placide d'une histoire de gémellité, fût-elle maléfique. Peu nous importe en fin de compte de savoir que Mr Hyde est «quelqu'un qui a un air extraordinairement bizarre sans qu'on puisse citer chez lui, pourtant, un seul trait, un détail quelconque qui le distinguerait» (p. 40). Du reste, cette sensation de flottement, face à Mr Hyde donnant «l'impression de quelqu'un de difforme, mais sans qu'on pût déterminer où était la malformation» (p. 52), nous montre suffisamment que le secret du Dr Jekyll ne tient pas seulement à sa «jeunesse impétueuse», ni même au fait que, «pour la loi divine, il n'existe pas de prescription» (p. 55), mais à l'évidence que le texte de Stevenson nous donne à voir une décréation en acte, une descente dans le cloaque de la non-forme, de la non-création.
Le grand romancier a beau affirmer que Hyde se caractérise par cela, justement, qui ne peut être caractérisé, «le sentiment obsédant d'une difformité indénonçable» (p. 68), ce qui signifie d'abord, prosaïquement, que notre écrivain sait tenir en suspens son lecteur sans jamais trop en dévoiler, leçon qui sera retenue, je l'ai dit, par Machen mais aussi Conrad, et encore par Lovecraft, mais, surtout, qu'il a conscience de n'être peut-être point suffisamment armé (techniquement, je veux dire du point de vue de la technique de l'écrivain, moralement et, qui sait, spirituellement) pour affronter, directement, via la métamorphose de Jekyll en Hyde, le secret que lui révélera «une nouvelle province du savoir», mais aussi «des avenues nouvelles vers la puissance et la gloire» (p. 118).
Quelles sont ces nouvelles avenues dans lesquelles Machen ne tardera pas, lui aussi, à faire s'aventurer ses savants en quête de la connaissance suprême, qui révélera son véritable visage à celui-là seul qui osera abolir son humanité (ou celle de son cobaye) et la tranquillité et l'assurance de son intelligence ?
 Je le répète : il est trop facile de n'évoquer que le thème du double, y compris même en faisant remarquer que le Mal, comme Jekyll ne va pas tarder à le découvrir, aura vite fait de prendre le dessus sur le Bien (cf. p. 129 : «Tout le bénéfice de l'opération était donc pour le mal»), y compris en faisant finement remarquer que le Docteur Jekyll n'est point complètement préservé de l'ordure, puisqu'il se déclare dans sa confession «depuis longtemps engagé dans une vie de profonde duplicité» (p. 121). Il est tout aussi facile de supposer que Stevenson s'est révélé comme l'un des pères de la théorie des personnalités multiples (cf. p. 123 : «je me risque à prédire qu'on finira par découvrir que l'homme n'est en définitive qu'une sorte de régime politique administrant tout un peuple de citoyens divers, indépendants et incongrus»).
Je le répète : il est trop facile de n'évoquer que le thème du double, y compris même en faisant remarquer que le Mal, comme Jekyll ne va pas tarder à le découvrir, aura vite fait de prendre le dessus sur le Bien (cf. p. 129 : «Tout le bénéfice de l'opération était donc pour le mal»), y compris en faisant finement remarquer que le Docteur Jekyll n'est point complètement préservé de l'ordure, puisqu'il se déclare dans sa confession «depuis longtemps engagé dans une vie de profonde duplicité» (p. 121). Il est tout aussi facile de supposer que Stevenson s'est révélé comme l'un des pères de la théorie des personnalités multiples (cf. p. 123 : «je me risque à prédire qu'on finira par découvrir que l'homme n'est en définitive qu'une sorte de régime politique administrant tout un peuple de citoyens divers, indépendants et incongrus»). Nous approchons toutefois de la vérité en affirmant que Stevenson est allé aussi loin qu'il l'a pu en ne cédant pas au vertige des affres et des tortures «de la dissolution» (p. 128), et nous comprenons finalement qu'il n'a pu que s'arrêter devant le spectacle inouï de Hyde prenant le pas et le contrôle sur Jekyll, puisque «l'obstacle grandissait du côté de la transformation du retour» (p. 135), non pas le mal triomphant de son contraire, non pas le spectacle d'une créature, Edward Hyde qui, «d'un bout à l'autre de l'échelle humaine, était purement le mal» (p. 128), mais la surrection, au sein de notre banale réalité quotidienne, de cela qui est sans forme, et qu'il est absolument prodigieux de pouvoir contempler : «C'était cela, la chose scandaleuse, que la fange de l'abîme parût douée de la parole et fût capable de pousser des cris; que la poussière amorphe gesticulât et commît des crimes; que ce qui était mort, inerte et informe, usurpât les fonctions et les offices de la vie» (p. 147).
Voici bel et bien la découverte qui a dû faire se reculer d'épouvante Jekyll bien sûr, mais plus encore son créateur, Stevenson lui-même, qui finalement rattrapa in extremis sa créature infernale, Mr Hyde, en l'acculant au suicide, alors que Jekyll lui-même n'a point eu ce courage, le courage élémentaire, face à l'intolérable atrocité, de se tuer : curieuse façon d'affirmer que le hideux et féroce double n'était point si mauvais que cela et que, même dans le mal absolu, se niche un atome de grâce qui vaut mieux, à tout le moins, que le vide intégral de ce qui n'est pas.
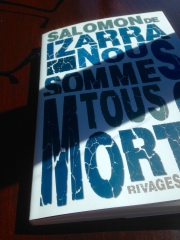 Acheter Nous sommes tous morts sur Amazon.
Acheter Nous sommes tous morts sur Amazon.Nous sommes tous morts, le premier texte publié de Salomon de Izarra, présente bien des affinités, du moins superficielles et faisant donc l'objet, comme il se doit, de quelques lignes banales en quatrième de couverture, avec les textes de Melville, London, Maupassant (nul n'est parfait), Stevenson et Lovecraft mais aussi, et à l'évidence, avec La Montagne morte de la vie de Michel Bernanos que cette quatrième de couverture, et quelque critique ou passant pour tel qu'il s'agisse, oublie justement de citer. (2) Nous pourrions dire de ce récit habilement conduit par l'auteur, même s'il me semble un peu s'égarer en mentionnant l'existence d'un avatar, qu'il est un dévoilement de l'horreur qui se tapit au tréfonds des hommes et qui ne demande qu'une circonstance particulière pour éclore, comme une fleur monstrueuse, ici de glace, au grand jour. Peu importe de connaître quelle fut la nature exacte du «premier renoncement», autant dire le premier péché, comme dans la ballade de Samuel Taylor Coleridge, à partir duquel «se manifesta la présence du mal» (3) puisque, de toute façon, la survie des membres de l'équipage du bateau encalminé dans les glaces maléfiques ne peut avoir pour prix que l'horreur (cf. p. 70).
Une fois le mécanisme inexorable enclenché, procédé commun à tout scénario décrivant une descente aux Enfers, comme le montre le glacial et halluciné The Divide de Xavier Gens, il est frappant de voir que le «mal s'insinue délicatement et on réalise qu'on est irrémédiablement perdu, un matin noir, en se réveillant» (p. 105), à tel point, même, que celui qui se croyait vivant et luttant de toutes ses forces contre l'avancée rampante de l'immobilité glacée (souvenir, peut-être, de La Ballade du Vieux Marin de Coleridge je l'ai dit, voire du Poe des Aventures d'Arthur Gordon Pym), comprend en fait qu'il est mort, depuis des jours ou des semaines, et que c'est sa seule présence qui a peut-être contaminé le bateau tout entier, et porté la guigne à ses infortunés compagnons de voyage.
Bien sûr, et ce léger détail n'a comme il se doit pas été vu ni même simplement aperçu par la critique journalistique sous prétexte, comme tel binoclard l'affirme sur La Cause littéraire, de ne pas «en dire plus» sur le récit, alors qu'il n'en dit strictement rien, le narrateur de Salomon de Izarra écrit depuis le lieu même où il est impossible d'écrire, depuis l'univers, terrifiant à imaginer et pourtant directement vécu dans l'horreur de son évidence par l'équipage du vaisseau fantôme, de ce qui n'est pas : les limbes plusieurs fois mentionnées dans le texte, tout comme Valdemar écrit depuis le royaume des morts, depuis un lieu sans Dieu ni Providence, où seule l'écriture, apparemment, ose encore défier la destruction, mais pour la dire et, en la disant, l'instiller dans notre propre monde, dont elle sape les si fragiles fondations.
Vite, refermons ces deux trouées sur l'innommable que sont les textes de Robert Louis Stevenson et de Salomon de Izarra, de peur qu'elles ne dégorgent de nouvelles insidieuses et ignobles créatures.
Notes
(1) Dr Jekyll et Mr Hyde (présentation et traduction d'Armel Guerne, Libretto, 2010), p. 23. Sans autre indication, les pages citées entre parenthèses renvoient à notre édition.
(2) Comme dans le magnifique texte de Michel Bernanos, Salomon de Izarra fait dire à l'un des ses personnages que l'univers dans lequel ils se retrouvent prisonniers est différent du nôtre (cf. p. 72, ou encore p. 99 : «Ce monde n'était pas le mien. Ce monde n'était pas humain et pourtant nous y étions, nous l'habitions comme des parasites»). Signalons encore la thématique commune de la pétrification ou même celle de la dévoration, de ce qui vit par les plantes chez Bernanos, des hommes par les hommes chez Salomon de Izarra.
(3) Salomon de Izarra, Nous sommes tous morts (Payot & Rivages, 2014), p. 42. Le texte a été assez mal relu : signalons ainsi un «à» fautif dans une phrase («car Sogarvans n'en manquait pas après à ses multiples succès») de la page 14 ou encore un «ayant» manquant («Je craignais que certains ayant les nerfs à vif ne causent des accidents», p. 62).
18/05/2017 | Lien permanent
Apologia pro Vita Kurtzii, 6 : Exterminate all the brutes !

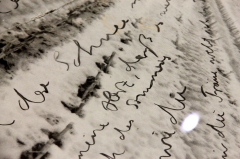 Apologia pro vita Kurtzii.
Apologia pro vita Kurtzii.«It was very simple, and at the end of that moving appeal to every altruistic sentiment it blazed at you, luminous and terrifying, like a flash of lightning in a serene sky : ‘Exterminate all the brutes !’.»
«J’ai étudié cette phrase pendant plusieurs années. J’ai réuni une quantité de documentation que je n’ai jamais eu le temps de dépouiller. J’aimerais disparaître dans ce désert où personne ne peut me joindre, où j’ai tout le temps possible. Disparaître et revenir seulement quand j’aurais compris ce que je sais déjà.»
Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes ! (Éditions Les Arènes, 2007).
«Et lorsque ce qui avait été commis au cœur des ténèbres se répéta au cœur de l’Europe, personne ne le reconnut. Personne ne voulut reconnaître ce que chacun savait.»
Ibid.
Cœur des ténèbres est une sorte de monstre. Il n’est pourtant pas le seul exemple de son espèce car d’autres œuvres nous permettraient de lire, d’une façon à peine métaphorique, la crise dans laquelle l’Occident se trouve plongé.
Cette crise est une crise du langage, familière à Georges Bernanos lorsqu’il affirme en 1926 à Frédéric Lefèvre : «On nous avait tout pris. Oui ! quiconque tenait une plume à ce moment-là s’est trouvé dans l’obligation de reconquérir sa propre langue, de la rejeter à la forge. Les mots les plus sûrs étaient pipés. Les plus grands étaient vides, claquaient dans la main».
Conrad, avant Bernanos, fit l’expérience douloureuse de cette universelle tricherie.
«La phrase «Exterminez toutes ces brutes !» n’est pas plus éloignée du cœur de l’humanisme que Buchenwald de la Goethehaus à Weimar. Cette idée a été presque complètement refoulée – même par les Allemands qui ont été faits les uniques boucs émissaires des théories de l’extermination, lesquelles, en réalité, appartiennent à toute l’Europe.»
Je ne puis m’étendre sur l’infinie complexité des raisons de cette crise, que George Steiner, reprenant les remarquables intuitions d’un Fritz Mauthner (encore bien ignoré dans notre pays, cet auteur développe dans son œuvre principale (Contribution à une critique du langage qui n’a pas été traduite en français alors qu’elle a paru en… 1903) un scepticisme radical à l’égard de ce qu’il nomme la «superstition des mots», ajoutant que ces derniers ne «donnent pas d’intuition réelle et ne sont pas réels»), que Steiner donc rattache à la grande cassure épistémologique propre au début du siècle passé, et que, plus largement, nous pourrions étendre à la Modernité, comprise comme une période où vacille l’autorité de la tradition logocentrique (1), où la parole perd de sa transparence, devient le vecteur idoine d’un mensonge généralisé.
Qu’il nous suffise de dire que les mots ne se nourrissent plus que d’autres mots depuis que Dieu est devenu un fantôme, le Revenant suprême qui ne cesse de hanter les corridors vides de notre monde mais ne parle plus, ne daigne plus nous soulever d’une seule parole. Qu'il nous suffise de dire que les mots, ne se nourrissant plus que d'autres mots (dans un sens aussi dramatique que le pensait le jeune Hofmannsthal, avant même le mutisme de Lord Chandos), deviennent ainsi les vecteurs du langage souillé, de tous les mensonges. Le langage putanisé devient le faux silence (le mutisme donc) qui est gros de toutes les trahisons : le bavardage.
Et les livres ne répondent finalement qu'aux livres, à d'autres livres desquels ils sont nés, dans une chaîne presque infinie, plus qu'ils n'évoquent, sans y parvenir autrement que laborieusement et de toute façon incomplètement, le réel.
Et les livres eux-mêmes, en bavardant, s'enferment dans le mutisme des idiots : en bavant, en bégayant, en se vidant de leur merde.
D’autres œuvres disais-je ? Oui car, contrairement aux ogres des contes, nos monstres littéraires ne sont pas des créatures solitaires. Mieux, ils entretiennent entre eux des ressemblances souvent remarquables, comme s’ils étaient les fils d’un même père dégénéré, Cœur des ténèbres. Ainsi, l’une des œuvres les plus directement inspirée par la nouvelle de Joseph Conrad est sans nul doute Le Transport de A. H. de George Steiner. Dans ce roman qui fit scandale il y a quelques années, Hitler n’est qu’une voix, dont l’étrange et perfide mélopée contamine les pages, comme les mots de l’aventurier Kurtz contaminent celles de l’œuvre de Conrad, comme les mots du vagabond Marius Ratti contaminent les cervelles d’un petit village tyrolien où Broch fait éclore la parole vide de son pitoyable tentateur, comme les mots de Monsieur Ouine sapent lentement les esprits des habitants de Fenouille et les fondations mêmes d’une paroisse qui se meurt.
Mais Kurtz n’est rien, rien d’autre qu’une ombre, un homme dont la caboche remplie d’un peu de bourre fomente dans l’obscurité impénétrable de la jungle des plans grandioses d’éducation et de rédemption des âmes sauvages dont nous ne saurons rien, si ce n’est qu’ils préconisent, alors que l’aventurier, comme un missionnaire démoniaque, est parvenu au bout de la nuit, l’extermination de toutes les «brutes». Mais Marius Ratti n’est rien, rien de plus qu’un vagabond suspect, un prophète raté réclamant des paysans qu’ils délaissent l’utilisation des machines et retournent à l’exploitation de la mine abandonnée, afin que les puissances de la terre, celles-là même que Hitler, selon Steiner, saura diaboliquement évoquer dans ses discours chthoniens, retrouvent leur antique grandeur, détruite par le christianisme. Mais Ouine enfin, au moment de mourir, n’est plus rien, lui qui n'a jamais été grand chose de plus qu'une coquille vide, le vieillard bredouillant des paroles incohérentes et insensées, tandis qu’il semble avalé par un gouffre sans fond – sa propre âme, nous dit Bernanos – dont les forces de marée délitent le monde des vivants.
Ces romans sont autant d’astres vides dont le centre de gravité, le foyer obscur, le cœur vorace est le conte de Joseph Conrad, ce dernier se souvenant bien évidemment de l'exemple de Macbeth. Toutes ces œuvres sont des trous noirs, qui paraissent aspirer le langage et dévorer ce qui les entoure. Les contempler, c’est comprendre que leur puits est sans fond. Les observer de loin, c’est admettre que nous ne saurons jamais rien du mal qui mine notre âge si, comme l’ont fait les romanciers que nous avons nommés, nous ne tentons à notre tour de nous y enfoncer.
Sven Lindqvist ne s'est point enfoncé dans ce puits de ténèbres mais il s'est perdu au plus profond du désert là où, selon Ernest Hello, l'âme parle à Dieu dans un dialogue dont le plus petit grain ne sera jamais perdu. Dieu ou... le démon ? Selon Marlow, la forêt tropicale a pris possession de l'âme vide de Kurtz. Le démon de midi, hantant les contrées chaudes, a peut-être soufflé à Lindqvist quelques-unes de ses intuitions, notamment celle qui lui fait dire que la Shoah, aussi irréductible qu'on le voudra dans son caractère d'atrocité absolue, comme élue à rebours, n'en a pas moins été longuement mûrie par et surtout dans l'Europe éclairée (2).
Ainsi, c'est volontairement perdu sur la terre la plus aride (qu'il retrouvera en Australie avec Terra Nullius, également édité par Les Arènes) que Lindqvist a entrevu la moiteur infernale dans laquelle se sont corrompues les âmes de peu de poids de Kurtz et de ses séides, personnages reprenant, selon les dires de l'auteur, les débats concernant la colonisation (3) qui ont agité la société anglais de la fin du 19e siècle. En voulant se perdre dans le désert, Lindqvist s'est retrouvé au milieu des cadavres humains déambulant comme les fantômes noirs du roman de Conrad : pas encore morts et pourtant déjà morts.
En fait, comme Marlow dont il a reproduit le dangereux voyage, Lindqvist nous a rapporté du plus profond du désert, de sa propre âme donc, un savoir dont il soupçonnait la présence, comme Marlow sait, intimement, que presque rien ne le sépare de Kurtz, comme Macbeth sait qu'il ne pourra pas résister à la tentation et qu'il est déjà le meurtrier de son roi annoncé par les trois sorcières, comme nous savons que bien peu de choses nous séparent d'un de ces criminels errants décrits par Cormac McCarthy.
Notes
(1) «L’ordre du cosmos s’est effondré, émietté dans des chaînes associatives et des points de vue non communicants. Le langage des signes se met à parler pour lui-même […]; il ne s’appuie plus sur un Logos subsistant», Gilles Deleuze, Proust et les signes (P.U.F., coll. Perspectives critiques, 1964), p. 137.
(2) Point sans doute le plus contestable du livre de Lindqvist, qui bien évidemment ne se préoccupe pas de la dimension métaphysique de la Shoah. L'auteur écrit ainsi : «[...] l’Holocauste fut unique – en Europe. Mais l’histoire de l’expansion occidentale dans d’autres parties du monde montre maints exemples d’exterminations totales de peuples entiers» puis «[…] le pas entre massacre et génocide ne fut pas franchi avant que la tradition antisémite ne rencontre la tradition du génocide qui avait surgi durant l’expansion européenne en Amérique, en Australie, en Afrique et en Asie.», op. cit., p. 210.
(3) «Lorsque Conrad rédigea Cœur des ténèbres, il ne fut pas seulement influencé par le débat sur le Congo, par le retour de Kitchener et d’autres événements de l’époque. Il fut également influencé par un monde littéraire, un monde de mots, où Kipling était le rival et l’antipode, mais aussi par d’autres écrivains qui signifiaient davantage pour lui : Henry James, Stephen Crane, Ford Madox Ford et, surtout, H.G. Wells et R.B. Cunninghame Graham.», p. 99. Et encore : «Je ne prétends pas que Joseph Conrad a entendu le discours de lord Salisbury. Il n’en avait pas besoin. Ce qu’il avait lu de Dilke [l’article de Dilke, intitulé Civilization in Africa, paru dans la revue Cosmopolis, juillet 1896, est une esquisse de la nouvelle de Conrad], dans La Guerre des mondes de Wells et dans Higginson’s Dream de Graham lui avait suffi. Tout comme ses contemporains, Conrad ne pouvait pas éviter d’entendre parler des génocides incessants qui marquèrent tout son siècle. C’est nous qui l’avons refoulé. Nous refusons de nous souvenir. Nous voulons que le génocide ait commencé et fini avec le nazisme. C’est plus réconfortant ainsi», op. cit., p. 186.
06/06/2007 | Lien permanent
Le souvenir du monde de Michel Crépu ou les Mémoires d'outre-dilettantisme

 À propos de Michel Crépu, Le souvenir du monde. Essai sur Chateaubriand (Grasset, 2011).
À propos de Michel Crépu, Le souvenir du monde. Essai sur Chateaubriand (Grasset, 2011).Grasset, s'il a cru éditer un ouvrage sur Chateaubriand, comme l'affirme le sous-titre de la première de couverture, s'est bien trompé.
Le livre qui n'a rien d'un essai de Michel Crépu est consacré à la poursuite du bonheur, Chateaubriand, selon notre habitué des salons et des raouts d'ambassadeurs et patron (lucide) de l'austère et «grande-bourgeoise» Revue des Deux Mondes (p. 58) dont «le fond de sauce» est constitué par les médiocres «héros de l'Administration», «un Guizot, un Molé, un Royer-Collard» (p. 178), en étant un digne représentant et même «le premier et le dernier catholique heureux de l'après-Révolution» (p. 14), affirmation qui doit lui tenir particulièrement à cœur puisqu'il la répète 101 pages plus loin.
Curieux leitmotiv d'ailleurs qui, de livre en livre de Michel Crépu, nous donne à voir, par opposition à ce catholique heureux qu'est censé être Chateaubriand, plusieurs catholiques qui ne le sont pas du tout, comme Léon Bloy mais aussi Charles Péguy et Georges Bernanos, sur lequel on croit lire, sous la plume de Crépu et malgré le fait qu'il trouve à son attitude «quelque chose de définitivement splendide» (p. 22), l'opinion récente émise par tel poltron signant ses rinçures virtuelles sous un nom d'emprunt et cachant sa trouille derrière l'accusation, grotesque aussi bien que mensongère, que le Grand d'Espagne a été un lâche ou plutôt, selon ses propres termes, un «planqué» : «Il n'est guère que Bernanos, ce furieux admirable dans ses aveuglements, qui aura eu ce courage [celui d'aller à la bataille, la vraie], mais Bernanos, non plus, n'aime guère sentir le sol trembler sous ses pas. Ce qui est gagné d'un côté, est perdu de l'autre : ce lutteur est dévoré d'une panique intime. Sa violence verbale signe un affolement, un énervement de l'esprit» (ibid.). Affirmation d'abord stupide, ensuite fausse, même si elle se vérifie parfois dans quelques lignes des essais bien davantage que des romans, comme du reste elle pourrait se vérifier dans les textes d'une multitude d'écrivains point tous «furieux». Panique intime ? Qu'est-ce donc à dire, cher Michel Crépu qu'on dirait affublé d'une blouse à l'impeccable blancheur et tenant le stéthoscope à la main ? Que Bernanos, pour parvenir à extraire de la boue des personnages tels que Donissan, Cénabre ou Monsieur Ouine a bien dû payer pareille exploration de terrifiantes crises d'angoisse que nous pourrions assimiler, bien que naïvement, à une forme de panique intérieure, intime ?
Comme toujours, Michel Crépu, à l'instar de son cher Philippe Sollers, se contente de lancer des mots, parfois brillants qui toutefois, bien plutôt que de pesantes sondes auscultant les profondeurs, se dissipent à la première brise, tout en lâchant souvent une mauvaise odeur quand même suspecte.
Il est vrai qu'on a quelque mal à imaginer, une fois qu'on l'a rencontré, Michel Crépu descendre dans l'arène pour «tendre la muleta» au taureau qui, avec notre badin dilettante, pourrait bien faire un «malheur» (p. 19) mais il est tout de même curieux de constater la présence, comme une signature infalsifiable apposée sur le vélin détrempé par une trouille comique, de ce tour de passe-passe habituel derrière lequel les prudents dissimulent toujours leur liquéfiant petit secret.
Je les vois déjà, nos apeurés, se cacher derrière et me renvoyer dans les dents (car nos pleutres sont des combattants !) les mots d'«affolement» et d'«énervement de l'esprit», ce serait drôle à la fin, comme l'a fait dans l'un des tomes de son ridicule Journal le très froussard Renaud Camus !
Quoi qu'il en soit de cette commune complexion si visiblement étalée, le bonheur est assurément la proie que recherche, encore une fois de livre en livre, Michel Crépu, lecteur de l'Ecclésiaste (cf. p. 193) et voyageur dont les mondanités internationales ont pour théâtre cossu les salles d'ambassades, un bonheur que nous pourrions définir comme un dilettantisme habile (le mot dilettante est employé, p. 135, à propos de Chateaubriand et de Proust), une vivacité d'écriture (voir le chapitre intitulé Qui est René ?) tout de même gâchée par un nombre consternant d'anglicismes ridicules (1) et de facilités sollersiennes (2) consistant à rapprocher sans les expliquer des tartines avec des paratonnerres, des trouillards avec des courageux, des écrivains avec des riens, soit, ici, Chateaubriand avec James Dean et Bonaparte avec les Rolling Stones entre autres consternants exemples (3).
Livre touchant, point dépourvu de qualités (une écriture, incontestable) et de défauts (des manies stylistiques grotesques, tout aussi incontestables) qui nous donne, d'abord, une image assez fidèle de notre essayiste tel que lui-même s'est campé devant le miroir des vanités : au fond, et pour le paraphraser, il est l'un de ceux «à user, par jeu rhétorique, d'une telle désinvolture, arme de refus du pathos» (p. 193).
Ce bonheur, nous pourrions également penser que Crépu cherche à l'incarner par l'exemple chateaubrianesque d'une voie médiane qui veillerait à se tenir à égale distance d'un indigent et dangereux progressisme et d'un anti-modernisme qui ne l'est pas moins : «Difficile en tout cas d'en faire un militant de l'antimodernisme, difficile d'en faire un gendre idéal, difficile pour tout emploi» (p. 23). Si je comprends bien l'intention de Crépu, le mariage serait donc progressiste.
Cette recherche stendhalienne, et donc, ici, chateaubrianesque du bonheur est sans doute, selon Crépu, ce qui donne «à penser que Chateaubriand s'est trouvé pris dans le piège de la légèreté inadmissible», ce qu'on appellerait aujourd'hui, au fond, un délit de «sale gueule» (p. 64) duquel notre bon avocat, vif comme l'éclair, va sauver son client puisque, comme il ne manque pas de nous le rappeler, chez «Chateaubriand, jamais la surface ne paie pour la profondeur. Au contraire même : plus il y a de la profondeur, plus il y a de la surface» (p. 68). Apologie pro domo ? Rien n'est plus certain et, si Le souvenir du monde n'était qu'un petit monument de papier à la gloire de son esthète d'auteur, il ne mériterait même pas que nous l'évoquions.
Mais il y a autre chose, une chose qui ne peut que retenir notre attention, tant elle témoigne d'une sensibilité bien réelle à ce que nous pourrions nommer la lecture du monde, ou du moins de la geste que les hommes impriment sur ce dernier et qui a pour nom Histoire, sensibilité qui se cache derrière des paillettes et une écriture qui confine souvent au cabotinage.
Selon les dires de Michel Crépu, il y a peut-être ainsi, en filigrane de son curieux livre, un second sujet (et même un troisième ?, (4)) qui serait la volonté de relier entre eux les siècles par-delà la brisure nette qu'a provoquée la Révolution, «vérité secrète d'une rupture à comprendre, à ouvrir, à traverser» (p. 77) afin de réaliser le grand œuvre que serait, selon Crépu, le fait d'être «un moderne sans mépris pour la tradition» (p. 150), témoin irremplaçable d'un «effondrement» dont il a été «le premier à détecter la secousse sismique» (p. 133).
C'est qu'aux yeux de Crépu, Chateaubriand est le témoin idéal qui, par deux fois, a eu la possibilité de juger l'Histoire : «La Révolution française est la matrice des Mémoires, Napoléon son œil du cyclone» (p. 117) qui est d'ailleurs «un cyclone à lui-même» (p. 147). Certes, au moment de la Révolution, c'est encore un jeune homme puisqu'il est né en 1768. Il aura cependant tout le loisir de pouvoir observer un second événement après lequel plus rien ne sera comme avant, un aérolithe fonçant comme l'éclair vers le sol où il explosera, d'en consigner la trajectoire époustouflante de vitesse au-dessus du ciel de la France et même de l'Europe : Napoléon, sujet des plus belles pages (le chapitre intitulé L'homme qui venait de nulle part), qui se lisent d'un seul souffle et restent aimantées jusqu'à leur dernier mot, de l'ouvrage de Michel Crépu.
Après Napoléon, bolide imprévisible qui, selon l'auteur, a laissé un legs tout bonnement intransmissible (5) puisque lui-même n'a fait que parodier le pouvoir royal (6), que faire, à quel homme se vouer ? De nouveau, il faut tenter d'inventer une issue, comme Benjamin Constant l'a essayé (cf. p. 138) d'après Crépu mais en faisant le deuil de la grandeur, en acceptant de patauger dans la médiocrité, se tenir tout contre la ligne de partage des eaux, annonce, Chateaubriand l'a bien compris, d'une fin de l'Histoire se diluant, après une Restauration fantoche (7), dans la démocratie, ce règne du médiocre, de la demi-mesure, des procéduriers et des proviseurs, des aventures de boudoir avec Juliette Récamier, sottement décrite comme la «Marilyn Monroe de son temps» (p. 170) qui aura au moins réussi, mais c'est un peu court en guise d'antidote à la Révolution dévoratrice, à créer «un hors-lieu intime, une sorte de cénacle de l'intimité sensible» (p. 174) : «Ce sont les restes d'un naufrage qui a tout dispersé : désormais, il n'y aura plus d'unité nulle part, nulle Majuscule, le fameux N ne viendra pas courir de sa majesté toute velléité de symbole quelconque» (pp. 155-6).
Rien à faire, le passé n'est plus bien sûr, mais surtout ce que Crépu appelle, bellement, la «substance allégorique française» qui reposait sur le «sens de l'honneur, la charité, le don de soi», la «figure archétypique du chevalier en [étant] la parfaite incarnation» si, «dans l'honneur, vaincre n'est pas le dernier mot» puisqu'il est «de ces victoires qui sont des péchés contre l'esprit de clémence» (p. 195), une évidence qu'il faudrait répéter à nombre de médiocres contemporains.
Une nouvelle fois, Michel Crépu évoque Bonaparte, surgeon monstrueux de l'unique événement autour duquel le texte de l'auteur gravite, la Révolution bien sûr : «Les Français ont pataugé dans le sang, ils se sont éperdument jetés dans une expérience historique sans équivalent. Dix fois, vingt fois, ils ont été au bord de précipiter l'heure de l'Apocalypse, menés par un stratège sublime à bicorne [...], ils ont laissé les Bourbons installer leur cirque avec de leur tourner le dos» (p. 178).
Michel Crépu dilettante ? Il faut peut-être nuancer notre jugement d'une imperceptible nuance mélancolique, finalement la plus subtile humeur dans laquelle le livre de Crépu semble trouver un éclat aussi trouble qu'intéressant. Ce n'est ainsi pas sans bonne raison que, à la fin de son texte, Michel Crépu convoque l'ombre du grand Maurice Barrès et son plus perspicace lecteur, le remarquable Guy Dupré, opposant l'attitude de l'auteur des Déracinés à celle de Chateaubriand : «L'affirmation d'un moi confondu avec l'instinct de la patrie psychique : cela seul, relayé au-dehors par le verbe politique militant, pourrait empêcher la désagrégation. Où la politique de Chateaubriand revenait à ménager un chemin d'accès à l'unité dans l'épreuve majeure de la Révolution, Barrès opte tout à l'inverse pour un enfoncement de soi dans la glaise patriotique» (p. 198).
L'opposition cependant est un peu trop exagérée pour être juste, Maurice Barrès n'étant pour Crépu qu'un apôtre de l'enfermement, du repliement sur soi-même, du «maintien de soi hostile et méfiant», le «culte du moi barrésien, dans son dandysme mortifère», étant «exactement l'épopée égocentrique d'un maintien de soi, hors de toute confrontation avec autrui» (p. 199).
Mais cette mélancolie qui nimbe le texte de Crépu est finalement aussi fugace, et de peu d'intensité, que le rayon vert sur lequel se clôt le livre, ce qui fait que nous pourrions affirmer que c'est, bien plutôt que «tout Chateaubriand», tout Michel Crépu, si la comparaison n'est pas d'emblée ridicule et si ce «tout» a quelque valeur autre que métaphorique, qui est «une esthétique du rayon vert» (p. 211), moins une «esthétique de l'adieu» que «celle d'une métamorphose» (p. 76).
Il ne faudrait tout de même pas que Michel Crépu, dans ces conditions pour le moins volatiles où ses textes, bien que nous ne puissions les confondre avec tel professoral article (évoquant également Chateaubriand) au style et à la pensée absents, sont toujours tout près de se dissiper dans un nuage de dilettantisme aussi dangereux, en fin de compte, que la moraline qu'il a raison de condamner (cf. p. 66), oublie qu'il lui reste encore à nous montrer ce que son œuvre deviendra une fois la mue accomplie.
Notes
(1) Quelques exemples de cet usage parfaitement ridicule et, surtout, laid, de termes anglais : «big bang (pp. 11 et 19), «dead zone» (p. 33), «revival» (p. 38), «timing» (p. 72), «punkie» (p. 98), «mood» (pp. 100 et 105), «come-back» (p. 127), «shadow cabinet» (p. 171), «people» (P; 193).
(2) Quelques sollersismes, un mot que nous pourrions remplacer par les synonymes que sont facilités, généralités ou formules creuses, soit l'aptitude fort peu humble de considérer que «tout cela s tient» (p. 194), une formule typiquement sollersienne, soit l'habitude prise de penser qu'on est le premier à avoir compris, intimement, charnellement, spirituellement, intellectuellement, tel ou tel auteur, Sade ou Casanova, Mozart ou Joyce, Dante ou Lautréamont, Stendhal ou Chateaubriand. Pour Michel Crépu, que nous avions déjà flashé en flagrant délit de dépassement de vitesse sollersienne autorisée, cela donne : «On verra ce qu'il y a au juste de si boutonné et si faux qu'on le dit, dans cette œuvre, en réalité l'une des plus méconnues qui soientv (pp. 27-8). Quelques lignes à peine plus loin : «Pas d'écrivain plus antistendhalien que Chateaubriand, et pourtant pas d'écrivain plus proche, en définitive. Voilà un joli mystère à résoudre» (p. 28). Encore : [...] le récit des Natchez tient en quelque sorte lieu de Tristes tropiques (p. 49). Ne pensez point que, contextualisé, cet extrait aurait quelque sens : «Bâti selon les lois du modèle homérique, les dieux de l'Olympe ayant cédé la place aux légions de Satan et aux anges du Seigneur, le récit des Natchez tient en quelque sorte lieu de Tristes Tropiques. À la fois désillusion quant au mythe du bon Sauvage, il ouvre la porte sur un jour qui n'humilie pas l'esprit de concorde entre des ordres différents, voire antagonistes». Sollersisme encore que cette image : «[...] l'Itinéraire [de Paris à Jérusalem] semble avoir été écrit dans l'éclair, comme du Hemingway» (p. 108).
Il va de soi que, en homme du monde, Michel Crépu ne manque jamais de saluer les hautes vues de Philippe Sollers sur la littérature (cf. p. 34).
Au rayon des facilités, pour écrire comme Michel Crépu, signalons encore quelques journalistiques «terrain du style» et «front du goût» (p. 36).
Enfin, le sollersisme de Michel Crépu provoque d'aventureuses analyses, comme celle du quiétisme qui provoquerait encore, au XXe siècles des remous profonds (cf. pp. 111-2).
Pour finir, une grosse bêtise, Eliot évoquant de mystérieux «petits hommes creux» (p. 73), traduction bien évidemment fausse de ses «hollow men».
(3) Page 10 : «René, James Dean du XIXe siècle commençant». La comparaison entre Bonaparte à la Malmaison et les Rolling Stones de la villa Nellcote se trouve à la page 99. Autre (double) rapprochement qui, développé, aurait peut-être quelque sens : «Car le grand art, bien entendu, est de pouvoir recevoir son lecteur à quelque endroit qu'il se trouve, du jour ou de la nuit, comme dans une Recherche du temps perdu, ce que sont aussi bien les Mémoires d'outre-tombe : le clavier s'y souvient de Montaigne, il devine la grande nébuleuse proustienne, avec ses arches, ses courbes, ses ellipses jetées au-dessus de l'oubli» (p. 51).
(4) Chateaubriand a été l'homme le plus intelligent de son temps; en un sens c'est tout le sujet du présent livre (p. 36). On se rassure en comprenant que, dans l'esprit de Crépu, ce sujet n'en fait avec celui de la quête du bonheur puisque, en somme, c'est parce qu'il était heureux, et même le dernier catholique heureux, que Chateaubriand a été l'homme le plus intelligent de son temps.
(5) «Il est vrai que le legs institutionnel est colossal, mais ce legs demeurera sans héritier, il ne sera pas transmis. il restera là comme un souvenir durci» (pp. 147-8).
(6) «C'est le vieux socle judéo-chrétien où s'arc-boutaient depuis Capet les royautés successives qui a été touché : rien de ce qui se produit à partir de là dans l'histoire européenne n'est étranger à cette première brisure. La prodigieuse comédie du Sacre, avec ses litanies bibliques héritées d'un Isaïe relu par Talleyrand, la présence même du pape, rameuté à grands frais à condition qu'il avale sans broncher la potion, n'y pourra rien» (p. 105). Crépu insiste sur l'incapacité tragique de Napoléon à récapituler ce qui le précède et fonder ce qui le suivra : «Bonaparte, Premier consul, surgi de nulle part : il n'a pour lui que d'être lui-même. Ce sera son drame, au fur et à mesure de l'épopée, de ne pouvoir sortir de cette solitude en fabriquant de la dynastie, une manière d'être dans le continu des siècles qui ne fasse pas tout reposer sur l'obtention aléatoire des succès militaires» (p. 102).
(7) «Avec la première Restauration, point d'irréductible. Voici le monde des autres si aisément remplaçables. Le monarque a beau se réserver l'Autorité suprême dans la Charte, il doit savoir que c'est une fiction destructible. Le saint chrême n'est qu'une fiole contenant de la mauvaise huile», p. 151.
01/12/2011 | Lien permanent
Excellences et nullités, une année de lectures : 2011

 Excellences et nullités de l'année 2010.Une nouvelle fois, comme pour l'année passée, ce petit palmarès bien évidemment personnel, absolument partial mais argumenté, concerne aussi bien des livres parus cette année que des livres tout simplement lus en 2011 comme Diadorim et Missa sine nomine, sans conteste mes plus mémorables souvenirs de lecture de ces douze derniers mois.La palme de la nullité, j'aimerais pouvoir écrire toutes catégories confondues (romans, recueil de nouvelles), revient, sans le moindre doute, aux livres d'Antoni Casas Ros, lus, d'une traite, grâce à la publicité virale inepte (celle, si typiquement anodine et rimailleuse, de la bonne femme à prétentions littéraires comiques) dont Éric Bonnargent, que l'on a connu bien mieux inspiré, s'est fait l'aimable relais.Les commentaires, comme pour la note de l'année dernière, sont ouverts.Excellences
Excellences et nullités de l'année 2010.Une nouvelle fois, comme pour l'année passée, ce petit palmarès bien évidemment personnel, absolument partial mais argumenté, concerne aussi bien des livres parus cette année que des livres tout simplement lus en 2011 comme Diadorim et Missa sine nomine, sans conteste mes plus mémorables souvenirs de lecture de ces douze derniers mois.La palme de la nullité, j'aimerais pouvoir écrire toutes catégories confondues (romans, recueil de nouvelles), revient, sans le moindre doute, aux livres d'Antoni Casas Ros, lus, d'une traite, grâce à la publicité virale inepte (celle, si typiquement anodine et rimailleuse, de la bonne femme à prétentions littéraires comiques) dont Éric Bonnargent, que l'on a connu bien mieux inspiré, s'est fait l'aimable relais.Les commentaires, comme pour la note de l'année dernière, sont ouverts.Excellences La puissance du discours de Wilfried Stroh (Les Belles Lettres).
La puissance du discours de Wilfried Stroh (Les Belles Lettres). Des villes dans la plaine de Cormac McCarthy (Seuil/Points).
Des villes dans la plaine de Cormac McCarthy (Seuil/Points). La déshumanisation de l'art de José Ortega y Gasset (Sulliver).
La déshumanisation de l'art de José Ortega y Gasset (Sulliver). La Grande forêt de Robert Penn Warren (Stock).
La Grande forêt de Robert Penn Warren (Stock). La Fausse parole d'Armand Robin (Le Temps qu'il fait).
La Fausse parole d'Armand Robin (Le Temps qu'il fait). Les eaux montent de Robert Penn Warren (Stock).
Les eaux montent de Robert Penn Warren (Stock). Journal de galère d'Imre Kertész (Actes Sud).
Journal de galère d'Imre Kertész (Actes Sud). Missa sine nomine d'Ernst Wiechert (Le Rocher, coll. Motifs).
Missa sine nomine d'Ernst Wiechert (Le Rocher, coll. Motifs). Match retour de Julien Capron (Flammarion).
Match retour de Julien Capron (Flammarion). Robespierre, derniers temps de Jean-Philippe Domecq + Entretien avec Jean-Philippe Domecq (Gallimard).
Robespierre, derniers temps de Jean-Philippe Domecq + Entretien avec Jean-Philippe Domecq (Gallimard). Diadorim de João Guimarães Rosa (Albin Michel).
Diadorim de João Guimarães Rosa (Albin Michel). Deux livres de László Krasznahorkai : Thésée universel et Au nord, par une montagne... (Vagabonde et Cambourakis).
Deux livres de László Krasznahorkai : Thésée universel et Au nord, par une montagne... (Vagabonde et Cambourakis). Le gardien du verger de Cormac McCarthy (Seuil/Points).
Le gardien du verger de Cormac McCarthy (Seuil/Points). L'Obscurité du dehors de Cormac McCarthy (Seuil/Points).
L'Obscurité du dehors de Cormac McCarthy (Seuil/Points). Un Enfant de Dieu de Cormac McCarthy (Seuil/Points).
Un Enfant de Dieu de Cormac McCarthy (Seuil/Points). La guerre de six jours de Pierre Boutang (Les provinciales).
La guerre de six jours de Pierre Boutang (Les provinciales). Le Cavalier de la nuit de Robert Penn Warren (Stock).
Le Cavalier de la nuit de Robert Penn Warren (Stock). Les Enfants humiliés de Georges Bernanos (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade).
Les Enfants humiliés de Georges Bernanos (Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade). Aux portes du ciel de Robert Penn Warren (Stock).
Aux portes du ciel de Robert Penn Warren (Stock). Troisième nuit de Walpurgis de Karl Kraus (Agone).
Troisième nuit de Walpurgis de Karl Kraus (Agone). La Caverne de Robert Penn Warren (Stock).
La Caverne de Robert Penn Warren (Stock). Baleine de Paul Gadenne (Actes Sud).
Baleine de Paul Gadenne (Actes Sud). Du temps qu'on existait de Marien Defalvard (Grasset).
Du temps qu'on existait de Marien Defalvard (Grasset). La Terreur d'Arthur Machen.
La Terreur d'Arthur Machen. La Trilogie des confins de Cormac McCarthy (L'Olivier).
La Trilogie des confins de Cormac McCarthy (L'Olivier). L'Homme qui marchait sur la lune d'Howard McCord (Gallmeister).
L'Homme qui marchait sur la lune d'Howard McCord (Gallmeister). Autour de Robert Browning (Le Bruit du Temps).Nullités
Autour de Robert Browning (Le Bruit du Temps).Nullités Petit traité des vertus réactionnaires d'Olivier Bardolle (L'Éditeur).
Petit traité des vertus réactionnaires d'Olivier Bardolle (L'Éditeur). Du Soufre au cœur d'Arnaud Le Guern (Alphée / Jean-Paul Bertrand).
Du Soufre au cœur d'Arnaud Le Guern (Alphée / Jean-Paul Bertrand). Dans l'obscur royaume de Giorgio Pressburger (Actes Sud). Signalons les critiques de Thierry Guinhut et d'Éric Bonnargent qui expriment un autre point de vue que le mien sur ce livre prétentieux.
Dans l'obscur royaume de Giorgio Pressburger (Actes Sud). Signalons les critiques de Thierry Guinhut et d'Éric Bonnargent qui expriment un autre point de vue que le mien sur ce livre prétentieux. Chroniques de la dernière révolution d'Antoni Casas Ros (Gallimard).
Chroniques de la dernière révolution d'Antoni Casas Ros (Gallimard). L'invention de Philippe Muray d'Alexandre de Vitry (Carnets Nord).
L'invention de Philippe Muray d'Alexandre de Vitry (Carnets Nord). Enigma d'Antoni Casas Ros (Gallimard).
Enigma d'Antoni Casas Ros (Gallimard). Le théorème d'Almodóvar d'Antoni Casas Ros (gallimard).
Le théorème d'Almodóvar d'Antoni Casas Ros (gallimard). Mort au romantisme d'Antoni Casas Ros (Gallimard).
Mort au romantisme d'Antoni Casas Ros (Gallimard).
28/12/2011 | Lien permanent | Commentaires (27)



























































