Rechercher : francis moury george romero
Dracula, 10 : Une Messe pour Dracula de Peter Sasdy, par Francis Moury

 CritiqueTaste the Blood of Dracula [Une messe pour Dracula] (Grande-Bretagne, 1969) de Peter Sasdy est chronologiquement le quatrième film consacré au personnage de Bram Stoker produit par la Hammer Film. Son ouverture cauchemardesque constitue une suite directe à la fin du précédent Dracula Has Risen From the Grave [Dracula et les femmes] (Grande-Bretagne, 1968) de Freddie Francis, à la critique duquel nous renvoyons le lecteur concernant la chronologie globale du cycle. Le scénariste John Elder a trouvé une fois de plus un biais inquiétant pour relancer la série en l’approfondissant. Lee reprend naturellement le rôle-titre. Arthur Grant et James Bernard (supervisé par Philip Martel) se retrouvent à nouveau, respectivement directeur de la photographie et compositeur : leur travail à tous deux est, comme d’habitude, somptueux. Bernard Robinson n’est plus de la partie pour la direction artistique mais Scot MacGregor a aménagé un étonnant décor d’église abandonnée. Les extérieurs sont une fois de plus splendides. Fisher et Francis sont remplacés par Sasdy, jeune réalisateur d’origine hongroise qui signait là sa première et très remarquée collaboration pour la Hammer Film, immédiatement suivie par ses originaux Countess Dracula (Grande-Bretagne, 1970) avec une très érotique Ingrid Pitt en vedette dans le rôle mi-historique, mi-fantastique de la célèbre comtesse hongroise Ersebeth Bathory et Hands of the Ripper [La Fille de Jack l’éventreur] (Grande-Bretagne, 1971) qui allie explicitement psychanalyse et cinéma d’horreur et d’épouvante.Une messe pour Dracula est riche en idées originales, dramatiquement comme plastiquement novatrices : on peut noter son thème oedipien puisque Dracula s’y substitue aux pères respectifs des enfants qu’il vampirise après les leur avoir fait parfois assassiner d’une part, que son fils spirituel accepte de se sacrifier pour assurer sa résurrection d’autre part. La perversion caractérise d’ailleurs le rapport paternel le plus scandaleux du film (celui d’Alice à son propre père) et il baigne tout du long dans un climat morbide et baroque : caractéristiques engendrant un surcroit de violence graphique et d’érotisme, qui faisaient partie du cahier des charges de la productrice Aïda Young à ce moment précis de l’histoire de la Hammer. Le thème du satanisme permettant la continuation vitale du vampire – déjà évoqué dans les dialogues de The Brides of Dracula [Les Maîtresses de Dracula] (Grande-Bretagne, 1960) de Terence Fisher puis montré « tel quel » (le sang de l’époux de Barbara Shelley, utilisé rituellement par le serviteur Klove pour faire revivre son maître) durant la première partie de Dracula prince of Darkness [Dracula prince des ténèbres] (Grande-Bretagne, 1965) de Terence Fisher – est une valeur thématique sûre riche de possibilités esthétiques. (*) Peter Sasdy dose soigneusement les « scènes-choc » et la violence graphique explose régulièrement sur l’écran.Un sang par ailleurs neuf alimente le casting : les seconds rôles sont tous excellents. À commencer par le toujours bon Roy Kinneard (le commerçant qui récupère le sang de Dracula) qu’on reverra dans Juggernaut [Terreur sur le Britanic] (Grande-Bretagne, 1974) de Richard Lester. Ralph Bates (Lord Courtley) campera l’année suivante un original «jeune» baron Frankenstein dans Horrors of Frankenstein [Les Horreurs de Frankenstein] (Grande-Bretagne, 1970) écrit et réalisé par Jimmy Sangster puis Dr.Jekyll dans le remarquable Dr. Jekyll & Sister Hyde (Grande-Bretagne, 1971) de Roy Ward Baker. Les trois acteurs incarnant les trois père sont moins connus mais ils sont bons acteurs, et les deux jeunes jeunes premières sont les actrices Linda Hayden (vedette de l’érotique Baby Love et surtout célèbre, en matière de cinéma fantastique, pour son interprétation dans Satan’s Skin / Blood on Satan’s Claw [La Nuit des maléfices] Grande-Bretagne, 1971) de Piers Haggard, produit par la firmeTigon dans laquelle elle apparaissait intégralement nue) et Isla Blair. Seuls Michael Ripper (l’inspecteur de police incapable) et, bien sûr, Christopher Lee appartiennent à la vieille garde des castings de la Hammer. Lee, enfin, parvient à nouveau à surprendre. Il accentue la rupture entre apparitions fantomatiques et moments de violence hystérique : il a toujours réussi non seulement à maintenir la conception fishérienne initiale, à incarner la dualité fondamentale et terrifiante du personnage mais encore à l’approfondir. Sa renaissance comme sa mort sont les deux très grandes scènes du film et Sasdy a su tirer tout le parti possible de ce grand comédien, un des plus grands de l’histoire du cinéma fantastique.Note(*) Thème qui sera illustré une fois de plus par la Hammer dans le beau et intéressant Twins of Evil [Les Sévices de Dracula] (Grande-Bretagne, 1971) de John Hough. Le vampire n’est pas, en dépit du titre français d’exploitation, le comte Dracula créé par Stoker : il n’appartient donc pas rigoureusement au même cycle.Pour l'affiche du film, carte postale éditée à Londres par la London Postcard Company, collection de Francis Moury.
CritiqueTaste the Blood of Dracula [Une messe pour Dracula] (Grande-Bretagne, 1969) de Peter Sasdy est chronologiquement le quatrième film consacré au personnage de Bram Stoker produit par la Hammer Film. Son ouverture cauchemardesque constitue une suite directe à la fin du précédent Dracula Has Risen From the Grave [Dracula et les femmes] (Grande-Bretagne, 1968) de Freddie Francis, à la critique duquel nous renvoyons le lecteur concernant la chronologie globale du cycle. Le scénariste John Elder a trouvé une fois de plus un biais inquiétant pour relancer la série en l’approfondissant. Lee reprend naturellement le rôle-titre. Arthur Grant et James Bernard (supervisé par Philip Martel) se retrouvent à nouveau, respectivement directeur de la photographie et compositeur : leur travail à tous deux est, comme d’habitude, somptueux. Bernard Robinson n’est plus de la partie pour la direction artistique mais Scot MacGregor a aménagé un étonnant décor d’église abandonnée. Les extérieurs sont une fois de plus splendides. Fisher et Francis sont remplacés par Sasdy, jeune réalisateur d’origine hongroise qui signait là sa première et très remarquée collaboration pour la Hammer Film, immédiatement suivie par ses originaux Countess Dracula (Grande-Bretagne, 1970) avec une très érotique Ingrid Pitt en vedette dans le rôle mi-historique, mi-fantastique de la célèbre comtesse hongroise Ersebeth Bathory et Hands of the Ripper [La Fille de Jack l’éventreur] (Grande-Bretagne, 1971) qui allie explicitement psychanalyse et cinéma d’horreur et d’épouvante.Une messe pour Dracula est riche en idées originales, dramatiquement comme plastiquement novatrices : on peut noter son thème oedipien puisque Dracula s’y substitue aux pères respectifs des enfants qu’il vampirise après les leur avoir fait parfois assassiner d’une part, que son fils spirituel accepte de se sacrifier pour assurer sa résurrection d’autre part. La perversion caractérise d’ailleurs le rapport paternel le plus scandaleux du film (celui d’Alice à son propre père) et il baigne tout du long dans un climat morbide et baroque : caractéristiques engendrant un surcroit de violence graphique et d’érotisme, qui faisaient partie du cahier des charges de la productrice Aïda Young à ce moment précis de l’histoire de la Hammer. Le thème du satanisme permettant la continuation vitale du vampire – déjà évoqué dans les dialogues de The Brides of Dracula [Les Maîtresses de Dracula] (Grande-Bretagne, 1960) de Terence Fisher puis montré « tel quel » (le sang de l’époux de Barbara Shelley, utilisé rituellement par le serviteur Klove pour faire revivre son maître) durant la première partie de Dracula prince of Darkness [Dracula prince des ténèbres] (Grande-Bretagne, 1965) de Terence Fisher – est une valeur thématique sûre riche de possibilités esthétiques. (*) Peter Sasdy dose soigneusement les « scènes-choc » et la violence graphique explose régulièrement sur l’écran.Un sang par ailleurs neuf alimente le casting : les seconds rôles sont tous excellents. À commencer par le toujours bon Roy Kinneard (le commerçant qui récupère le sang de Dracula) qu’on reverra dans Juggernaut [Terreur sur le Britanic] (Grande-Bretagne, 1974) de Richard Lester. Ralph Bates (Lord Courtley) campera l’année suivante un original «jeune» baron Frankenstein dans Horrors of Frankenstein [Les Horreurs de Frankenstein] (Grande-Bretagne, 1970) écrit et réalisé par Jimmy Sangster puis Dr.Jekyll dans le remarquable Dr. Jekyll & Sister Hyde (Grande-Bretagne, 1971) de Roy Ward Baker. Les trois acteurs incarnant les trois père sont moins connus mais ils sont bons acteurs, et les deux jeunes jeunes premières sont les actrices Linda Hayden (vedette de l’érotique Baby Love et surtout célèbre, en matière de cinéma fantastique, pour son interprétation dans Satan’s Skin / Blood on Satan’s Claw [La Nuit des maléfices] Grande-Bretagne, 1971) de Piers Haggard, produit par la firmeTigon dans laquelle elle apparaissait intégralement nue) et Isla Blair. Seuls Michael Ripper (l’inspecteur de police incapable) et, bien sûr, Christopher Lee appartiennent à la vieille garde des castings de la Hammer. Lee, enfin, parvient à nouveau à surprendre. Il accentue la rupture entre apparitions fantomatiques et moments de violence hystérique : il a toujours réussi non seulement à maintenir la conception fishérienne initiale, à incarner la dualité fondamentale et terrifiante du personnage mais encore à l’approfondir. Sa renaissance comme sa mort sont les deux très grandes scènes du film et Sasdy a su tirer tout le parti possible de ce grand comédien, un des plus grands de l’histoire du cinéma fantastique.Note(*) Thème qui sera illustré une fois de plus par la Hammer dans le beau et intéressant Twins of Evil [Les Sévices de Dracula] (Grande-Bretagne, 1971) de John Hough. Le vampire n’est pas, en dépit du titre français d’exploitation, le comte Dracula créé par Stoker : il n’appartient donc pas rigoureusement au même cycle.Pour l'affiche du film, carte postale éditée à Londres par la London Postcard Company, collection de Francis Moury.
18/04/2010 | Lien permanent
Dracula, 7 : Les maîtresses de Dracula de Terence Fisher, par Francis Moury

 Les maîtresses de Dracula [The Brides of Dracula] (Grande-Bretagne, 1960) de Terence Fisher est le plus original des trois films que Fisher consacra au vampirisme.Son scénario écrit par Jimmy Sangster, Peter Bryan et Edward Percy ne doit pratiquement rien au roman de Bram Stoker alors que Le Cauchemar de Dracula [Dracula / Horror of Dracula] (1958) en était largement inspiré et que Dracula prince des ténèbres [Dracula Prince of Darkness] (1965) lui empruntera le personnage de Renfield. Dracula est mort : on nous le confirme dès le début, en voix-off. Mais le récit – démentiel tel que la géniale actrice Freda Jackson le narre à Yvonne Monlaur – de la jeunesse du baron Meinster établit bientôt le lien qui exista entre Meinster et un de ses disciples. Ce scénario multiplie les scènes-choc, atteignant des sommets inédits : les métaphores incestueuses, lesbiennes, homosexuelles, sado-masochistes envahissent symboliquement l’écran et leur puissance demeure, encore aujourd’hui, sans égale. il se révèle constamment d’une intelligence rare. Raison pour laquelle ses capacités de suggestion demeurent aussi impressionnantes que ce qu’il montre. L’ouverture du film décrivant une organisation criminelle qui amène (au moyen de la ruse et de la terreur imposée par une emprise maléfique immémoriale) Marianne à accepter l’invitation de la Baronne, maintient ainsi exactement la balance, d’une précision et d’une rigueur toutes deux intangibles, entre le dit et le non-dit, d’autant plus terrifiante.L’interprétation est exceptionnellement riche et novatrice. David Peel compose un vampire (paradoxalement unique, comme toujours) ne le cédant en rien à Christopher Lee. Il faut rendre définitivement justice à Peel. L’actrice française Yvonne Monlaur tient le rôle de sa vie, celui qui perpétue sa mémoire : c’est à cause de ce rôle qu’elle est désormais l’une des trois grandes «Yvonne» du cinéma fantastique anglais : Yvonne Furneaux, Yvonne Romain, Yvonne Monlaur. Freda Jackson est l’un des seconds rôles féminins les plus inquiétants non seulement de toute l’histoire du cinéma fantastique mais encore de celle de la Hammer. Martita Hunt n’a pas vraiment d’équivalent tandis que Marie Devereux incarne une des femmes-vampires muettes les plus érotiques et les plus agressives du cinéma parlant.La mise en scène de Terence Fisher rend un hommage appuyé à l’expressionnisme allemand dès l’ouverture (Yvonne Monlaur prise de panique à cause de la course folle du cocher) et le dialogue même rend un hommage explicite mais ambivalent à Fritz Lang. «l’Académie Lang» où doit enseigner Marianne est une école favorablement connue de la Baronne, mais il s’avère que son directeur est un imbécile. Faut-il y voir une métaphore filée jusqu’au bout ? Pas nécessairement : donner à une école le nom de Lang suffit à constituer un clin d’œil esthétique intéressant. L’expressionnisme de Fisher est d’une vigueur et d’une violence supérieures à celui de Lang. C’est qu’ici tout y conspire, et tout se tient magiquement. Musique et photographie créent un cauchemar plastiquement tangible : la peur et la folie y guettent les âmes sensibles. Un simple exemple : ce plan du baron Meinster sur le balcon, titubant au bord du vide, vu en plongée par Marianne, est repris quelques instants après… mais Meinster est absent : son absence suggère cruellement l’illusion, sa présence témoignait de la folie objective de la créature qu’il est devenue, et du chaos insoutenable dont il est issu, et qu’il sert désormais. Une telle ambivalence – revendiquée, soulignée, abyssale - est typique du contenu manifeste de tout le film. L’espace imparti nous interdit de développer plus avant une analyse minutieuse, plan par plan, séquence par séquence, du restant : elle mérite d’être écrite.Peut-être Les maitresses de Dracula est-il, tout compte fait, non seulement un des chefs-d’œuvre mais encore le chef-d’œuvre de Fisher, ce qui en ferait automatiquement le plus beau film fantastique de l’histoire du cinéma ? Nous sommes assez souvent tentés de répondre par l’affirmative. Reconnu à sa sortie par une élite critique puis un peu oublié à mesure qu’il devenait chimiquement et magnétiquement invisible, sa résurrection numérique permet à tout le moins de constater la permanence de son impact.* Dans le corps de l'article, reproduction d'une carte postale éditée en Angleterre par la London Postcard Company, collection personnelle de Francis Moury.
Les maîtresses de Dracula [The Brides of Dracula] (Grande-Bretagne, 1960) de Terence Fisher est le plus original des trois films que Fisher consacra au vampirisme.Son scénario écrit par Jimmy Sangster, Peter Bryan et Edward Percy ne doit pratiquement rien au roman de Bram Stoker alors que Le Cauchemar de Dracula [Dracula / Horror of Dracula] (1958) en était largement inspiré et que Dracula prince des ténèbres [Dracula Prince of Darkness] (1965) lui empruntera le personnage de Renfield. Dracula est mort : on nous le confirme dès le début, en voix-off. Mais le récit – démentiel tel que la géniale actrice Freda Jackson le narre à Yvonne Monlaur – de la jeunesse du baron Meinster établit bientôt le lien qui exista entre Meinster et un de ses disciples. Ce scénario multiplie les scènes-choc, atteignant des sommets inédits : les métaphores incestueuses, lesbiennes, homosexuelles, sado-masochistes envahissent symboliquement l’écran et leur puissance demeure, encore aujourd’hui, sans égale. il se révèle constamment d’une intelligence rare. Raison pour laquelle ses capacités de suggestion demeurent aussi impressionnantes que ce qu’il montre. L’ouverture du film décrivant une organisation criminelle qui amène (au moyen de la ruse et de la terreur imposée par une emprise maléfique immémoriale) Marianne à accepter l’invitation de la Baronne, maintient ainsi exactement la balance, d’une précision et d’une rigueur toutes deux intangibles, entre le dit et le non-dit, d’autant plus terrifiante.L’interprétation est exceptionnellement riche et novatrice. David Peel compose un vampire (paradoxalement unique, comme toujours) ne le cédant en rien à Christopher Lee. Il faut rendre définitivement justice à Peel. L’actrice française Yvonne Monlaur tient le rôle de sa vie, celui qui perpétue sa mémoire : c’est à cause de ce rôle qu’elle est désormais l’une des trois grandes «Yvonne» du cinéma fantastique anglais : Yvonne Furneaux, Yvonne Romain, Yvonne Monlaur. Freda Jackson est l’un des seconds rôles féminins les plus inquiétants non seulement de toute l’histoire du cinéma fantastique mais encore de celle de la Hammer. Martita Hunt n’a pas vraiment d’équivalent tandis que Marie Devereux incarne une des femmes-vampires muettes les plus érotiques et les plus agressives du cinéma parlant.La mise en scène de Terence Fisher rend un hommage appuyé à l’expressionnisme allemand dès l’ouverture (Yvonne Monlaur prise de panique à cause de la course folle du cocher) et le dialogue même rend un hommage explicite mais ambivalent à Fritz Lang. «l’Académie Lang» où doit enseigner Marianne est une école favorablement connue de la Baronne, mais il s’avère que son directeur est un imbécile. Faut-il y voir une métaphore filée jusqu’au bout ? Pas nécessairement : donner à une école le nom de Lang suffit à constituer un clin d’œil esthétique intéressant. L’expressionnisme de Fisher est d’une vigueur et d’une violence supérieures à celui de Lang. C’est qu’ici tout y conspire, et tout se tient magiquement. Musique et photographie créent un cauchemar plastiquement tangible : la peur et la folie y guettent les âmes sensibles. Un simple exemple : ce plan du baron Meinster sur le balcon, titubant au bord du vide, vu en plongée par Marianne, est repris quelques instants après… mais Meinster est absent : son absence suggère cruellement l’illusion, sa présence témoignait de la folie objective de la créature qu’il est devenue, et du chaos insoutenable dont il est issu, et qu’il sert désormais. Une telle ambivalence – revendiquée, soulignée, abyssale - est typique du contenu manifeste de tout le film. L’espace imparti nous interdit de développer plus avant une analyse minutieuse, plan par plan, séquence par séquence, du restant : elle mérite d’être écrite.Peut-être Les maitresses de Dracula est-il, tout compte fait, non seulement un des chefs-d’œuvre mais encore le chef-d’œuvre de Fisher, ce qui en ferait automatiquement le plus beau film fantastique de l’histoire du cinéma ? Nous sommes assez souvent tentés de répondre par l’affirmative. Reconnu à sa sortie par une élite critique puis un peu oublié à mesure qu’il devenait chimiquement et magnétiquement invisible, sa résurrection numérique permet à tout le moins de constater la permanence de son impact.* Dans le corps de l'article, reproduction d'une carte postale éditée en Angleterre par la London Postcard Company, collection personnelle de Francis Moury.
26/03/2010 | Lien permanent
Dracula, 5 : Les proies du vampire de Fernando Méndez, par Francis Moury

 Deux films de Méndez – en tout et pour tout – parvinrent historiquement à franchir la frontière française : Ladron de cadaveres [Le Monstre sans visage] (Mexique, 1955) et El Vampiro [Les Proies du vampire], Mexique, 1957), ce dernier sortit à Paris le 28 octobre 1959 . Deux œuvres qui suffisent à conserver précieusement son nom dans toutes les histoires du cinéma fantastique écrites dans notre langue depuis les années 1970. Mais en fait Méndez avait œuvré dans la plupart des genres populaires du cinéma mexicain. Et on relève dans sa filmographie, dès 1943, un Los Cadaveres del Terror. Sans oublier El Ataud del vampiro [Le Retour du vampire] (Mexique, 1957), la suite de El Vampiro avec quatre de ses acteurs principaux et quelques autres titres fantastiques dont Mysterios de Ultratumba (Mexique, 1959) et El Grito de la muerte (Mexique, 1963). Méndez demeure – nous en avons à présent confirmation sans équivoque en comparant ses œuvres avec celles d’un Rafael Baledon, d’un Alfonso Corona Blake et d’un Chano Urueta (également rééditées par Bach films) – le plus grand cinéaste mexicain du genre.Car ce grand classique du cinéma fantastique que sont Les Proies du vampire demeure aussi puissant, impressionnant et finalement secret qu’à sa première vision. Est-ce à cause de la beauté intangible de l’actrice d’origine cubaine Carmen Montejo, une des plus belles femmes vampires jamais vues sur un écran ? Est-ce en raison d’un scénario machiavélique qui met en jeu les ressorts de l’inceste et de l’homosexualité (*) avec une virulence et une âpreté toutes freudiennes ? Ou bien, tout simplement, du fait de la beauté plastique constante de la mise en scène dont la rigueur évoque Fritz Lang et Tod Browning autant qu’elle annonce Terence Fisher et parfois Jean Rollin ?
Deux films de Méndez – en tout et pour tout – parvinrent historiquement à franchir la frontière française : Ladron de cadaveres [Le Monstre sans visage] (Mexique, 1955) et El Vampiro [Les Proies du vampire], Mexique, 1957), ce dernier sortit à Paris le 28 octobre 1959 . Deux œuvres qui suffisent à conserver précieusement son nom dans toutes les histoires du cinéma fantastique écrites dans notre langue depuis les années 1970. Mais en fait Méndez avait œuvré dans la plupart des genres populaires du cinéma mexicain. Et on relève dans sa filmographie, dès 1943, un Los Cadaveres del Terror. Sans oublier El Ataud del vampiro [Le Retour du vampire] (Mexique, 1957), la suite de El Vampiro avec quatre de ses acteurs principaux et quelques autres titres fantastiques dont Mysterios de Ultratumba (Mexique, 1959) et El Grito de la muerte (Mexique, 1963). Méndez demeure – nous en avons à présent confirmation sans équivoque en comparant ses œuvres avec celles d’un Rafael Baledon, d’un Alfonso Corona Blake et d’un Chano Urueta (également rééditées par Bach films) – le plus grand cinéaste mexicain du genre.Car ce grand classique du cinéma fantastique que sont Les Proies du vampire demeure aussi puissant, impressionnant et finalement secret qu’à sa première vision. Est-ce à cause de la beauté intangible de l’actrice d’origine cubaine Carmen Montejo, une des plus belles femmes vampires jamais vues sur un écran ? Est-ce en raison d’un scénario machiavélique qui met en jeu les ressorts de l’inceste et de l’homosexualité (*) avec une virulence et une âpreté toutes freudiennes ? Ou bien, tout simplement, du fait de la beauté plastique constante de la mise en scène dont la rigueur évoque Fritz Lang et Tod Browning autant qu’elle annonce Terence Fisher et parfois Jean Rollin ? Un exemple de cette rigueur : la première apparition d’Eloisa (devenue secrètement vampire) aux yeux de sa famille. Elle se trouve en haut d’un escalier qu’elle descend naturellement pour recevoir sa nièce et l’homme qui l’accompagne. Comment ne pas songer à la première apparition de Christopher Lee, un an plus tard, dans Dracula [Horror of Dracula / Le Cauchemar de Dracula] (G.-B., 1958) de Terence Fisher dont ce dernier était si fier ? La réflexion sur la dialectique apparence/réalité se traduit par un plan semblable et tout aussi efficace dramatiquement. Impossible aussi de ne pas constater que Lavud, quelques minutes plus tard, monte un escalier qui le mène vers la surface, avec la même attitude hautaine. Marta est ainsi prise en tenaille entre ses deux bourreaux et plus aucune partie de l’espace ne lui est hospitalière : ni la surface ni le sous-sol de l’hacienda. Autre idée géniale : celle de l’autre tante décédée, Maria Teresa (qui n’est en réalité pas morte mais fait semblant de l’être afin de mieux se protéger contre sa sœur vampire et celui qui la domine) qui apparaît pour la première fois tel un fantôme pour, non pas agresser comme on le croit d’abord, mais protéger Marta pendant son sommeil. Admirable instauration d’une ambivalence génératrice d’une angoisse totale. On ne peut s’empêcher de penser à ce que fera Corman dans la série Edgar Poe dès The Fall of the House of Usher [La Chute de la maison Usher] (É.-U., 1960) et aussi dans Pit and the Pendulum [La Chambre des tortures] (É.-U., 1961). Enfin le comte Lavud / Duval joue des apparences contre tous, y compris sa proie : son objet est principalement de ressusciter son frère, mort 100 ans plutôt et de restaurer le pouvoir féodal qu’ils avaient sur la région, se nourrissant littéralement de ses terres autant que de ses hommes. C’est bien le seul désir qu’il manifeste par le dialogue : il est bien un animal tyrannique et pas du tout un amant, en dépit de son apparence de Dom Juan. Il vampirise d’ailleurs indifféremment une femme ou l’enfant d’un « peon », en une séquence hallucinante de froideur et de cruauté qui confine à l’onirisme cauchemardesque le plus étonnant. Nul érotisme sous-jacent en dépit de sa prestance plastique. De même que les deux sœurs sont restées célibataires car trop attachées à leur terre, de même Lavud revient sur la sienne : le vampire mexicain est conforme au mythe européen en tout point mais aussi, sans doute, à l’histoire économique de la petite propriété dans le Mexique rural de l’époque. Et c’est sans doute aussi cet aspect terrien qui acclimata si bien une mythologie pourtant hétérogène au Mexique.
Un exemple de cette rigueur : la première apparition d’Eloisa (devenue secrètement vampire) aux yeux de sa famille. Elle se trouve en haut d’un escalier qu’elle descend naturellement pour recevoir sa nièce et l’homme qui l’accompagne. Comment ne pas songer à la première apparition de Christopher Lee, un an plus tard, dans Dracula [Horror of Dracula / Le Cauchemar de Dracula] (G.-B., 1958) de Terence Fisher dont ce dernier était si fier ? La réflexion sur la dialectique apparence/réalité se traduit par un plan semblable et tout aussi efficace dramatiquement. Impossible aussi de ne pas constater que Lavud, quelques minutes plus tard, monte un escalier qui le mène vers la surface, avec la même attitude hautaine. Marta est ainsi prise en tenaille entre ses deux bourreaux et plus aucune partie de l’espace ne lui est hospitalière : ni la surface ni le sous-sol de l’hacienda. Autre idée géniale : celle de l’autre tante décédée, Maria Teresa (qui n’est en réalité pas morte mais fait semblant de l’être afin de mieux se protéger contre sa sœur vampire et celui qui la domine) qui apparaît pour la première fois tel un fantôme pour, non pas agresser comme on le croit d’abord, mais protéger Marta pendant son sommeil. Admirable instauration d’une ambivalence génératrice d’une angoisse totale. On ne peut s’empêcher de penser à ce que fera Corman dans la série Edgar Poe dès The Fall of the House of Usher [La Chute de la maison Usher] (É.-U., 1960) et aussi dans Pit and the Pendulum [La Chambre des tortures] (É.-U., 1961). Enfin le comte Lavud / Duval joue des apparences contre tous, y compris sa proie : son objet est principalement de ressusciter son frère, mort 100 ans plutôt et de restaurer le pouvoir féodal qu’ils avaient sur la région, se nourrissant littéralement de ses terres autant que de ses hommes. C’est bien le seul désir qu’il manifeste par le dialogue : il est bien un animal tyrannique et pas du tout un amant, en dépit de son apparence de Dom Juan. Il vampirise d’ailleurs indifféremment une femme ou l’enfant d’un « peon », en une séquence hallucinante de froideur et de cruauté qui confine à l’onirisme cauchemardesque le plus étonnant. Nul érotisme sous-jacent en dépit de sa prestance plastique. De même que les deux sœurs sont restées célibataires car trop attachées à leur terre, de même Lavud revient sur la sienne : le vampire mexicain est conforme au mythe européen en tout point mais aussi, sans doute, à l’histoire économique de la petite propriété dans le Mexique rural de l’époque. Et c’est sans doute aussi cet aspect terrien qui acclimata si bien une mythologie pourtant hétérogène au Mexique. Notons que l’intrigue du scénario de La Maschera del demonio [Le Masque du démon] (Italie, 1960) de Mario Bava , tout comme celle du Méndez, reposera aussi sur un jeu des apparences entre deux « sœurs », l’une morte et l’autre vivante, l’une tentant de prendre la place de l’autre au côté du père qui meurt de cette tentative après l’avoir désavouée. Face à ce réseau de relations pathologiques, la normalité repose sur le couple Marta et Enrique mais surtout sur une rupture inattendue : c’est parce qu’une des sœurs se retourne contre l’autre que le rapport de force est rompu en faveur du bien. Le personnage de Maria Teresa est tout à fait étonnant : même Bunuel n’a pas eu cette force plastique qui envahit chacune des séquences où elle apparaît, telle un Christ féminisé, souffrante et compatissante mais pourtant inquiétante : les plans évoquent autant la Universal de l’âge d’or des années 1931-1939 que la peinture baroque et religieuse espagnole la plus classique. Méndez adopte un parti pris équivalent à celui adopté par Browning dans son Dracula (É.-U., 1931) comme on l’a souvent fait remarquer : il présente son vampire dès le début comme un vampire, sans aucune ambiguïté. Ce qui l’intéresse, c’est de découvrir sous chaque palier dramatique, un nouveau palier sous-jacent : le film est une décompression constante qui nous fait passer de l’un à l’autre. Les mouvements doux et enveloppant de la caméra de Rosalio Solano, rompus par quelques plans à l’expressionnisme outré, quelques trucages à la naïveté abrupte mais magnifique car aussi purs qu’à l’époque du cinéma muet, composent une «symphonie de l’horreur» qu’un Murnau n’aurait pas désavouée et qui envoûte autant qu’elle angoisse. Elle permet de laisser surgir une violence ouvertement baroque en de brefs plans frappés de démence par leur violence sauvage : on pourrait parler de la veine authentiquement «primitive» de Méndez.Les Proies du vampire, outre ses qualités intrinsèques qui placent Méndez au rang de cinéaste majeur, est historiquement important comme étape unique, carrefour incontournable – tel celui de cette forêt de studio admirablement éclairée auquel finissent par arriver le couple de voyageurs au début du film (couple voulu contemporains des spectateurs de l’époque) – entre l’acquis des années 1920, 1931-39, 1940-1945 et la modernité naissante de la Hammer Films d’une part et de l’American International Pictures et du cinéma fantastique italien de l’autre, voire même de notre Jean Rollin national qui non seulement le tenait en haute estime mais encore s’est peut-être inspiré de la séquence du livre qui tombe tout seul pour l’amplifier dans son propre Le Frisson des vampires (France, 1970). Pour toutes ces raisons, et aussi pour l’interprétation surprenante de Robles, pour le plaisir brut surtout que procure chacune de ses visions, il faut apprécier cette résurrection du film à sa juste valeur, à savoir la restauration d’une œuvre-clé du cinéma fantastique.(*) Lavud / Duval dit explicitement à ses sbires que sa tentative de reprise en main de la région a pour but la résurrection de son propre frère et qu’il compte régner avec lui : cette déclaration est symboliquement frappée d’une connotation incestueuse, homosexuelle et nécrophilique tout à la fois. Lavud méprise toutes les créatures humaines – vampirisées ou non – qu’il envisage uniquement comme proies inférieures. Seul son propre sang – sang désormais inhumain – trouve grâce à ses yeux : narcissisme forcené, qui fonda aussi, de toute évidence, l’emprise économique et sociale de son clan au temps de l’aristocratie terrienne. Parmi les armoiries qui composent son blason, on distingue nettement une chauve-souris.
Notons que l’intrigue du scénario de La Maschera del demonio [Le Masque du démon] (Italie, 1960) de Mario Bava , tout comme celle du Méndez, reposera aussi sur un jeu des apparences entre deux « sœurs », l’une morte et l’autre vivante, l’une tentant de prendre la place de l’autre au côté du père qui meurt de cette tentative après l’avoir désavouée. Face à ce réseau de relations pathologiques, la normalité repose sur le couple Marta et Enrique mais surtout sur une rupture inattendue : c’est parce qu’une des sœurs se retourne contre l’autre que le rapport de force est rompu en faveur du bien. Le personnage de Maria Teresa est tout à fait étonnant : même Bunuel n’a pas eu cette force plastique qui envahit chacune des séquences où elle apparaît, telle un Christ féminisé, souffrante et compatissante mais pourtant inquiétante : les plans évoquent autant la Universal de l’âge d’or des années 1931-1939 que la peinture baroque et religieuse espagnole la plus classique. Méndez adopte un parti pris équivalent à celui adopté par Browning dans son Dracula (É.-U., 1931) comme on l’a souvent fait remarquer : il présente son vampire dès le début comme un vampire, sans aucune ambiguïté. Ce qui l’intéresse, c’est de découvrir sous chaque palier dramatique, un nouveau palier sous-jacent : le film est une décompression constante qui nous fait passer de l’un à l’autre. Les mouvements doux et enveloppant de la caméra de Rosalio Solano, rompus par quelques plans à l’expressionnisme outré, quelques trucages à la naïveté abrupte mais magnifique car aussi purs qu’à l’époque du cinéma muet, composent une «symphonie de l’horreur» qu’un Murnau n’aurait pas désavouée et qui envoûte autant qu’elle angoisse. Elle permet de laisser surgir une violence ouvertement baroque en de brefs plans frappés de démence par leur violence sauvage : on pourrait parler de la veine authentiquement «primitive» de Méndez.Les Proies du vampire, outre ses qualités intrinsèques qui placent Méndez au rang de cinéaste majeur, est historiquement important comme étape unique, carrefour incontournable – tel celui de cette forêt de studio admirablement éclairée auquel finissent par arriver le couple de voyageurs au début du film (couple voulu contemporains des spectateurs de l’époque) – entre l’acquis des années 1920, 1931-39, 1940-1945 et la modernité naissante de la Hammer Films d’une part et de l’American International Pictures et du cinéma fantastique italien de l’autre, voire même de notre Jean Rollin national qui non seulement le tenait en haute estime mais encore s’est peut-être inspiré de la séquence du livre qui tombe tout seul pour l’amplifier dans son propre Le Frisson des vampires (France, 1970). Pour toutes ces raisons, et aussi pour l’interprétation surprenante de Robles, pour le plaisir brut surtout que procure chacune de ses visions, il faut apprécier cette résurrection du film à sa juste valeur, à savoir la restauration d’une œuvre-clé du cinéma fantastique.(*) Lavud / Duval dit explicitement à ses sbires que sa tentative de reprise en main de la région a pour but la résurrection de son propre frère et qu’il compte régner avec lui : cette déclaration est symboliquement frappée d’une connotation incestueuse, homosexuelle et nécrophilique tout à la fois. Lavud méprise toutes les créatures humaines – vampirisées ou non – qu’il envisage uniquement comme proies inférieures. Seul son propre sang – sang désormais inhumain – trouve grâce à ses yeux : narcissisme forcené, qui fonda aussi, de toute évidence, l’emprise économique et sociale de son clan au temps de l’aristocratie terrienne. Parmi les armoiries qui composent son blason, on distingue nettement une chauve-souris.
11/03/2010 | Lien permanent
Le rationnel et l’irrationnel dans la pensée allemande, par Francis Moury

«Cher frère,
Je suis sûr que tu as pensé à moi depuis que nous nous sommes quittés sur ce mot de ralliement – Royaume de Dieu ! A ce mot de ralliement, nous nous reconnaîtrions, je crois, après n’importe quelle métamorphose. […]»
Lettre de Hölderlin à Hegel, adressée le 10 juillet 1794, in Hölderlin, Œuvres (traduites sous la direction de Philippe Jaccottet, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade-N.R.F., 1967), p. 314.
Avec ces deux livres, voici deux exemples – l’un très connu, l’autre beaucoup moins – de la constante ambition philosophique allemande de penser conjointement l’irrationnel et le rationnel, de les tenir ensemble pour ainsi dire dans un même rayon visant un même terme, une même cible, une même fin. Rayon d’une nature inévitablement dualiste – le kantisme étant l’exemple d’une séparation affirmée et à peine franchissable entre les deux règnes – car composé d’une section lumineuse et d’une section ténébreuse, finissant par se réunir harmonieusement en une totalité apaisée, après leur combat déchirant. Combat à l’origine inévitable, naturel et que tout le problème est, pour les penseurs allemands les plus concernés par cette thématique, de penser correctement. Car il y a, assurément, un problème allemand du début de l’histoire comme il y a un problème allemand de la fin de l’histoire, marquant l’un le début, l’autre le terme du combat en question : les deux sont d’essence religieuse d’abord, philosophique ensuite, politique enfin.
De ce point de vue, G.W.F. Hegel au XIXe siècle, Carl Schmitt au XXe siècle, tels qu’ils sont étudiés en détail à l’occasion d’une oeuvre précise ici (Hegel par Martin), de l’ensemble de la vie et de l’œuvre là (Schmitt par Storme) sont bien tous deux autant représentatifs l’un que l’autre d’une pensée allemande que les études françaises d’histoire de la philosophie allemande n’ont jamais cessée de scruter d’un œil toujours plus fasciné, à mesure que les conséquences de ses positions se sont précisées. Lorsque nous disons «pensée allemande», il faut d’ailleurs s’entendre.
La ligne à laquelle appartiennent des penseurs comme le protestant Hegel ou le catholique Schmitt (1) est celle qui va de Luther à Nietzsche, pas celle de l’Aufklärung des Lumières, ni celle de Lessing ou Kant. Hegel est certes historiquement un «post-kantien» mais il est surtout un condisciple d’Hölderlin et l’auteur d’une grandiose tentative de conciliation métaphysique de l’idéalisme subjectif de Fichte et de l’idéalisme objectif de Schelling. Dans le terme «Phénoménologie», on voit sans être grand devin qu’il y a «phénomène» et qu’il y a «logos». Jean-Clet Martin place Hegel, au début de sa lecture commentée – qui est riche mais point exempte de jugements historiques sommaires, comme celui de la toute première page sur Spinoza, qui serait le premier penseur systématique selon l’auteur : au sens où l’entend Hegel peut-être, mais il y a eu bien des systèmes avant le sien, voir par exemple Octave Hamelin, Le Système d’Aristote édité par Léon Robin, et encore Octave Hamelin, Le Système de Descartes – sous le signe d’Héraclite. C’est vrai mais unilatéralement vrai donc réellement faux. Car Hegel s’est immédiatement placé dans ses propres Leçons sur l’histoire de la philosophie sous le double signe de Parménide et d’Héraclite, déterminant ainsi, dans sa Science de la Logique une théorie de l'être décomposée en une première triade dynamique «être» (Parménide), «néant», «devenir» (Héraclite). L’introduction du néant, de la négation, de la mort comme moyen-terme permettant à l’être d’accéder au devenir, c’est toute l’ambition dialectique de Hegel. De ce point de vue, Jean-Clet Martin a raison de considérer que le crime – et notamment le crime tragique – est une des clés de lecture de la Phénoménologie de l’Esprit (2). Histoire, crimes de l’histoire, guerres, grands hommes, héros : des Grecs à l’Allemagne prussienne, ils constituent des jalons. Le plus grand crime de l’histoire humaine signant aussi sa seconde naissance : la mort du Christ, le Christ auquel Hegel a consacré un livre, et qui fut l’un des points centraux, névralgiques, dynamiques de sa pensée concentrique, circulaire. Si l’un des moteurs irrationnels du rationalisme hégélien fut le Christ et sa mort, l’autre fut l’histoire des États avant et après le Christ. Schmitt repensera sur ces bases, mais d’une manière appauvrie.
Carl Schmitt était un juriste catholique, pas un philosophe de formation mais il est pourtant un passionné de théologie, considérant l’État comme conditionné par l’exigence sotériologique née de l’Ancien puis du Nouveau Testament. Le jeune Schmitt – grand lecteur d’Adolphe de Harnack et très intéressé par les positions du gnostique Marcion (3) – considère la désignation d’un ennemi comme le moteur post-adamique inévitable de la constitution de l’État. Le Schmitt mature, encouragé par Martin Heidegger à se rallier au nazisme, découvre dans le Léviathan de Hobbes une faille – celle du libéralisme et du droit naturel – par laquelle s’engouffre l’esprit maritime juif, opposé à l’esprit terrestre catholique et allemand. Il considère que Hitler perd la guerre en raison de son athéisme tandis que les SS se méfient politiquement de lui. Le Schmitt emprisonné, déchu, interdit d’Université de l’après-guerre, réfléchit sur la nouvelle disposition de l’espace mondial. Il reconnaît que la forme transnationale juive a triomphé sous les apparences de la victoire militaire des Juifs américains. Fernand Braudel avait raison, en somme ! Cependant, la Théorie du partisan assure que la pensée de la guerre internationale n’est possible que si on la considère comme une continuation de la politique. Tristan Storme ne cite pas Clausewitz (4) alors que cette formule schmittienne en semble être l’héritière directe. Du Mal originel lié au péché adamique, en passant par la rédemption incarnée par l’État, jusqu’à un nouvel ordre mondial catholique retardant la Parousie face à l’Antéchrist (ordre foncièrement antisémite, antisémitisme issu en partie du marcionisme de Schmitt qui refuse par exemple la possibilité de la conversion juive au catholicisme), la dynamique dialectique demeure évidente, récurrente.
Est-ce que Schmitt – discuté par ses contemporains allemands (par exemple Habermas) avec respect, voire admiré en son temps par Alexandre Kojève et Raymond Aron – est un fossoyeur de l’hégélianisme ou un de ses plus étranges avatars ? L’étude de Storme est autant nourrie de riches notes et commentaires – annexes entre lesquelles on doit constamment trancher mais qu’on doit aussi constamment conserver en mémoire, ce qui rend la lecture un peu difficile – que celle de Martin est linéaire, dépouillée, claire et coulée, seules quelques notes émaillant le commentaire. D’autre part, certaines phrases «universitaires» de Storme sont particulièrement ridicules voire parfaitement incompréhensibles (5). Dans un cas, on commente assez clairement un monument déjà bien cerné; dans l’autre, on pénètre un univers chaotique inconnu sauf par les spécialistes de la pensée politique allemande. Storme n’a pas eu la tâche la plus facile. G.W.F. Hegel est au programme de l’agrégation de philosophie depuis l’après-guerre de 1945 alors que Schmitt fut révélé tardivement par Julien Freund (Léviathan de Hobbes et Essence du politique obligeant : Freund s’intéressait à ce qui est intéressant dans son domaine) en France, vers 1970, et ne commence à être vraiment édité et commenté chez nous que depuis 1990. De toute évidence, le niveau de culture de Schmitt est inférieur à celui d’un Hegel, si on s’en tient à la médiocrité des quelques lignes commentant Spinoza, et même Hobbes, citées ou rapportées par Storme. Si le calibre général de sa pensée est inférieur à celle de Hegel, la ligne rouge dynamique de sa dialectique les relie forcément dans un même mouvement tragique. Comme Hegel a eu son moment «Napoléon», Schmitt a eu son moment «Hitler» : Schmitt se qualifiait d’Épiméthée chrétien pour s’en excuser, référence mythologique qu’il assumait au maximum de sa signification relativement à une critique des valeurs humanistes, critique contemporaine de celle de Martin Heidegger dans sa Lettre sur l’humanisme.
Il faut, en somme, considérer que les livres de Martin et de Storme confirment chacun, à nouveau et s’il en était besoin, la clairvoyance des analyses historiques, techniques et critiques de l’histoire de la philosophie allemande telles qu’on les trouve chez un Émile Boutroux (Études d’histoire de la philosophie allemande, Vrin 1926 et Le philosophe allemand Jacob Boehme (1888) repris in Études d’histoire de la philosophie, Félix Alcan, 1925), un Alexandre Koyré (La Philosophie de Jacob Boehme, Vrin, 1929), un Victor Delbos, un Émile Bréhier, un Jean-Édouard Spenlé ou plus récemment un François Chatelet (Hegel par lui-même, Seuil, coll Microcosmes, section Écrivains de toujours, 1968) et enfin un André Glucksmann (Les Maîtres penseurs, Grasset, 1977).
Notes
(1) Religions différentes qui peuvent, à l’occasion, se trouver d’accord sous la plume d’un Joseph de Maistre dans Du Pape (Éditions Pélagaud, Lyon, 1874), p. 19 : «Celui qui aurait le droit de dire au Pape qu’il s’est trompé, aurait, par la même raison, le droit de lui désobéir; ce qui anéantirait la suprématie (ou l’infaillibilité), et cette idée fondamentale est si frappante, que l’un des plus savants protestants qui ait écrit dans notre siècle a fait une dissertation pour établir que l’appel du Pape au futur concile détruit l’unité visible. Rien n’est plus vrai; car d’un gouvernement habituel, indispensable, sous peine de la dissolution du corps, il ne peut y avoir appel à un pouvoir intermittent.»
(2) Une remarque concernant les traductions françaises intégrales, modernes ou contemporaines, de ce texte classique de Hegel : il en existe actuellement quatre mais elles sont parfois considérablement différentes les unes des autres sur des points essentiels. En privilégier une au dépend des autres, ne va donc pas de soi. Pour mémoire, il s’agit dans l’ordre chronologique des traductions de Jean Hyppolite (Aubier, coll. Bibliothèque philosophique, deux volumes, VII-358, 1941), de Jean-Pierre Lefebvre (Aubier, Bibliothèque philosophique, 1991), de Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière (Gallimard, coll. N.R.F.-Bibliothèque philosophique, 1993) et de Bernard Bourgeois (Vrin, coll. Bibliothèque des Textes Philosophiques, 2006).
Martin précise qu’il a privilégié celle de Lefebvre mais qu’il utilise parfois celle d’Hyppolite. Cette précision qui n’est pas justifiée était cependant nécessaire et honnête relativement à la situation inextricable, au choix cornélien posé au novice des études hégéliennes par cette multitude absurde de traductions. Pour notre part, nous déconseillons celle de la N.R.F. de 1993 : elle est redoutable de complexité et ses néologismes sont peut-être les pires jamais créés dans l’histoire des traductions hégéliennes en France. Nous aurions tendance à préconiser la première (parce que Jean Hyppolite fut un révélateur et un moment-clé, après Jean Wahl, Henri Lefebvre et N. Guterman, enfin Alexandre Kojève, de la révélation de l’hégélianisme en France) et la dernière (parce que Bernard Bourgeois a traduit l’essentiel de l’Encyclopédie des Sciences philosophiques de Hegel et qu’il est, pour cette raison, bien tentant de le considérer comme le plus commode car le plus «totalisant» et peut-être aussi parce que le plus «totalisant», comme étant le plus proche de la vérité de cette totalité). Reste qu’en l’état, le spécialiste ou celui rêvant de le devenir, est tenu de lire les quatre, sans parler de l’essentiel : le texte allemand original.
Hegel et Heidegger sont les deux philosophes allemands ayant posé le plus de problèmes aux traducteurs français : pas de chance car ce sont deux des plus intéressants ! Dans le cas de Hegel, on se souvient que François Châtelet s’en remettait presque plus volontiers aux traductions françaises du XIXe siècle qu’à celles du XXe : en tout cas, nous confirmons qu’il n’est toujours pas inutile de comparer la vieille traduction de la Grande Logique par Véra avec celles de La Science de la Logique par S. Jankélévitch (même s’il y manque une négation, selon notre cher M. Barnouin !) ou plus récemment par Bernard Bourgeois. Pour une simple raison : les traducteurs contemporains d’un auteur saisissent parfois plus aisément ses nuances de style et de pensée. On sait ainsi que Goethe préférait, à la fin de sa vie, lire son propre Faust dans la traduction française de notre Gérard de Nerval.
(3) Cf. Serge Hutin, Les Gnostiques (P.U.F., coll. Que sais-je ? n°808, pp. 98 et 102) : Marcion fut excommunié, en raison de son dualisme radical «conséquence d’une minutieuse exégèse anti-judaïque» par son propre père qui était évêque de la communauté chrétienne de Sinope. Saint Paul, avant Marcion, avait déjà polémiqué contre la Loi de Moïse, loi morte gravée sur des pierres, opposée à la Loi nouvelle apportée par Jésus, gravée dans les cœurs. L’impossibilité de l’œcuménisme n’est pas uniquement le fait du gnosticisme mais aussi celui du catholicisme originel. Plusieurs penseurs allemands du XXe siècle récusèrent l’idée d’œcuménisme pour des raisons variées, pas uniquement religieuses : l’une d’elles étant que les formes de la culture, si elles se mélangent, disparaissent en perdant leur originalité.
(4) Dans le cas des livres de Martin comme de Storme, un commun défaut : les index des noms cités sont incomplets. Par exemple il manque Épiméthée, souvent cité mais irrémédiablement absent de l’index dans l’ouvrage de Storme et il manque Roger Caillois ou Alexandre Kojève, cités dans une note mais absents de l’index dans celui de Martin. Le cas de Clausewitz est un cas limite : Storme ne le cite pas du tout alors qu’il aurait dû le citer.
(5) Un terrifiant exemple, presque parodique, à la page 40 : «Cette théorie représente l’aboutissement d’une dynamique processuelle, ou plutôt d’un modèle théorico-narratif tendanciellement elliptique, tout au moins quant à sa trame, qui procède selon un mode fragmentaire, mais qui, cependant, n’exclut à aucun moment la possibilité d’une reconstruction cohérente, non interpolée, du schéma sous-tendu.»
Qui dit mieux ?
Derrida ou Guattari sont battus sur leur propre terrain.
Heureusement, de telles cauchemardesques occurrences demeurent assez rares et l’étude de Storme passionnante d’un bout à l’autre, en dépit de ces quelques inepties, et aussi des assez nombreuses répétitions et redites, ces dernières d’ailleurs pas tout à fait inutiles tant la matière est parfois ardue pour l’esprit français non prévenu ou peu rompu à l’analyse exégétique. Reste que ce livre de 265 pages aurait pu tenir en 100, y compris son bel appareil critique final. Mais encore une fois, tel quel, à lire de toute manière sans l’ombre d’une hésitation en raison de la richesse du contenu !
09/07/2010 | Lien permanent
Les deux visages du Dr. Jekyll de Terence Fisher, par Francis Moury
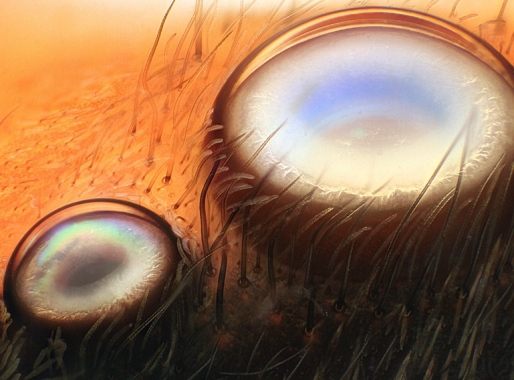
Les Envoûtés de John Schlesinger.
La chambre des tortures de Roger Corman.
Les Vierges de Satan de Terence Fisher.
Meurtres sous contrôle de Larry Cohen.
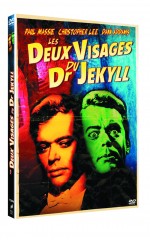 Fiche technique succincte :
Fiche technique succincte :Réalisation : Terence Fisher
Production : Anthony Nelson-Keys et Michael Carreras (Hammer film)
Distribution originale : Columbia
Scénario : Wolf Mankowitz d'après le roman de R. L. Stevenson
Dir. ph. : Jack Asher, B.S.C. (MegaScope-Technicolor 2.35)
Dir. art. : Bernard Robinson
Montage : James Needs et Eric Boyd-Perkins
Musique : John Hollingsworth, Monty Norman, David Heneker
Maquillage : Roy Ashton
Casting succinct par ordre d'apparition à l'écran :
Janina Faye (Jane, la petite enfant muette), Paul Massie (Dr. Henry Jekyll), David Kossoff (professeur Ernst Littauer), Dawn Addams (Kitty Jekyll), Christopher Lee (Paul Allen, amant de Kitty), Oliver Reed (le proxénète), Norma Marla (Maria la danseuse au serpent), Francis de Wolf (l'inspecteur de police), etc.
Résumé du scénario :
Londres 1874 : le docteur Henry Jekyll, un savant marginal radié de l'université et marié à la belle mais infidèle Kitty, a mis au point une drogue permettant de révéler la dualité humaine sans aucune limite sociale. Une nuit, il se l'injecte et devient pour quelques heures le beau, séduisant, intelligent mais sadien Mr. Hyde. Ce double maléfique enclenche un engrenage infernal destiné à anéantir Jekyll dont il veut la mort.
«[...] On ne peut pas montrer le Mal sous l'aspect d'un chérubin. Ce qui par contre ne signifie pas que le Mal soit toujours repoussant. Il peut prendre des formes très séduisantes. N'est-ce pas ? [...] Évidemment, il y a déjà cette double personnalité qui doit représenter les deux aspects de son âme, mais ni Jekyll ni Hyde ne doivent être simples. Ils ont eux même deux visages [...].»
Terence Fisher, extraits d'un entretien accordé à Michel Caen, paru in Midi-Minuit Fantastique, n°10-11 (éd. Éric Losfeld / Le Terrain vague, hiver 1964-1965), p. 9.
Les deux visages du Dr. Jekyll [The Two Faces of Dr. Jekyll, G.-B., 1959] de Terence Fisher est un film rare qui s'avère fidèle à sa réputation majeure, et cela pour deux raisons principales.
Replacé dans la filmographie du roman initial (paru en 1886) de Robert Louis Stevenson (1850-1894), il est clairement sa version cinématographique la plus originale, la plus oppressante et la plus adulte.
Replacé dans la filmographie elle-même de Terence Fisher, on peut désormais affirmer qu'il constitue, de toute évidence, une pierre d'angle à son édifice thématique et plastique.
Replacée dans la filmographie parlante du roman, tout d'abord, la version Fisher apporte des innovations capitales par rapport aux versions classiques américaines antérieures de Rouben Mamoulian (1931) et Victor Fleming (1941). Au contraire de la version de 1931 qui marque l’accomplissement de la représentation traditionnelle du thème à l’écran, la version de 1941 produite et réalisée par Fleming était déjà un pas franchi dans une direction nouvelle, celle qui aboutit précisément à la révision fondamentale du thème dans Les Deux visages du Dr. Jekyll.
Sous ses dehors plus civilisés et moins frustes, apparaissant moins surréaliste et moins baroque que la version de 1931, la version de 1941 demeure encore aujourd’hui plus terrifiante car beaucoup plus intelligente. L’horreur physique y est supplantée par l’horreur psychologique et la lourde démonstration des effets spéciaux, attendus, s’estompe heureusement au profit d’un approfondissement du sujet. Hyde chez Fleming n’est pas un monstre de foire mais un sadique dont le visage demeure strictement humain : c’est simplement le visage d’une brute vicieuse au terme de sa transformation. Et les effets de sa brutalité sont d’autant plus impressionnants. C’est sans doute la raison pour laquelle la bande annonce de 1941 refusa de dévoiler le visage de Hyde aux spectateurs : Fleming et la M.G.M. étaient bien conscients qu’ils avaient innové. En somme, on pourrait dire que la version Mamoulian de 1931 est la version pure de l’enfance, que la version Fleming de 1941 est la version plus complexe de l’adolescence, que la version Fisher est la version de l'âge adulte (1).
La vision donnée du personnage mythique de Stevenson est renouvelée de plusieurs manières dans Les Deux visages du Dr. Jekyll : le scénario de Wolf Mankowitz (1924-1998) joue sur un approfondissement de l'idée de dualité d'une part, et d’autre part sur un pessimisme supérieur qui contamine les autres personnages principaux.
Jekyll est toujours un savant positiviste spiritualiste mais il est déjà, en dépit de quelques traces de sociabilité, sur la voie de la marginalité, de l'isolement. Il est ainsi placé sous le signe de :
- Freud auquel renvoie directement l'hypothèse émise par Jekyll concernant l'étiologie névrotique, probablement hystérique, de l'infirmité des enfants muets qu'il accepte dans son jardin par humanité mais aussi pour mieux pouvoir étudier in vivo la nature humaine,
- Honoré de Balzac (Mankowitz avait peut-être lu La Peau de chagrin) dont la métapsychologie décrite par le Dr. Francis Pasche est ici illustrée dans la mesure où le Dr. Littauer diagnostique que le métabolisme de Jekyll est en train de se brûler tant sont temps interne organique semble accéléré, au prix d'une dépense d'énergie prodigieuse,
- Spinoza (le conatus amoral spinoziste correspond à l'argumentation ultime de Hyde dans le miroir : il ne peut agir autrement s'il veut subsister) et surtout de
- Nietzsche auquel le dialogue rend hommage en citant pratiquement deux fois explicitement le titre Par-delà le bien et le mal. Du coup le personnage verse du côté de la problématique expressionniste de la toute-puissance et vers le problème romantique puis expressionniste allemand du «doppelganger» : le double dialogue démoniaquement avec son original, à travers un miroir ! La séquence est spectaculaire et elle a bien, au fond, quelque chose de faustien mais en penchant davantage du côté du Faust de F. W. Murnau que du côté du texte original de Goethe. Cela dit, Lotte H. Eisner qui savait ce que le terme démoniaque voulait dire dans la culture allemande, aurait certainement apprécié le film à sa juste valeur : comme un héritier cultivé et original.
Autre aspect pessimiste traité d'une manière à la fois littéraire et plus contemporaine : la drogue qui lève les inhibitions mais engendre l'impuissance sexuelle, le mal et le sado-masochisme. Mamoulian avait déjà revendiqué cet aspect métaphorique et Fisher insiste encore en faisant de Jekyll un opiomane en puissance – les effets immédiats de sa première auto-injection évoquent plutôt ceux de l'héroïne : l'allusion est hors de doute pour les spectateurs londoniens de 1959 qui savent faire la part littéraire du thème de l'opium et la part sociologique montante de la drogue à la mode – et de Hyde un opiomane en acte, finalement un sadique pur qui jouit davantage de la strangulation que du viol, au dernier stade du vice. La drogue ravage de l'intérieur la vie sociale et la vie amoureuse de Jekyll devenu pauvre, marginal, impuissant tandis que son double est en apparence un homme sociable, aisé et surpuissant mais en réalité un animal intellectuel, dangereux et inhumain : on n'oublie pas le plan ahurissant et authentiquement dostoïevskien – plan exemplaire du «noir et blanc coloré» dont parlait Jean-Marie Sabatier à propos de la photo de Asher, bien que tout le restant du film soit admirablement coloré – où Jekyll se réveille à l'aube, dans le ruisseau alors que c'est Hyde qui s'est fait assommer. Fisher avait raison d'être fier de ce plan qui demeure magnifique. Il faut saluer ici la performance de Paul Massie, comédien un peu oublié aujourd'hui mais qui demeure pourtant remarquable grâce à ce film-ci. Sous certains angles, son visage évoque celui de Klaus Kinski lorsqu'il joue Hyde, et celui de Freud lorsqu'il joue Jekyll.
Troisième innovation : la dualité féminine n'est plus illustrée par l'emprise de deux femmes différentes sur Jekyll-Hyde, mais par la peinture de la dualité au sein d'une seule femme qui est sa propre épouse. Kitty est d'une certaine manière une seconde Jekyll féminine, la drogue et la science en moins. C'est peut-être le trait de génie le plus profond du scénario, et son innovation la plus impressionnante qui aboutit au suicide plastiquement spectaculaire de la très érotique Dawn Addams, qui trouve ici le plus beau rôle de sa carrière, la même année où elle apparaissait plus brièvement mais tout aussi belle dans Die Tausen Augen des Dr. Mabuse [Le Diabolique Dr. Mabuse, RFA, 1960], l'ultime chef-d'œuvre de Fritz Lang. Une certaine dualité est également introduite dans le personnage ambivalent de la danseuse au serpent, incarnée par Norma Marla qui ne fréquente que Hyde sans nullement connaître Jekyll : elle est montrée comme une marginale névrosée hésitant entre la bestialité et l'amour pervers d'une idée qui est celle de la toute-puissance virile. On est déjà bien au-delà, concernant les personnages de femmes gravitant autour de Jekyll et Hyde, de la relative univocité des anciennes versions muettes et parlantes.
Replacé dans la filmographie de Terence Fisher, Les Deux visages du Dr. Jekyll est historiquement, thématiquement et esthétiquement non moins passionnant, tant sa cohérence avec l'univers fishérien est profonde. Notons immédiatement que sa date mentionnée au copyright sur la copie Technicolor, écrite en chiffres romains minuscules, nous semble bien être 1959 : ce qui contredit un certain nombre de dates mentionnées dans divers livres et sites Internet. Fisher n'était pas satisfait d'un script pourtant superbe et qu'il a encore approfondi dialectiquement par sa mise en scène. On se souvient de sa déclaration à la revue française Midi-Minuit Fantastique : il ne lui suffisait pas que Jekyll ait «deux visages», il souhaitait que Jekyll et Hyde eussent, «chacun, deux visages» : il a réussi dans la mesure où Jekyll comme Hyde, à défaut d'avoir chacun deux visages, sont bien vus de deux manières différentes dans le film : par eux-mêmes et conscients de la situation, et par les autres qui en sont inconscients durant la majeure partie de l'intrigue, si bien qu'il y a, effectivement, deux Jekyll et deux Hyde.
La première apparition de Hyde procède d'une idée identique à celle initialement réalisée dans Le Cauchemar de Dracula [Dracula / The Horror of Dracula, G.-B., 1958] et dont Fisher était si légitimement fier : de même que le spectateur est surpris en 1958 de ne pas voir un vampire mais un être d'apparence physique normale au comportement normal, il ne constate en 1960 qu'une modification d'écriture avant de voir, d'abord de dos pour augmenter le suspense, un bel homme qui s'avère n'être nullement monstrueux physiquement.
L'expérimentation sur le singe évoque pour sa part celles sur d'autres singes que pratiquait Frankenstein dans La Revanche de Frankenstein [The Revenge of Frankenstein, G.-B., 1958]. Cet échange entre animalité et humanité, échange trouble amenant la confusion la plus démoniaque, est une constante fishérienne. La même année, Les Étrangleurs de Bombay (G.-B., 1959) aussi tourné en MégaScope (le «StrangloScope» parfois mentionné sur le matériel promotionnel étant une simple idée publicitaire) mais en N&B identifiait le serpent (un cobra) au mal : ici le serpent (un python ou un boa) est expressément identifié à celui du Livre de la Genèse par le dialogue, et, s'il est cette fois-ci filmé en MégaScope Technicolor, aucune mangouste providentielle n'en vient à bout. Le jeune acteur Oliver Reed en proxénète tabassé par Paul Massie dégage déjà une étrange impression de bestialité : Fisher donnera à Reed peu de temps plus tard son premier grand rôle vedette, celui du loup-garou Léon Carido, dans La Nuit du Loup-Garou [The Curse of the Werewolf, G.-B., 1961].
Les couples de Les Deux visages du Dr. Jekyll sont des couples maudits car leur accord physique, moral et intellectuel est impossible ou alors cet accord existe mais repose sur le mal qui le déséquilibre inévitablement : Henry-Kitty, Kitty-Paul, Hyde-Maria sont ainsi autant de couples voués par le scénario à la destruction ou à l'auto-destruction. Ils évoquent bien d'autres couples fishériens victimes du destin, d'eux-mêmes, ou du mal qui les environne : on songe par exemple, et rétrospectivement, au couple tragique qui sera formé par Christina et Hans dans Frankenstein créa la femme. Lee est d'ailleurs assez étonnant dans ce rôle de Paul Allen, sorte de perdant magnifique, assez dostoïevskien aussi mais en même temps très victorien, et qu'il incarne avec une belle sincérité. Lee était, c'est l'occasion de le noter une fois pour toutes, tout aussi bon lorsqu'il incarnait un second rôle que lorsqu'il était un personnage de premier plan : voir par exemple son interprétation dans l'intéressant Hammer Film Hurler de peur (G.-B., 1961) de Seth Holt appartenant au même catalogue Columbia, et que Sony édite simultanément en DVD zone 2 français.
Le viol de Marla Landi par l'ancêtre des Baskerville, viol qui aboutit à un meurtre sadique, dans Le Chien des Baskerville (G.-B., 1959) fait écho au viol de Kitty par Hyde en 1959 qui annonce celui de la servante Yvonne Romain par le prisonnier dans La Nuit du Loup-garou (G.-B., 1961) puis celui de Veronica Carlson par Frankenstein dans Le Retour de Frankenstein [Frankenstein must be destroyed, G.-B., 1969]. Le viol a plusieurs sens chez Fisher : d'abord il marque de la part de son agent sa nature mauvaise, voire diabolique, ensuite il concorde souvent avec une advenue, une révélation, une confirmation du mal comme mal, et de son irruption ou de son emprise sur le personnage passif ou sur la société entière à laquelle ce dernier appartient. C'est non seulement une femme mais l'ordo rerum entier qui est violé : le viol débouche donc sur la terreur, devient un élément d'une esthétique fantastique reconduite à son origine mythique primitive.
La peinture des bas-fonds victoriens du Londres de 1874 est aussi virulente par son sadisme et sa perversion que celle présentée dans le Jack l'éventreur (G.-B., 1958) de Robert S. Baker et Monty N. Berman, producteurs-réalisateurs concurrents de la Hammer à la même époque et qui venaient de produire L'Impasse aux violences [The Flesh and the Fiend] en 1959. Le père qui vend sa fille avant d'agresser Hyde est joué par un acteur qu'on voyait chez Baker et Berman d'ailleurs et l'importance donnée aux ambivalences sexuelles, au French-cancan graveleux, à la dégradation masochiste, au voyeurisme, à l'homosexualité tant masculine que féminine (la fascination de Hyde pour les deux lutteurs demi-nus, la maîtresse de la boîte de nuit où Kitty passe sa dernière soirée) en proviennent aussi en droite ligne : la filiation est évidente.
L'approfondissement de la dualité mal-bien en dualité homme-femme sera poursuivie par Fisher six ans plus tard dans Frankenstein créa la femme puis reprise et restituée dans le cadre stevensonnien par le trouble et passionnant Dr. Jekyll & Sister Hyde (G.-B., 1971) de Roy Ward Baker, la dernière grande variation sur le thème, et l'un des derniers grands Hammer Films, aussi bien.
Enfin, sur un plan davantage philosophique, Fisher livre à nouveau une description désabusée, pessimiste, des limites et des moyens de la connaissance humaine, qu'il critique avec un romantisme parfois surprenant : critique sociale acide, sans complaisance qui s'oppose à ce gros plan romantique du visage presque extatique de Jekyll méditant sur le problème de l'identité, ou encore à cette stupéfiante séquence du retour caché de Hyde au laboratoire clamant sa volonté de revenir mais se blessant à la main sous l'effet de l'instance contraire, et dont la solitude terrifiante et l'infirmité morale évoquent immédiatement, charnellement, une malédiction analogue à celle qui pèse sur le vampire en 1958 ou sur la créature de Frankenstein en 1958. Il y a un désespoir lyrique fishérien allié à un empirisme amer. La conclusion du film de 1959 est originale, apportant un rebondissement inédit qui modifie presque la portée ontologique du personnage. Sa puissance provient de ce qu'elle est démultipliée en deux temps, au lieu d'un seul. Elle provient aussi du fait qu'elle met un terme en apparence classique, au départ, à une histoire qui a été renouvelée en profondeur. Dialectiquement, le visage émacié de Paul Massie semble alors celui d'un personnage quasiment inédit.
Un mot sur l'aspect purement technique du film : son originalité syntaxique relativement à la métamorphose de Jekyll en Hyde est patente. Fisher refuse le fondu, les trucages, tous ces effets appliqués laborieusement par le cinéma muet puis parlant. Il s'en passe magistralement. Tout est dit grâce au travelling menaçant qui évoque la montée en puissance de la drogue, et au champ-contrechamp qui révèle le changement du visage. Fisher a déclaré qu'il n'aimait pas le format «letterbox» (le CinemaScope 2.35) mais lorsqu'il l'utilise, il lui fait rendre, au lieu du clinquant gratuit, le maximum d'intensité tant du point de vue du cadre que du point de vue de la profondeur de champ. Les plans séquences sont fabuleux d'élégance et d'efficace discrétion même lorsqu'ils sont très brefs ou décomposés en mini-plans séquences entrecoupés de plans fixes (sortes de plans séquences qu'on pourrait dénommer : plan-séquence fragmenté) : celui qui ouvre le film sur un jardin d'enfants dévoilant brusquement la psychopathologie du mal chez des enfants handicapés, s'achevant sur les yeux de la petite fille muette, est sublime de précision. Quelques effets visuels très brillants émaillent en outre le film : passage par un effet de rideau angulaire ou droit, qui ressemble à un dévoilement voire même à un déchirement syntaxique, d'un gros plan du visage de Hyde à une séquence brutale de lutteurs en plan de demi-ensemble, décadrage unique mais techniquement somptueux et tiré au cordeau pendant la grande séquence nocturne du suicide d
18/07/2009 | Lien permanent
D’une nouvelle position des vieux problèmes, par Francis Moury


18/03/2009 | Lien permanent
Le Golem de Paul Wegener et Carl Boese, par Francis Moury

25/08/2009 | Lien permanent
Gerbert d’Aurillac, héritier de Boèce, an 1000, par Francis Moury

 Gerbert d’Aurillac (1) (né vers 940/945, mort le 12 mai 1003) est né en Aquitaine ou en Auvergne, d’une famille modeste. Remarqué par ses maîtres scolaires et spirituels de Saint-Géraud d’Aurillac – monastère réformé par Odon de Cluny en 925 – il sillonna l’Europe médiévale de France en Allemagne et en Italie, s’élevant aux plus degrés de la hiérarchie ecclésiastique et politique. Il devint, après un certain nombre d’aventures et d’alliances mouvementées (il craignit à un moment pour sa vie, comme en témoigne la lettre 203A datée de 996, p. 543) pape de l’Église catholique de 999 à 1003. Érudit formé par la théologie, par les éléments grecs et latins transmis de la philosophie antique, par les lettres d’humanité antique encore disponibles sous la forme manuscrite qui demeurait rare et recherchée, Gerbert est un intellectuel comme on pouvait l’être à la fin du Xe siècle en Occident : renommé pour ses connaissances ressortant des 4 disciplines de la physique ou quadrivium (arithmétique, astronomie, géométrie, musique) auxquelles s’adjoignent les 3 disciplines du trivium (grammaire, rhétorique, logique).Dans l’histoire de la philosophie médiévale, à laquelle il appartient autant qu’à l’histoire générale, à l’histoire de la littérature latine ou à l’histoire du catholicisme, on peut le situer commodément mais d’une manière grossière entre Jean Scot Érigène et saint Anselme. Si Gerbert n’a absolument pas leur originalité, il est en revanche le «compendium» parfait de ces générations d’élite conservatrices vivant au sein d’une pauvreté matérielle dangereuse mais au sein desquelles pouvait fleurir le génie. Il en restitue, reflet dérivé de sa propre image telle qu’il la sculpte par son style, la moyenne ambition, la moyenne culture, les moyennes aspirations, d’une manière parfaitement claire. Il est l’exact modèle médiéval transcrivant le modèle antique de l’orateur politique formé par Cicéron et Quintilien, celui du «vir bonus dicendi peritus».C’est sa surprenante et variée Correspondance que nous lisons aujourd’hui dans cette nouvelle édition rassemblée en un seul fort volume de 730 pages bilingues, alors que la première édition précédente (de 1993) était divisée en deux tomes. Commodité supérieure évidente : la division entre un premier groupe (lettre n°1 du printemps 983 à n°129 de fin août 988) et un second groupe (n°130 de septembre 988 à n°220 d’été 997) est maintenue mais elle est unifiée par la possibilité de les lire dans un ordre chronologique matériel simplifié, et par celle d’utiliser les «conspecti siglorum» et «index nomini» d’une manière plus aisée. Sans oublier les quelques annexes (lettres de divers correspondants à Gerbert lui-même) et les cartes géographiques et tableaux chronologiques ou de concordance. Cette belle collection philologique des Belles lettres, connue sous le nom de Classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, a beau avoir supprimé le mot «France» de son intitulé, et son papier a beau être deux fois plus mince que le papier qu’elle utilisait dans les années 1960, reconnaissons que son 45e volume rend philologiquement autant qu’historiquement hommage à son fondateur Louis Halphen.Gerbert a davantage été considéré comme un intellectuel que comme un philosophe. Lorsque le quotidien Le Monde avait chroniqué 10 grandes figures de l’an mil, Jean-Pierre Langelier avait intitulé son article sur Gerbert, paru le 18 juillet 2000, du titre voltairien de Gerbert, le pape horloger. Cette connotation évoquant des réductions similaires dans d’autres domaines (Louis XVI, le «roi serrurier», par exemple) trahit fondamentalement son objet. Lorsque F. Picavet avait écrit sa biographie de Gerbert, il l’avait doté d’un titre autrement magique : Gerbert, un pape philosophe d’après l’histoire et d’après la légende (éd. Leroux, 1897). C’est d’autant plus dommage pour cet article de Langelier, dont nous avons retrouvé la référence notée par nous au crayon sur notre exemplaire de Gilson, qu’il nous avait, il nous en souvient très bien, réellement passionné : Gerbert y était présenté non seulement comme le prototype de l’intellectuel médiéval mais encore restitué avec toute sa densité historique et métaphysique. À quoi tiennent le souvenir et l’effet produit par un article de journal ? Il nous semble que tenir aujourd’hui en main cet épais et noble volume rouge estampillé du «sceau au chevalier» qui identifie visuellement cette collection des Belles lettres nous a permis, huit ans après sa lecture, de pénétrer bien plus avant l’envers du miroir, et de saisir enfin réellement l’épaisseur authentique de sa réalité.L’historiographie française de la philosophie est sans doute responsable de ce gauchissement possible puisqu’il fut réel. Car, si on tient aux critères qui permettent de se dire philosophe au Xe siècle, Gerbert le fut absolument même s’il ne fut pas un grand philosophe. Bréhier ne lui rend pas tout à fait justice puisque qu’il ne retient de Gerbert que son traité de logique, certes techniquement passionnant et qui entre bien le fer de la dialectique dans la plaie métaphysique majeure du moyen âge, mais qu’il met de côté le restant : son admirable discours d’investiture lorsqu’il est nommé pape, recopié dans une lettre, et bien d’autres choses. C’est Gilson qui restitue exactement et synthétiquement ce qu’il fut «sub specie aeternitatis» comme «sub specie philosophiae» dans la mesure où Gilson a une conception plus compréhensive, plus extensive (nous n’entendons pas ici ces deux termes au sens étroitement technique qu’ils ont en logique formelle) de la philosophie médiévale que Bréhier. Gilson est nourri de la vie du moyen âge autant que Bréhier était nourri de celle de l’antiquité hellénistique mais il faut savoir qu’il y eut entre eux une différence d’appréciation fondamentale de la période ici considérée. Pour mesurer ce qui les sépare lorsqu’ils envisagent un philosophe médiéval, il convient de lire un troisième homme, qui résume admirablement l’enjeu de la question, nous avons nommé Claude Tresmontant, dans l’avant-propos de La Métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie chrétienne – Problème de la création et de l’anthropologie des origines à Saint Augustin (Le Seuil, 1961).Tresmontant y prend d’une manière très précise et puissante la mesure du combat et choisit le parti de Gilson – qu’il ne nomme pas – contre Bréhier en discutant très précisément les textes essentiels de Bréhier consacrés à la philosophie médiévale. Non seulement le fascicule 3 de Bréhier, non seulement tel passage de l’introduction de Bréhier à Énnéades II, 9 Contre les Gnostiques (aussi aux Belles Lettres, textes grecs avec traduction) mais encore et surtout le fameux article de Bréhier Y a-t-il une philosophie chrétienne ? paru dans la Revue de Métaphysique et de Morale de 1931. Il faut dire que d’autres l’avaient déjà très bien tranché : il suffit de lire le Saint Anselme de Karl Jaspers dans Les Grands philosophes (trad. française chez U.G.E., coll. 10/18, in tome 4) ou les premières pages de l’étude classique de Koyré, L’Idée de Dieu dans la philosophie de saint Anselme (réédition Vrin, coll. Reprise, 1923-1984 et notamment son §IV, Les Sources de la philosophie de saint Anselme), pour saisir toute la densité matérielle de la question. En résumé, ces humanités antiques, cette logique d’Aristote, ce néoplatonisme partiellement assimilé par la Patristique, ils se combattent au sein d’une évolution philosophique théologique authentiquement chrétienne, contrairement à ce que Bréhier soutient même si, techniquement, on peut comme lui admirablement en isoler les éléments hétérogènes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Gilson renvoyait généreusement et techniquement au traité de Bréhier sur La Philosophie du Moyen Âge (Albin Michel, coll. L’Evolution de l’humanité, 1937) dans sa préface à la deuxième édition (1944) de sa propre Philosophie au Moyen Âge, distinguées dans leur titre par le moyen terme, si on ose dire. Mais il devait trouver en revanche un peu trop succinct le fascicule 3 du tome I de l’Histoire de la philosophie de Bréhier, à laquelle il ne fait aucune allusion. Ce dépouillement a son intérêt en raison de sa clarté synthétique, cela dit.Le mérite d’une telle Correspondance est pourtant bien de prouver le caractère excessif et partial de cette opération qu’on pourrait presque qualifier de chimique tant Bréhier l’exerçait avec précision, concernant Gerbert, et tant son résultat ressemble à un précipité net et transparent, parfaitement réduit et comme stérilisé. Alors qu’il s’agit de la chair et du sang, que derrière un simple conseil d’arithmétique (l’intérêt du nombre 10 et ses conséquences, une règle de division, la construction d’une sphère destinée à étudier l’astronomie), derrière une injonction exigeant qu’on baptise les nouveau-nés dans telle paroisse qui a cessé de le faire pour une obscure raison juridique interne, derrière une formule de politesse copiée de Cicéron ou d’Horace, derrière un problème de logique aristotélicienne, la chair et le sang de l’homme comme du Fils de Dieu sont en question ! À chaque instant de chaque minute, et sous le regard public de tous, et dans une perspective eschatologique à peine sous-jacente, on le ressent derrière chaque mot, derrière chaque lettre, la plus courte (cinq lignes environ) comme la plus longue (la lettre 217 en annexe, soixante-dix pages environ, qui est en réalité un mémoire expressément conçu comme tel par l’auteur, et artistiquement maquillé en correspondance) et c’est ce ressenti qui est inégalable, et irréductible au résidu hellénistique auquel Bréhier voulait le réduire. Bréhier isolait un aspect réel de la vérité mais juste un aspect : il niait le restant bien qu’en saisissant parfaitement les tenants et aboutissants.Le résumé – assez saisissant dans sa rapide sécheresse – de la biographie de Gerbert, fourni en introduction par Riché et Callu à sa Correspondance, rend compte du relatif dénuement et de la relative brutalité de cette époque. Le miracle, dans un tel contexte, est qu’une telle Correspondance ait été écrite, conçue comme œuvre à léguer, et cela par Gerbert lui-même, qu’elle ait été transmise (l’histoire des manuscrits vaut, comme toujours, d’être lue : elle est ahurissante de précision et riche en rebondissements) et que, relue en ce mois de décembre 2008, elle puisse nous toucher au plus profond, comme double témoignage. Témoignage d’humanité au sens de l’association Guillaume Budé, au sens philologique et littéraire pur, donc, mais aussi comme témoignage d’une sorte de rêve platonicien transformé en acte chrétien, au jour le jour, d’un homme au pouvoir mi-spirituel mi-politique régnant sur le monde occidental par le simple envoi d’une missive, ou envoi physique d’un envoyé à tel prélat ou seigneur médiéval, et maintenant ainsi une incroyable efficacité et une incroyable unité au sein d’un monde menacé par le chaos. Les maintenant avec humanité au sens moderne du terme, doit-on ajouter et les exemples abondent, notamment lorsqu’il s’agit des cas d’inceste et d’adultère, de remariage, d’abus sexuel que Gerbert considère avec philosophie tout en les assujetissant à une règle prudente mais jamais excessive. Les maintenant, doit-on surtout ajouter, parce que l’esprit du moyen-âge, et de sa philosophie, était un esprit passionné d’unité, en ce sens qu’il était passionné par le problème de la manière dont la diversité peut être réglée, ordonnée, gouvernée par l’unité sans jamais être niée comme telle ou réduite à néant. Le néant, au moyen âge, n’était d’ailleurs pas rien : il était souvent, en métaphysique, quelque chose. Dans la Correspondance de Gerbert d’Aurillac, un tel esprit se dit et s’agit concrètement sous nos yeux, plus de 1000 ans après avoir modifié et réglé son propre temps.(1) Note biographique : afin que le lecteur bénéficie d’une perspective historique immédiate qui n’est ici nullement la nôtre et afin de lui épargner la peine de la rechercher, nous lui recopions ci-après la petite présentation biographique rédigée par Les Belles lettres : «Gerbert d'Aurillac (940-1003), devint pape sous le nom de Sylvestre II (de 999 à 1003). Il fut aussi philosophe et mathématicien. Il est le plus grand esprit de son temps, et introduisit les chiffres arabes en Occident. Ses engagements politiques et intellectuel le conduisirent aux plus hautes cours d'Europe : il assista notamment à l’élection par les grands de France d’Hugues Capet. Il œuvra à restaurer un empire universel sur les bases de l'Empire Carolingien. Dans ce but, l’empereur du Saint-Empire romain germanique Otton (980-1002) le plaça sur le Saint-Siège. Il fut un acteur scientifique et politique majeur du renouveau de l'Occident médiéval de l'an mil. S’il écrivit des traités de mathématiques et de philosophie, ses lettres offrent un aperçu passionnant de la période et nous font rencontrer les grands personnages de l’histoire d’Europe, comme saint Louis ou Emma, la reine des Francs.»Ajoutons à ce texte que la date de naissance de Gerbert, comme le signalent ses deux éditeurs dans leur introduction, n’est pas aussi précise que celle indiquée par cette commode mais très succincte présentation. Elle flotte en réalité entre 940 et 945. Quant à l’Otton mentionné, il s’agit d’Otton III.
Gerbert d’Aurillac (1) (né vers 940/945, mort le 12 mai 1003) est né en Aquitaine ou en Auvergne, d’une famille modeste. Remarqué par ses maîtres scolaires et spirituels de Saint-Géraud d’Aurillac – monastère réformé par Odon de Cluny en 925 – il sillonna l’Europe médiévale de France en Allemagne et en Italie, s’élevant aux plus degrés de la hiérarchie ecclésiastique et politique. Il devint, après un certain nombre d’aventures et d’alliances mouvementées (il craignit à un moment pour sa vie, comme en témoigne la lettre 203A datée de 996, p. 543) pape de l’Église catholique de 999 à 1003. Érudit formé par la théologie, par les éléments grecs et latins transmis de la philosophie antique, par les lettres d’humanité antique encore disponibles sous la forme manuscrite qui demeurait rare et recherchée, Gerbert est un intellectuel comme on pouvait l’être à la fin du Xe siècle en Occident : renommé pour ses connaissances ressortant des 4 disciplines de la physique ou quadrivium (arithmétique, astronomie, géométrie, musique) auxquelles s’adjoignent les 3 disciplines du trivium (grammaire, rhétorique, logique).Dans l’histoire de la philosophie médiévale, à laquelle il appartient autant qu’à l’histoire générale, à l’histoire de la littérature latine ou à l’histoire du catholicisme, on peut le situer commodément mais d’une manière grossière entre Jean Scot Érigène et saint Anselme. Si Gerbert n’a absolument pas leur originalité, il est en revanche le «compendium» parfait de ces générations d’élite conservatrices vivant au sein d’une pauvreté matérielle dangereuse mais au sein desquelles pouvait fleurir le génie. Il en restitue, reflet dérivé de sa propre image telle qu’il la sculpte par son style, la moyenne ambition, la moyenne culture, les moyennes aspirations, d’une manière parfaitement claire. Il est l’exact modèle médiéval transcrivant le modèle antique de l’orateur politique formé par Cicéron et Quintilien, celui du «vir bonus dicendi peritus».C’est sa surprenante et variée Correspondance que nous lisons aujourd’hui dans cette nouvelle édition rassemblée en un seul fort volume de 730 pages bilingues, alors que la première édition précédente (de 1993) était divisée en deux tomes. Commodité supérieure évidente : la division entre un premier groupe (lettre n°1 du printemps 983 à n°129 de fin août 988) et un second groupe (n°130 de septembre 988 à n°220 d’été 997) est maintenue mais elle est unifiée par la possibilité de les lire dans un ordre chronologique matériel simplifié, et par celle d’utiliser les «conspecti siglorum» et «index nomini» d’une manière plus aisée. Sans oublier les quelques annexes (lettres de divers correspondants à Gerbert lui-même) et les cartes géographiques et tableaux chronologiques ou de concordance. Cette belle collection philologique des Belles lettres, connue sous le nom de Classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, a beau avoir supprimé le mot «France» de son intitulé, et son papier a beau être deux fois plus mince que le papier qu’elle utilisait dans les années 1960, reconnaissons que son 45e volume rend philologiquement autant qu’historiquement hommage à son fondateur Louis Halphen.Gerbert a davantage été considéré comme un intellectuel que comme un philosophe. Lorsque le quotidien Le Monde avait chroniqué 10 grandes figures de l’an mil, Jean-Pierre Langelier avait intitulé son article sur Gerbert, paru le 18 juillet 2000, du titre voltairien de Gerbert, le pape horloger. Cette connotation évoquant des réductions similaires dans d’autres domaines (Louis XVI, le «roi serrurier», par exemple) trahit fondamentalement son objet. Lorsque F. Picavet avait écrit sa biographie de Gerbert, il l’avait doté d’un titre autrement magique : Gerbert, un pape philosophe d’après l’histoire et d’après la légende (éd. Leroux, 1897). C’est d’autant plus dommage pour cet article de Langelier, dont nous avons retrouvé la référence notée par nous au crayon sur notre exemplaire de Gilson, qu’il nous avait, il nous en souvient très bien, réellement passionné : Gerbert y était présenté non seulement comme le prototype de l’intellectuel médiéval mais encore restitué avec toute sa densité historique et métaphysique. À quoi tiennent le souvenir et l’effet produit par un article de journal ? Il nous semble que tenir aujourd’hui en main cet épais et noble volume rouge estampillé du «sceau au chevalier» qui identifie visuellement cette collection des Belles lettres nous a permis, huit ans après sa lecture, de pénétrer bien plus avant l’envers du miroir, et de saisir enfin réellement l’épaisseur authentique de sa réalité.L’historiographie française de la philosophie est sans doute responsable de ce gauchissement possible puisqu’il fut réel. Car, si on tient aux critères qui permettent de se dire philosophe au Xe siècle, Gerbert le fut absolument même s’il ne fut pas un grand philosophe. Bréhier ne lui rend pas tout à fait justice puisque qu’il ne retient de Gerbert que son traité de logique, certes techniquement passionnant et qui entre bien le fer de la dialectique dans la plaie métaphysique majeure du moyen âge, mais qu’il met de côté le restant : son admirable discours d’investiture lorsqu’il est nommé pape, recopié dans une lettre, et bien d’autres choses. C’est Gilson qui restitue exactement et synthétiquement ce qu’il fut «sub specie aeternitatis» comme «sub specie philosophiae» dans la mesure où Gilson a une conception plus compréhensive, plus extensive (nous n’entendons pas ici ces deux termes au sens étroitement technique qu’ils ont en logique formelle) de la philosophie médiévale que Bréhier. Gilson est nourri de la vie du moyen âge autant que Bréhier était nourri de celle de l’antiquité hellénistique mais il faut savoir qu’il y eut entre eux une différence d’appréciation fondamentale de la période ici considérée. Pour mesurer ce qui les sépare lorsqu’ils envisagent un philosophe médiéval, il convient de lire un troisième homme, qui résume admirablement l’enjeu de la question, nous avons nommé Claude Tresmontant, dans l’avant-propos de La Métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie chrétienne – Problème de la création et de l’anthropologie des origines à Saint Augustin (Le Seuil, 1961).Tresmontant y prend d’une manière très précise et puissante la mesure du combat et choisit le parti de Gilson – qu’il ne nomme pas – contre Bréhier en discutant très précisément les textes essentiels de Bréhier consacrés à la philosophie médiévale. Non seulement le fascicule 3 de Bréhier, non seulement tel passage de l’introduction de Bréhier à Énnéades II, 9 Contre les Gnostiques (aussi aux Belles Lettres, textes grecs avec traduction) mais encore et surtout le fameux article de Bréhier Y a-t-il une philosophie chrétienne ? paru dans la Revue de Métaphysique et de Morale de 1931. Il faut dire que d’autres l’avaient déjà très bien tranché : il suffit de lire le Saint Anselme de Karl Jaspers dans Les Grands philosophes (trad. française chez U.G.E., coll. 10/18, in tome 4) ou les premières pages de l’étude classique de Koyré, L’Idée de Dieu dans la philosophie de saint Anselme (réédition Vrin, coll. Reprise, 1923-1984 et notamment son §IV, Les Sources de la philosophie de saint Anselme), pour saisir toute la densité matérielle de la question. En résumé, ces humanités antiques, cette logique d’Aristote, ce néoplatonisme partiellement assimilé par la Patristique, ils se combattent au sein d’une évolution philosophique théologique authentiquement chrétienne, contrairement à ce que Bréhier soutient même si, techniquement, on peut comme lui admirablement en isoler les éléments hétérogènes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Gilson renvoyait généreusement et techniquement au traité de Bréhier sur La Philosophie du Moyen Âge (Albin Michel, coll. L’Evolution de l’humanité, 1937) dans sa préface à la deuxième édition (1944) de sa propre Philosophie au Moyen Âge, distinguées dans leur titre par le moyen terme, si on ose dire. Mais il devait trouver en revanche un peu trop succinct le fascicule 3 du tome I de l’Histoire de la philosophie de Bréhier, à laquelle il ne fait aucune allusion. Ce dépouillement a son intérêt en raison de sa clarté synthétique, cela dit.Le mérite d’une telle Correspondance est pourtant bien de prouver le caractère excessif et partial de cette opération qu’on pourrait presque qualifier de chimique tant Bréhier l’exerçait avec précision, concernant Gerbert, et tant son résultat ressemble à un précipité net et transparent, parfaitement réduit et comme stérilisé. Alors qu’il s’agit de la chair et du sang, que derrière un simple conseil d’arithmétique (l’intérêt du nombre 10 et ses conséquences, une règle de division, la construction d’une sphère destinée à étudier l’astronomie), derrière une injonction exigeant qu’on baptise les nouveau-nés dans telle paroisse qui a cessé de le faire pour une obscure raison juridique interne, derrière une formule de politesse copiée de Cicéron ou d’Horace, derrière un problème de logique aristotélicienne, la chair et le sang de l’homme comme du Fils de Dieu sont en question ! À chaque instant de chaque minute, et sous le regard public de tous, et dans une perspective eschatologique à peine sous-jacente, on le ressent derrière chaque mot, derrière chaque lettre, la plus courte (cinq lignes environ) comme la plus longue (la lettre 217 en annexe, soixante-dix pages environ, qui est en réalité un mémoire expressément conçu comme tel par l’auteur, et artistiquement maquillé en correspondance) et c’est ce ressenti qui est inégalable, et irréductible au résidu hellénistique auquel Bréhier voulait le réduire. Bréhier isolait un aspect réel de la vérité mais juste un aspect : il niait le restant bien qu’en saisissant parfaitement les tenants et aboutissants.Le résumé – assez saisissant dans sa rapide sécheresse – de la biographie de Gerbert, fourni en introduction par Riché et Callu à sa Correspondance, rend compte du relatif dénuement et de la relative brutalité de cette époque. Le miracle, dans un tel contexte, est qu’une telle Correspondance ait été écrite, conçue comme œuvre à léguer, et cela par Gerbert lui-même, qu’elle ait été transmise (l’histoire des manuscrits vaut, comme toujours, d’être lue : elle est ahurissante de précision et riche en rebondissements) et que, relue en ce mois de décembre 2008, elle puisse nous toucher au plus profond, comme double témoignage. Témoignage d’humanité au sens de l’association Guillaume Budé, au sens philologique et littéraire pur, donc, mais aussi comme témoignage d’une sorte de rêve platonicien transformé en acte chrétien, au jour le jour, d’un homme au pouvoir mi-spirituel mi-politique régnant sur le monde occidental par le simple envoi d’une missive, ou envoi physique d’un envoyé à tel prélat ou seigneur médiéval, et maintenant ainsi une incroyable efficacité et une incroyable unité au sein d’un monde menacé par le chaos. Les maintenant avec humanité au sens moderne du terme, doit-on ajouter et les exemples abondent, notamment lorsqu’il s’agit des cas d’inceste et d’adultère, de remariage, d’abus sexuel que Gerbert considère avec philosophie tout en les assujetissant à une règle prudente mais jamais excessive. Les maintenant, doit-on surtout ajouter, parce que l’esprit du moyen-âge, et de sa philosophie, était un esprit passionné d’unité, en ce sens qu’il était passionné par le problème de la manière dont la diversité peut être réglée, ordonnée, gouvernée par l’unité sans jamais être niée comme telle ou réduite à néant. Le néant, au moyen âge, n’était d’ailleurs pas rien : il était souvent, en métaphysique, quelque chose. Dans la Correspondance de Gerbert d’Aurillac, un tel esprit se dit et s’agit concrètement sous nos yeux, plus de 1000 ans après avoir modifié et réglé son propre temps.(1) Note biographique : afin que le lecteur bénéficie d’une perspective historique immédiate qui n’est ici nullement la nôtre et afin de lui épargner la peine de la rechercher, nous lui recopions ci-après la petite présentation biographique rédigée par Les Belles lettres : «Gerbert d'Aurillac (940-1003), devint pape sous le nom de Sylvestre II (de 999 à 1003). Il fut aussi philosophe et mathématicien. Il est le plus grand esprit de son temps, et introduisit les chiffres arabes en Occident. Ses engagements politiques et intellectuel le conduisirent aux plus hautes cours d'Europe : il assista notamment à l’élection par les grands de France d’Hugues Capet. Il œuvra à restaurer un empire universel sur les bases de l'Empire Carolingien. Dans ce but, l’empereur du Saint-Empire romain germanique Otton (980-1002) le plaça sur le Saint-Siège. Il fut un acteur scientifique et politique majeur du renouveau de l'Occident médiéval de l'an mil. S’il écrivit des traités de mathématiques et de philosophie, ses lettres offrent un aperçu passionnant de la période et nous font rencontrer les grands personnages de l’histoire d’Europe, comme saint Louis ou Emma, la reine des Francs.»Ajoutons à ce texte que la date de naissance de Gerbert, comme le signalent ses deux éditeurs dans leur introduction, n’est pas aussi précise que celle indiquée par cette commode mais très succincte présentation. Elle flotte en réalité entre 940 et 945. Quant à l’Otton mentionné, il s’agit d’Otton III.
29/12/2008 | Lien permanent
Les Vierges de Satan de Terence Fisher, par Francis Moury

 CritiqueThe Devil Rides Out / The Devil’s Bride [Les Vierges de Satan] (Angleterre, 1967) de Terence Fisher est un de ses films les plus étonnants. Adapté du roman homonyme de Dennis Wheatley par Richard Matheson, le scénario offre à Fisher l’occasion de signer un film tout à fait unique dans sa carrière.La démonologie, la sorcellerie, le satanisme sont des thèmes qui ont finalement souvent porté chance aux grands cinéastes du cinéma fantastique. Fisher aborde ici de front ce thème classique pour livrer une mise en scène épurée, en dépit de son caractère parfois éminemment spectaculaire. Les effets spéciaux sont parcimonieux car toujours remarquablement employés, intégrés dans une action qu’ils servent au lieu que ce soit l’inverse. D’une précision géométrique qui est la marque d’un approfondissement, d’une recherche stylistique constante, sa mise en scène organise dans des décors – d’une pureté de ligne et d’un dépouillement voulus – de savants mouvements de caméra, un montage d’une souplesse et d’une nervosité constantes, une direction d’acteurs homogène.Le ressort du scénario comme du film, ressort moral comme esthétique, est la symétrie et l’interaction calculée. Les oppositions une fois mises en place (Mocata / l’orgie démoniaque / Satan contre le Duc de Richleau / l’amour pur / l’Ange) un couple constitué de facto comme «couple de proies» (une masculine et une féminine) devient l’enjeu d’une lutte à mort, sous les yeux de la Mort elle-même invoquée, finale et cruelle arbitre. Fisher a déclaré un jour qu’il croyait à la réalité positive du mal comme du bien : c’est tout l’enjeu de son cinéma de les faire agir positivement sous la forme d’énergies spirituelles revêtant des formes historiques appartenant au monde de la culture. Bergson comme Max Scheler auraient apprécié Les Vierges de Satan.Dennis Wheatley, Richard Matheson et l’acteur Christopher Lee (qui s’intéressait personnellement à la démonologie) contribuèrent à la matière première occultiste mais cette matière devient une forme cohérente uniquement grâce à la mise en scène de Fisher. De fait, Les Vierges de Satan inquiéta considérablement les spectateurs lors de sa sortie en salle : c’est en effet un film expressément conçu pour être visionné par une communauté car il réfléchit sur l’idée même de communauté. Le malaise augmente donc naturellement lorsque sa vision est collective. D’autant que Fisher utilise d’une manière finalement très étonnante les symboles primitifs comme les symboles évolués de l’imaginaire religieux et contre-religieux. Il les domine tous deux en les plaçant à travers un courant dialectique qui est sa marque personnelle. En Anglais fondamentalement pragmatique, nous dirions presque «positiviste» – le philosophe anglais John Stuart Mill n’était-il pas un des plus fervents disciples d’Auguste Comte ? – Terence Fisher filme le fait religieux comme le fait contre-religieux avec la même attention sincère, la même fascination dominée et étrangement réfléchissante. Et il se permet de filmer non seulement Satan, mais encore la Mort et même… un Ange en action. Sans oublier l’action déterminante du Temps, corollaire de la Mort invoquée, qui devient l’authentique Deux ex machina du film.Les Vierges de Satan, un film qui, au premier degré, a systématiquement suscité le mépris des intellectuels cinéphiles généralistes déjà réticents envers Fisher et le rire le plus vulgaire chez une partie marginale des spectateurs des salles populaires (rire qui était évidemment une réaction de défense contre la peur profonde qu’ils éprouvaient : les autres se contentaient modestement d’avoir peur sans chercher à lutter) demeure inaltérablement effectif et fascinant.PS : on regrette que le distributeur Metropolitan Filmexport / Seven 7 n’ait pas repris l’affiche d’exploitation française, particulièrement belle pourtant, pour illustrer la jaquette de son DVD, certes sympathique puisqu’elle reprend une photo de plateau célèbre qui n’appartient d’ailleurs pas à sa continuité filmique mais qui a néanmoins une valeur historique. C’est tout de même une lacune iconographique. De rares affiches françaises de Hammer films sont graphiquement médiocres – celle de Frankenstein créa la femme, par exemple : aucune de ses affiches ou affichettes françaises n’étant dignes du film, on peut lui préférer la très belle jaquette composée par le bon graphiste de Metropolitan – mais la plupart sont magnifiques. Celle des Vierges de Satan fait partie des plus belles et nous regrettons qu’elle ne soit ni reproduite en jaquette, ni présentée en supplément avec le jeu complet de photos d’exploitation françaises.
CritiqueThe Devil Rides Out / The Devil’s Bride [Les Vierges de Satan] (Angleterre, 1967) de Terence Fisher est un de ses films les plus étonnants. Adapté du roman homonyme de Dennis Wheatley par Richard Matheson, le scénario offre à Fisher l’occasion de signer un film tout à fait unique dans sa carrière.La démonologie, la sorcellerie, le satanisme sont des thèmes qui ont finalement souvent porté chance aux grands cinéastes du cinéma fantastique. Fisher aborde ici de front ce thème classique pour livrer une mise en scène épurée, en dépit de son caractère parfois éminemment spectaculaire. Les effets spéciaux sont parcimonieux car toujours remarquablement employés, intégrés dans une action qu’ils servent au lieu que ce soit l’inverse. D’une précision géométrique qui est la marque d’un approfondissement, d’une recherche stylistique constante, sa mise en scène organise dans des décors – d’une pureté de ligne et d’un dépouillement voulus – de savants mouvements de caméra, un montage d’une souplesse et d’une nervosité constantes, une direction d’acteurs homogène.Le ressort du scénario comme du film, ressort moral comme esthétique, est la symétrie et l’interaction calculée. Les oppositions une fois mises en place (Mocata / l’orgie démoniaque / Satan contre le Duc de Richleau / l’amour pur / l’Ange) un couple constitué de facto comme «couple de proies» (une masculine et une féminine) devient l’enjeu d’une lutte à mort, sous les yeux de la Mort elle-même invoquée, finale et cruelle arbitre. Fisher a déclaré un jour qu’il croyait à la réalité positive du mal comme du bien : c’est tout l’enjeu de son cinéma de les faire agir positivement sous la forme d’énergies spirituelles revêtant des formes historiques appartenant au monde de la culture. Bergson comme Max Scheler auraient apprécié Les Vierges de Satan.Dennis Wheatley, Richard Matheson et l’acteur Christopher Lee (qui s’intéressait personnellement à la démonologie) contribuèrent à la matière première occultiste mais cette matière devient une forme cohérente uniquement grâce à la mise en scène de Fisher. De fait, Les Vierges de Satan inquiéta considérablement les spectateurs lors de sa sortie en salle : c’est en effet un film expressément conçu pour être visionné par une communauté car il réfléchit sur l’idée même de communauté. Le malaise augmente donc naturellement lorsque sa vision est collective. D’autant que Fisher utilise d’une manière finalement très étonnante les symboles primitifs comme les symboles évolués de l’imaginaire religieux et contre-religieux. Il les domine tous deux en les plaçant à travers un courant dialectique qui est sa marque personnelle. En Anglais fondamentalement pragmatique, nous dirions presque «positiviste» – le philosophe anglais John Stuart Mill n’était-il pas un des plus fervents disciples d’Auguste Comte ? – Terence Fisher filme le fait religieux comme le fait contre-religieux avec la même attention sincère, la même fascination dominée et étrangement réfléchissante. Et il se permet de filmer non seulement Satan, mais encore la Mort et même… un Ange en action. Sans oublier l’action déterminante du Temps, corollaire de la Mort invoquée, qui devient l’authentique Deux ex machina du film.Les Vierges de Satan, un film qui, au premier degré, a systématiquement suscité le mépris des intellectuels cinéphiles généralistes déjà réticents envers Fisher et le rire le plus vulgaire chez une partie marginale des spectateurs des salles populaires (rire qui était évidemment une réaction de défense contre la peur profonde qu’ils éprouvaient : les autres se contentaient modestement d’avoir peur sans chercher à lutter) demeure inaltérablement effectif et fascinant.PS : on regrette que le distributeur Metropolitan Filmexport / Seven 7 n’ait pas repris l’affiche d’exploitation française, particulièrement belle pourtant, pour illustrer la jaquette de son DVD, certes sympathique puisqu’elle reprend une photo de plateau célèbre qui n’appartient d’ailleurs pas à sa continuité filmique mais qui a néanmoins une valeur historique. C’est tout de même une lacune iconographique. De rares affiches françaises de Hammer films sont graphiquement médiocres – celle de Frankenstein créa la femme, par exemple : aucune de ses affiches ou affichettes françaises n’étant dignes du film, on peut lui préférer la très belle jaquette composée par le bon graphiste de Metropolitan – mais la plupart sont magnifiques. Celle des Vierges de Satan fait partie des plus belles et nous regrettons qu’elle ne soit ni reproduite en jaquette, ni présentée en supplément avec le jeu complet de photos d’exploitation françaises.
14/11/2008 | Lien permanent
Antoine de Baecque et l’ontologie historiale du cinéma, par Francis Moury

 Notes philosophiques, historiques, esthétiques et critiques sur Antoine de Baecque, L’histoire-caméra (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée des histoires, 105 illustrations, 2008).
Notes philosophiques, historiques, esthétiques et critiques sur Antoine de Baecque, L’histoire-caméra (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée des histoires, 105 illustrations, 2008).«Dans le monde tragique d’Eschyle, la crainte est le sentiment humain dont la présence est le plus sensible. […] Naturellement, c’est le plus souvent au chœur qu’il appartient d’exprimer cette crainte ou cette angoisse : il est assez étroitement mêlé à l’action pour en être vivement affecté et cependant il reste, par nature, impropre à la conduire activement. Sauf dans les Choéphores et les Euménides, tous les chœurs d’Eschyle sont formés de gens épouvantés. […] Enfin dans les Euménides, si le chœur n’exprime plus l’effroi, c’est qu’au contraire il le sème, le célèbre, l’incarne, au point que, lors de la représentation, la terreur causa, si l’on en croit la Vie d’Eschyle des accidents dans le public; [...]»
Jacqueline de Romilly, La Crainte et l’angoisse dans le théâtre d’Eschyle (Éditions Les Belles lettres, coll. Études anciennes, série grecque, deuxième tirage, 1958-1971), pp. 11-13.
«Dans l’art, il faut voir non pas je ne sais quel jouet plaisant ou agréable, mais l’esprit qui se libère des formes et du contenu de la finitude, – la présence et la conciliation de l’absolu dans le sensible et l’apparence, – un déploiement de la Vérité qui ne s’épuise pas comme histoire naturelle, mais se révèle dans l’histoire universelle dont il est le plus bel aspect, – la meilleure récompense pour le dur travail dans le réel et les efforts pénibles de la connaissance.»
G.W.F. Hegel, Morceaux choisis, 8e section, L’Art, §243, Grandeur de l’art (Introduction et traduction française par Henri Lefebvre et Natan Guterman, Gallimard, coll. N.R.F., 1939), p. 280.
«Dans le cinéma, la fumée d’elle-même s’élève, la feuille réellement tremble : elle s’énonce elle-même comme feuille tremblante au vent. C’est une feuille telle qu’on en rencontre dans la nature et c’est en même temps beaucoup plus, dès le moment qu’étant cette feuille réelle, elle est aussi, elle est d’abord réalité représentée. Si elle n’était que feuille réelle, elle attendrait d’être signifiée par mon regard. Parce que représentée, dédoublée par l’image, elle s’est déjà signifiée, proférée en elle-même comme feuille tremblant au vent. […] J’y ajouterai toujours de moi-même; le sens de ce mouvement dans son immanence me demeurera fermé. Au cinéma, c’est ce sens immanent lui-même qui, à la fois, se propose et se cèle.»
Roger Munier, L’image fascinante, in revue Diogène n° de juillet 1961, cité par Jean Mitry, Esthétique et psychologie du cinéma, tome I, Les structures, §2, L’image filmique (Éditions universitaires, 1963), p 128.
«Comme, à vos yeux, toutes les formes sont nées au contact de la peur, faut-il pousser votre raisonnement à l’absurde, et dire que le cinéma tout entier s’apparente à un «cinéma d’épouvante»?
Oui [...].»
Jean-Marie Sabatier, Les Classiques du cinéma fantastique, §I, Pour une approche du cinéma fantastique (Éditions Balland, 1973), p. 14.
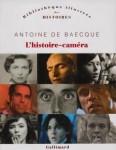 L’histoire-caméra d’Antoine de Baecque est le premier livre consacré au cinéma par Gallimard dans sa belle collection intitulée Bibliothèque illustrée des histoires : cette reconnaissance matérielle qui lui permet de prendre place entre des anthologies iconographiques d’une haute tenue intellectuelle et plastique, aussi bien vouées à La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours qu’à Saturne et la Mélancolie établit donc une nouvelle date éditoriale par elle-même dans l’intégration du cinéma au corpus universitaire des arts plastiques. Ce volume relié (avec signet et tranchefil, doté d’une belle jaquette reproduisant des visages issus de neuf films tournés de 1952 à 1999) de presque 500 pages sur papier glacé contenant une centaine d’illustrations N.&B. et couleurs – certaines sont des photogrammes (parfois flous, parfois nets) ou des captures précises de DVD opérées par l’auteur mais d’autres sont de magnifiques reproductions d’affiches originales – une bibliographie, un Index nomini, un Index des titres de films, est autant un livre d’histoire qu’un livre de philosophie, un livre d’esthétique du cinéma qu’un livre d’histoire du cinéma, et il aurait donc pu, étant donné le contenu et le style de son questionnement, tout aussi bien trouver place (les illustrations en moins) dans la Bibliothèque de philosophie du même éditeur.
L’histoire-caméra d’Antoine de Baecque est le premier livre consacré au cinéma par Gallimard dans sa belle collection intitulée Bibliothèque illustrée des histoires : cette reconnaissance matérielle qui lui permet de prendre place entre des anthologies iconographiques d’une haute tenue intellectuelle et plastique, aussi bien vouées à La Mort et l’Occident de 1300 à nos jours qu’à Saturne et la Mélancolie établit donc une nouvelle date éditoriale par elle-même dans l’intégration du cinéma au corpus universitaire des arts plastiques. Ce volume relié (avec signet et tranchefil, doté d’une belle jaquette reproduisant des visages issus de neuf films tournés de 1952 à 1999) de presque 500 pages sur papier glacé contenant une centaine d’illustrations N.&B. et couleurs – certaines sont des photogrammes (parfois flous, parfois nets) ou des captures précises de DVD opérées par l’auteur mais d’autres sont de magnifiques reproductions d’affiches originales – une bibliographie, un Index nomini, un Index des titres de films, est autant un livre d’histoire qu’un livre de philosophie, un livre d’esthétique du cinéma qu’un livre d’histoire du cinéma, et il aurait donc pu, étant donné le contenu et le style de son questionnement, tout aussi bien trouver place (les illustrations en moins) dans la Bibliothèque de philosophie du même éditeur.Antoine de Baecque réfléchit, à travers des cas précis et emblématiques, sur les rapports authentiquement ontologiques qui lient le cinéma et l’histoire. Intrinsèquement, dans la mesure où le cinéma est un témoignage matériel qui se rajoute dorénavant aux autres témoignages des autres arts, et dialectiquement, dans la mesure où le cinéma reconstitue l’histoire : il existe, pour parler à la manière de Spinoza, un cinéma historicisé et un cinéma historicisant.
Cette ambivalence, poussée plus avant, est déjà le cœur du célèbre «complexe de la momie» analysée par André Bazin, dans une perspective pleinement ontologique. L’Arrivée d’un train en Gare de La Ciotat filmée par les frères Auguste et Louis Lumière, est datée et le train filmé existait. Ses premiers spectateurs craignirent d’être écrasés, comme on sait. Capturer le temps, par défi, par hasard, comme par nécessité, c’est l’un des aspects ontologiques du cinéma. Et le temps, c’est de l’histoire. Jusqu’ici, tout paraît simple. Les exemples les plus élémentaires de ce rapport dialectique temps/cinéma sont les meilleurs du livre.
Oui Peter Watkins, un peu comme Gualtiero Jacoppeti à la même époque 1960- 1970 (soit dit en passant : l’idée était dans l’air du temps mais Antoine de Baecque n’en crédite que Watkins) introduit une vision télévisuelle «live» dans le film historique ultra-violent (La Bataille de Culloden) ou dans ses pseudo-documentaires fantastiques/politiques à tendance toujours virulente et contestataire (La Bombe, Punishment Park) mais qui réussissent encore aujourd’hui à échapper au pur formalisme.
Oui encore Sacha Guitry filme réellement – contrairement à ses critiques de droite, de gauche, et universitaires de l’époque – quelque chose de réel et de central de l’histoire de la France dans Si Versailles m’était conté (1954) avec cette réserve que certains autres films français véritablement tournés à Versailles étaient parfois remarquables et tout à fait dignes d’être remémorés, contrairement à ce que dit Baecque. Nous songeons notamment au fantastique, érotique et très inquiétant L’Affaire des poisons (1955) d’Henri Decoin qui annonce un peu, dans le registre du film d’aventure historique, le malsain et la violence du Hellfire Club / Les Chevaliers du démon de R.S. Baker et M.N. Berman.
Oui derechef le problème du musée et de l’image, dans les Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, est autant influencé par «votre terrible Hegel» (Godard dixit) que par «votre gentil Walter Benjamin» (Idem), et par André Malraux que par Henri Langlois.
Oui enfin l’ambivalence culturelle proprement historique – car elle n’apparaît parfaitement, et si clairement, que parce que le temps a permis de la décanter – de la «Nouvelle Vague française» est avérée : c’est le meilleur chapitre du livre avec celui sur les «formes forcloses».
Antoine de Baecque démontre que la Nouvelle vague fut d’abord l’héritière intellectuelle des Hussards «antimodernes» au sens que donne Antoine Compagnon – cité d’ailleurs mais dans le chapitre sur le démodernisme dans le cinéma russe de la chute de l’ère soviétique – à ce terme. Ainsi Louis Malle adaptant en 1963 Le Feu follet de Pierre Drieu la Rochelle ou encore – nous rajoutons cette référence – travaillant avec Roger Nimier en 1957 sur l’adaptation du scénario de Calef, Ascenseur pour l’échafaud; ainsi Godard admirant Malraux au début du régime gaulliste. Elle devient miroir angoissé et très introspectif, anti-spectaculaire, de la Guerre d’Algérie. Recommandons ici, outre ses beaux textes très justes sur Adieu Philippine (1963) et Cléo de cinq à sept (1962), les deux belles analyses par Baecque des deux grands films d’Alain Cavalier que sont Le Combat dans l’île (1962) et L’Insoumis (1964). Elle est enfin le miroir «gauchisant» de Mai 1968 et la référence agissante de la (de notre) post-modernité cinématographique, dans la mesure où, selon Antoine de Baecque, la Nouvelle vague française ferait encore sens aujourd’hui.
Bémol tout de même car lorsqu’on visionne Vivre sa vie (1962) qui n’est pas cité par Baecque mais qui demeure peut-être le meilleur film de Godard avec Le Mépris (1963) et Week-end (1967) tout compte esthétique fait (alors que Le Petit soldat (1960-1963) si vanté par Baecque est un film de potache anecdotique qui n’a plus d’intérêt que purement filmographique ou purement historico-politique) on est assurément en présence d’un film encore efficace, portant sens directement par-delà son temps, alors que face à Les Cousins (1959) de Chabrol, on n’est pas forcément en présence d’un sentiment de Nouvelle vague, plutôt d’une «qualité française» améliorée, ce qui n’est nullement déméritant à nos yeux dans la mesure où la perfection formelle et dramaturgique de la Nouvelle Vague, c’est peut-être bien Chabrol qui a su la finaliser de la manière la plus équilibrée avec Les Biches (1968), La Femme infidèle (1969), Que la bête meure (1969), Le Boucher (1970), Les Noces rouges (1973), Nada (1974), sans oublier le plus ancien À double tour (1959) et le plus tardif La Cérémonie (1995). Il y a même encore, de toute évidence, de la Nouvelle vague – et de l’Actor’s studio tout autant ! – dans le cinéma français des années 1990-2000 : voir ce grand film noir réflexif qu’est La Haine (1995) ou la manière dont Bertrand Tavernier tourne ses deux meilleurs films qui sont aussi deux films noirs policiers : L627 (1992) et L’Appât (1995) qu’il ne faut pas confondre, bien sûr, avec le titre homonyme d’exploitation française du western classique américain d’Anthony Mann.
Historiquement, philosophiquement, métaphysiquement, les choses deviennent plus délicates avec la thèse initiale du livre, celle des «formes forcloses» sur laquelle Antoine de Baecque ente sa réflexion d’histoire du cinéma. Est-ce que le «regard caméra» définit le cinéma moderne ? Est-ce que le cinéma moderne est en outre définissable à partir des «regards-caméra» saisis par les documentaristes militaires anglais et américains, lorsqu’ils filmèrent les survivants des camps de concentration européens ? Car le livre d’Antoine de Baecque débute par une double affirmation, très soigneusement étayée et très bien étudiée : Europe 51 (1952) de Rossellini d’une part, Nuit et brouillard (1956) d’Alain Resnais d’autre part sont les deux films fondateurs de la modernité authentique de la seconde moitié du XXe siècle car ils regardent la mort, le mal absolu et la déréliction dans les yeux, et qu’ils nous regardent dans les yeux. Le cinéma antérieur ne pouvait pas l’exprimer car il manquait la «Shoah» et le traumatisme de la mort de masse exprimé par les yeux (médiatisés dans un autre contexte) d’Ingrid Bergman – ses yeux et les yeux de celles ou ceux qui la regardent en des séquences précisément repérées – et par le rapport dialectique établi par le montage dans le documentaire de Resnais, introduisant entre les documents bruts filmés par d’autres en 1945 et les plans d’ensemble des lieux désertés, abandonnés, filmés par Resnais en 1955, la médiation de sa mise en scène. C’est une thèse qui en vaut une autre, loin qu’elle soit l’unique et la seule possible. Elle mérite d’être discutée.
Bien sûr, sans la vision indélébile (différée ou «in situ», selon les biographies) des camps de concentration – et Antoine de Baecque l’établit très précisément par des documents de première ou seconde main, tous scrupuleusement cités en notes – ni Orson Welles en 1946 (Le Criminel), ni Charlie Chaplin en 1947 (Monsieur Verdoux), ni Alfred Hitchcock en 1953 (passionnante interprétation, très étayée historiquement, de la mise en scène et du montage de Mais qui a tué Harry ? qu’on considère souvent par ailleurs, et à juste titre, comme une comédie macabre ennuyeuse, mineure et sans grand intérêt), ni Samuel Fuller en 1959 et 1980 (Verboten ! / Ordres secrets aux espions nazis, et le très inégal mais passionnant The Big Red One) n’eussent été filmographiquement ce qu’ils furent.
Certes.
Mais il y a eu d’autres «regards caméra» avant 1952 et 1956. Sans même remonter à Dziga Vertov et à sa «caméra-œil» puisqu’elle est l’inverse dans sa proposition ! Et la faculté de l’esthétique de suggérer l’indicible du mal absolu (qui existait avant la «Shoah» : le mal échappe au temps dans la mesure où il ressort de la nature intemporelle de l’homme : il est passible d’histoire mais aussi de religion et de philosophie pour cette raison) et de l’horreur (il y a eu des meurtres de masse dès l’histoire de la haute antiquité, bien que la «Shoah» fût un meurtre de masse inédit et spécifique en raison de la ruse silencieuse proprement diabolique avec laquelle il fut perpétré, et il suffit pour s’en convaincre de lire un traité d’histoire ancienne, par exemple, si notre mémoire est bonne, le très sérieux G. Lafforgue, L’Orient et la Grèce jusqu’à la conquête romaine (éd. P.U.F., coll. Le Fil du temps, 1977) a été maintes fois utilisée par les cinéastes de la période antérieure. Et le meurtre de masse, qu’il s’agisse de la Shoah ou d’un autre, n’est pas l’alpha ni l’oméga du mal : il en est une figure parmi d’autres. Autrement dit, on semble nous dire que la «Shoah» marque une date dans l’histoire du cinéma, à la fois ontologiquement et techniquement et elle permet de définir le cinéma «post-Shoah» comme moderne, le cinéma «pré-Shoah» comme ancien. C’est abusif même si c’est suggestif. La première partie de la proposition nous paraît parfaitement pensable et très bien illustrée mais la seconde partie de cette même proposition nous semble excessive.
Il est au demeurant curieux, dans un tel contexte, que le génial documentaire homonyme de Claude Lanzmann ne se voit accorder d’attention que dans une simple note, évidemment laudative: le film de Lanzmann est pourtant un cas limite de l’esthétique documentariste qui aurait mérité, étant donné la thèse d’Antoine de Baecque, un chapitre à lui seul, à défaut d’un livre. Car si la «Shoah» est la base des formes forcloses qui ouvrent le cinéma moderne, alors quid du Shoah (1985) de Claude Lanzmann ? Et si dire dans cette note p.106 qu’il est en lui-même «le sujet d’un livre à part entière» nous semble exact, cela demeure un peu court étant donné le contexte et en dépit de la citation intéressante d’une lettre du cinéaste Arnaud Desplechin de 2001 qui assure – d’une manière d’ailleurs tout aussi réductrice et fausse – que l’histoire de la Nouvelle-vague s’ouvre par Nuit et brouillard et se clôt trente ans plus tard par Shoah. Aucun mouvement esthétique ne meurt jamais vraiment une fois qu’il est né : il y a de la Nouvelle vague mais il y a encore aussi de l’expressionnisme ou du baroque dans le cinéma moderne et contemporain. C’est une loi connue de la temporalité esthétique, de l’évolution de la vie des beaux-arts. Relire Alain, et bien d’autres grands philosophes classiques à ce sujet.
Autre point gênant, relatif au chapitre sur les films «démodernes» du cinéma russe post-soviétique. L’analyse du Stalker (1979) de Tarkovski qu’on y lit est fine, détaillée mais range le film au milieu d’œuvres médiocres et sans intérêt autre, pour le coup, que purement historique. Similitude chronologique étalée sur une dizaine d’années, et Stalker en précurseur puisque filmé avant la chute de l’U.R.S.S. On lit la dizaine de pages qui lui sont consacrées en cherchant, en vain, le terme «christianisme», sans trouver davantage mention du fait que Tarkovski soit croyant comme fait génétique de son cinéma tout entier. Tarkovski l’a pourtant écrit. Antoine de Baecque ne nous parle que de ce processus esthétique de la démodernisation à l’œuvre dans Stalker. Dont acte, on peut le nommer ainsi : pourquoi pas ? Mais on rate la substance élémentaire du Stalker en ne l’abordant que par cet aspect, en négligeant qu’il est un acte explicite de foi militant. Le contexte où Baecque emploie le terme de «démoderne» permet certes de l’employer : ce terme n’est donc pas en cause. Mais c’est ici qu’une interprétation purement historicisante d’un cinéaste manque bel et bien le sens profond de son œuvre. Ce n’est pas, au demeurant, qu’on soit gêné d’être nous même, quelque part et par contrecoup, ignoré : on l’attendait de la part de quelqu’un qui semble admirer Lacan et Walter Benjamin comme de grands philosophes – alors que ce n’est pas le cas : le premier fut simplement un sophiste très cultivé qui avait débuté par un intéressant essai sur la psychose paranoïaque, l’autre fut un philosophe plus authentique mais demeure néanmoins mineur – et on n’est guère surpris qu’il n’ait pas daigné lire les analyses respectives du Stalker parues sur ce même blog, rédigées d’abord par Juan Asensio ici puis par moi-même là.
Par ailleurs, lorsqu’on lit, à la page 96, que «Maurice Blanchot pourrait apporter une autre clé d’interprétation [...] «La mort, écrit-il dans L’Espace littéraire, est le travail de la vérité dans le monde», on se dit que la culture est
10/01/2009 | Lien permanent
























































